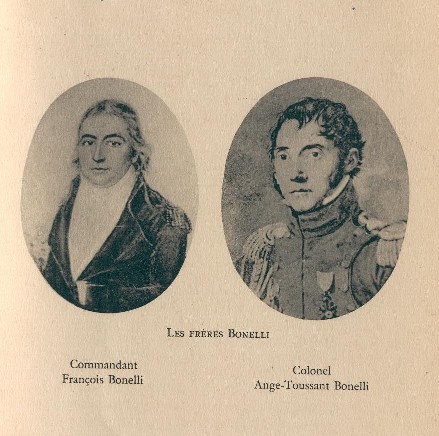août 31, 2007
NAPOLEON, LES LIEUX DU POUVOIR
Ce n’est pas tout d’être aux Tuileries. Il faut y rester.
Ces lieux du pouvoir ne sont pas nés en un jour par la seule volonté de Napoléon. Devenu chef de l’Etat avec le titre de Premier Consul en novembre 1799, Bonaparte fait immédiatement promulguer la constitution de l’an VIII (13 décembre 1799) qui lui affecte comme unique résidence le palais des Tuileries, baptisé pour la circonstance Palais du Gouvernement. Il n’en aura pas d’autre jusqu’à l’automne 1802. Souhaitant s’y installer le plus tôt possible, il ordonne de faire disparaître piques, faisceaux, cocardes tricolores ou bonnets phrygiens ornant les murs, disant à l’architecte qu’il ne voulait pas de « pareilles saloperies ». A ses yeux, la résidence du premier magistrat se doit de refléter la puissance de la France. Peu à peu, surtout après l’Empire, il considérera les Tuileries comme le sanctuaire de la monarchie, faisant plus pour les appartements de réception que pour sa propre habitation. Ce sera sa résidence officielle pendant les quinze années où il fut au pouvoir.
Longtemps hésitant, Bonaparte décide finalement en septembre 1801 de faire du château de Saint-Cloud sa résidence d’été, sa petite demeure personnelle de Malmaison ne suffisant plus pour l’embryon de cour consulaire qui s’installe autour de lui. Il lui faut désormais un vrai palais, car peu à peu on se donne autour de lui des allures de Versailles, surtout après l’adoption de la constitution de l’an X qui le nomme consul à vie.
Mais c’est la constitution de l’an XII (18 mai 1804) qui fixe le statut des résidences de la couronne ; l’article 14 précise dans son second alinéa que l’empereur établit « une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation », et dans l’article 16 que « l’Empereur visite les départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points de l’empire ». Outre les Tuileries et Saint-Cloud déjà affectés à son service, le nouvel empereur dispose désormais d’une liste civile comprenant les châteaux royaux de l’Ancien Régime comme Fontainebleau, Versailles et les deux Trianon, Rambouillet et Meudon. Napoléon les fera aménager au fur et à mesure de ses besoins, repoussant d’année en année le projet de s’installer à Versailles, comme si l’ombre du grand roi l’en empêchait. En fonction des circonstances politiques, Napoléon créée donc de nouveaux palais impériaux aux quatre coins de l’Empire comme à Strasbourg (1806), Bordeaux (1808), Marrac près de Bayonne (1808) ou dans les nouveaux départements français du Mont-Tonnerre à Mayence (1804) ou de la Dyle à Laeken aux portes de Bruxelles (1804). Après avoir eu le titre de Président de la République italienne, Napoléon est couronné roi d’Italie en 1805 ; la encore, il faut donc prévoir des palais dignes de le recevoir ; c’est d’abord dans la capitale, à Milan, qu’il fait embellir le Palais Royal situé aux pieds de la cathédrale ; puis la seconde ville du royaume, Venise, se voit dotée d’une résidence officielle pour laquelle on démolit une vieille église du XVIè siècle, ce que les Vénitiens ne lui pardonneront jamais. Encore de nos jours, récemment retrouvée en Amérique, la statue de l’Empereur qui se dressait place Saint-Marc a dû, après avoir été rachetée, prendre place à l’intérieur de l’ancien palais, devenu le musée Correr, afin d’échapper à la rancoeur des Vénitiens. Après la réunion des états du pape à la France en 1809, Rome devient la seconde capitale du grand empire ; il faut donc là encore un palais pour l’empereur. Ce sera le Quirinal rebaptisé pour la circonstance palais de Monte-Cavallo. Napoléon ne le verra jamais, mais il se fait aménager une somptueuse résidence meublée par de nombreux envois faits depuis Paris. On expédie même une batterie de cuisine complète qui sert aujourd’hui de décoration au restaurant des musées du Vatican… Il fait de même pour les départements italiens nouvellement intégrés, que ce soit en Toscane où, à Florence un appartement lui est réservé au palais Pitti, ou bien dans l’ancienne république de Gênes où il fait acheter le palais Durazzo, ou bien encore en Piémont où il décide de transformer le château de Stupinigi, aux portes de Turin, en un palais impérial.
Toutes ces décisions découlent d’une même volonté politique : montrer la puissance de l’Empire tant à l’intérieur de ses anciennes frontières que dans les pays nouvellement conquis, et faire de ces palais la vitrine des industries du luxe français. Toutes les résidences françaises avaient été vidées de leur contenu au moment des ventes révolutionnaires ; en à peine quatorze ans, l’empereur les fait entièrement remeubler, fort de la supériorité des productions françaises. Il fait imposer un nouveau style que mettent au point les architectes Percier et Fontaine ; on leur doit la profusion de palmettes, de foudres, de sphinx ailés, de pieds en forme de gaine ou de Victoires qu’ils empruntent au répertoire de la Rome antique. Ils suivent en cela la volonté de Napoléon qui déclarait en 1808 : « J’ai à cœur de voir les artistes français effacer la gloire d’Athènes et de l’Italie » ; pour l’empereur, ce qui est grand est beau. La cour doit être fastueuse et son train de vie doit entraîner des dépenses somptuaires qui soutiennent les industries de luxe et encouragent les arts. C’est dire combien les ébénistes, les bronziers, les soyeux, les tapissiers ou les porcelainiers sont mis à contribution pour accomplir cet extraordinaire programme.
Il s’agit bien là d’un programme politique, car pour lui-même, l’empereur conserve des goûts simples. C’est un homme d’habitudes qui exige que les appartements de toutes ses résidences soient aménagés selon la même disposition, souhaitant par exemple que sa bibliothèque soit toujours située à proximité de sa chambre à coucher. Il aime retrouver partout les mêmes meubles, placés aux mêmes endroits dans les mêmes pièces. Ses goûts simples sont connus de l’Administrateur du Garde Meuble de la Couronne qui écrit invariablement aux fournisseurs : « Simplifier les ornements : c’est pour l’Empereur ».
Plus que pour construire sa propre gloire, ces lieux du pouvoir ont été considérés par Napoléon comme une priorité politique ; il convenait d’éblouir une Europe momentanément asservie, et ce fut la une des vraies victoires de l’empereur, car pendant encore vingt ou trente après Waterloo, le style Empire restera la référence absolue en matière d’arts décoratifs des Etats-Unis à la Russie du Portugal à la Suède.¨
Pour en savoir plus : Napoléon, les lieux du pouvoir (Bernard Chevallier – Editions Artlys 2004).
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
NAPOLEON BONAPARTE PAR SES APHORISMES
1786
Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie.
1791
Je crois l’amour nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes. Enfin, je crois que l’amour fait plus de mal que de bien.
1795
L’homme esclave est à peine l’ombre de l’homme libre.
La vie est un songe léger qui se dissipe.
1796
Malheur au général qui vient sur le champ de bataille avec un système.
De nos jours personne n’a rien conclu de grand ; c’est à moi de donner l’exemple.
1797
On ne conduit un peuple qu’en lui montrant un avenir ; un chef est un marchand d’espérance.
Les vraies conquêtes sont celles que l’on fait sur l’ignorance.
1798
Je mesurais mes rêveries au compas de mon raisonnement.
Quand j’avais l’honneur d’être lieutenant en second, je déjeunais avec du pain sec, mais je vérouillais ma porte sur ma pauvreté.
1799
De Clovis au comité de salut public, je me sens solidaire de tout.
On ne fait de grandes choses en France qu’en s’appuyant sur les masses ; d’ailleurs, un gouvernement doit aller chercher son point d’appui là où il est.
Les grands noms ne se font qu’en Orient.
1800
Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut être gouverné. C’est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple.
Les guerres inévitables sont toujours justes.
La première des vertus est le dévouement à la patrie.
L’amour est une sottise faite à deux !
Mon héritier naturel, c’est le peuple français. C’est là mon enfant ! Je n’ai travaillé que pour lui.
Je suis bien vieux en coeur humain.
Je n’ai qu’un besoin, c’est celui de réussir.
Un talent dans quelque genre qu’il soit, est une vraie puissance.
L’homme supérieur n’est sur le chemin de personne.
Il n’y a que la religion qui puisse faire supporter aux hommes des inégalités de rang parce qu’elle console de tout.
Les conquérants habiles ne sont jamais brouillés avec les prêtres.
Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole.
1801
Il ne faut pas croire que je me laisserai faire comme Louis XVI ! Je suis soldat, fils de la Révolution et je ne souffrirai pas qu’on m’insulte comme un roi.
1802
Celui qui gouverne doit avoir de l’énergie sans fanatisme, des principes sans démagogie et de la sévérité sans cruauté.
Les soldats n’ont qu’un sentiment : l’honneur ! Il faut donc donner de l’aliment à ce sentiment-là, il leur faut des distinctions.
La religion ce n’est pas pour moi le mystère de l’incarnation ; c’est le mystère de l’ordre social.
Je suis loin d’être athée, mais je ne puis croire tout ce que l’on m’enseigne en dépit de ma raison, sous peine d’être faux et hypocrite.
On croit en Dieu parce que tout le proclame autour de nous et que les plus grands esprits y ont cru.
1804
La faiblesse du pouvoir suprême est la plus affreuse calamité des peuples.
Il y a deux leviers pour remuer les hommes : la crainte et les intérêts.
Je n’ai qu’une passion, qu’une maîtresse : c’est la France ! Je couche avec elle… je jure que je ne fais rien que pour la France.
Je n’ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne.
Le grand art d’écrire, c’est de supprimer ce qui est inutile.
1805
Une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au coeur : l’une est un bijou, l’autre est un trésor.
La chasteté est pour les femmes ce que la bravoure est pour les hommes : je méprise un lâche et une femme sans pudeur.
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir.
1806
La haute politique n’est que le bon sens appliqué aux grandes choses.
Il n’y a plus d’ennemis après la victoire, mais seulement des hommes.
L’art de la guerre est un art simple et tout d’exécution. La part des principes est minimes : rien n’y est idéologie.
Il n’y pas deux puissances au monde : le sabre et l’esprit. A la longue le sabre est toujours vaincu par l’esprit.
De toutes les institutions, la plus importante est l’institution publique. Tout en dépend, le présent et l’avenir.
Il faut être lent dans la délibération, et vif dans l’exécution.
1807
La royauté est un rôle : les souverains doivent toujours être en scène.
A la guerre l’audace est le plus beau calcul du génie.
Je gagne mes batailles avec les rêves de mes soldats endormis.
Les Romains donnaient leurs lois à leurs alliés ; pourquoi la France ne ferait-elle pas adopter les siennes ?
1808
C’est la volonté, le caractère, l’application et l’audace qui m’ont fait ce que je suis.
1809
La force morale plus que le nombre décide de la victoire.
Je suis le plus esclave des hommes, obligé d’obéir à un maître qui n’a point de coeur : le calcul des évènements et la nature des choses.
1810
On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
L’ambition est le principal mobile des hommes ; on dépense son mérite tant qu’on espère s’élever.
L’amour devrait être un plaisir et non pas un tourment.
Ne croyez pas que je n’ai pas le coeur sensible comme les autres hommes, mais dès la première jeunesse je me suis habitué à rendre muette cette corde qui, chez moi, ne rend plus aucun son.
Je suis l’instrument de la providence ; elle me soutiendra tant que j’accomplirai ses desseins, puis elle me cassera comme un verre.
Je ne puis pas bien écrire parce que je suis dans deux courants : l’un des idées, l’autre de la main. Les idées vont plus vite, alors adieu les caractères.
Le courage est une vertu qui échappe à l’hypocrisie.
1812
Le génie n’est pas héréditaire.
On me croit sévère et dur. Tant mieux, cela me dispense de l’être.
Du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas.
1813
L’athéisme est un principe destructeur de toute organisation sociale qui ôte à l’homme toutes ses consolations et toutes ses espérances.
1815
Les hommes qui ont changé l’univers n’y sont jamais parvenus en changeant les chefs, mais toujours en remuant les masses.
L’anarchie ramène toujours le gouvernement absolu.
L’amour devrait être l’occupation de l’homme oisif, la distraction du guerrier, l’écueil du souverain.
La fibre populaire répond à la mienne ; je suis sorti des rangs du peuple, ma voix agit sur lui.
1816
L’autorité ne doit voir point les personnes ; elle ne doit voir que les choses, leurs poids et leurs conséquences.
Si j’avais pu gouverner la France pendant quarante ans, j’en aurais fait le plus bel empire qu’il eût jamais existé !
Une femme qui couche avec son mari exerce toujours une influence sur lui.
Le manque de jugement et les défauts d’éducation peuvent porter une femme à se croire en tout l’égale de son mari.
J’avais le goût de la fondation, mais je n’ai jamais eu celui de la propriété.
Quel roman pourtant que ma vie !
La vraie sagesse des nations, c’est l’expérience.
Il est noble et courageux de surmonter l’infortune.
Le sentiment religieux est si consolant que c’est un bienfait du ciel que de le posséder.
L’honnête homme ne doute jamais de l’existence de Dieu ; car, si la raison ne suffit pas pour le comprendre, l’existence de l’âme l’adopte.
Les plus petites circonstances conduisent les plus grands évènements.
L’homme n’a pas d’amis ; c’est son bonheur qui en a.
1817
Un homme n’est qu’un homme. Ses moyens ne sont rien si les circonstances et l’opinion ne le favorisent pas.
Les hommes ne sont vraiment grands que par ce qu’ils laissent d’institutions après eux.
Le génie agit par inspiration.
Les conquérants doivent être tolérants et protéger toutes les religions.
Ce qui est supérieur en Mahomet, c’est qu’en dix ans il a conquis la moitié du globe, tandis qu’il a fallu trois cents ans au christianisme pour s’établir.
Dans les révolutions, il ya deux sortes de gens : ceux qui les font et ceux qui en profitent.
1818
Ma gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil et les procès verbaux au Conseil d’Etat.
1820
Ce n’est point à un incident de gouverner la politique, mais bien à la politique de gouverner les incidents.
Je n’ai point usurpé la couronne ; je l’ai relevée dans le ruisseau. Le peuple me l’a mise sur la tête. Je voulais que le titre de Français fût le plus beau, le plus désirable de la terre.
C’est une de mes fautes que d’avoir cru mes frères nécessaires pour assurer ma dynastie.
Mes frères ont été beaucoup plus rois que moi ! Ils ont eu les jouissances de la royauté, je n’en ai eu que les fatigues.
J’ai toujours été heureux, jamais mon sort n’a resisté à ma volonté.
Je suis construit pour le travail. J’ai connu les limites de mes jambes, j’ai connu les limites de mes yeux, je n’ai pu connaître les limites de mon travail.
En mourant, je laisse deux vainqueurs, deux hercules au berceau : la Russie et les Etats-Unis d’Amérique.
Une de mes grandes pensées avait été l’agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques qu’on dissout et morcelle. J’eusse voulu faire de chacun de ces peuples un seul et même corps de nation ; c’est avec un tel cortège qu’il eût été beau de s’avancer dans la bénédiction des siècles. Je me sentais digne de cette gloire.
Le sot a un grand avantage sur l’homme d’esprit : il est toujours content de lui-même.
C’est dans la morale que se trouve la vraie noblesse ; hors d’elle, elle n’est nulle part.
Les peuples passent, les trônes s’écroulent, l’Eglise demeure.
Une tête sans mémoire est une place sans ganison.
ACTEURS DE LA REVOLUTION ET DU CONSULAT PAR NAPOLEON 1er
Ni Robespierre, ni Danton, ni Marat n’avaient d’égaux quand « liberté, égalité ou la mort » se lisaient en lettres de sang sur toutes les bannières françaises ; ils étaient les premiers d’une aristocratie terrible, dont la livrée était teinte journellement par la hache du bourreau.
- Louis Marie Joseph Maximilien Caffarelli, général (1756-1799)
Le général Caffarelli était d’une activité qui ne permettait pas de s’apercevoir qu’il avait une jambe de moins. Il entendait parfaitement les détails de son arme, mais il excellait par les qualités morales et par l’étendue de ses connaissances dans toutes les parties de l’administration publique. C’était un homme de bien, brave soldat, fidèle ami, bon citoyen. Il périt glorieusement au siège de Saint-Jean-d’Acre en prononçant sur son lit de mort un très éloquent discours sur l’instruction publique.
- François Athanase de Charette de la Contrie, chef vendéen (1763-1796)
Le vrai caractère perce toujours dans les grandes circonstances ; voilà l’étincelle qui signale le héros de la Vendée.
- Georges Jacques Danton (1759-1794)
C’était un homme bien extraordinaire, fait pour tout ; on ne conçoit pas pourquoi il s’est séparé de Robespierre et s’est laissé guillotiner. Il paraît que les deux millions qu’il avait pris en Belgique avait altéré son caractère. C’est lui qui disait : « de l’audace, puis de l’audace et encore de l’audace ».
- Louis Charles Antoine Desaix, général (1768-1800)
Desaix était dévoué, généreux, tourmenté par la passion de la gloire. Sa mort fut une de mes calamités ! Il était habile, vigilant, plein d’audace ; il comptait la fatigue pour rien, la mort pour moins encore.
- Pierre Roger Ducos, directeur, consul provisoire (1747-1816)
Ce nain de Ducos, ce cul-de-jatte de Ducos, un homme borné et facile.
- Jacques François Coquille Dugommier, général (1738-1794)
Dugommier avait toutes les qualités d’un vieux militaire ; extrêmement brave de sa personne, il aimait les braves et en était aimé ; il était bon, quoique vif, très actif, juste, avait le coup d’oeil militaire, le sang-froid et de l’opiniâtreté dans le combat.
- Louis Lazare Hoche, général (1768-1797)
Hoche fut un des premiers généraux que la France ait produits. Il était brave, intelligent, plein de talent, de résolution et de pénétration. Il était aussi intrigant. Si Hoche avait débarqué en Irlande, il aurait réussi. Il possédait toutes les qualités nécessaires pour assurer le succès de son expédition. Il était accoutumé à la guerre civile et savait comment s’y prendre en pareil cas. Il avait pacifié la Vendée et était ce qu’il fallait pour l’Irlande : c’était un homme superbe, très adroit et d’un extérieur prévenant.
Ce fut une des plus belles réputations militaires de la Révolution… Hoche était un véritable homme de guerre.
- Barthélemy Joubert, général (1769-1799)
Le général Joubert qui a commandé à la bataille de Rivoli, a reçu de la nature les qualités qui distinguent les guerriers : grenadier par le courage, il était général par le sang-froid et les talents militaires.
Il était grand, maigre, semblait naturellement d’une faible complexion : mais avait trempé sa constitution au milieu des fatigues, des champs et de la guerre et des montagnes. Il était intrépide, vigilant, actif… Il était fait pour arriver à une grande renommée militaire.
Joubert avait une haute vénération pour moi ; à chaque revers éprouvé par la République, durant l’expédition d’Egypte, il déplorait mon absence. Se trouvant en cet instant chef de l’armée d’Italie, il m’avait pris pour modèle, aspirait à me recommencer, et ne prétendait à rien de moins qu’à tenter ce que j’ai exécuté depuis en Brumaire, seulement, il eût agi avec les Jacobins.
- Jean-Baptiste Kléber, général (1753-1800)
Kléber était doué d’un grand talent, mais il n’était que l’homme du moment ; il cherchait la gloire comme la seule route aux jouissances ; d’ailleurs, nullement national, il eût pu, sans effort, servir l’étranger ; il avait commencé dans sa jeunesse sous les Prussiens, dont il demeurait fort engoué.
Il y a des dormeurs dont le réveil est terrible : Kléber était d’habitude endormi, mais dans l’occasion -et toujours au besoin- il avait le réveil du lion.
Si Kléber avait vécu, la France aurait conservé l’Egypte.
La mort de Kléber fut une perte irréparable pour la France et pour moi. C’était un homme doué des talents les plus brillants et de la plus grande bravoure.
Kléber, c’était l’image du dieu Mars en uniforme.
- Louis Marie de la Révellière-Lépeaux, directeur (1753-1824)
Il était de la très petite bourgeoisie ; petit, bossu, de l’extérieur le plus désagréable qu’on puisse imaginer, c’était un véritable Esope. Il n’avait ni l’habitude des affaires ni la connaissance des hommes. Du reste il était patriote, chaud et sincère, honnête homme, citoyen probe et instruit ; il entra au Directoire et sortit pauvre. La nature ne lui avait accordé que les qualités d’un magistrat subalterne.
- Charles François Lebrun, consul, duc de Plaisance (1739-1824)
Naturellement dissimulé, inobligeant, dur et sans affection, dévoré d’ambition.
- Jean-Paul Marat (1743-1793)
Marat avait de l’esprit mais était un peu fou. Ce qui lui a donné une grande popularité, c’est qu’en 1790 il annonçait ce qui arriverait en 1792 ; il luttait seul contre tous. C’était un homme bien singulier.
- Jean-François Rewbell, directeur (1747-1807)
Il était l’un des meilleurs avocats de Colmar. Il avait l’esprit qui caractérise un bon praticien ; il influença presque toujours les délibérations, prenait facilement des préjugés, croyait peu à la vertu et était d’un patriotisme assez exalté. Il avait, comme les patriciens, un préjugé d’Etat contre les militaires.
- Maximilien de Robespierre (1758-1794)
C’était un fanatique, un monstre ; mais il était incorruptible et incapable de voter ou causer la mort de qui que ce fût par inimitié personnelle ou par désir de s’enrichir. C’était un enthousiaste, il croyait agir selon la justice, et il ne laissa pas un sou après sa mort.
- Emmanuel Joseph Sieyès, consul provisoire (1748-1736)
Sieyès était l’homme du monde le moins propre au gouvernement mais essentiel à consulter, car quelquefois il avait des aperçus lumineux et d’une grande importance.
août 30, 2007
NAPOLEON ET LES ADIEUX DE MALMAISON
Je crois que la nature m’avait calculé pour les grands revers ; ils m’ont trouvé une âme de marbre, la foudre n’a pas mordu dessus, elle a dû glisser.
- Vaincu à Waterloo, Napoléon arrive directement à l’Elysée au matin du mercredi 21 juin 1815 et se résout à abdiquer pour la seconde fois en faveur de son fils Napoléon II, le lendemain 22 au début de l’après-midi. Mais il ne peut rester ainsi indéfiniment à Paris ; les ministres souhaitent le voir s’éloigner de la capitale, sa présence déclenchant l’enthousiasme et des acclamations continuelles de la part de la population parisienne. Après avoir longuement hésité, l’Empereur prend le parti de se rendre à Malmaison afin d’y attendre la réponse à la demande des passeports faite pour aller aux Etats-Unis d’Amérique où il avait décidé de se retirer définitivement.
- Pensant que Malmaison appartenait à Hortense, alors que dans le partage des biens de l’impératrice Joséphine, le domaine était tombé dans le lot de son frère, le prince Eugène, Napoléon lui demande une hospitalité que l’ancienne reine de Hollande s’empresse de lui accorder, en dépit des risques qu’il y avait pour elle à s’identifier au sort de l’empereur déchu. Courageusement, elle fait cacher ses deux fils chez sa marchande de bas, pensant qu’ils seraient plus à l’abri chez une personne de condition modeste, et accourt à Malmaison afin d’y recevoir celui qu’elle avait toujours considéré comme son père. Elle lui affecte toute l’aile sud du château comprenant au rez-de-chaussée la salle à manger, la salle du conseil et la bibliothèque et à l’étage, l’appartement qu’il occupait avant le divorce, tandis qu’elle se réserve l’aile nord, habitant son propre appartement au premier et faisant du salon de musique sa salle à manger.
- Tout est prêt lorsque l’Empereur arrive le dimanche 25 vers une heure et demi de l’après-midi dans la cour du château, une heure après avoir quitté l’Elysée. Trois cents grenadiers et chasseurs, renforcés par quarante dragons de la garde assurent sa sécurité et son service d’honneur ; ils sont commandés par le général Beker qui avait été affecté à cette mission par le Gouvernement provisoire, plus pour surveiller sa personne que pour veiller au respect qui lui est dû ; les consignes venaient de Fouché qui avait signifié à Davout, alors ministre de la Guerre, qu’au cas où Napoléon ne se décide pas à partir pour se rendre à l’île d’Aix, « vous devez le faire surveiller à Malmaison, de manière à ce qu’il ne puisse s’en évader. En conséquence, vous mettrez à la disposition du général Beker la gendarmerie et les troupes nécessaires pour garder les avenues qui aboutissent de toutes parts à Malmaison ». Quand Beker se trouva en face de l’Empereur, il ne put s’empêcher de pleurer et Napoléon lui dit : « Rassurez-vous, général, je suis bien aise de vous voir près de moi ; si l’on m’avait laissé le choix d’un officier, je vous aurais désigné de préférence, puisque je connais depuis longtemps votre loyauté ». Beker fit en effet tout son possible pour remplir sa mission de la manière qui fut la moins désagréable pour l’Empereur.
- A peine arrivé à Malmaison, Napoléon s’étonne d’y rencontrer si peu de monde, confiant à Gourgaud : « Eh bien, je ne vois pas un de mes aides de camp ! » ; c’est que bien des gens que l’on voit dans la prospérité vous abandonnent dans l’adversité, lui répond celui-ci. Il faut attendre le soir pour que le service s’organise un tant soit peu, Bertrand, Savary, Montholon, Gourgaud et Lallemand faisant office d’aides de camp, tandis que Résigny et Planat tiennent le rôle des officiers d’ordonnance, Montaran celui de l’écuyer, Las Cases celui de chambellan et Sainte-Catherine d’Audiffredi, jeune parent martiniquais de Joséphine, celui de page. Seuls les services de la bouche et de la chambre ont suivi l’Empereur déchu et sont les mêmes qu’à Paris. Deux autres généraux, Piré et Chartrand, étaient bien venus aussi à Malmaison, mais c’était uniquement pour demander de l’argent à l’Empereur, arguant qu’il leur fallait des moyens pour fuir, que l’échafaud attendait ceux qui, les premiers, s’étaient dévoués à sa cause et ils menaçaient de se brûler la cervelle s’il refusait ! Au regard de leur fidélité et devant leur obstination, il finit par accéder à leur demande, mais ceux-ci revinrent mécontents de Paris, ayant trouvant insuffisante la somme de 10 000 francs qui leur avaient été allouée! Ce même soir, l’Empereur reçoit trois de ses frères, les princes Joseph, Lucien et Jérôme, le quatrième, Louis, s’étant retiré en Italie ; ils sont rejoints par Maret duc de Bassano et par le comte de Lavalette. Enfin à onze heures du soir, l’Empereur regagne son appartement du premier étage où il se couche, tous les hommes présents ayant décidé de veiller en cas de tentative d’enlèvement de Napoléon par les royalistes.
- Les trois jours qui suivirent furent des journées très actives et bien remplies, tant on craignait que l’on attentât à la vie de l’Empereur. Le lundi 26, à onze heures du matin, se promenant seul dans les jardins, il fait chercher Hortense avant de recevoir les fidèles venus de Paris. C’est l’instant de la rêverie et du souvenir ; ces lieux lui rappellent tant de jours heureux qu’il ne peut s’empêcher de se confier à sa fille adoptive : « Cette pauvre Joséphine ! Je ne puis m’accoutumer à habiter ce lieu sans elle ! Il me semble toujours la voir sortir d’une allée et cueillir ces plantes qu’elle aimait tant ! Pauvre Joséphine ! ». Arrivent alors ses frères qu’accompagne leur mère, Letizia, qui semble fort abattue. Tout le monde se retrouve au salon où les attendent les fidèles qui l’accompagneront jusqu’à la fin, La Bédoyère, Flahaut, Savary accompagné de sa femme qui évoque l’éventualité d’un complot royaliste dont le but est d’assassiner l’Empereur. Le soir, on retrouve au salon Maret accompagné de plusieurs dames dont la belle comtesse Duchâtel qui retint, dit-on, un instant l’attention du maître, la charmante Mme Regnault de Saint-Jean d’Angély venue dire que l’on conspirait contre l’Empereur et que Fouché était à la tête du complot, la comtesse Walewska accourue à l’appel du malheur comme elle l’avait déjà fait l’année précédente à l’île d’Elbe et l’épouse de Caulaincourt, devenue enfin duchesse de Vicence au moment de la première Restauration, Napoléon n’ayant jamais autorisé le mariage de son ministre des relations extérieures avec une femme divorcée. Est-ce ce jour-là ou un autre qu’il voit pour la première fois le jeune Léon, cet enfant d’ Eléonore Denuelle de la Plaigne, dont il avait longtemps douté être le père ; sa ressemblance avec le roi de Rome, que confirme Hortense, le convainc de sa paternité et le décide à assurer son avenir. Désirant mettre également de l’ordre dans ses affaires, et avant de quitter la France, il fait venir son notaire Me Noël accompagné du baron Peyrusse, Trésorier général de la Couronne pendant les Cent-Jours, qu’il fait son « mandataire général et spécial » afin de vendre une inscription au Grand Livre lui appartenant. Il semble que ce soit ce même soir qu’il convoque dans sa bibliothèque, pour huit heures et demi, le banquier Jacques Laffitte ; il s’agit de lui confier les débris de sa fortune. Napoléon s’approche de son secrétaire, en retire un gros paquet de billets de banque et lui dit : « Tenez, voici huit cent mille francs, je vous enverrai cette nuit dans un fourgon trois millions en or. M. de Lavalette et le prince Eugène vous remettront douze cents mille francs ; je fais remettre de plus dans votre calèche mon médailler, c’est tout ce qui me reste. Vous me garderez ça ». Puis, pendant les deux heures que dure l’entretien, la conversation roule sur son éventuel départ pour les Etats-Unis, sur le commerce de ce pays, sur les moeurs de ses habitants et leur manière de vivre, concluant : « Au total, c’est un pays assez ennuyeux à habiter ». A onze heures, Laffitte, craignant d’abuser des moments de l’Empereur, met fin à la conversation et sort de cet entretien les yeux mouillés de larmes. Comme pour la nuit précédente, les hommes décident de veiller, inquiets d’une éventuelle attaque.
- Le lendemain matin mardi 27, à l’aube, Las Cases arrive accompagné de Decrès, le ministre de la Marine, auquel il était très lié ; les deux hommes se tutoyaient, tous deux ayant été officiers de marine avant la Révolution. Decrès vient apporter le texte d’un arrêté daté de la veille et signé par Fouché par lequel le gouvernement provisoire donne bien l’ordre pour que deux frégates du port de Rochefort soient armées afin transporter Napoléon aux Etats-Unis, mais il est stipulé qu’elles ne pourront quitter la rade avant l’arrivée des sauf-conduits demandés à l’Angleterre. Prenant à juste titre cette restriction pour un piège et se méfiant d’une probable duplicité de Fouché, Napoléon décide de renoncer à son voyage par crainte que les passeports annoncés ne parviennent à Rochefort ; il est fermement déterminé à les attendre à Malmaison.
- C’est le lendemain, mercredi 28, que Flahaut va signifier à la commission du Gouvernement cette décision de l’Empereur, ce qui ne laisse pas d’effrayer Fouché dont le but est un départ immédiat de Malmaison. La fermeture des barrières de Paris et la barricade élevée au pont de Neuilly rendent d’ailleurs les communications beaucoup plus incertaines avec Malmaison ; malgré ces difficultés d’accès, les fidèles se pressent encore aux portes du petit château. En plus de ceux que leur service appelle auprès de l’Empereur, on voit arriver Méneval, Talma, puis Corvisart qui remet à Napoléon un petit flacon renfermant un poison violent que Marchand a pour mission d’attacher aux vêtements de son maître. Devant l’avance des Prussiens qui approchent de Gonesse, le ministre de la Guerre, Davout, donne l’ordre de faire sauter les ponts de Chatou et de Bezons afin de garantir Malmaison d’un coup de main. Le soir, avant de se coucher, l’Empereur fait venir l’ancien valet de chambre de Joséphine, Pierre-Joseph Frère, et il se remémore les jours heureux de Malmaison : « C’est très beau Malmaison, c’est un beau lieu ; Joséphine a bien dépensé de l’argent et il n’y a pas de maison ; j’ai bien crié contre elle dans le temps…. tout lui plaisait ; j’ai rencontré en Italie des caisses encore pour elle, des bêtises, des pierres, des drogues, il y en avait pour trois cents mille francs. Malmaison coûte fort cher d’entretien. Je parie que cela va à cinquante mille francs ». A Paris pendant ce temps, et face à l’urgence, à neuf heures du soir, Fouché amène la commission du Gouvernement à abandonner la clause restrictive de l’arrivée des sauf-conduits ; les frégates sont donc mises à la disposition de l’Empereur et plus rien ne fait désormais obstacle à son départ.
- C’est le jeudi 29, entre trois et quatre heures du matin, que Decrès, accompagné de Boulay de la Meurthe qui avait été appelé à la Justice par la Commission, arrivent à Malmaison pour signifier cette décision à Napoléon. Sans faire aucune objection, il leur promet de se mettre en route le jour même. En effet, dès neuf heures du matin, il fait venir son frère Joseph, Flahaut, Lavalette et Maret pour leur annoncer son départ imminent. Mais devant les cris répétés de « Vive l’Empereur » scandé par les troupes passant à proximité, Napoléon fait appeler le général Beker et lui demande de se rendre immédiatement à Paris auprès de la Commission afin de prendre le commandement de l’armée, non plus comme empereur, mais comme simple général, afin de battre les Prussiens, puis de se retirer définitivement de la scène politique. Subjugué par les paroles de l’Empereur, Beker arrive aux Tuileries à midi, mais Fouché, irrité et prenant la décision seul, sans un geste de ses collègues restés sombres et taciturnes, exige un départ immédiat pour Rochefort en prétextant que les Prussiens marchent sur Versailles. Le retour de Beker à Malmaison vers deux heures de l’après-midi annonce la fin. Napoléon s’achemine alors vers la chambre de l’Impératrice, seul afin de s’y recueillir et en sort les yeux gonflés de larmes avant de faire ses adieux à ses proches dans la bibliothèque ; c’est d’abord Hortense qui lui remet son beau collier de diamants d’une valeur de 200 000 francs, pensant qu’il lui serait utile dans l’adversité, puis Mmes de Vicence, Caffarelli et Walewska ; il reçoit ensuite ses proches, le roi Joseph et sa mère, ignorant qu’ils se voient pour la dernière fois. A 17 h 30, en habits bourgeois, Napoléon monte dans une calèche jaune attelée de quatre chevaux, accompagné du général Beker, de Bertrand et de Savary, puis par une porte située au fond du parc, il rejoint la grande route de Paris à Rochefort. Malmaison avait vu, ce jour-là, se dérouler sa dernière grande page d’histoire.
- © Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
ENNEMIS, ADVERSAIRES ET OPPOSANTS PAR NAPOLEON 1er
Bien qu’on m’ait salué, en leur nom, de moderne Attila, de Robespierre à cheval, tous [les rois d’Europe] savent mieux dans le fond de leur coeur que, si je l’avais été, je règnerais encore peut-être ; mais eux, bien sûrement et depuis longtemps, il ne règneraient plus.
- Alexandre 1er, empereur de Russie (1777-1825)
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est qu’on ne peut prévoir ce qui lui manquera dans un cas donné ou dans une circonstance particulière, car ce qui lui manque varie à l’infini.
C’est un grec du Bas-Empire, fin, faux et adroit.
- Paul François Jean Nicolas, vicomte de Barras (1755-1829)
N’ayant aucun talent pour la tribune, et nulle habitude au travail, il se jeta dans le parti thermidorien menacé par Robespierre ainsi que Tallien et tout le reste du parti de Danton. Ils se réunirent et firent la journée du 9 Thermidor. Cette réussite lui donna une grande célébrité. Les évènements le portèrent au Directoire : il n’avait point les qualités nécessaires pour cette place.
Barras était d’une haute stature, il parla quelquefois dans les moments d’orage et sa voix couvrait alors la salle. Ses facultés morales ne lui permettaient pas d’aller au-delà de quelques phrases. La passion avec laquelle il parlait l’aurait fait prendre pour un homme de résolution, mais il ne l’était point : il n’avait aucune opinion faite sur aucune partie de l’administration publique.
- Gebhard Leberecht Blücher, prince, maréchal prussien (1742-1819)
Blücher est un très brave soldat, un bon sabreur. C’est comme un taureau qui ferme les yeux et se précipite en avant sans voir aucun danger. Il a commis des millions de fautes et, s’il n’eût été servi par les circonstances, j’aurais pu différentes fois le faire prisonnier, ainsi que la plus grande partie de son armée. Il est opiniâtre et infatigable, n’a peur de rien et est très attaché à son pays ; mais comme général, il est sans talent.
- Les Bourbons d’Espagne – Charles IV (1748-1819), Ferdinand VII (1784-1833), Marie-Louise de Bourbon-Parme (1751-1819)
Le prince des Asturies est très bête, très méchant, très ennemi de la France ; avec mon habitude de manier les hommes, son expérience de vingt-quatre ans n’a pu m’en imposer.
Le roi Charles est un brave homme. Je ne sais si c’est sa position ou les circonstances, il a l’air d’un patriarche franc et bon.
La reine a son coeur et son histoire sur sa physionomie, c’est vous en dire assez. Cela passe tout ce qui est permis de s’imaginer.
- Karl Wilhelm Ferdinand duc de Brunswick, général prussien (1735-1806)
Le duc de Brunswick a eu tous les torts dans cette guerre [contre la Prusse en 1806] ; il a mal conçu et mal dirigé les mouvements de l’armée ; il croyait l’empereur à Paris lorsqu’il se trouvait sur ses flancs ; il pensait avoir l’initiative des mouvements et il était déjà tourné.
- Archiduc Charles d’Autriche, général (1771-1847)
Le prince Charles est un homme sage, aimé par ses troupes… Bien qu’il ait commis un millier de fautes, il est le meilleur général autrichien.
- François-René de Chateaubriand (1768-1848)
Il s’est offert vingt fois à mois ; mais comme c’est pour me faire plier à son imagination et non pour m’obéir, je me suis refusé à ses services, c’est-à-dire à le servir.
Je n’ai point de reproches à faire à Chateaubriand. Il m’a resisté dans ma puissance.
Tout ce qui est grand et national doit convenir au génie de Chateaubriand.
- Sir George Cockburn, contre-amiral anglais (1772-1853)
Malgré certaines contrariétés, l’amiral Cockburn avait mérité ma parfaite confiance ; mais il ne paraît pas que son successeur soit jaloux de m’en inspirer une semblable.
C’est un homme d’honneur. Sa brusquerie nous blesse parfois ; mais en définitive, c’est un vieux et brave soldat, et avec eux je finis toujours par m’entendre… J’ai eu quelques reproches à lui faire, mais j’ai toujours rendu justice à ses sentiments honorables. Jamais il ne m’a inspiré la plus légère méfiance.
- Benjamin Constant 1767-1830)
Comme homme d’esprit, écrivain, il fallait qu’il écrive, qu’il accuse. Il était l’amant de Madame de Staël qui eût aimé me culbuter. Il avait été fort partisan du 18 Fructidor et du 18 Brumaire. Constant avait toujours été désireux de se rapprocher de moi sous l’Empire.
- Louis Antoine Henri de Bourbon, duc d’Enghien (1772-1804)
Il faut supporter la responsabilité de l’événènement ; la rejeter sur d’autres, même avec vérité, ressemblerait trop à une lâcheté pour que je veuille m’en laisser soupçonner.
Assurément, si j’eusse été instruit à temps de certaines particularités concernant les opinions et le naturel du duc d’Enghien, et surtout si j’avais vu la lettre qu’il m’écrivit et que Talleyrand me remit que quand il n’était plus, bien certainement j’eusse pardonné.
- François Ier, Empereur d’Autriche (1768-1835)
Ce squelette de François II, que le mérite de ses ancêtres a placé sur le trône.
Je préfère un homme d’honneur qui tient parole à un homme consciencieux. L’empereur François a fait ce qu’il estimait être le plus utile pour le bien de son peuple, il est consciencieux, mais il n’est pas homme d’honneur.
Je croyais que l’empereur François était un bon homme : je me suis trompé ! C’est un imbécile, un paresseux sans cervelle et sans coeur. Il est dépourvu de tout talent. Il ignore l’affection, la sensibilité et la gratitude. En fait, les bonnes qualités lui font complètement défaut.
- Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse (1770-1840)
C’est un homme entièrement borné, sans caractère, sans moyens, un vrai benêt, un balourd, un ennuyeux.
Le plus grand sot de la terre, sans talent, sans instruction, incapable de soutenir une conversation de cinq minutes. Il a l’air d’un vrai don Quichotte.
Pas un tailleur e savait plus long que le roi Frédéric-Guillaume sur ce qu’il fallait de drap pour faire un habit. Si l’armée française avait été comandée par un tailleur, le roi de Prusse aurait certainement gagné la bataille à cause de son savoir supérieur en cette matière.
- Marie Joseph du Motier, marquis de La Fayette (1757-1834)
La Fayette a été un niais politique. Sa bonhomie doit le rendre constamment dupe des hommes et des choses. Son insurrection des chambres, au retour de Waterloo, a tout perdu.
La Fayette… était un homme sans talents, ni civils ni militaires ; esprit borné, caractère dissimulé, dominé par des idées vagues de liberté, mal digérées chez lui et mal conçues. Au reste, dans la vie privée, La Fayette était un honnête homme.
Les deux issues si malheureuses des invasions de la France lorsqu’elle avait encore tant de ressources sont dues aux trahisons de Marmont, Augereau, Talleyrand, et La Fayette. Je leur pardonne ; puisse la postérité française leur pardonner comme moi !
- Sir Hudson Lowe, gouverneur de Sainte-Hélène (1769-1844)
Vous êtes pour nous un plus grand fléau que les misères de cet affreux rocher.
J’ai vu des tartares, des cosaques, des kalmouks, mais je n’ai jamais vu une figure aussi sinistre et aussi repoussante.
Si un tel homme reste un instant seul près d’une tasse de café, c’est à ne pas la boire ! Il a le crime gravé sur le visage.
- Klemens de Metternich, comte puis prince, ministre des affaires étrangères d’Autriche (1773-1859)
Metternich est tout prêt d’être un homme d’Etat : Il ment très bien.
- Jean Victor Marie Moreau, général (1763-1813)
Il a du génie sur le champ de bataille, mais, dans la vie, c’est un faible servilement soumis à sa femme. Sa belle-mère lui a monté la tête contre moi.
La nature en lui n’avait pas fini sa création ; il avait plus d’instinct que de génie.
Moreau ne connaissait pas le prix du temps ; il le passait toujours le lendemain d’une bataille dans une fâcheuse indécision.
Il était supérieur pour commander une forte division ou un de mes corps d’armées, mais pour bien commander en chef il faut être un autre homme que lui.
- Horatio Nelson, vicomte, amiral anglais (1758-1805)
Nelson était un brave homme. Si Villeneuve à Aboukir et Dumanoir à Traflagar avait eu un peu de son sang, les Français auraient été vainqueurs.
- Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein (1766-1817)
Madame de Staël était ardente dans ses passions, furieuse et forcenée dans ses expressions. Sa demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi ; on venait y faire armer chevalier. Elle s’occupait à me susciter des ennemis et me combattait elle-même.
Il est vrai de dire que personne ne saurait nier qu’après tout Madame de Staël est une femme d’un grand talent, fort distinguée, de beaucoup d’esprit : elle restera.
- Arthur Wellesley, duc de Wellington, commandant en chef de l’armée anglaise (1769-1852)
Si je juge les actions de Wellington d’après les dépêches, et surtout d’après sa conduite envers Ney, son procès et son exécution, je dois dire que c’est un homme de peu d’esprit, sans générosité ni grandeur d’âme. Wellington est un homme ordinaire. Il a été prudent et heureux, mais ce n’est pas un grand génie.
août 29, 2007
DOUCE ET INCOMPARABLE JOSEPHINE, IMPERATRICE DES FRANCAIS (1763-1814)
Joséphine était une femme des plus agréables. Elle était pleine de grâce, et femme dans toute la force du terme, ne répondant jamais d’abord que « non » pour avoir le temps de réfléchir. Elle mentait presque toujours, mais avec esprit. Je puis dire que c’est la femme que j’ai le plus aimée.
« Douce et incomparable Joséphine », l’expression est de Napoléon lui-même qui l’utilise dans une des toutes premières lettres qu’il lui adresse en 1795 ; lui seul réellement pouvait juger si elle était aussi « douce et incomparable » qu’il l’imaginait.
Il convient avant tout de faire une mise au point sur son nom réel. La plupart des gens la connaissent de nos jours sous le nom de Joséphine de Beauharnais, or stricto sensu, Joséphine de Beauharnais n’a jamais existé ! Cette affirmation demande une explication : elle est baptisée en 1763 sous le nom de Marie-Joseph-Rose de Tascher de la Pagerie et Rose est son prénom usuel qu’elle portera jusqu’à sa rencontre avec le futur empereur en 1795. Mais bien évidemment personne ne sait de nos jours qui est Rose de Beauharnais. C’est Napoléon lui-même qui décide de féminiser son prénom de Joseph en Joséphine et elle devient alors Joséphine Bonaparte, puis l’impératrice Joséphine. Au moment de son décès en 1814, les journaux royalistes annoncent la mort de Mme veuve de Beauharnais, comme si l’empereur n’avait jamais existé. On évacue alors le patronyme Bonaparte pour ressusciter celui de Beauharnais tout en conservant le prénom que Napoléon lui avait donné : ainsi naquit Joséphine de Beauharnais ! Je vous engage donc à ne plus la nommer ainsi, mais Joséphine Bonaparte ou l’impératrice Joséphine.
Elle naît à la Martinique en 1763, c’est-à-dire seulement huit ans seulement après la reine Marie-Antoinette, et lorsqu’elle épouse Napoléon, elle a déjà trente-trois ans et a vécu plus de la moitié de sa vie. Elle est donc une femme ancrée dans le XVIIIè siècle, ce qui lui permettra plus tard de jouer un rôle important dans la fusion des deux sociétés, celle issue de l’Ancien Régime et celle générée par la Révolution.
La famille de Tascher est d’antique noblesse, certains de ses membres ayant été chevaliers croisés auprès de Saint-Louis ; c’est en 1726 qu’une branche Tascher de la Pagerie vient s’installer à la Martinique. La petite Marie-Joseph-Rose trouve son île trop étroite et rêve d’aller à Paris. Ce rêve prend corps lorsqu’on la marie à l’âge de seize ans à Alexandre de Beauharnais, un époux qu’elle n’a quasiment jamais vu et qui va lui donner deux enfants, d’abord un fils, Eugène, en 1781, puis une fille, Hortense, en 1783. La suspicion et la jalousie maladive du mari débouchent très rapidement sur la séparation du couple qui intervient après la naissance d’Hortense ; Joséphine s’installe alors dans l’abbaye de Panthémont, rue de Grenelle, où les religieuses mettent des appartements à la disposition des femmes de distinction ; elle conserve alors la garde de sa fille. En 1788, elle décide de retourner en Martinique avec Hortense pour tenter de récupérer quelque argent auprès de son père. Elle y reste deux ans, lorsque les mouvements révolutionnaires ayant atteint les Antilles, elle rentre précipitamment en France en octobre 1790 pour découvrir qu’Alexandre est devenu un personnage en vue, bientôt Président de la Constituante. Sans reprendre la vie commune, elle se rapproche de cet époux influent, cherchant comme elle le fera toute sa vie à se rapprocher du pouvoir, non pas pour le plaisir de l’exercer, mais pour les facilités matérielles qu’il apporte. Dès lors, elle fréquente avec une grande insouciance les milieux politiques les plus contrastés, cherchant toujours à rendre service à son entourage. Mais la loi des suspects de septembre 1793 ordonnant l’arrestation des gens jugés dangereux, Alexandre est d’abord emprisonné, puis est rejoint par Joséphine en avril 1794. S’il est guillotiné quelques jours avant la chute de Robespierre, Joséphine échappe de justesse au supplice, mais restera marquée à tout jamais par cet enfermement, au cours duquel elle s’attendait chaque matin à entendre prononcer son nom sur la liste des condamnés.
A sa sortie de prison, elle devient avec Mme Tallien l’une des gloires de la société thermidorienne, se rapprochant du plus influent des directeurs, Barras dans le salon duquel elle rencontre un jeune général corse répondant au nom de Napoléon Bonaparte. Elle pense qu’à trente-deux ans passés, il serait convenable de se remarier pour assurer son avenir et celui de ses enfants. Ce jeune général semble avoir de l’avenir ; de plus il l’amuse et la croit très riche, ce qu’elle lui laisse croire. A ses yeux, ce n’est qu’un mariage de convenance, célébré un peu rapidement par un beau jour de mars 1796, dans lequel Joséphine trouve un protecteur et Napoléon une femme influente qui lui ouvre les portes de la société directoriale. Mais il s’avère que le mari est follement amoureux de son épouse, chose étrange pour une femme d’Ancien Régime, et qui lui semble du dernier bourgeois ! Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et s’amuse des lettres enflammées que lui envoie son mari. Elle y répond de temps à autre, mélangeant le « tu » et le « vous », ce qui ne manque pas d’irriter notre amoureux qui lui répond rageusement « vous toi-même » !
La vie agitée qu’elle mène à Paris la fait hésiter à le rejoindre en Italie, mais peu à peu elle se fait à l’idée que ce mari qu’elle a épousé un peu vite a un véritable avenir devant lui. Elle en prend réellement conscience lorsque le coup d’état de brumaire fait d’elle la première dame de France à l’âge de trente-six ans, avec le titre peu gracieux de consulesse, mais sans imaginer un seul instant qu’elle deviendra un jour impératrice.
Dès cette époque, l’épouse du Premier Consul s’investit dans de multiples tâches. D’abord sa grande connaissance des milieux aristocratiques lui permet d’aider au retour des émigrés et elle organise quasiment le bureau des radiations ; c’est grâce à son action qu’une grande partie de la noblesse d’Ancien Régime va se rallier à Bonaparte. Devenue impératrice des Français le 18 mai 1804, elle se glisse alors avec une aisance déconcertante dans ses nouveaux habits impériaux. Elle comprend immédiatement qu’elle succède à la reine Marie-Antoinette dans ce rôle, tient sa cour avec beaucoup de tact et de distinction et se met à protéger les artistes.
Elle aide d’abord les jeunes peintres et active le goût pour le Moyen-Age en leur commandant des tableaux retraçant l’histoire nationale. On fait généralement commencer la naissance de ce mouvement romantique avec la publication de Notre-Dame de Paris ou bien avec le patronage de la duchesse de Berry, alors que c’est Joséphine qui l’initie dès le début des années 1800. La plupart des thèmes abordés sont tristes et mélancoliques, liés à la mort, la séparation ou l’abandon, et se retrouvent dans sa collection de peintures modernes.
Elle développe également sa passion pour les antiques, réunissant une magnifique collection de deux cent cinquante vases grecs ou de bronzes provenant des fouilles d’Herculanum et de Pompéi, qui lui sont offerts par les souverains napolitains.
Pour enrichir ses collections, elle n’hésite pas à se servir dans les collections nationales, les limites du domaine public et du domaine privé n’étant pas alors aussi clairement définies que de nos jours. Aussi lui arrive-t-il de se servir parfois aussi bien dans les collections du musée des Monuments Français que dans celles du musée Napoléon, notre actuel musée du Louvre ! Elle n’hésite pas non plus à faire ôter les bas-reliefs de la laiterie de Rambouillet pour garnir sa chère Malmaison. Nous jugeons sévèrement ces comportements avec nos yeux du XXIè siècle, mais de telles pratiques étaient alors monnaie courante.
Joséphine recherche également des objets ayant appartenus à Louis XVI ou à Marie-Antoinette, comme des plaques en porcelaine de Sèvres provenant de leurs appartements de Versailles ; elle entre aussi en possession du guéridon livré par Sèvres à Mme du Barry. On retrouve là son attachement pour l’art de sa jeunesse, celui de la fin du XVIIIè siècle qui a marqué si fortement son goût.
Elle n’omet pas non plus de patronner la musique à l’instar de Marie-Antoinette. Afin de régénérer l’opéra français, la reine avait appelé à Paris le chevalier Gluck qui livra son premier opéra français, Iphigénie en Aulide ; parallèlement, Joséphine impose l’italien Spontini qui lui dédie la Vestale, premier grand opéra à la française, ancêtre des œuvres lyriques de la première moitié du siècle jusqu’à Berlioz.
Mais sa vraie passion va aux sciences naturelles, d’abord à la botanique, puis à la zoologie. La légende veut que le nom de Joséphine soit attaché aux roses. Tout ceci repose sur un malentendu qui s’appelle Redouté ! Le succès de son ouvrage sur les Roses, en a répandu la célébrité sur la terre entière, allant jusqu’à fasciner les Japonais qui en font un véritable mythe. En réalité, aux yeux de Joséphine, sa collection de roses n’a pas plus d’importance que ses pélargoniums ou ses bruyères. Et qui plus est, elle n’avait pas de roseraie ! Cette notion de roseraie ne remonte guère au-delà de la fin du XIXè siècle lorsque Jules Gravereaux réalise la première roseraie moderne à l’Haÿ-les-Roses. Sous l’Empire, les rosiers n’étant pas remontants et ne fleurissant donc qu’une fois l’an en mai et juin, sont placés dans des pots, sortis juste le temps de leur floraison. En vraie passionnée, elle connaît les noms latins des plantes qu’elle cultive, et ne dédaigne pas de correspondre directement avec les professeurs du Museum d’histoire naturelle qui la considèrent un peu comme faisant partie des leurs. Dans ses serres de Malmaison qui sont construites à grand frais, plus de deux cents plantes nouvelles fleurissent pour la première fois en Franc comme le camélia, le phlox ou le dahlia. Pour moitié avec un pépiniériste londonien, elle engage un jeune botaniste écossais qui herborise dans la région du Cap, en Afrique du sud, afin de lui fournir des plantes jusqu’alors inconnues comme les proteas et les erikas.
La zoologie ne la laisse pas indifférente. Elle profite de l’expédition aux Terres australes envoyée par le Premier Consul en 1800 et conduite par le capitaine Baudin, pour littéralement rafler les plus beaux sujets lorsqu’ils arrivent au port de Lorient. Le partage est inégal avec le Museum et Joséphine s’approprie le seul couple de cygnes noirs alors connus en Europe ; il s’acclimatera et se reproduira à Malmaison.
Les dettes sont intimement liées à la vie de Joséphine. Ses rapports avec l’argent ont toujours été à l’origine de terribles colères de la part de Napoléon. Elle oublie aussitôt ce qu’elle vient d’acheter, ce que Bourrienne relate joliment en écrivant que son plaisir n’était pas de posséder, mais d’acquérir. Combien de caisses réglées à force de larmes et jamais ouvertes, que ce soit à Malmaison ou à Saint-Cloud ; on en a même retrouvé sous Napoléon III dans cette dernière résidence, laissées là depuis un demi-siècle !
Joséphine a certes coûté très cher à la France, et certainement plus que la reine Marie-Antoinette, mais sa grande bonté et sa qualité de française lui ont épargné les foudres de ses sujets. On peut évaluer à cinquante millions de francs ce qu’elle a coûté à notre pays, sachant qu’à la même époque un garçon jardinier gagnait six cents francs par an ! Mais elle était la souveraine du pays le plus puissant et Napoléon avait souhaité que le commerce de luxe dépassât le niveau qui était le sien avant la Révolution. En réalité, il a été entendu au-delà de toute espérance et connaissant la propension de Joséphine à dépenser sans compter, il aurait dû être plus méfiant et ne s’en prendre qu’à lui-même.
Elle ne suit pas la mode, mais elle la créée, dépensant sans compter tant pour ses toilettes que pour ses bijoux. Son écrin est le plus riche d’Europe.
Tous les moyens lui sont bons pour se procurer de l’argent. Si Bonaparte avait accepté que les généraux s’enrichissent au moment du Directoire, il n’admet plus de malversations dès qu’il devient le chef de l’Etat. Or, Joséphine ne le comprend pas et continue de s’enrichir par des moyens peu honnêtes. Elle continue à s’impliquer dans les fournitures aux armées, n’hésitant pas à vendre des chevaux borgnes au prix de purs sangs. Elle va jusqu’à commettre ce qu’on appellerait de nos jours un délit d’initié ; informée avant tout le monde que la paix allait être signée avec l’Angleterre, elle s’acoquine aussitôt avec un agent de change, lui promettant de partager les bénéfices, ce qu’elle se gardera bien de faire. C’est seulement après la mort de l’Impératrice que le pauvre agent de change osa réclamer son dû au prince Eugène qui s’empressa de régler la dette de sa mère. Napoléon ne l’apprit jamais. Elle ne lui avouait d’ailleurs jamais la vérité, lui disant d’abord non pour se laisser le temps de la réflexion. Ensuite, elle consentait à lui révéler généralement la moitié de sa dette, ce qui le faisait immanquablement crier ; alors elle pleurait et il finissait toujours par payer, ne sachant pas résister aux larmes de Joséphine.
Le divorce a toujours été son épée de Damoclès ; il en est déjà question dès 1798 au moment de sa liaison probable avec le jeune Hippolyte Charles, puis peu à peu elle se rend compte qu’elle ne peut pas donner d’héritier à Napoléon. Elle avait réussi à le convaincre de sa stérilité, arguant la naissance de ses deux enfants, Eugène et Hortense. Si l’Empereur avait déjà eu un fils naturel en 1806, le futur comte Léon, il n’était pas totalement certain de sa paternité, la jeune femme ayant probablement partagé en même temps que Napoléon les faveurs de Murat. Mais sa rencontre avec Marie Walewska et la naissance de leur fils, Alexandre Walewski, le convainc définitivement de sa faculté de procréer. Il faut un héritier à l’Empire et sa décision de divorcer est alors arrêtée. Cette séparation est vécue comme une véritable épreuve par les deux époux ; le temps et des moments difficiles partagés ensemble avaient renforcé leur complicité ; ils s’étaient élevés ensemble jusqu’aux marches du trône. Elle partageait ses habitudes depuis si longtemps, et Napoléon savait qu’il allait devoir affronter une nouvelle épouse qui ne le connaissait pas. Cette séparation par consentement mutuel reste unique dans l’histoire de notre pays. Le jour de la cérémonie, devant la cour et la famille impériale assemblée, Napoléon fait cette déclaration stupéfiante lors d’un divorce : « Elle a embelli quinze ans de ma vie ».
Consciente de s’être sacrifiée au bonheur de la France, Joséphine vit ses dernières années dans une triste solitude. Elle conserve son titre d’impératrice, et Napoléon ne manque jamais de venir lui rendre visite, généralement une fois l’an, et toujours dans le jardin afin d’être vus de tous. Elle occupe son temps en voyageant beaucoup, principalement en Suisse et en Savoie où elle n’hésite pas à monter sur la mer de glace à Chamonix, accompagnée d’une véritable caravane d’environ quatre-vingts personnes ! Une autre année, elle se rend à Milan pour les couches de sa belle-fille, l’épouse d’Eugène, et surtout pour faire la connaissance de ses petits-enfants qu’elle n’a jamais vus. Les enfants d’Eugène feront de splendides mariages : l’un épousera la reine du Portugal, l’une sera impératrice du Brésil, et une autre deviendra reine de Suède en épousant le fils de Bernadotte. De cette dernière descendent actuellement les rois des Belges, de Norvège et de Suède, les reines des Hellènes et du Danemark et le grand-duc de Luxembourg, qui né prince de Bourbon-Parme, descend aussi bien de Joséphine que de Louis XIV !
A la fin de sa vie, Joséphine devient une grand-mère attentive et aimante ; ses petits-enfants comptent beaucoup pour elle, principalement les deux fils d’Hortense Napoléon-Louis et Louis-Napoléon qu’elle voit très souvent et qui passent régulièrement l’été à Malmaison. Le dernier, qui deviendra Napoléon III, fait sa joie ; surnommé Oui-Oui, il la ravit par ses bons mots et elle l’autorise même à couper les cannes à sucre de la serre chaude pour les sucer. Ces souvenirs d’enfance l’avaient tant marqués qu’il rachètera Malmaison en 1861 afin d’en faire un premier musée napoléonien.
Rentrée de Milan à l’automne 1812, elle apprend les nouvelles désastreuses de la campagne de Russie ; désormais, elle se terre à Malmaison et ne voyage plus. Elle part seulement quelques jours dans sa terre de Navarre, aux portes d’Evreux, à l’approche des armées alliées et y apprend l’abdication de Napoléon. Désormais l’épopée est terminée, elle ne peut compter que sur elle-même. Elle rentre alors à Malmaison, respectée de tous et principalement du tsar Alexandre ; ayant toujours besoin d’un protecteur, elle s’en rapproche comme elle l’avait fait précédemment plusieurs fois au cours de sa vie avec Alexandre de Beauharnais, Barras ou Napoléon. Le tsar sépare le sort des Beauharnais de celui des Bonaparte ; l’attitude de Joséphine et de ses deux enfants a toujours forcé son admiration tant par leur éducation que par leur fidélité à Napoléon, et de plus, le beau-père d’Eugène, le roi de Bavière, a épousé la sœur de la tsarine. La Restauration lui ayant conservé son titre d’impératrice, elle reçoit à Malmaison les souverains alliés comme le roi de Prusse ou le tsar de Russie et éclipse la cour des Tuileries ; Louis XVIII est veuf depuis longtemps et les Tuileries rappellent trop de souvenirs pénibles à sa nièce, la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, pour qu’elle y tienne une cour brillante. Ces mois d’avril et mai 1814 voient donc l’apothéose de Joséphine et elle a le bonheur de disparaître au bon moment, en pleine gloire, n’ayant certainement pas pu résister au-delà de la première Restauration. Au retour de Napoléon de l’île d’Elbe, elle n’aurait pu se tenir à l’écart des Cent-Jours, et elle aurait tout perdu après Waterloo, devant vraisemblablement s’exiler et quitter sa chère Malmaison. Elle a été le grand amour de Napoléon qui se rappelait à Sainte-Hélène que « c’était une vraie femme » et ajoutant que « Joséphine était la grâce personnifiée ».
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
LES PERSONNAGES HISTORIQUES PAR L’EMPEREUR NAPOLEON 1er
Quand on veut se meler de gouverner, il faut savoir payer de sa personne, au besoin savoir se laisser assassiner.
- Alexandre Le Grand (356-323 avant JC)
Ce que j’aime chez Alexandre le Grand, ce ne sont pas ses campagnes que nous ne pouvons concevoir, mais ses moyens politiques. Il laissa à trente-trois ans un immense empire bien établi, et il avait eu l’art de se faire aimer des peuples vaincus.
Alexandre Le Grand, César, Hannibal, le Grand Gustave et d’autres réussissent toujours ; est-ce parce qu’ils ont eu du bonheur qu’ils deviennent ainsi de grands hommes ? Non, mais parce qu’étant des grands hommes ils ont maîtrisé leur bonheur ! Quand on veut étudier les ressorts de leurs succès, on est tout étonné de voir qu’ils avaient tout fait pour l’obtenir.
- Catherine II (1729-1796)
C’était une maîtresse femme, elle était digne d’avoir de la barbe au menton.
- Jules César (100-44 avant JC)
César n’a jamais voulu se faire roi, et il n’a pas été tué pour avoir ambitionné la couronne, mais pour avoir voulu établir l’ordre civil par la réunion de tous les partis. Il a été tué dans le Sénat où il avait placé un grand nombre de ses ennemis, c’est à dire plus de quarante amis de Pompée.
- Pierre Corneille (1606-1684)
D’où a-t-il cette grandeur antique ? C’est le génie ! Le génie, voyez-vous, est une flame qui tombe du ciel mais qui trouve rarement un esprit prèt à la recevoir. Corneille était un homme qui connaissait le monde. C’est justement pourquoi je prétends qu’il est un grand homme.
S’il vivait, je le ferais prince.
- Olivier Cromwell (1599-1658)
Ce n’était pas un grand militaire, il n’a gagné que deux batailles. La révolution d’Angleterre n’a rien de commun avec la nôtre, et Cromwell rien de commun avec moi : Cromwell a tout fait par la force, et moi tout régulièrement par les lois.
- François 1er (1494-1547)
Si François Ier avait embrassé le luthérianisme, si favorable à la suprématie royale, il eût épargné à la France de terribles convulsions religieuses amenées plus tard par les calvinistes. Après tout, il n’était qu’un héros de tournoi, un beau de salon, un de ces grands hommes pygmées.
- Frédéric II le Grand (1712-1786)
En plaine, je pense comme Frédéric : il faut toujours attaquer le premier.
Il a été grand surtout dans les moments les plus critiques : c’est le plus bel éloge que l’on puisse faire de son caractère. Ce qui distingue le plus Frédéric, ce n’est pas l’habileté de ses manoeuvres, c’est son audace ! Il a exécuté ce que je n’ai jamais tenté. Il a quitté sa ligne d’opération et a souvent agi comme s’il n’avait aucune connaissance de l’art militaire.
- Johann-Wolfgang Goethe (1749-1832)
Voilà un homme !
- Hannibal (247-183 avant JC)
Il a été le plus audacieux de tous [les grands guerriers], le plus étonnant peut être ! Si hardi, si sûr, si large en toutes choses, qui, à vingt-six ans, conçoit ce qui est à peine concevable, exécute ce qu’on devait tenir pour impossible ; qui, renonçant à toute communication avec son pays, traverse des peuples ennemis ou inconnus qu’il faut attaquer et vaincre, escalade les Pyrénées et les Alpes… Certes, il devait être doué d’une âme de la trempe la plus forte et avoir une bien haute idée de sa science en guerre.
- Henri IV (1553-1610)
C’était un bon homme, mais il n’a rien fait d’extraordinaire, et ce barbon qui courait les rues de Paris après les catins n’était qu’un vieux fou. Je suis sûr que, de son temps, il n’avait pas la réputation qu’on lui donne maintenant.
- Louis XIV (1638-1715)
Depuis Charlemagne, quel est le roi de France qu’on puisse comparer à Louis XIV sous toutes les faces ?
Louis XIV fut un grand roi ; c’est lui qui a élevé la France au premier rang des nations… Mais le soleil n’a-t-il pas lui même ses taches ?
- Louis XVI (1754-1793)
Sa mort m’a paru une opprobe pour la nation ! Quant aux juges du roi, chez plusieurs, c’est la peur plutôt que la haine et la méchanceté qui l’a jugé. J’ai toujours regardé sa mort comme un crime.
Nous condamnons Louis XVI ; mais, indépendamment de sa faiblesse, il a été le premier prince attaqué. C’est celui sur lequel les nouveaux principes faisaient leur essai.
Qui fut plus populaire, plus débonnaire que le malheureux Louis XVI ? Pourtant quelle a été sa destinée ? Il a péri ! C’est qu’il faut servir dignement le peuple et ne pas s’occuper de lui plaire. La belle manière de le gagner, c’est de lui faire du bien, car rien n’est plus dangereux que de le flatter : s’il n’a pas ensuite tout ce qu’il veut, il s’irrite et pense qu’on lui a manqué de parole et, si alors on lui résiste, il hait d’autant plus qu’il se dit trompé.
Si Louis XVI s’était échappé à Varennes, le duc d’Orléans aurait été fait roi et la Révolution aurait pris un tout autre cours.
- Jean Racine (1639-1699)
Bien que Racine ait accompli des chefs-d’oeuvre en eux-même, il a répandu néanmoins une perpétuelle fadeur, un éternel amour et son ton douceureux, son fastidieux entourage. Mais ce n’était pas précisément sa faute. C’était le vice et les moeurs du temps.
- Tacite (55-120)
Ne me parlez pas de ce pamphlétaire qui a calomnié les empereurs. Il fait des scélérats profonds de tous les empereurs, sans faire admirer le génie qui les a pénétrés.
- Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (1611-1675)
Turenne est le plus grand général français. Contre l’ordinaire, il a pris de l’audace en vieillissant ; ses dernières campagnes sont superbes.
août 28, 2007
LES DIGNITAIRES CIVILS DE L’EMPIRE PAR NAPOLEON 1er
L’art le plus difficile n’est pas de choisir les hommes, mais de donner aux hommes que l’on a choisis toute la valeur qu’ils peuvent avoir.
Un homme que je fais ministre ne doit plus pouvoir pisser au bout de quatre ans. C’est un honneur et une fortune éternelle pour sa famille.
- Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, diplomate et secrétaire du Premier Consul (1769-1834)
Je parie que je ferais enfermer Bourrienne seul dans le jardin des Tuileries qu’il finirait pas y trouver une mine d’argent.
- Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Consul, duc de Parme (1753-1824)
Si vous voulez bien manger, allez chez Cambacérès.
- Lazare Nicolas Marguerite Carnot, ministre de l’intérieur (1753-1823)
Il aura toujours droit à ma reconnaissance et à mon intérêt. Je ne ferai point de difficulté pour l’employer.
Carnot était travailleur, sincère dans tout, sans intrigues, mais facile à tromper. Il montra toujours un grand courage moral. Il a été fidèle, travailleur, probe, et toujours vrai.
Carnot, c’est le plus honnête des hommes. Il a quitté la France sans un sou.
- Armand Augustin de Caulaincourt, marquis, duc de Vicence, ministre des affaires étrangères (1773-1827)
Caulaincourt n’a pas fait grand-chose à Saint-Petersbourg. C’est un honnête homme qui m’a bien servi, mais il ne convenait pas comme ministre des affaires étrangères.
- Henri Jacques Clarke, duc de Feltre, ministre de la guerre (1765-1818)
Un vrai courtisan, et d’ailleurs l’homme le plus vaniteux qu’il eût jamais vu.
Il croyait que j’étais comme Louis XV, qu’il fallait me cajoler, me plaire. Si j’avais des maîtresses, il serait le plus empressé serviteur.
- Pierre Antoine Noël Bruno Daru, comte, ministre, secrétaire d’Etat, intendant général de la Grande Armée (1767-1829)
Un homme d’une rare capacité, mon meilleur administrateur… un boeuf au travail.
- Denis Decrès, duc, ministre de la marine (1761-1820)
Decrès est généralement détesté mais on a tort ; il a rendu de grands services à la marine. Il est très capable, homme d’esprit, beaucoup de caractère, et ennemi, en tout genre, des abus.
- Louis de Fontanes, grand maître de l’Université (1757-1821)
Homme d’esprit, mais petite tête… trop adulateur.
Mon Université, tel que je l’avais conçue, était un chef-d’oeuvre dans ses combinaisons, et devait en être un de ses résultats nationaux. Un méchant homme [Fontanes] m’a tout gâté, et cela avec mauvaise intention et par calcul sans doute.
Si je ne l’eusse pas retenu, il nous aurait donné l’éducation de Louis XV, nous aurait fait des marquis ; or ils ne sont bons qu’à la comédie.
- Joseph Fouché, duc d’Otrante, ministre de la police (1759-1820)
Celui-ci n’est qu’intrigant ; il a prodigieusement d’esprit et de facilité d’écrire. C’est un voleur qui prend de toutes mains. Il doit avoir des millions ! Il a été un grand révolutionnaire, un homme de sang. Il croit racheter ses torts ou les faire oublier en cajolant les parents de ses victimes et se faisant, en apparence, le protecteur du Faubourg Saint-Germain. C’est un homme qu’il peut être utile d’employer parce qu’il est encore le drapeau de beaucoup de révolutionnaires, et d’ailleurs très capable, mais je ne puis jamais avoir confiance en lui.
J’aurais dû le faire pendre plus tôt, j’en laisse maintenant le soin aux Bourbons.
C’est un homme de peu de moyens, d’une parfaite immoralité, qui n’est bon qu’à tramer de petites intrigues, et ce qui peut lui arriver de plus heureux c’est qu’on ne parle plus de lui. Louis XVIII a sagement fait de le chasser.
- Martin Michel Charles Gaudin, duc de Gaète, ministre des finances (1756-1841)
C’est un homme tout d’une pièce, et c’est une forteresse inattaquable pour la corruption. Je me suis toujours applaudi de son concours, et je lui porte une amitié que je me plais à rappeler.
- Jean Gérard Lacuée, comte de Cessac, ministre de l’administation de guerre (1753-1841)
Lacuée est un homme intègre ; plus propre que personne, après Daru, pour mener l’administration de guerre.
- Philippe Antoine Merlin de Douai, comte, conseiller d’Etat (1754-1838)
Au Conseil d’Etat, j’étais très fort tant qu’on demeurait dans domaine du code. Mais, dès qu’on passait aux régions extérieures, je tombais dans les ténèbres et Merlin était ma ressource. Sans être brillant, il était fort érudit, puis sage, droit et honnête. Il m’était fort attaché.
- Louis Mathieu Molé, comte, ministre de la justice (1781-1855)
Molé, ce beau nom de la magistrature, caractère appelé probablement à jouer un rôle dans les ministères futurs.
- François Nicolas Mollien, comte, ministre du trésor (1758-1850)
Mollien avait ramené le trésor public à une simple maison de banque, si bien que, dans un seul petit cahier, j’avais constamment sous les yeux l’état complet de mes affaires : ma recette, ma dépense, mes arriérés, mes ressources.
- Louis Jacques Almaric Narbonne-Lara, comte, diplomate (1755-1813)
J’aurais nommé Narbonne grand maréchal à la mort de Duroc… Il est devenu homme de cour, homme de beaucoup d’esprit et diplomate de haute valeur. Malheureusement, j’ai écouté Talleyrand qui le craignait.
- Jean Etienne Marie Portalis, ministre des cultes (1746-1807)
Portalis serait l’orateur le plus fleuri et le plus éloquent s’il savait s’arrêter.
- Michel Regnault Saint-Jean-d’Angely, comte, minitre (1760-1819)
Quel dommage que Regnault aime tant l’argent et les plaisirs qu’il procure ! Ce serait un ministre comme jamais je n’en ai pu trouver un.
- Anne Jean Marie René Savary, duc de Rovigo, ministre de la police (1774-1833)
Il ne faut pas laisser entrevoir à Savary l’opinion que j’ai de son incapacité.
Savary est un homme secondaire, qui n’a pas assez d’expérience et de calme pour être à la tête d’une grande machine. Du reste, c’est un homme d’énergie.
Si on le laissait faire, il mettrait bientôt le feu à la France
Les mouvements de Savary font hausser les épaules aux hommes qui raisonnent.
- Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Bénévent, ministre des affaires étrangères
Je l’ai couvert d’honneurs, de richesses, de diamants. Il a employé tout cela contre moi ! Il m’a trahi autant qu’il le pouvait à la première occasion qu’il a eue de le faire.
Comment voulez-vous que cet homme ne soit pas riche, ayant vendu tous ceux qui l’ont acheté ?
Nous n’étions pas toujours du même avis, Talleyrand et moi ; il lui est arrivé plus d’une fois de m’en donner de bons.
C’est un homme d’intrigue, d’une grande immoralité, mais avec beaucoup d’esprit et, certes, le plus capable des ministres que j’aie eus.
Non que je ne rende justice à ses talents. C’est l’homme qui a le plus de vues et d’adresse, mais c’est de l’or à côté de la merde.
Il n’a jamais été pour moi éloquent ni persuasif ; il roulait beaucoup, et longtemps autour de la même idée. Il était si adroitement évasif et divagant qu’après des conversations de plusieurs heures il s’en allait, ayant échappé souvent aux éclaircissements ou aux objets que je m’étais promis d’en obtenir lorsque je l’avais vu arriver.
LE PATRIMOINE NAPOLEONIEN
Je veux faire des quais de Paris des voies romaines avec, de distance en distance, les statues de tous les grands hommes d’Europe.
Si l’Empereur s’est toujours méfié des architectes, les quatorze années qu’ont durés le Consulat et l’Empire ont néanmoins laissé des réalisations et des projets qui ne manquent pas de grandeur. Appliquant à la lettre ce qu’il avait dit aux membres de l’Institut le 5 mars 1808 « J’ai à cœur de voir les artistes français effacer la gloire d’Athènes et de l’Italie », Napoléon jette les bases d’un Paris moderne emprunt d’Antiquité classique. Tout un chacun connaît l’arc de triomphe du Carrousel, le palais de la Bourse, l’église de la Madeleine, la façade du Palais-Bourbon, la colonne Vendôme ou la rue de Rivoli. Ce que l’on sait moins, c’est que Napoléon apporta un effort tout particulier aux constructions édilitaires et l’on oublie trop souvent de mettre à son actif les ponts d’Austerlitz, d’Iéna ou des Arts, l’aménagement des trois grands cimetières parisiens (Montmartre, Père Lachaise et Montparnasse), la construction de trois kilomètres de quais, le creusement des canaux pour amener à Paris les eaux de la rivière de l’Ourcq, ce qui détermina l’édification de quinze nouvelles fontaines dont celle de la place du Châtelet reste la plus spectaculaire.
A côté de ce Paris construit, il ne faut pas oublier le Paris projeté dont la chute de l’Empire ne permit pas l’achèvement. Si Napoléon eut le temps de voir l’arc de triomphe de l’Etoile s’élever de quelques mètres au-dessus du sol, il ne connut que les fondations du palais érigé sur la colline de Chaillot pour servir de résidence au roi de Rome, ainsi que celles du futur palais des Archives et de celui de l’Université et des Beaux-Arts.
Comment ne pas songer au rétablissement des industries de luxe, faisant à nouveau de Paris la capitale des arts décoratifs. Non seulement l’Empereur fait remeubler les anciens châteaux royaux, mais il redonne du travail aux manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Enfin, après avoir fait achever le palais du Louvre, il y ouvre le Musée Napoléon, notre actuel musée du Louvre.
On le voit, l’activité incessante de l’Empereur dans le domaine des arts a transformé radicalement notre paysage patrimonial ; axée principalement sur Paris, capitale du Grand Empire, elle a ouvert la voie aux transformations que connaîtra Paris sous le règne de Napoléon III.
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
août 27, 2007
LES GENERAUX D’EMPIRE PAR L’EMPEREUR NAPOLEON 1er
J’ai tiré la plupart de mes généraux de la boue. Partout où j’ai trouvé le talent et le courage, je l’ai élevé et mis à sa place car mon principe était de tenir la carrière ouverte aux talents.
- Henri Gatien Bertrand, comte, grand maréchal du palais (1773-1844)
J’ai dit que le général Bertrand était l’homme de la vertu, je n’ai rien dit de trop ; sa réputation est faite.
Bertrand est le meilleur ingénieur depuis Vauban.
- Louis Auguste Victor Bourmont de Ghaisne (1773-1846)
Bourmont s’est conduit bassement… Il était connu pour être un des Véndéens les plus faux et les plus hypocrites : je n’aurais jamais dû l’employer.
Bourmont est une de mes erreurs.
- Michel Sylvestre Brayer, comte (1769-1840)
Je n’ai jamais rencontré d’homme aussi prononcé, aussi déterminé dans l’exécution de son opinion. J’aurai dû le nommer commandant de la garde nationale de Paris.
- Jean-Baptiste Juvénal Corbineau (1776-1848)
C’est une famille de braves. Je n’ai pas assez fait pour lui.
- Jean-Baptiste Drouet d’Erlon, comte (1765-1844)
Je gagne brillament la bataille de Ligny, mais un lieutenant [Drouet d’Erlon] me prive de ses fruits… Le mouvement d’Erlon m’a fait bien du tort… D’Erlon est un bon chef d’état-major, a de l’ordre, mais voilà tout.
- Antoine Drouot, Commandant général de la Garde Impériale, Comte (1774-1847)
Drouot, c’est la vertu.
Plein de charité et de religion, sa morale, sa probité et sa simplicité lui eussent fait honneur dans les plus beaux jours de la république romaine. ; il n’existait pas deux officiers dans le monde pareils à Murat pour la cavalerie et à Drouot pour l’artillerie.
- Pierre Dupont de l’Etang, comte (1765-1840)
Dupont a flétri nos drapeaux. Quelle ineptie, quelle bassesse ! Il a signé une capitulation où il a compromis les intérêts de son armée en ne la faisant pas garantir par les agents anglais au camp de l’ennemi.
- Géraud Christophe Michel Duroc, duc de Frioul, maréchal du palais (1772-1813)
J’aime Duroc parce qu’il est sérieux et décidé de caractère ; je crois que cet homme n’a jamais pleuré.
C’est depuis vingt ans la seule fois qu’il n’ait pas deviné ce qui pouvait me plaire.
« Ici le général Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais de l’Empereur Napoléon, frappé glorieusement par un boulet, est mort dans les bras de l’empereur, son ami. »
Duroc avait des passions vives, tendres et secrètes, qui répondaient peu à sa froideur extérieure. Duroc était pur et moral, tout à fait désintéressé pour recevoir, extrêmement généreux pour donner.
- Jean-Baptiste Eblé, comte (1758-1812)
Eblé était un homme du plus grand mérite.
- Auguste Charles Joseph Flahaut de la Billarderie, comte (1785-1870)
Ce n’est pas comme on l’a dit, parce qu’il était trop jeune que je ne l’ai pas nommé [comme grand maréchal du palais, après la mort de Duroc en 1813]. C’est parce qu’il était homme à bonnes fortunes, et surtout parce que sa mère, Mme De Souza, était dans toutes les intrigues de Paris. Flahaut je l’aimais… Il a beaucoup d’esprit naturel, une brillante bravoure et une grande habitude au monde.
- Maurice Etienne Gérard, comte (1773-1852)
Le comte Gérard s’y couvrit de gloire et y montra autant d’intrépidité que de talent… Les généraux qui semblaient devoir s’élever aux destinées de l’avenir étaient Gérard, Clauzel, Foy, Lamarque… C’étaient mes nouveaux maréchaux.
- Antoine Henri Jomini, baron (1779-1869)
C’est un militaire de peu de valeur ; c’est cependant un écrivain qui a saisi quelques idées saines sur la guerre.
Il était aveuglé par un sentiment honorable ; l’amour de la patrie ne l’a pas retenu.
- Jean Andoche Junot, duc d’Abrantès (1771-1813)
Junot dans la campagne de Russie me mécontenta fort ; on ne le reconnaissait plus ; il fit des fautes capitales qui nous coûtèrent bien cher.
Il avait dissipé de vrais trésors sans discernement, sans goût ; trop souvent même dans des excès grossiers.
- Charles François Huchet La Bédoyère, comte (1786-1815)
La Bédoyère était éminemment français ; il fut guidé par les sentiments les plus nobles et les plus chevaleresques dans la démarche qu’il fit à Grenoble ; dévouement alors admirable, car tout était douteux.
- François Antoine Lallemand, baron (1774-1839)
Lallemand s’est déclaré pour moi à mon retour de l’île d’Elbe, dans le moment le plus périlleux.
Il a beaucoup de résolution, est capable de faire des combinaisons, et il y a peu d’hommes plus propres que lui à conduire une entreprise hasardeuse. Il a le feu sacré.
- Antoine Charles Louis Lasalle, comte (1775-1809)
Le général de division Lasalle a été tué d’une balle. C’était un officier du plus grand mérite et l’un de nos meilleurs généraux de cavalerie légère.
- Claude Jacques Lecourbe, comte (1759-1815)
Lecourbe était un excellent général, accumulant des victoires qui ont achevé la victoire de son ami le général Moreau à Hohenlinden en 1800.
Très brave, il eût été un excellent maréchal de France ; il avait reçu de la nature toutes les qualités nécessaires pour être un excellent général… Je l’ai éloigné parce que, lors du procès de Moreau et Georges Cadoudal, il s’est rangé du côté de mes ennemis.
- Jean-Baptiste Antoine Marcelin Marbot, baron (1782-1854)
Voilà le meilleur ouvrage que j’aie lu depuis quatre ans ! Il y a des choses qu’il dit mieux que moi ; il les sait mieux parce que, dans le fond, il était plus chef de corps que moi. C’est un homme instruit qui écrit bien, simplement et convenablement.
Je l’engage à continuer à écrire pour la défense et la gloire des armées françaises et en confondre les calomniateurs et les apostats.
- Jean-Gabriel Marchand, comte (1765-1851)
Le général Marchand n’est pas maréchal d’Empire, mais il vaut quatre maréchaux.
- Armand Samuel Marescot, comte (1758-1832)
Le général Marescot s’étant déshonoré en attachant son nom à une infâme capitulation, ce qui m’a contraint à lui ôter toutes ses charges et emplois.
- Georges Mouton, comte de Lobau (1770-1838)
Mon Mouton est un lion.
Mouton est le meilleur colonel qui ait jamais commandé un régiment de Français.
- Jean Rapp, comte (1771-1821)
Le général de division comte Rapp a eu un cheval tué sous lui ; l’intrépidité dont ce général a donné tant de preuves se montre dans toutes les occasions.
- Louis Joseph Vincent Le Blond de Saint-Hilaire, comte (1766-1809)
Le général Saint-Hilaire, blessé au commencement de l’action, est resté toute la journée sur le champ de bataille et s’est couvert de gloire.
Ceux-là [Lannes et Saint-Hilaire] n’eussent pas été infidèles à la gloire du peuple français.
- Dominique Vandamme, Comte d’Unsebourg (1770-1830)
Pillard comme un enragé mais brave comme un César.
Si j’avais deux Vandamme, j’en ferais fusiller un, mais je n’en ai qu’un et je le garde pour moi.
août 26, 2007
LA FAMILLE IMPERIALE PAR L’EMPEREUR NAPOLEON 1er
Je n’ai pas trouvé de coopération dans ma famille. Si je n’avais pas voulu l’utiliser, j’aurai réussi plus aisément.
- Letizia Bonaparte, Madame Mère (1750-1836)
Tout petit garçon, j’ai été initié à la gêne et aux privations d’une nombreuse famille. Mon père et ma mère ont connu de mauvais jours… huit enfants ! Le ciel est juste… Ma mère est une digne femme.
Ma mère était par trop parcimonieuse ; c’en était ridicule… C’était excès de prévoyance ; elle avait connu le besoin, et ces terribles moments ne lui sortaient pas de la pensée… mais chez elle le grand l’emportait encore sur le petit : la fierté, la noble ambition marchaient avant l’avarice.
Madame Mère avait une âme forte et trempée aux plus grands évènements.
- Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne (1768-1844)
Joseph, c’est un fort bon homme. Je ne doute pas qu’il ne fît tout au monde pour moi ; mais toutes ses qualités tiennent uniquement de l’homme privé. Dans les hautes fonctions que je lui avais confiées, il a fait ce qu’il a pu, mais dans les circonstances bien grandes la tâche s’est trouvée peu proportionnée avec ses forces.
- Lucien Bonaparte, prince de Canino et Musignano (1775-1840)
Beaucoup d’esprit, des connaissances, et beaucoup de caractère… ornement de toute assemblée politique.
- Elisa Bonaparte, princesse de Lucques et Piombino, grande duchesse de Toscane (1777-1820)
Maîtresse femme, elle avait de nobles qualités, un esprit recommandable et une activité prodigieuse, connaissant les affaires de son cabinet aussi bien qu’eût pu le faire le plus habile diplomate. Il n’y a pas eu d’intimité entre nous, nos caractères s’y opposaient.
- Louis Bonaparte, roi de Hollande (1778-1846)
Il a de l’esprit et n’est point méchant, mais avec ces qualités un homme peut faire bien des sottises et causer bien du mal. Dès son arrivée en Hollande, il n’imaginait rien de beau comme de faire dire qu’il n’était plus qu’un bon Hollandais. Jamais un homme ne s’égara plus complètement avec de bonnes intentions ; jamais l’honnêteté sans intelligence ne fit plus de mal.
Défenseur des intérêts matériels, Louis laissa par son départ un prétexte à bien des mécontentements, et sa révolte de 1810 servit en 1814 d’exemple et d’excuse aux passions égoïstes.
Quand il était petit, il faisait des vers. Mais, pour Dieu, pourquoi les fait-il imprimer ? Il faut avoir le diable au corps !
- Pauline Bonaparte, princesse Borghese (1780-1825)
Pauline était trop prodigue ; elle avait trop d’abandon. Elle aurait dû être immensément riche par tout ce que je lui ai donné ; mais elle donnait tout à son tour, et sa mère la sermonnait souvent à cet égard, lui prédisant qu’elle pourrait mourir à l’hôpital.
- Caroline Bonaparte, reine de Naples (1782-1839)
Dans sa petite enfance, on la regardait comme la sotte et la cendrillon de la famille ; mais elle en a bien rappelé ; elle a été une très belle femme et elle devenue très capable.
La reine de Naples s’était beaucoup formée dans les évènements. Il y avait chez elle de l’étoffe, beaucoup de caractère et une ambition désordonnée.
- Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie (1784-1860)
Jerôme en mûrissant, eût été propre à gouverner ; je découvrais en lui de véritables espérances.
- Joséphine, impératrice des Français (1763-1814)
Un fils de Joséphine m’eût été nécessaire et m’eût rendu heureux non seulement comme résultat politique, mais comme douceur domestique.
Joséphine faisait des dettes que j’étais obligé de payer. Je ne l’aurais jamais quitté si elle avait pu avoir un enfant.
Joséphine avait donné le bonheur à son mari et s’était constamment montrée son amie le plus tendre, professant – à tout moment et en toute occasion – la soumission, le dévouement et la complaisance la plus absolue.
- Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie, prince (1781-1824)
Eugène est une tête carrée, un administrateur habile, c’est un homme de mérite supérieur, mais ce n’est pas un homme de génie. Il n’a pas ce caractère qui distingue les grands hommes.
- Marie-Louise d’Autriche, impératrice des Français (1791-1847)
Le mariage avec une Autrichienne, ce que les meilleures têtes considéraient comme le chef-d’oeuvre de ma politique, m’a précipité du trône. J’ai posé le pied sur un abîme recouvert de fleurs.
C’est une bonne petite femme timide qui avait toujours peur en se voyant au milieu des Français qui avait assassiné sa tante.
- Napoléon II, empereur des Français (1811-1832)
Je l’envie ! La gloire l’attend, alors que j’ai dû courir après elle. Pour saisir le monde il n’aura qu’à tendre les bras. J’aurais été Philippe, il sera Alexandre.
Je préférerais qu’on egorge mon fils plutôt de le voir jamais élevé comme un prince autrichien.
août 25, 2007
LES MARECHAUX D’EMPIRE PAR L’EMPEREUR NAPOLEON 1er
Ces gens-là [les maréchaux] n’ont ni coeur ni entrailles ; je suis moins vaincu par la fortune que par l’égoïsme et l’ingratitude de mes frères d’armes.
- Charles Pierre François Augereau, duc de Castiglione (1757-1816)
Jadis il était brave. Je n’oublierai jamais l’affaire de Castiglione. Son courage, ses vertus premières l’avaient élevé très haut hors de la foule. Les honneurs, les dignités, la fortune l’y avaient replongé.
Il a vieilli vingt ans sous mes ordres, il n’a plus la même ardeur ; d’ailleurs il a eu des moyens militaires, mais jamais de génie ni d’éducation… Le vainqueur de Castiglione eût pu laisser un nom cher à la France ; mais elle réprouvera la mémoire du défectionnaire de Lyon, dont la trahison a fait tant de mal à la patrie.
Sa taille, ses manières, ses paroles lui donnaient l’air d’un bravache, ce qu’il était bien loin d’être quand une fois il se trouva gorgé d’honneurs et de richesses.
- Jean-Baptiste Jules Bernadotte, prince de Pontecorvo (1763-1844)
C’est lui qui a donné à nos ennemis la clef de notre politique, la tactique de nos armées ; c’est lui qui a montré le chemin du sol sacré. Vraiment dirait-il pour excuse qu’en acceptant le trône de Suède, il n’a plus dû n’être que suédois, excuse banale, bonne tout au plus pour la multitude et le vulgaire des ambitieux. Pour prendre femme on ne renonce point à sa mère, encore moins est-on tenu de lui percer le sein et de lui déchirer les entrailles.
Si une nation acceptait un Français qui s’est fait étranger, qui est venu les armes à la main envahir son pays avec les hordes du Nord, ce serait se déshonorer. Le destin, il faut l’espérer, n’a pas réservé une telle honte à la France ! Un Français qui doit la gloire qu’il s’est acquise, la réputation qui l’a porté sur la première marche du trône, au courage et à la valeur de ses compatriotes, ce Français, qui a oublié qu’il est né sur cette terre des braves et qui vient pour asservir, celui-là ne peut espérer commander à la grande nation ; son nom seul doit faire bouillonner le sang de tout ce qui est français.
Il était suédois en quelque sorte et n’a jamais promis que ce qu’il avait l’intention de tenir. Je puis l’accuser d’ingratitude, non de trahison.
- Louis-Alexandre Berthier, prince-souverain de Neuchâtel et de Vallengin, prince de Wagram (1753-1815)
En vérité, je ne puis comprendre comment il a pu s’établir entre Berthier et moi une relation qui ait quelque apparence d’amitié. Je ne m’amuse guère aux sentiments inutiles, et Berthier était si médiocre que je ne sais pourquoi je m’amusais à l’aimer. Et cependant, au fond, quand rien ne m’en détourne, je crois que je ne suis pas tout à fait sans quelque penchant pour lui.
Il y a des hommes que la nature a marqués pour les postes subordonnés. Tel était Berthier ! Il n’y avait pas au monde meilleur chef d’état major, mais, changé son état, il ne pouvait commander à cinq cents hommes.
- Jean-Baptiste Bessières, duc d’Istrie (1768-1813)
Ce maréchal, qu’on peut à juste titre nommer brave et juste, était recommandable autant par son coup d’oeil militaire et par sa grande expérience de l’arme de la cavalerie que par ses qualités civiles et son attachement à l’empereur.
Le duc d’Istrie est mort de la plus belle mort, sans souffrir. Il laisse une réputation sans tache : c’est le plus bel héritage qu’il ait pu laisser à ses enfants.
Bessières a vécu comme Bayard et il est mort comme Turenne.
Les hommes de 1815 n’étaient pas les mêmes que ceux de 1792. Les généraux craignaient tout… J’aurai eu besoin d’un commandant de la garde ; si j’avais eu Bessières à Waterloo, ma garde aurait décidé de la victoire. Il était d’une bravoure froide, calme au milieu du feu ; il avait de très bons yeux, il était fort habile aux manoeuvres de cavalerie. Plein de vigueur mais prudent et circonspect. On le verra dans toutes les grandes batailles rendre les plus grands services. Il avait en moins ce que Murat avait en trop.
- Guillaume Marie-Anne Brune, comte d’Empire (1763-1815)
Il s’est perdu dans mon esprit à cause de sa conduite avec le roi de Suède dans les affaires de Stralsund. Un maréchal de France valait un roi de Suède ! Je rends justice au maréchal Brune, il a bien fait en Hollande ; la bataille d’Alkemaar a sauvé la République d’un grand péril.
- Louis Nicolas Davout, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl (1770-1823)
La conduite du maréchal prince d’Eckmühl avait été pure et les mémoires qu’il avait publiés convenables.
- Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833)
En voilà un que j’ai fort maltraité assurément. Rien de plus naturel sans doute que de penser qu’il eût dû m’en vouloir beaucoup. Eh bien, j’ai appris avec un plaisir qu’après ma chute il est demeuré constamment très bien. Il a montré là cette élévation d’âme qui honore et classe les gens. Du reste, c’est un vrai patriote ; c’est une réponse à bien des choses.
- François-Christophe Kellermann, duc de Valmy (1735-1820)
Kellermann était un brave soldat, extrêmement actif, avait beaucoup de bonnes qualités, mais il était tout à fait privé des moyens nécessaires pour la direction en chef d’une armée. Il ne fit dans la conduite de cette guerre d’Italie que des fautes.
- Jean Lannes, duc de Montebello (1769-1809)
Je perds le général le plus distingué de mes armées, celui que je considérais comme mon meilleur ami ; ses enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection.
L’un des militaires les plus distingués qu’a eus la France ! Chez Lannes, le courage l’emportait d’abord sur l’esprit, mais l’esprit montait chaque jour pour se mettre en équilibre. Je l’avais pris pygmée, je l’ai perdu géant… Un des hommes au monde sur lesquels je pouvais le plus compter.
- François Joseph Lefebvre, duc de Dantzig (1755-1820)
Au siège de Dantzig, il m’écrivait d’abord que des sottises; mais, lorsque les Russes débarquèrent, il se trouva dans son élément et ses rapports devinrent ceux d’un homme qui voit bien.
Lefebvre est cause de la victoire de Fleurus. C’est un bien brave homme qui ne s’occupe pas des grands mouvements qui s’opèrent à sa droite et à sa gauche ; il ne songe qu’à bien se battre. Il n’a pas peur de mourir. C’est bien ! Mais parfois, ces gens là se trouvent dans une position aventurée, entourés de tous côtés, alors ils capitulent, et après, ils deviennent lâches pour toujours.
- André Masséna, duc de Rivoli , prince d’Essling (1758-1817)
Masséna, d’un rare courage et d’une tenacité si remarquable, dont le talent croissait par l’excès du péril et qui, vaincu, était toujours prêt à recommencer comme s’il eût été vainqueur.
C’eût été un grand homme si ses qualités brillantes n’eussent été ternies par l’avarice… C’est Masséna qui a fait les plus grandes choses, quoique sa capitulation de Gênes, dont la défense lui fait un si grand honneur dans le public, soit sa plus grande faute.
Masséna avait été un homme très supérieur qui, par un privilège très particulier, ne possédait l’équilibre tant désiré qu’au milieu du feu ; il lui naissait au milieu du danger.
- Bon Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano (1754-1842)
Moncey est un honnête homme.
- Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier, duc de Trévise (1768-1835)
Mortier m’a fait du mal en quittant le commandement de la Garde à Beaumont pendant la campagne de Waterloo ; il connaissait tout ce corps. Ce sera sûrement la faute de Mortier, à qui l’on aura écrit de Paris que le Corps législatif conspirait.
- Joachim Murat, grand-duc de Berg et de Clèves, roi de Naples et des Deux-Siciles (1767-1815)
Le roi de Naples était vraiment sublime au feu, le meilleur officier de cavalerie au monde. Au combat c’était un « césar », mais, hors de là, « presqu’une femme »… Murat avait un très grand courage et fort peu d’esprit. La trop grande différence entre ces deux qualités l’explique en entier.
A Waterloo, je manquai d’un général pour mener toute ma cavalerie ; si j’avais eu Murat, j’aurai gagné la bataille.
Murat et Ney étaient les hommes les plus braves que j’aie jamais vus. Cependant Murat avait un caractère plus noble que Ney. Murat était généreux et franc ; Ney tenait de la canaille. Mais, chose étrange, quoique Murat m’aimât, il m’a fait plus de mal que qui que ce soit au monde…
Sa mort a été un assassinat car il était bien roi, ayant été reconnu par toutes les puissances.
Ce qui m’a porté le dernier coup, c’est d’avoir fait Murat roi de Naples.
- Michel Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa (1769-1815)
Il est aussi faible qu’il est brave et son excessive ambition donne prise sur lui. Ney est le plus brave des hommes, mais là se bornent toutes ses facultés.
Il y avait en lui une disposition ingrate et factieuse et, si je devais mourir de la main d’un maréchal, il y a à parier que ce serait de la sienne.
Ney n’a eu que ce qu’il méritait ! Je le regrette comme un homme précieux sur le champ de bataille, mais il était trop immoral et trop bête pour réussir.
- Catherine-Dominique Perignon, comte d’Empire (1754-1818)
…
- Jean Mathieu Philibert Sérurier, comte d’Empire (1742-1819)
Sérurier avait conservé toutes les formes et la rigidité d’un major. Il était fort sévère sur la discipline et passait pour un aristocrate… Il était brave, intrépide de sa personne, mais pas heureux. Il avait moins d’allant que les précédents [généraux Masséna et Augereau], mais il les dépassait par la moralité de son caractère et la sagesse de ses opinions politiques.
- Nicolas Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie (1769-1851)
Soult ne m’a pas servi à Waterloo autant qu’il eût été nécessaire. Son état-major, malgré tous mes ordres, n’était pas bien organisé. Berthier eût mieux fait.
Soult avait ses qualités et ses défauts : toute sa campagne du Midi de la France a été très belle et, ce qu’on aura de la peine à croire, c’est avec son attitude et sa tenue qui indiquent un grand caractère.
- Claude Victor-Perrin dit Victor, duc de Bellune (1764-1841)
Victor est meilleur qu’on ne suppose. Au passage de la Berezina, il avait tiré très bon parti de son corps.
- Etienne Jacques Joseph Macdonald, duc de Tarente (1765-1840)
Il ne m’aime pas, mais c’est un homme d’honneur qui a des sentiments élevés et sur lequel je peux, je crois, pouvoir compter.
- Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse (1774-1852)
Il était le plus médiocre des généraux ; je l’ai soutenu, défendu contre tous parce que je lui croyais de l’honneur. Elevé dans mon camp, nourri dans ma maison, marié par moi, comblé de faveurs, de richesses, devenu un des hommes les plus marquants de la France, au moins un des plus élevés en dignité, son ambition lui a fait rêver qu’il pouvait s’élever encore ; il a oublié sous quel drapeau il a obtenu tous ses grades, sous quel toit il a passé sa jeunesse ; il a oublié qu’il doit tous ses honneurs au prestige de cette cocarde nationale qu’il foule aux pieds pour se parer du signe des traîtres qu’il a combattu pendant vingt-cinq ans !… Voilà le sort des souverains : ils font des ingrats !
- Nicolas-Charles-Marie Oudinot, duc de Reggio (1767-1847)
C’est un général éprouvé dans cent combats, où il a montré autant d’intrépidité que de savoir.
Ce maréchal avait, pour son malheur, épousé une demoiselle de Couchy ; cette jeune femme le dominait entièrement et était dans le camp royaliste ; sa mauvaise conduite, ses propos en 1814, indisposèrent les Lorrains à tel point qu’il leur était devenu en horreur ; on ne l’appelait que « traître ».
- Louis Gabriel Suchet, duc d’Albufera (1770-1826)
C’est un homme qui, s’il était venu près de moi à Waterloo, aurait de suite tout compris… Si j’avais eu Suchet à la place de Grouchy, je n’aurais pas perdu Waterloo.
- Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, comte d’Empire (1764-1830)
Mon tort est d’avoir employé Saint-Cyr ; il ne va pas au feu, ne visite rien, laisse battre ses camarades et aurait pu secourir Vandamme.
- Józef Antoni Poniatowski, Prince de Pologne et du Saint Empire romain germanique, Généralissime des Polonais (1763-1813)
Le vrai roi de la Pologne, c’était Poniatowski : il réunissait tous les titres, et il en avait tous les talents.
Il était un homme de noble caractère, rempli d’honneur et de bravoure. J’avais l’intention de le faire roi de Pologne si mon expédition de Russie était heureuse.
- Emmanuel de Grouchy, comte d’Empire (1766-1847)
La conduite du maréchal Grouchy, qui s’était distingué si souvent depuis vingt-cinq ans à la tête de la cavalerie, était aussi imprévisible que si, sur sa route, son armée eut éprouvé un tremblement de terre qui l’eût engloutie.
Non, non, Grouchy n’a pas agi [à Waterloo] avec l’intention de trahir, mais il a manqué d’énergie. Il y a eu aussi de la trahison parmi l’état-major. Cependant je n’en suis pas certain, n’ayant jamais revu Grouchy depuis lors.
août 23, 2007
DOMINIQUE DE VILLEPIN ET NAPOLEON – LE SOLEIL NOIR DE LA PUISSANCE…
…OU LE COMBLE DE L’INDECENCE.
A la guerre comme en politique, le moment perdu ne revient plus…
Après s’être pris niaisement les pieds dans le dossier du CPE, réformette pourtant sans portée sur le fond, Dominique de Villepin –Père Joseph déclassé d’un pathétique chef d’Etat- voyait subitement son étoile pâlir, et son pseudo destin présidentiel se dissiper tel un songe léger. Il semblait déjà alors se résigner à reprendre la plume, seule échappatoire pour conserver l’illusion d’exister dans le petit monde médiatique, voire de rêver à un plus qu’hypothétique come-back dans l’arène politique.
C’était d’autant plus sa seule issue que les échecs répétés de la « Camarilla » chiraquienne pour éliminer son rival de la course à la Présidence allait vite sonner le glas des derniers espoirs de ce drole de zozo de Galouzeau. Nicolas Sarkozy, en vraie bête politique, avait toujours été prompt à parer chacun des coups élyséens, depuis 2002, retournant même contre son bînome adverse le plus tordu et dangereux de tous, celui de l’affaire des faux listings Clearstream.
Et la rumeur en provenance de l’Hôtel Matignon semblait donc indiquer en ce début de crépuscule de la Chiraquie, que le Dominique de Villepin « écrivain » avait soudainement un retour de flamme napoléonien. Il était très curieusement redevenu féru de l’Empereur après une facheuse éclipse de cinq ans, manquant quelques bicentenaires napoléoniens au passage, et pas des moindres.
Cela devait me faire sourire sur l’instant de savoir Villepin de nouveau « en phase » avec Napoléon, moi qui avais été aux premières loges pour voir à quel point cet hypocrite n’en avait cure quand il s’imaginait encore en piste pour l’Elysée. Je lui sais « gré » de m’avoir permis de goûter aux délices de la technocratie française qu’il incarne si bien jusqu’à la caricature. Lui et ses conseillers m’avaient en effet trimballé pendant plus de dix-huit mois sur un projet dont j’ai la vanité de croire qu’il aura un autre impact au final qu’un énième bouquin verbeux d’un « has been » de la politique.
L’annonce de nouveaux écrits de Dominique de Villepin sur Napoléon Bonaparte est à mes yeux plus qu’une mauvaise plaisanterie, c’est une grossière provocation, des plus indécentes. Avec son Soleil Noir de la Puissance, il essaye de nous rejouer le néo-romantique napoléonien de 2001. Lors de sa petite traversée du désert auprès de Chirac, il s’était alors refait une santé politique avec son essai sur les Cent Jours. Joli coup médiatique qui, bien avant son discours de l’ONU, l’avait remis en selle. Le succès de l’ouvrage avait alors presque fait oublier le désastreux effet de l’abracadantesque dissolution de 1997.
Lors de la publication de ses Cent Jours ou l’Esprit de Sacrifice, nous pouvions lui accorder le bénéfice du doute, sans pour autant occulter son comportement pusillanime face à son maître et mentor Jacques Chirac, radical-socialiste déguisé en gaulliste, et haissant Napoléon.
Mais là, en 2007, comment ose t-il se représenter devant les vrais amateurs et connaisseurs de l’épopée napoléonienne avec le lourd passif de son gouvernement sur l’Empereur, véritable paria de la République depuis plus de trente ans. Il est incontestable que Villepin s’est plus que désintéressé de Napoléon alors qu’il était au sommet de l’Etat et disposait de moyens d’actions innombrables.
Il n’a cessé d’éluder Napoléon et le Premier Empire, poursuivant même cette politique de repentance masochiste des socialistes et des chiraquiens. Rappelons-nous qu’il a poussé le vice jusqu’à envoyer un porte-avions afin de fêter avec les anglais la défaite de Trafalgar. Par contre, le 2 décembre 2005, son planning lui faisait préférer la visite d’une ANPE à un déplacement sur le champ de bataille d’Austerlitz, où était organisée une reconstitution à la hauteur de l’évènement historique. Elle exigeait pourtant la présence d’au moins une des deux têtes de l’Exécutif français.
Tous les admirateurs de Napoléon Bonaparte ne doivent faire en aucun cas abstraction de cette succession de rendez-vous ratés. Villepin ne fait appel à Napoléon que lorsqu’il est dans la panade, voire comme aujourd’hui dans les abymes politiques et judiciaires. Il n’a, au fond, jamais assumé pleinement sa passion réelle ou feinte pour le personnage, et s’est surtout bien gardé d’agir concrètement pour la défense du patrimoine napoléonien. Et pourtant, l’épopée impériale et Napoléon sont encore bien souvent à l’origine du prestige de la France à l’étranger.
Il faut donc bien lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu’il n’a plus aucune légitimité politique, historique, et même littéraire pour nous imposer sa prose sur Napoléon Bonaparte. Les livres de valeurs sur le Grand Homme ne manquent pas, qu’il s’agisse des historiens les plus éminents (Frédéric Masson, Jean Tulard), ou de vrais écrivains (Chateaubriand, Stendhal, Léon Bloy).
L’ouvrage de Dominique de Villepin ne rejoindra pas ma bibliothèque napoléonienne. C’est une évidence qu’il n’y a nullement sa place. Je pense que nous serons d’ailleurs nombreux, parmi les passionnés de l’Empire ayant lu Les Cent Jours et l’Esprit de Sacrifice, à faire cette fois sciemment l’impasse sur son nouvel essai et ceux qu’il pourrait encore avoir l’impudence de faire paraître plus tard.
Que Dominique de Villepin abandonne Napoléon aux napoléoniens et aux bonapartistes. Et en attendant de reprendre ses vers de mirliton, qu’il aille donc dédicacer son Soleil Noir de la Puissance dans les ANPE de France et de Navarre pour finir glorieusement dans celle de son arrondissement, le 2 décembre. Enfin, si l’affaire Clearstream lui en laisse le temps bien sûr. :)
août 22, 2007
LES REFUGIES DE LA GORGONA – NAPOLEON BONAPARTE
Je m’étais embarqué à Livourne pour me rendre en Espagne lorsque les vents contraires nous obligèrent de relâcher à la Gorgona. La Gorgona est un rocher escarpé qui peut avoir une demi-lieue de circuit. Il n’y avait aucun bon refuge mais, dans la nécessité où nous étions, nous fîmes comme nous pûmes, vu que notre navire faisait eau de plusieurs côtés.
Il est peu de situations aussi pittoresques que la position de cette île, éloignée de toute terre par des bras de mer immenses, environnée de rochers contre lesquels les vagues se brisent avec fureur. Elle est quelquefois le refuge du pâle matelot contre les tempêtes, mais plus souvent la Gorgona n’est pour eux q’un écueil où bien des navires ont souvent fait naufrage.
Fatigué des tempêtes que nous avions essuyées, je débarquai aussitôt avec des matelots. Ils n’avaient jamais vu cette île et ne savaient pas si elle était habitée. Arrivés à terre, j’emploie le peu de force qui me restait à la parcourir et ne tardai pas à me convaincre que jamais créature humaine n’avait habité un si stérile séjour. Je me trompais toutefois et je revins de mon erreur lorsque j’entrevis des pans de murailles demi-ruinées par le temps. Ils paraissaient avoir été bâtis depuis plusieurs siècles. Le lierre et d’autres arbrisseaux de cette espèce avaient tellement crû à leur abri qu’il était difficile d’apercevoir les pierres.
Je fis dresser une tente dans cette enceinte où avaient été jadis des maisons, pour pouvoir y passer la nuit. Les matelots couchèrent à bord et je me trouvai seul dans cette région. Cette idée m’occupa assez agréablement pendant une partie de la soirée. Je me trouvais, je puis le dire, dans un petit monde où bien certainement il y avait de quoi pourvoir à mon entretien, à l’abri des séductions des hommes, de leurs jeux ambitieux, de leurs passions éphémères. A quoi ne tenait-il que je n’y vécusse sinon heureux, du moins sage et tranquille ?…
Je m’endormis dans ces idées et l’on peut croire que je m’égalai plusieurs fois à Robinson Crusoé. Comme lui j’étais roi de mon île. Je n’avais pas encore achevé on premier somme quand la clarté d’un flambeau et des cris de surprise me réveillèrent. Mon étonnement se changea en crainte quand j’entendis que l’on criait en langue italienne : «Malheureux ! tu périras…»
Je n’avais pour toute arme que ma canne. Je l’empoigne en me jetant en bas de mon matelas. Je cherchais la porte que je trouvais embarrassée. Je réfléchissais au parti que je devais prendre lorsqu’on mit le feu à la tente en s’écriant : «Ainsi périssent tous les hommes !» L’accent avec lequel était prononcée cette horrible imprécation me glaça d’épouvante. Je me fis courage cependant et, demi étouffé par les tourbillons de fumée, je parvins à me débarrasser et à me mettre hors d’atteinte du feu. Je cherchai alors le lâche ennemi qui m’avait voulu sacrifier aussi inhumainement, mais je ne vis personne et n’entendis aucun bruit. Que l’on se figure ma situation !
Le coeur encore saisi du danger auquel je venais d’échapper…, alarmé de ceux que je pouvais encore courir et que je ne pouvais prévoir…, nu, exposé à un vent des plus violents, les maux de ma situation étaient encore augmentés par le mugissement des vagues et l’obscurité de la nuit. Je voyais, à la lueur de la flamme qui consumait mon habitation, les ruines où j’avais assis ma demeure. Elles semblaient me dire que tout périt dans la nature et qu’il fallait que je périsse.
… Je ne restai pas un quart d’heure dans cette situation que j’entendis du bruit et, un moment après, je vis arriver deux hommes. Je l’avoue, sans armes, je me cachai derrière la demeure en attendant que je pusse comprendre pourquoi ils étaient si cruels, car je ne pouvais m’imaginer qu’ils fussent si animés contre les hommes sans quelque forte raison.
Quel fut mon étonnement quand les paroles suivantes frappèrent mes oreilles :
«Ma fille, sur le bord de sa tombe, tu as livré ton père aux cuisants remords. O Dieu ! entends les gémissements de cette déplorable victime. Il invoque l’Eternel qui, depuis tant d’années, soutient notre vie. Ma fille, qu’as-tu fait ? Peut-être as-tu immolé aux mânes de nos compatriotes un compatriote même. Peut-être est-ce un de ces Anglais vertueux qui protègent encore nos fugitifs citoyens… Non ! non ! mon âme ne peut y survivre. J’ai supporté les malheurs de ma patrie, ceux de ma famille, les miens, tant que l’innocence a régné dans mon coeur, mais ces cheveux blancs souillés par le crime… Adieu, ma fille… J’expie ton crime. Oui, flammes ardentes, purifiez… Ma fille, je te pardonne. Vis pour me venger et ne pardonne jamais aux tyrans de la patrie… Impute-leur jusqu’à ce nouveau crime. Impute-leur la mort de ton père».
Ce discours me fit renaître… De pareilles situations sont difficiles à peindre… Je me précipite aux pieds du vertueux vieillard. «Oui, mon père, lui dis-je, je suis Anglais et Anglais de vos amis. Ce que je viens d’entendre me console de l’accident malheureux qui a failli me coûter la vie». Après l’expression d’allégresse, le vieillard me conduisit dans la caverne qu’il habitait : «Sois bienvenu, Anglais. Vous régnez ici. La vertu a le droit d’être vénérée en tous lieux». Je ne finirais jamais si je voulais rapporter tous les récits que nous tînmes. Je lui demandai le récit des événements qui l’avaient porté à fuir la société de l’homme et il commença en ces termes :
«J’ai puisé la vie en Corse et avec elle un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance. Nous languissions alors dans les chaînes des Génois. Agé encore que de vingt ans, je déployai le premier l’étendard de la liberté et mon bras jeune et désespéré remporta sur les tyrans des avantages que mes compatriotes chantaient encore il y a dix ans… Quelques années après, nos tyrans appelèrent à leur secours les Allemands. Qu’avions-nous fait aux Allemands pour qu’ils vinssent nous faire la guerre ? Ils en furent la dupe toutefois et nous vîmes plusieurs fois l’aigle impériale fuir devant nos agiles montagnards… Les méchants dans ce monde ont des amis et les Français vinrent à leur secours. Les Français après avoir été battus nous battirent. Les plaines et les villes se soumirent. Pour moi, je me réfugiais avec ceux de mes compagnons qui avaient juré de ne pas survivre à la liberté de la patrie.
«Après diverses vicissitudes, Paoli di Rostino fut fait premier magistrat et général. Nous chassâmes nos tyrans. Nous étions libres, nous étions heureux, losque les Français, que l’on dit être ennemis des hommes libres, vinrent armés du fer et du flambeau et, en deux ans, contraignirent Paoli de s’en aller et la nation à se soumettre. Quant à moi, avec mes amis et parents nous soutînmes la guerre pendant huit ans. Je vis, pendant cet intervalle, quarante de mes compagnons terminer leur vie par le supplice du criminel. Un jour que nous résolûmes de nous venger, nous descendîmes près de soixante – c’était le triste reste des défenseurs de la liberté ! Dans les plaines nous prîmes plus de cent Français. Nous les conduisions à notre demeure lorsque nous fûmes avertis que les tyrans s’en étaient emparés. Je quittai mes gens pour voler au secours de mon infortuné père que je trouvai nageant dans son sang. Il n’eut que la force de me dire : «Mon fils, venge-moi. C’est la première loi de la nature. Meurs comme moi, n’importe, mais ne reconnais jamais les Français pour maîtres». Je continuais mon chemin pour aller savoir des nouvelles de ma mère lorsque je trouvai son corps nu, chargé de blessures et dans la posture la plus révoltante. Ma femme, trois de mes frères avaient été pendus sur les lieux mêmes. Sept de mes fils, dont trois ne passaient pas cinq ans, avaient eu le même sort. Nos cabanes étaient brûlées, le sang de nos brebis était confondu avec celui de mes parents. Je cherchais ma fille et ne la trouvai pas ; furieux, égaré, transporté par la rage, je voulais voler mourir par les coups de ces brigands qui avaient fait périr tous les miens. Retenu cependant par mes compagnons, nous enterrâmes tous les corps de nos infortunés parents et nous résolûmes… O Dieu ! que ne résolûmes-nous pas !… Mais enfin nous prîmes le parti de quitter une île proscrite où des tigres régnaient. Notre bâtiment débarque à la Gorgona. Je trouvai le paysage conforme à mon humeur et j’y restai. Je ne gardai que trois fusils et quatre barils de poudre. Mes compagnons continuèrent leur cours vers l’Italie. Je vis partir le navire sans chagrin. J’avais des nourritures pour trois jours. Je sais qu’il est peu d’endroits sur la terre où il n’y ait de quoi nourrir l’homme. Les bâtiments où vous étiez sont les ruines d’un ancien monastère et la citerne existe encore. Les poissons et les insectes de la mer, les glands des chênes verts que vous voyez me servent de nourriture. Je me regarde ici comme le dictateur d’une république. Les oiseaux sont nombreux sur ces rochers, mais je n’en tue jamais. Ce sont mes sujets. Mais comment pourrais-je en tuer puisque je n’en vois jamais ?… Les malheurs qui ont empoisonné mes jours m’ont rendu la clarté du soleil importune. Il ne luit jamais pour moi. Je ne respire l’air que la nuit et mes regrets ne sont pas renouvelés par l’aspect des montagnes où vécurent mes ancêtres. La petite forêt de pins que vous voyez ici à côté nous donne du bois plus que nous n’en avons besoin et ce bois nous éclaire.
«C’est à la lueur de ces flambeaux que nous vivons. Nos courses, nos pêches sont éclairées par cet astre, qui, s’il n’est pas aussi brillant que le vôtre, n’éclaire du moins que des actions justes.
«Je passai une année sans aucun événement, lorsque environ à cette heure-ci, un jour, dans le mois de décembre, j’aperçus du côté de la citerne des feux qui m’annonçaient l’arrivée de quelques hommes. Je me glissai avec le moins de bruit qu’il me fut possible et je vis sept Turcs qui tenaient trois hommes enchaînés. Je les vis les délier, en tuer un, et donner la liberté aux autres en ne leur donnant aucune nourriture. Après cet événement, ils se rembarquèrent. Quand je me fus assuré que les deux nouveaux débarquants n’étaient pas Français, je résolus de leur donner refuge. Pour cela faire, je retournai à ma demeure et allumai un grand feu. Attirés par la lueur, ils y vinrent. Quelle fut ma surprise, je reconnus ma fille. L’autre était un jeune Français. En considération de ma fille je lui accordai la vie. «Monsieur, lui dis-je, vous saurez que je suis un ennemi de votre nation, et j’ai juré sur mes autels, par le Dieu qu’ils ont outragé, de venger, de massacrer tous ceux qui tomberaient en ma puissance. je vous exempte toutefois en considération de ma fille. Cherchez une demeure dans cette île qui soit éloignée de celle-ci. Ne sortez jamais que lorsque le soleil est sur l’horizon. Je vous laisse vivre. A défaut de quoi votre mort s’ensuivrait». Trois ans se passèrent ainsi sans que j’eusse eu la curiosité de voir s’il vivait toujours. J’y allai au bout de ce terme et ne trouvai aucun vestige de son corps. J’ignore ce qu’il peut être devenu. Je bénis toutefois le ciel qui m’a délivré de ce méchant homme.
«Il y a six ans que je fus réveillé par le bruit de plusieurs coups de canon et de mousqueterie. Le soleil s’était levé. Je ne voulus pas, quoique j’en eusse bien envie, trahir mon serment et j’attendis la nuit. Elle n’avait pas plutôt répandu ses voiles que j’allumai un grand feu et me mis à faire la tournée de mon royaume. Je vis sept hommes couchés à terre, étendus sur des couvertures, et quatre autres qui les soignaient. Les quatre vinrent à moi. Insensé ! je n’eus pas l’esprit de me défendre. Ils me tirèrent ma barbe, me battirent, me bafouèrent, m’appelèrent sauvage. Ils voulurent m’obliger à dire où il y avait de l’eau. Je ne voulus jamais pour les punir de leurs mauvais traitements. C’étaient d’ailleurs des Français. Ma fille qui me suit presque toujours vint bientôt. Elle ne me vit pas plutôt dans l’état où j’étais tiré qu’elle tua d’un coup de fusil deux de ces brigands. Les deux autres se sauvèrent. La frégate était à une certaine distance. Elle ne pouvait pas approcher à cause des rochers. Je leur criai de venir prendre leurs malades. Ils envoyèrent trois hommes qui vinrent à la nage. Je leur permis à tous de s’embarquer. O ingratitude affreuse ! Ils ne furent pas plutôt arrivés à leur frégate qu’ils tirèrent quelques coups de canon contre les restes des ruines qu’ils prirent pour mon habitation.
«Depuis ce temps-là, j’ai juré de nouveau sur mon autel de ne plus pardonner à aucun Français. Il y a quelques années que j’ai vu périr deux bâtiments de cette nation. Quelques bons nageurs se sauvèrent dans l’île, mais nous leur donnâmes la mort. Après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français.
«L’année passée, un des bateaux qui font la correspondance de l’île de Corse avec la France vint échouer ici. Les cris épouvantables de ces malheureux m’attendrirent. Je me suis souvent reproché cette faiblesse depuis, mais que voulez-vous, monsieur, je suis homme et avant d’avoir le coeur d’un roi ou d’un ministre, il faut bien avoir étouffé ces sentiments qui nous lient à la nature et je n’étais roi que depuis onze ans. J’allumai donc un grand feu vers l’endroit où ils pouvaient aborder et, par ce moyen, je les sauvai. Vous vous attendez peut-être que leur reconnaissance… Eh ! non ! Ces monstres, à peine arrivés ici, tranchèrent des maîtres. Deux cavaliers escortaient un criminel qu’ils laissèrent à bord. Je demandai ce qu’il avait fait. Ils me répondirent que c’était une canaille de Corse, que ces gens méritaient tous d’être pendus. Ma colère fut grande. Mais que devais-je faire ? Ils me reconnurent comme Corse et prétendirent me conduire avec eux. J’étais un coquin qu’il fallait rouer. Ils firent plus : ils m’enchaînèrent. Ils prétendaient que l’on avait promis une récompense pour ceux qui me livreraient. J’étais perdu. J’allais expier par les supplices ma fâcheuse mollesse. Mes ancêtres irrités se vengeaient de ce que j’avais trahi la vengeance due à leurs mânes… Cependant le ciel, qui connaissait mon repentir, me sauva. Le bâtiment fut retenu sept jours. Au bout de ce terme, ils manquèrent d’eau. Il fallait savoir où l’on pourrait en puiser. Il fallut me promettre la liberté. L’on me délia. Je profitai de ce moment et j’enfonçai le stylet de la vengeance dans le coeur de deux de ces perfides. Je vis alors pour la première fois l’astre de la nature. Que sa splendeur me parut brillante mais, ô Dieu ! comment pouvait-il contempler de pareilles trahisons !
«Cependant ma fille était à bord, garrottée ainsi que je l’avais été. Heureusement que ces hommes brutaux ne s’étaient pas aperçus de son sexe. Il fallait aviser au moyen de la délivrer. Après y avoir longtemps rêvé, je me revêtis de l’habit d’un des soldats que j’avais tués. Armé de deux pistolets que je trouvai sur lui, de son sabre, de mes quatre stylets, j’arrivai au bâtiment. Le patron et un mousse furent les premiers qui sentirent le glaive de mon indignation. Les autres tombèrent également sous les coups de ma fureur. Je recueillis tous les meubles qui pouvaient appartenir à l’équipage. Nous traînâmes leurs corps aux pieds de notre autel et là, nous les consumâmes. Ce nouvel encens parut être favorable à la divinité…»
LE MASQUE PROPHETE – NAPOLEON BONAPARTE
L’An 160 de l’hégire, Mikadi régnait à Bagdad ; ce prince, grand, généreux, éclairé, magnanime, voyait prospérer l’empire arabe dans le sein de la paix. Craint et respecté de ses voisins, il s’occupait à faire fleurir les sciences et en accélérait les progrès, lorsque la tranquillité fut troublée par Hakem, qui, du fond du Korassan, commençait à se faire des sectateurs dans toutes les parties de l’empire. Hakem, d’une haute stature, d’une éloquence mâle et emportée, se disait l’envoyé de Dieu ; il prêchait une morale pure qui plaisait à la multitude ; l’égalité des rangs, des fortunes, était le texte ordinaire de ses sermons. Le peuple se rangeait sous ses enseignes. Hakem eut une armée.
Le calife et les grands sentirent la nécessité d’étouffer dans sa naissance une insurrection si dangereuse ; mais leurs troupes furent plusieurs fois battues, et Hakem acquérait tous les jours une nouvelle prépondérance.
Cependant une maladie cruelle, suite des fatigues de la guerre, vint défigurer le visage du prophète. Ce n’était plus le plus beau des Arabes. Ses traits nobles et sévères, ses yeux grands et pleins de feu étaient défigurés ; Hakem devint aveugle. Ce changement eût pu ralentir l’enthousiasme de ses partisans. Il imagina de porter un masque d’argent.
Il parut au milieu de ses sectateurs ; Hakem n’avait rien perdu de son éloquence. Son discours avait la même force ; il leur parla, et les convainquit qu’il ne portait le masque que pour empêcher les hommes d’être éblouis par la lumière qui sortait de sa figure.
Il espérait plus que jamais dans le délire des peuples qu’il avait exaltés, lorsque la perte d’une bataille vint ruiner ses affaires, diminuer ses partisans et affaiblir leur croyance : il est assiégé, sa garnison est peu nombreuse. Hakem, il faut périr, ou tes ennemis vont s’emparer de ta personne ! Il assemble tous les sectateurs et leur dit : «Fidèles, nous que Dieu et Mahomet ont choisis pour restaurer l’empire et regrader notre nature, pourquoi le nombre de vos ennemis vous décourage-t-il ? Ecoutez ; la nuit dernière, comme vous étiez plongés dans le sommeil, je me suis prosterné et ai dit à Dieu : Mon père, tu m’as protégé pendant tant d’années ; moi ou les miens t’aurions-nous offensé, puisque tu nous abandonnes ? Un moment après, j’ai entendu une voix qui me disait : Hakem, ceux seuls qui ne t’ont pas abandonné sont tes vrais amis et seuls sont élus. Ils partageront avec toi les richesses de tes superbes ennemis. Attends la nouvelle lune, fais creuser de larges fossés, et tes ennemis viendront s’y précipiter comme des mouches étourdies par la fumée». Les fossés sont bientôt creusés, l’on en remplit un de chaux, l’on pose des cuves pleines de liqueurs spiritueuses sur le bord.
Tout cela fait, l’on sert un repas en commun, l’on boit du même vin, et tous meurent avec les mêmes symptômes. Hakem traîne leurs corps dans la chaux qui les consume, met le feu aux liqueurs et s’y précipite. Le lendemain, les troupes du calife veulent avancer, mais s’arrêtent en voyant les portes ouvertes ; l’on entre avec précaution et l’on ne trouve qu’une femme, maîtresse d’Hakem, qui lui a survécu. Telle fut la fin de Hakem, surnommé Durhaï, que ses sectateurs croient avoir été enlevé au ciel avec les siens.
Cet exemple est incroyable. Jusqu’où peut pousser la fureur de l’illustration !
août 21, 2007
LES FRERES BONELLI – BOCOGNANO
François Bonelli
François Bonelli né à Bocognano le 17 janvier 1760, était déjà capitaine depuis le 1er octobre 1790 d’une compagnie détachée dans le district d’Ajaccio lorqu’il fut élu capitaine au deuxième bataillon de volontaires corses. Il était au siège de Bastia où Lacombe Saint-Michel le fit chef du 16ème bataillon d’infanterie légère (22 avril 1794). Envoyé en Corse par Bonaparte (21 mai 1796) et chargé du commandement d’une colonne mobile du Liamone (17 octobre 1796), réformé (1er janvier 1799), envoyé à Milan au dépôt de la 22ème demi-brigade (15 avril 1799), nommé commandant auxiliaire du bataillon du Liamone (15 octobre 1799), derechef réformé (18 décembre 1799), derechef employé comme chef du premier bataillon des chasseurs du Liamone (2 septembre 1803) puis comme chef de bataillon des 2ème chasseurs du Golo (23 septembre 1805), il obtint sa pension par un décret du 28 mai 1809 et cessa d’être en activité le 30 septembre de la même année. Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur le 2 juin 1815 par le duc de Padoue et reçut de Murat « à titre de souvenir », le 23 septembre 1815, le décrèt daté de Bocognano, de sa propre maison, qui le nommait chevalier des Deux-Siciles. Il avait le 2 juin 1793 épousé Anne-Françoise Tartaroli. Sa mort survint le 13 août 1843.
Ange-Toussaint Bonelli
Angelo-Santo Bonelli, fils de Zampaglino (Ange-Mathieu Bonelli) et de Marie-Antonie Muffragi, né à Bocognano le 5 septembre 1771, soldat au régiment Royal Corse (4 février 1788), sergent-major au 2ème bataillon de volontaires corses (15 janvier 1792), sous-lieutenant au 17ème bataillon d’infanterie légère où était entrée la compagnie d’infanterie commandée par son frère François (4 mai 1793), capitaine à ce même bataillon par ordre de Lacombe Saint-Michel en remplacement de son frère François devenu lieutenant-colonel du 16ème bataillon (22 février 1794), continuant par arrêté de Saliceti et e Ritter à jouir des appointements attachés à son grade de capitaine après la suppression de la compagnie (9 février 1795), capitaine à la suite de la 16ème demi-brigade d’infanterie légère (10 juin 1795), capitaine titulaire (4 août 1795), capitaine dans la gendarmerie nationale en Corse (26 novembre 1797), adjoint à l’état-major général de l’armée d’Italie (5 décembre 1799), reçoit l’ordre de se rendre à Luxembourg pour être attaché provisoirement à la 65ème demi-brigade, mais, grace à la protection de Lucien Bonaparte, est envoyé en Corse à la suite de la 23ème demi-brigade légère (19 août 1802), devient chef du 3ème bataillon léger corse (22 novembre 1804), et passe au service de Naples dans la gendarmerie (10 mars 1806). Colonel (13 février 1813), licencié (20 mars 1815), réadmis au service de la France comme lieutenant-colonel de cavalerie en non-actyivité (18 décembre 1816), mis en retraite provisoire (1er juillet 1818) et en retraite définitive (20 septembre 1820), il commandait en 1831 les dix-sept compagnies de garde nationale qui formaient la légion de Bocognano, une des trois légions que comptait le département de la Corse.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 17, 2007
NAPOLEON BONAPARTE A AUXONNE PAR MARTINE SPERANZA* (2)
Vie Militaire
Les premiers travaux de Bonaparte sur l’artillerie datent de 1788, c’est qu’à cette époque il voulait devenir un bon artilleur. La personnalité du commandant de l’Ecole et celle du professeur de mathématiques, tous deux passionnés pour leur arme, ont sans doute fortement encouragé Bonaparte dans cette voie.
Dans ses Cahiers sur l’histoire de l’artillerie dont le premier est conservé à la Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze), il prend des notes sur les systèmes en usage au XVIIIème siècle, Vallière et Gribeauval, et sur le cours du professeur Lombard concernant l’emploi des différentes charges de poudre.
En août 1788 le baron du Teil fait des expériences sur le jet des bombes avec le canon : comment employer des bombes de différents calibres lorsqu’on n’a pas de mortiers ou des mortiers sans affûts ? Bonaparte, le plus jeune lieutenant de la commission est chargé, selon l’usage, de rédiger le procès verbal des épreuves. Pour complèter ces expériences et les pousser plus avant, il écrit lui-même en mars 1789, un mémoire sur le jet des bombes qui fit autorité quelques années plus tard et, servit à tout le corps de l’artillerie.
Le Régiment de la Fère possède à cette époque un traité de fabrication de l’artifice de guerre qui passe pour un des meilleurs traités du corps royal.
Comme le professeur Lombard dont les ouvrages sont reconnus par tous, plusieurs officiers du régiment publient sur l’artillerie. Le Chevalier du Teil, frère du baron et major du Régiment a pris une part active dans la controverse opposant les partisans de l’ancien système de Vallière et les promoteurs du nouveau système de Gribeauval, en donnant « De l’usage de l’artillerie nouvelle dans la guerre de campagne » Metz – 1778. Gassendi, capitaine détaché, fait paraître en 1789 un Aide-mémoire destiné aux officiers d’artillerie du Corps-Royal. Le chevalier d’Uturbie, chef de brigade au Régiment, rédige un Manuel de l’Artilleur, dont les nombreuses éditions ont prouvé la valeur.
Bonaparte rédige même en septembre 1788, sur la demande de ses camarades, un projet de règlement de la Constitution de la Calotte du Régiment, société formée par les lieutenants pour juger les officiers qui manquent à l’honneur. Mais il le fait avec tant de sérieux et d’un ton si grave que tous se moquent de lui.
Les Lectures – Les Ecrits
Pendant les loisirs que lui laissent ses études d’artilleur, Bonaparte s’éfforce de compléter son instruction. Enfermé dans sa chambre, il lit et ses nombreuses notes de lecture sont la preuve de son infatigable curiosité.
C’est l’histoire surtout qui l’attire : Rollin, l’abbé Marigny, Mably, Raynal, Barrow, mais aussi la géographie de Lacroix, l’Histoire Naturelle de Buffon, les tragédiens de Corneille et Racine, et des auteurs aussi variés que Bernardin de Saint-Pierre, Stevenson, Montesquieu ou Rousseau.
Il emprunte des livres et il en achète. En 1791, il demande à M. Joly libraire imprimeur à Dole de lui faire parvenir l’ouvrage de Guishardt « Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains » Lyon – 1760. Mais les deux volumes sont livrés après le départ de Bonaparte pour Valence ; ils figurent à la Bibliothèque Municipale de Dole qui les acheta sans doute au libraire.
Ces lectures inspirent à Bonaparte plusieurs nouvelles en prose : « Le Comte d’Essex » nouvelle anglaise écrite en 1789, « Le Masque Prophète » » (avril 1789) et une « Nouvelle Corse ». D’autres écrits plus politiques datent de cette période : la Dissertation sur l’autorité royale (1788) et les Lettres sur la Corse.
Il n’y a pas d’imprimeur à Auxonne. En avril 1791, Bonaparte demande à M. Joly à Dole d’imprimer cent exemplaires de sa « Lettre à Buttafoco », écrite en Corse quelques mois plus tôt. C’est un pamphlet plein d’insolence et d’ironie contre Matteo de Buttafoco, chef de file des royalistes et adversaire de Paoli, le célèbre patriote corse.
Il se rend plusieurs fois à pied à Dole pour corriger les épreuves, en compagnie de son frère Louis (récit de Joly dans sa lettre à Amanton du 14 août 1821. Bibliothèque Municipale de Dole).
Les Fréquentations
Parmi les artilleurs du Régiment de la Fère Bonaparte a de bons amis, surtout le lieutenant des Mazis qui était déjà avec lui à l’Ecole Militaire de Paris, puis à Valence. Il s’entretient volontiers avec le capitaine Gassendi, qui aime la Corse, lit Dante, Le Tasse et Rouseau et écrit des vers.
Ses liens avec le professeur Lombard qui l’a pris en amitié, lui permettent d’être reçu dans les salons d’Auxonne, chez Madame de Berbis, chez le Directeur de l’Arsenal, et chez le baron du Teil.
D’autres liens se créent avec Jean-Marin Naudin, le Commissaire de Guerres, qui a passé treize années en Corse avant de venir à Auxonne. Naudin vit séparé de sa femme dont il divorcera en 1793. Bonaparte rencontre chez lui Madame Renaud et semble avoir éprouvé de l’amitié pour elle. Jeanne Lucant avait épousé en 1775 Dominique Renaud, trésorier du Régiment de Grenoble, mais son mari l’avait abandonnée lorsque le Régiment avait quitté Auxonne. Elle divorcera en 1793 et deviendra Madame Naudin en 1798.
Chez Naudin, il rencontre André Degoy, quartier-maître du Régiment, qui avait fait campagne en Amérique, et Norbert Bersonnet agent comptable des vivres qui lui prête des livres. Souvent, il rend visite à Jean-Baptiste Lardillon, directeur de la Poste aux Lettres, pour y lire les journaux.
De Manesca Pillet, que Bonaparte aurait voulu épouser, nous n’avons trouver aucune trace.
Les Promenades
« Bonaparte vint un jour chez moi à Dole, d’Auxonne à 8 h du matin, (il était vêtu d’une carmagnole et d’un pantalon de toile blanche rayée de bleu, chapeau rond) me proposer de lui imprimer la lettre à Buttafoco… Il me demanda le jour où il devait revenir pour vérifier l’épreuve de la 1ère feuille d’impression : il dit qu’il y arriverait à 8 h du matin. Deux jours après précisément à cette heure, Bonaparte était dans ma chambre. Il lut l’épreuve sans s’asseoir et ne voulut prendre qu’un doigt de vin, malgré mes instances… Il me demanda encore le jour fixe où il devait revenir à la même heure, pour voir le reste des épreuves ; il ajouta qu’il amènerait son jeune frère qui était curieux de voir comment on imprimait… Il repartit tout de suite parce qu’il devait être présent à Auxonne à 11 h précise… » (Extrait de la lettre de Joly à Amanton – Bibliothèque municipale de Dole).
A Auxonne Bonaparte est un marcheur infatigable, l’aller et le retour à Dole dans la matinée ne l’effraye pas, même si parfois des ampoules aux pieds (lors du voyage du Creusot) l’obligent à prendre un cheval. Il devient familier de la campagne à l’entour de sa ville de garnison. Il préfère les lieux ombragés : Villers-Rotin où le Tilleul planté en 1601 à la naissance de Louis XIII a déjà presque deux cents ans ; le hameau de la Cour, à la lisière de la forêt de Crochères, où se trouve une clairière de vieux chênes ; la Levée, ce lieu de promenade favori des Auxonnais. La Chapelle de la Levée, plus tard appelée Chapelle Napoléon, est située tout près de la nouvelle route surélevée qui conduit à Auxonne, en franchissant huit ponts de pierre construits en 1739. Le bois de Boutrans la touche ; à côté coule une source d’eau très pure. En 1867 Maître Garnier notaire honoraire, fit ériger là, selon le voeu de sa fille Amélie morte en 1863, un obélisque gravé en souvenir des promenades de Bonaparte (aujourd’hui terrain privé).
Les Décors
Comme ses camarades officiers, Bonaparte prend pension chez la veuve du traiteur Dumont et mange dans la grande pièce du rez-de-chaussée qui donne sur la rue de Saône. L’inventaire après décès de Jeanne Chevalier, veuve Dumont (2 avril 1806 – Maître Caire- Archives de Maître Lagé) nous restitue le décor : la cheminée avec crémaillère et tournebroche, une grande armoire en noyer avec commode et tiroirs pour le linge de table, un placard et bureau formant une seule pièce, entre la fenêtre et la cheminée, pour la vaisselle, au mur deux miroirs à cadre doré et un Saint Suaire, au milieu de la pièce une grande table avec allonges et tréteaux, et des chaises paillées.
A partir de 1787 quatre salles de billard seulement sont autorisées à Auxonne. Les officiers y sont assidus. Celle du Sieur Bourotte est située à l’angle de la rue Chesnois et de la rue des Pelletiers. Son décor sur toile peint par Picard en 1773, était encore en place il y a peu de temps (collection particulière).
Bonaparte accompagne fréquemment M. et Mme Lombard chez M. Pillon d’Arquebouville, directeur de l’Arsenal (rue Chesnois). Le soir on joue au loto dans le grand salon au rez-de-chaussée : des tables à jouer, des fauteuils garnis de coussins, un secrétaire en noyer, une glace sur la cheminée, des rideaux de toile de coton composent l’ameublement ; à l’office six paires de flambeaux d’argent, à la cave six pièces de vin de Comté et deux cents bouteilles de vin d’extraordinaire. A l’étage se trouve l’appartement où réside l’inspecteur d’artillerie, M. de la Mortière lorsqu’il vient visiter l’Ecole d’Auxonne, et le petit salon décoré (O) (Apposition de scellés au domicile de François Laurent Pillon d’Arquebouville – 5 mars 1790).
(Extrait du catalogue réalisé par Martine Speranza à l’occasion du bicentenaire de Bonaparte à Auxonne)
* Martine Speranza est présidente de l’Association Auxonne-Patrimoine.
août 15, 2007
NAPOLEON BONAPARTE A AUXONNE PAR MARTINE SPERANZA* (1)
Auxonne, est une ancienne place forte dont le passé militaire, les fortifications, l’Arsenal et les Casernes seraient vite tombés dans l’oubli, s’ils n’avaient eu pour hôte, un jour de juin 1788, le lieutenant Napoléon Bonaparte.
Tous disent que déjà à cette époque on le remarque : c’est un jeune officier d’artillerie, fort maigre, très brun, aux yeux perçants, au visage sérieux, à l’accent légèrement italien : il est Corse, intelligent, et ambitieux. « Ce jeune homme ira loin » dit Lombard, son professeur de mathématiques, mais Bonaparte n’est encore qu’un simple lieutenant en second.
Lorsque le 18 Floréal an VIII, le Premier Consul en route pour l’Italie, s’arrête à Auxonne, il est fêté comme un héros. Le 2 décembre 1804, il devient Napoléon 1er, mais aujourd’hui à Auxonne il reste Bonaparte.
Son séjour ici comme à Valence, a fait l’objet de maints ouvrages, des plus grandes biographies aux plus mauvaises compilations ; il a fallut tous les lire et revenir aux sources, c’est à dire aux archives militaires et civiles qui permettent de redresser les erreurs des uns et vérifier le sérieux des autres ; mais rien n’est jamais terminé.
AUXONNE EN BOURGOGNE
« Auxonne, petite ville du Duché de Bourgogne, située sur la Saône qui passe à sa partie occidentale, est à 74 lieues de Paris, long. 23 d 3 ‘ 35″, lat. 47 d 11 ‘ 24″. Son territoire est plat, marécageux et argileux ; à l’occident sont de superbes prairies qui vont du nord au midi ; elles sont terrminées par de petites collines couvertes de forêts en divers endroits. La Saône coule dans la même direction et baigne les murs de la ville. A son orient sont d’excellentes terres, on y récolte des grains de toutes espèces, elles sont aussi bornées à environ une lieue et plus par des collines et des montagnes qui sont pareillement couvertes de forêts et sur lesquelles les nuées orageuses ont coutume de se diriger ». (Description topographique et médicale de la ville d’Auxonne – Par Roussel méd. adj. de l’Hôpital. 1786 ms F 502 – Archives départementales de la Saône et Loire).
La popualtion de la ville est de 3599 habitants en 1786, à cela s’ajoute le régiment d’artillerie, soit environ 1200 hommes et officiers.
Le voyageur qui passe par Auxonne, tel Arthur Young le 30 juillet 1789, voit une belle rivière et de grasses prairies, mais la réalité est un peu différente. Le climat est mauvais, la fin de l’automne et le printemps sont humides et froids, le peuple des campagnes est misérables, il ne se nourrit que de céréales et de légumes, « surtout d’une espèce de bouillie faite avec la farine de blé de Turquie appelée gaude ». La ville enfermée dans ses murs semble jouir d’une situation plus privilégiée ; la présence du régiment et de ses officiers lui procure une activité quotidienne, il n’y a pas moins de 35 cabaretiers, aubergistes, cafetiers ou traiteurs en ville en 1788. Mais de graves problème inquiètent le commandant de l’Ecole et le médecin de l’Hôpital : les casernes sont construites dans un lieu malsain, le long du fossé des fortifications, là où les eaux stagnent. Les latrines s’y diversent et c’est « le militaire si précieux à l’état, qui est la première victime de cette insalubrité » (ms Roussel -op. cit). Le canal de la petite Saône qui traverse la ville n’a pas assez de courant d’eau, les égoûts s’y déversent et répandent une odeur intolérable. Cette situation engendre des fièvres intermittentes dont Bonaparte a souffert en arrivant à Auxonne ; on compte 40 morts au Régiment entre 1788 et 1791.
La municipalité essaye, dans la mesure de ses modestes ressources, d’améliorer la vie quotidienne : le nom des rues est peint systématiquement aux angles des maisons, permettant aux soldats porteurs de billets de logement de s’orienter plus facilement ; le soir la ville est éclairée par 30 réverbères ; en 1786 le Roi donne enfin l’autorisation de démolir la tour de la Porte de France, vestige des anciennes fortifications, qui donnait à l’entrée d’Auxonne « une teinte sombre et lugubre » et causait par son étroitesse des encombrements perpétuels. Les propriétaires de maisons contribuent à l’embellissement de la ville par la construction de façades à la mode surtout dans la rue principale : on se préoccupe d’urbanisme.
Les relations entre la municipalité et le commandant de l’Ecole n’ont pas toujours été bonne et l’absence continuelle de M. de Bissy, gouverneur d’Auxonne, en est en partie responsable. Le Roi dut envoyer au baron du Teil, en 1783, un brevet l’établissant lieutenant-général, sous l’autorité du gouverneur, pour commander tant aux habitants qu’aux gens de guerre ; la situation devient meilleure avec le nouveau maire, de La Ramisse, puis son successeur Petit en 1788.
Et pourquoi ne pas rapporter pour mieux évoquer les hommes, les petits évènements qui rompent la vie monotone et réglée de la ville ? Parfois la Saône rejette le cadavre d’un soldat noyé, ainsi Jean-Baptiste Larcher dit l’Espérance trouvé mort au bas du grand pont, « vêtu d’un habit de culotte bleu uniforme d’artillerie, un gilet de coton blanc… portant cheveux noirs en queue et attachés d’un ruban noir vulgairement nommé floret… » Parfois on voit en ville une scène semblable à celle décrite par le Mercure Dijonnais en 1788 : « MM les officiers d’artillerie s’étaient mis à danser en rond l’un d’entre eux entra dans le milieu de la danse, monta sur les épaules d’un tambour et reçut sur son derrière un coup de main de chaque officier. Il remercia le tambour et lui donna douze sous ».
Ce jeu s’appelle fondre la cloche, l’officier avait manqué à une dame.
Comme partout la Révolution va tout bouleverser ; c’est l’heure des doléances, le désordre des esprits va gagner la rue. En janvier 1789 commence déjà la Révolution dont Bonaparte ne connaîtra que les prémisses à Auxonne, du 14 juillet au serment du 23 août.
LA REVOLUTION
11 et 12 juin 1788 : deux émeutes éclatent à Dijon après la « mise en vacances » du Parlement.
13 juin 1788 : 400 hommes du Régiment de la Fère arrivent à Dijon sur la demande du commandant de la province. Ils rentreront à Auxonne le 25 octobre après le retour des parlementaires.
11 juin 1789 : le Tiers-Etat auxonnais se prononce pour le vote par tête dans une assemblée de toute la nation formée des trois ordres réunis.
15 juillet 1789 : une émeute éclate à Dijon. A Auxonne, on reçoit des nouvelles alarmantes de Paris.
19 juillet et 20 juillet : à Auxonne la populace brise les barrières des octrois et pille la maison du receveur des gabelles. La bourgeoisie prend les armes pour veiller à la sureté publique. Le Régiment de la Fère intervient et le calme revient.
Fin juillet : Un régiment de garde nationale s’organise.
23 août 1789 : le Régiment de la Fère prête serment conformément aux décrets des Etats Généraux ; environ 150 artilleurs ont été répartis en détachements dans la province, à Macon, Cluny, Tournus ; chaque ville soucieuse de sa tranquillité réclame des troupes royales. Des canonniers sont envoyés à Dijon avec 4 pièces pour exercer les volontaires artilleurs.
10 décembre 1789 : le maire d’Auxonne Petit démissionne. Il est remplacé le 28 janvier 1790 par F.A. de Suremain.
27 et 28 février 1790 : la garde nationale proclame son adhésion aux décrets de l’Assemblée Nationale et invite la garnison qui avait su maintenir l’ordre « dans les temps de trouble et d’anarchie » à s’unir à elle pour défendre la tranquillité publique.
14 juin 1790 : le maire de Suremain, nommé administrateur au district, est remplacé par C. Bertrand.
14 juillet 1790 : nouvelle prestation de serment par les gardes nationaux et par le régiment, chaque officier et soldat « reçoit à la boutonnière un ruban aux couleurs de la nation ».
16 août 1790 : les cannoniers du régiment se révoltent et exigent de leur colonel la distribution de la masse noire. Un détachement de 50 hommes ne peut s’opposer à cette action. Le maire Bertrand dénonce la collusion entre les soldats insurgés et une certaine classe de citoyens.
23 janvier 1791 : l’aumonier du Régiment prête serment à la constitution civile avec 7 prêtres familiers.
20 juin 1791 : la fuite du Roi est présentée comme un enlèvement. La peur réapparaît : on fait l’inventaire des armes de l’Arsenal, on ramène en ville les armes du Polygone, on double la garde du Pont.
4 juillet 1791 : le Régiment de la Fère, devenu le 1er Régiment d’Artillerie, prête le serment conformément au décret de la Constitutante du 21 juin.
21 juillet 1791 : constitution à Auxonne d’une société populaire.
Fin 1791 : de nombreux officiers du Régiment émigrent pour constituer à l’étranger une armée destinée à délivrer le Roi : 14 capitaines et presqu’autant de lieutenants.
(Extrait du catalogue réalisé par Martine Speranza à l’occasion du bicentenaire de Bonaparte à Auxonne)
* Martine Speranza est présidente de l’Association Auxonne-Patrimoine.
août 13, 2007
LES CAHIERS D’ALEXANDRE DES MAZIS – VALENCE ET AUXONNE (2)
Le 8 septembre 1785… Buonaparte put subir au bout de la première année les examens d’élèves et d’officiers, faculté qu’avaient les élèves des écoles militaires sans passer par l’école de Metz. Il fut nommé lieutenant d’artillerie au régiment de La Fère, je me présentais en même temps que lui, mais à ma seconde année.
Nous partîmes de l’Ecole militaire à 11 heures du soir pour rejoindre notre régiment à Valence, un sous-officier nous conduisit à la diligence. Le lendemain matin, lorsque nous pûmes marcher, nous mîmes pied à terre pour monter une côte rapide, sa première exclamation fût : « Enfin, je suis libre ». Et il se mit à courir comme un fou, sautant, gesticulant, et respirant ce premier air de liberté.
A Lyon, ayant manqué la diligence, nous fûmes obligés d’y rester un jour et, oubliant toute prévoyance, nous dépensâmes en achat de livres le peu d’argent que nous avions. Nous aurions été fort embarrassés pour rejoindre notre garnison si un officier d’artillerie, avec lequel nous avions voyagé, voyant notre embarras, ne nous eût pas offert sa bourse.
Buonaparte fut placé dans la compagnie de Bombarbiers de Monsieur de Coquebert. Mon frère aîné, qui était déjà capitaine au régiment de la Fère, nous reçut à notre arrivée et accueillit Buonaparte d’autant mieux que son frère, Joseph, sachant qu’il était placé dans le même régiment que moi, avait écrit à mon frère pour le prier d »être son mentor. Mais loin de là. Buonaparte fut fort choqué de la recommandation… disant qu’il n’avait pas besoin d’être mis sous tutelle.
Bien que mon frère déclinât au plus vite la mission qui lui étai donné, le jeune officier lui conserva toujours rancune d’avoir accepté, il s’éloigna de lui et jamais il ne me témoigna le désir de le voir, même après qu’il l’êut nommé administrateur de la loterie.
Peu de jours après notre arrivée à Valence, Buonaparte me proposa de faire une course à cheval à Chabeuil. Nous avions encore nos uniformes d’élèves de l’Ecole militaire, nous prîmes des chevaux de louage et ne fîmes qu’un temps de galop. Mon frère qui nous vit partir était fort effrayé de « voir d’aussi mauvais cavaliers monter d’aussi mauvais chevaux ». Une fois lancé, nous ne pûmes nous retenir, nous traversâmes un village à toute bride, nos chevaux épars, la poudre qu’ils renfermaient répandue sur nos habits, ce qui nous fit prendre pour des contrebandiers ; nous revînmes à Valence le même train et fûmes plusieurs jours à nous remettre de cette équipée, qui fut toujours pour Buonaparte un souvenir plein de charme parce qu’il lui rappelait ce premier élan de sa jeunesse libre.
Notre séjour à Valence fut consacré par Buonaparte à ses études favorites, il s’occupait peu de son métier. Quoi qu’on en ait dit, il n’a jamais lu l’histoire de nos capitaines ni des livres de tactiques. Il était d’une pureté de moeurs tout à fait rare chez un jeune homme, il ne pouvait concevoir qu’on pût se laisser dominer par une femme et il n’a jamais lu d’autre roman que Paul et Virginie qui lui plaisait beaucoup. Peu après notre arrivée au régiment, un officier qui vivait avec une actrice l’amena un jour pour souper avec nous, habillée en homme et nous la présenta comme un jeune officier nouvellement arrivé. Napoléon s’aperçut de la plaisanterie et jamais on ne put le déterminer à l’embrasser. A Lyon, comme à Paris ; je l’ai toujours vu fuir ce qui était contraire aux bonnes moeurs.
De Valence, Buonaparte partit pour la Corse où il passa son semestre et son congé d’été. Pendant son séjour, il parcourut toute cette île, habillé comme les gens du pays et errant avec les paysans dans le « makis ». De ce moment, il commença à être désabusé sur l’amour de la liberté qu’il croyait trouver dans les coeurs corses. Plus tard, il me dit qu’il s’était convaincu que plus les peuples s’éloignent de la civilisation, plus ils sont barbares. Ce fut lors de ce premier voyage que Buonaparte, n’ayant plus d’argent pour l’exécuter, mon frère et moi lui prétâmes vingt-cinq louis. A la fin de 1788, il rejoignit le régiment à Auxonne. Je revins l’y trouver. Il était alors très occupé d’écrire une histoire de la Corse. Lorsqu’il travaillait, il fermait les volets de sa chambre afin d’être plus recueilli (il envoya son ouvrage à un Père minime à Brienne). Nous mangions ensemble, nous voulions essayer une cure de laitage, mais ce régime n’allait pas à son tempérament et nous fûmes obligés d’y renoncer. A cette époque, nous visitâmes le Creusot établissement qui renfermait trois usines également intéressantes, l’exploitation des mines de charbon de terre, la fonderie et la maufacture de cristaux.
Nous partîmes à pied, le sac sur le dos, nous pûmes coucher à Cîteaux, mais mon camarade ne pouvant plus marcher parce qu’il avait des ampoules aux pieds, nous nous résolûmes de prendre un cheval. A Chagny, nous passèrent une soirée fort agréable dans la famille d’un ancien camarade de Buonaparte, comme lui élève à Brienne, qui nous reçut à merveille, Buonaparte aimait à se rappeler son voyage sentimental ; il fut au moment de l’écrire à la façon de Sterne. Devenu Empereur et se promenant un jour avec moi dans les jardins de Saint Cloud, il me dit : « Nous avons une dette Des Mazis. » Je cherchais inutilement à me rappeler.
« Vous souvenez-vous, dit-il, que nous nous fîmes faire la barbe avant d’arriver au Creusot ? Ayant remis à payer à notre retour, ayant pris un autre chemin, nous ne nous sommes pas acquittés. » Après cette conversation, Buonaparte fit jouer le télégraphe pour savoir ce qu’était devenu le barbier. Il étai mort et sa famille avait quitté le pays. Deux jours nous suffirent pour visiter Le Creusot, nous retournâmes à Auxonne par Chalon en remontant la Saône.
Pendant l’hiver de 1790, Buonaparte resta au régiment. Le général du Teil le chargea de plusieurs expérience relatives au tir de bombes, il s’acquita de cette mission avec zèle, c’était la première fois qu’il en mettait à s’occuper de son service. Les plans… et autres travaux que le général donnait à faire aux officiers ne furent jamais exécutés par lui, il n’y entendait rien. Un sergent les exécutait, il les signait. Il protestait qu’il ne pouvait pas plus s’astreindre à tracer des lignes qu’à bien écrire.
Au mois d’avril 1791, Buonaparte passa dans le régiment de Grenoble, il retourna alors à Valence, quant à moi je suivis le régiment de La Fère à Douai. Ce fut dans ce second séjour qu’il se fit présenter dans le monde, parce que, disait-il, il ne suffit pas de connaître les hommes par les livres, il faut, pour les étudier, vivre avec eux. Avant de nous séparer, il me remit les vingt-cinq louis qu’il m’avait empruntés. Les idées républicaines commençaient à germer dans les esprits, elles avaient surgi spontanément dans la tête de Buonaparte dès son enfance, mai son théâtre ne s’étendait pas au-delà de la Corse ; aussi, lorsque après la Fédération, on voulut obliger les officiers à assister aux assemblées populaires, il s’y refusa. Les mouvements politiques qui s’opéraient en France lui faisaient espérer qu’un jour Paoli, qui était son héros, reviendrait dans sa patrie et qu’il pourrait se jondre à lui pour fonder en Corse la république des Spartiates qu’il avait toujours rêvée. Le retour de Paoli, sa trahison lorsqu’il livra son pays à l’Angleterre, détrompèrent cruellement les illusions de sa jeunesse.
Mes opinions n’étant pas les siennes, malgré ses efforts pour m’y ramener, je restai fidèle à mon drapeau. Nous nous retrouvâmes en semestre à Paris dans cette même année. Je me rappelle qu’il me conta qu’étant au café de Foi un orateur impromptu, comme on en voyait tant alors, se mit à haranguer l’assistance d’une manière peu convenable ; lui, impatienté, monta sur une table et parvint à persuader les auditeurs que ce parleur était un espion de la police. On le jeta à la porte. C’était la première fois quue Buonaparte parlait en public.
A cette époque, nous nous séparâmes, je ne m’attendais guère à trouver sur le trône celui que je quittais, mon camarade, mon ami !
Revenu à Paris en 1792, Buonaparte vint chez mon oncle, M. des Mazis, ancien capitaine du régiment d’Eu, espérant m’y trouver et redoubler sur ses instances pour m’engager à ne point émigrer ; il m’écrvit une lettre que je n’aurais jamais reçue. Déjà j’avais quitté la France. Quel prodigieux contraste que celui des premières années de Buonaparte et son existence d’homme. Dans sa jeunesse rien d’extraordinaire en fait de science ni de dispositions naturelles, rien de saillant que de petites bizarreries de caractère ; il n’était ni catholique ni protestant sans être athée, la lecture des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau l’avait dirigé dans les principes qu’ils s’était faits. En butte à l’adversité, il est heurté par cette république, dont son imagination caressait le côté poétique.
Explusé de l’artillerie comme noble et forcé de quitter la Corse, il vit obscurément à Marseille. Puis le général Carteaux, aveugle, promoteur de sa grande fortune, le tire de sa retraite, où il vivait avec sa famille et lui ouvre la carrière qu’il doit remplir de son nom.
Telles sont les seules notes que mon père ait laissées. Pour les complèter, j’ajouterai quelques détails puisés dans mes souvenirs. ils m’ont été confirmés par des amis et camarades de mon père auxquels je les ai communiqués. Lorsqu’il émigra en 1792, mon père était capitaine au régiment de La Fère. Son frère Aîné, Gabriel Des Mazis, capitaine en premier dans le même régiment, commandait un détachement envoyé dans une ville éloignée de la garnison. Mon père et mon oncle n’étaient donc pas ensemble lorsqu’ils quittèrent la France pour rejoindre en Allemagne l’armée des Princes. Séparés au moment de leur départ, ils n’avaient pu se communiquer leurs projets ni leurs intentions, mais le Ciel qui protégeait l’amitié qui les unissait permit que mon père retrouvât son frère dans un petit village où il venait d’arriver, bien inquiets l’un pour l’autre et ne voyant pas de terme à leur séparation, ils regardèrent -et leurs camarades aussi- cette rencontre comme tout à fait providentielle. Dès lors, ils se promirent, quelque chose qu’il arrivât, de ne plus se séparer et nous savons si cette promesse a été religieusement gardée. Pendant les 10 ans que dura leur exil, ils allèrent d’Allemagne en Hollande, où s’était réunie l’armée des Princes, puis en Angleterre où ils durent faire partie de l’expédition de Quiberon. Puis, après qu’elle eut échoué, le Portugal ayant demandé à l’Angleterre des officiers d’artillerie, un certain nombre d’émigrés de ce corps passèrent au service de Sa Majesté très fidèle, mon père et mon oncle y restèrent jusqu’en 1802. A cette époque, le désir de rentrer dans leur patrie les décida à profiter du calme qui commençait à s’y rétablir pour solliciter des lettres d’amnistie. Elles furent délivrées le 26 février, an II (1803).
Plus heureux que bien d’autres, ils rentrèrent en France, ayant dans leur ceinture la même somme (100 louis) qu’ils s’étaient partagée, lorsqu’ils se retrouvèrent en Allemagne. Souvent, elle avait été réduite à bien peu de chose, malgré les leçons de mathématiques et dessin qu’ils donnaient. Ils aimaient à nous raconter ce trait qui excitait toujours leur reconnaissance envers la Providence qui avait veillé sur eux pendant ces dix longues années.
Les premiers temps de leur retour furent employés à visiter leur famille et leurs amis. Mais bientôt ils durent songer à l’avenir. Ils vinrent à Paris. Mon père et mon oncle se trouvant sans fortune par suite de la confiscation de leurs biens, mon père se décida à demander une audience au Premier Consul. Elle leur fut accordée de suite. Malgré les événements qui s’étaient passés depuis leur séparation, il reçut de Bonaparte un accueil tel que pouvait le désirer un ancien camarade. Le Premier Consul demanda avec intérêt des nouvelles de mon oncle et apprit qu’il venait d’être gravement malade.
« Eh bien, dit-il à mon père, soyez tranquille, je lui trouverai une place qui conviendrait mieux à un convalescent que la carrière qu’il a toujours suivie. » En effet, peu de temps après, il le nomma admistrateur de la loterie… et mon père travailla au Cadastre en attendant de pouvoir rentrer dans l’artillerie. En 1806, le 2 mars, l’Empereur le nomma admistrateur du mobilier des palais impériaux ; il lui annonça lui-même sa nominaton. Mon père, passionné pour l’artilerie, et tout entier au souvenir de sa vie militaire qu’il avait commencé à l’âge de cinq ans à l’école militaire de Rebais, ne put dissimuler sa surprise et exprima à l’Empereur combien il était incapable de remplir une place si peu en rapport avec ses goûts et ses études.
« Sire, dit-il, je ne suis point administrateur, renvoyez-moi plutôt à mes canons. » Mais Napoléon lui déclara qu’il avait besoin de lui, il accepta donc, et ce même jour, l’Empereur disait au ministre de l’Intérieur, : « aujourd »hui, j’ai gagné un million en choisissant des Mazis pour administrateur du mobilier. » Toutes les fois qu’il le voyait, il le traitait avec la même bienveillance et témoignage d’amitié, il aimait alors à revenir sur le passé et à causer intimement des années de leur jeunesse.
A cette époque, mon père fit par de son mariage à l’Empereur, qui, de son côté, voulait lui donner une femme : apprenant qu’il épousait Mademoiselle Henriette des Mazis, dont les parents habitaient le Maine : « Ah ! Ah ! une chouane ! -Oui, Sire, » répondit mon père.
Cela ne l’empècha de vouloir signer sur le contrat de mariage. Vers la fin de 1812, il le nomma chambellan pour l’attacher de plus près à sa personne. En 1815, mon père rentra dans la vie privée où il donna constamment l’exemple de la piété la plus solide et des vertus les plus aimables.
(notes de Cécile des Mazis, l’aînée des cinq enfants d’Alexandre)
août 11, 2007
LES CAHIERS D’ALEXANDRE DES MAZIS – ECOLE MILITAIRE (1)
Alexandre des Mazis (1768-1841), fut sans nul doute le plus intime des amis de jeunesse de Napoléon Bonaparte. Leur amitié née à l’Ecole Militaire de Paris fin 1784 se prolongea ensuite en garnison à Valence et Auxonne, au sein du régiment de la Fère, qu’ils intègrèrent ensemble en 1785. Et si la Révolution les sépara un temps, l’affection mutuelle que se portaient les deux compères ne s’était pas pour autant distendue. Ainsi, en 1802, de retour d’émigration, Alexandre des Mazis fut reçu par le Premier Consul au Palais des Tuileries. En charge du garde meuble impérial sous l’Empire, il semble qu »il continua de fréquenter assidument le Maître de l’Europe dans le cadre domestique, en plus de ses fonctions publiques peu exposées elles-aussi. Les courts mémoires de ce vieil homme droit, honnête, et moral, écrits sans doute trop tardivement (à l’été 1835), et qui étaient a priori destinés à ses petits-enfants, sont toutefois assez décevants. Outre un certain nombre d’erreurs (relevées assez durement par Robert Laulan), ils nous laissent un sentiment de frustration. Dans ses Cahiers, des Mazis ne fait état que des ses rapports de jeunesse avec Bonaparte, mais ne dévoile rien de son intimité avec lui et l’impératrice Joséphine à La Malmaison. Cependant, Alexandre des Mazis demeure le principal témoin et acteur de la vie de Bonaparte entre 1784 et 1791. Son témoignage ne peut donc être être totalement négligé. Ce court récit sur une véritable amitié de plus de trente ans nous livre malgré tout quelques anecdotes et faits intéressants sur le quotidien des deux jeunes hommes à Paris, en Bourgogne et dans la Drôme. Il nous confirme aussi que Napoléon avait un sens aigu de l’amitié.
Au 1er septembre 1783, je suis rentré à l’école militaire de Paris en sortant de Rebais où j’étais resté quatre ans environ, placé dans la classe de mathématiques pour suivre les instructions nécessaires pour entrer dans l’artillerie ; je me trouve placé dans la salle d’étude auprès de Le Lieur de Ville-sur-Arce, entré la même année à l’école, venant de Brienne et se destinant aussi à l’artillerie. Nous nous liâmes bientôt et notre amitié a duré jusqu’à la fin des jours de cet ami que je regrette encore et qui, comme moi, avait été lié étroitement à Buonaparte qu’il avait laissé à l’école de Brienne parce qu’il était trop jeune pour venir à l’école de Paris. Je vous dirai quelle a été la destinée de ce bon camarade. Ses aventures font aussi partie des réminiscences de notre jeune âge et vous feront connaître un honnête homme, jouet de la fortune, que Buonaparte estimait, qu’il voulait rendre heureux, mais qui détruisait par sa mauvaise étoile le bien qu’on lui faisait. Ville-sur-Arce me parlait souvent de son camarade et du regret de ne pas se trouver ensemble à Paris, il m’en faisait beaucoup d’éloges, tant sous le rapport du caractère que sous celui de l’instruction, il me donnait envie de me lier aussi avec lui. A la fin de 1784, vers le mois de septembre, Ville-sur-Arce fut reçu élève d’artillerie, il quitta l’école et fut reçu à celle de Metz. Nous eûmes le regret de nous quitter et il ne vit pas Buonaparte qu n’arriva qu’un mois après son départ. Il avait été choisi par Monsieur Reynaud des Monts, inspecteur des écoles militaires, pour faire partie de élèves de Brienne qui devaient en sortir pour aller à Paris. Ville-sur-Arce en partant me dit qu’il désirait que j’accueillisse son ami, que je pourrais lui être utile, soit auprès de ses camarades, soit auprès des chefs, que l’originalité de son caractère, ses manières un peu étrangères pourraient lui attirer des ennuis que je pourrais lui éviter. Je lui promis de rechercher l’amitié de Buonaparte et nous nous dîmes adieu en conservant l’espoir que nous nous retrouverions ensemble dans l’artillerie et que notre première liaison se cimenterait encore dans le monde où nous allions entrer. Cet espoir n’a pas été trompé : après avoir parcouru les diverses vicissitudes des événements politiques, nous nous sommes toujours retrouvés amis et dans la même union de pensées, quoiqu’ayant, l’un et l’autre, été le jouet des tempêtes des révolutions et longtemps séparés par d’immenses distances. Lorsque Buonaparte arriva, je fus à lui en lui parlant de Ville-surArce. Il m’accueillit assez froidement, mais sans refuser mes avances ; nous fumes placés dans la même division et le hasard fit qu’on le plaçât à côté de moi dans la classe de mathématiques, se destinant à entrer dans la marine.
Nous passâmes plusieurs mois sans rapprochement particulier, mais une circonstance que son caractère inflexible fit naître, me mit en rapport avec Buonaparte ; on lui avait donné un instructeur dans le maniement des armes un élève nommé Champeaux assez sévère dans son commandement. Un jour le jeune élève, qui souvent avait ses idées ailleurs qu’à l’exercice, n’obéit pas aux leçons qu’on lui donnait, ou les exécutait mal.
Son instructeur lui donna un coup de baguette de fusil sur les doigts. Buonaparte, enflammé de colère, lui jetta son fusil à la tête en promettant que jamais il ne recevrait de leçon de lui. Les chefs, voyant qu’il fallait agir avec douceur avec cet indocile élève, me chargèrent de son éducation militaire. Je m’acquittai fort mal de cette commission. Si mon élève put gagner quelque chose du côté des formes, il perdit beaucoup du côté de l’instruction. Car, pendant les heures qu’on faisait marcher au pas ordinnaire et faire la charge en douze temps, nous laissions de côté nos fusils pour causer de tout autre chose ; j’appris alors à connaître ce que valait mon nouveau camarade, soit par l’originalité de son caractère, soit par son instruction. Nous désirâmes réciproquement de nous lier ensemble, ce que j’avais d’opposé à lui pouvait aussi lui convenir, il trouvait quelqu’un qui le concevait, l’appréciait, et à qui il pouvait sans contrainte, manifester ses pensées.
Au bout de quelques mois il fut admis au Bataillon sans, cependant être très instruit des manoeuvres, mais les distractions continuelles qu’il avait en faisant l’exercice du bataillon lui attiraient souvent de fortes réprimandes de ses chefs, surtout de M. de Lanoy qui voulait que les élèves fissent l’exercice comme de vieux soldats ; il arrivait quelquefois que lorsqu’on faisait le comandement de reposer sur les armes, on voyait au second rang un fusil resté en l’air, on était sûr que c’était celui de M. Buonaparte, j’avais soin de le pousser du coude, étant son voisin de droite, mais son arme n’en arrivait pas moins trop tard à « libre » et le bruit qu’elle faisait troublait l’unité exigée si strictement par M. de Lanoy qui s’emportait en criant : « Monsieur Buonaparte, réveillez-vous donc, vous faites toujours manquer les temps d’exercices. »
Buonaparte était arrivé à l’école militaire avec plusieurs élèves de Brienne, il y en avait un qui avait attiré son amitié. C’était Laugier, il avait beaucoup d’esprit naturel et plaisait sous tous les rapports, mais il était dissipé et avait un caractère tout à fai opposé à celui de Buonaparte, il aimait le plaisir, les jeux et se liait avec les élèves les plus gais. Voyant que Buonaparte vivait retiré, peu communicatif, il s’éloigna de lui, il s’associa à ceux qui le raillaient, soit sur sa réserve, soit sur sa taciturnité. Buonaparte s’aperçut de ce changement, il s’en plaignit, lui fit des reproches de sa dissipation, Laugier n’écouta pas les conseils d’un ami, il excitait même les camarades à lui faire des niches, mais il en fut puni, car un jour qu’il se promenait seul dans la salle de récréation, Laugier vint doucement par-derrière lui, au moment où il traversait d’une salle à dans l’autre et, le poussant fortement, s’enfuit dans la foule des élèves pour se soustraire à sa colère, mais il l’eut bientôt distingué et atteint, malgré les efforts de ceux qui l’entouraient et qui riaient de cette malice. Buonaparte le prit au collet et le poussa à terre avec tant de force que Laugier fut tomber violemment contre la grille en fer d’un poêle, il s’y fit une blessure assez profonde au front. Le capitaine commandant de service, en entendant ce bruit, vint à Buonaparte pour le punir, mais avec le plus grand sang froid, il répondit au chef : « J’ai été insulté, je me suis vengé. Tout est dit. » Et il continua sa promenade sans émotion. Depuis ce moment, Laugier fut plus réservé. Buonaparte regrettait d’avoir perdu cet ami qui avait de si heureuses dispositions, hors de l’école militaire, il en parlait encore avec un sentiment sincère d’affection. Laugier a émigré, il s’est distingué dans son régiment, il est mort en 1796, tué en duel à l’armée de Condé par des Roches, officier d’artillerie qui, au régiment de la Fère à Auxonne, avait manqué de se battre avec Buonaparte. Un ouvrage sur Buonaparte a été fait par lui ou par quelqu’un qui a pris son nom.
Buonaparte était dans la classe de mathématiques… MM. Dagelet et Monge, deux hommes distingués étaient nos professeurs, M. Dagelet avait fait le tour du monde de M. de Bougainville, il avait de l’esprit, de l’instruction et aimait beeaucoup à raconter ses voyages, il nous intéressait infiniment lorsqu’il nous parlait. Souvent toute une étude se passait à l’écouter, il racontait très bien et ses récits excitaient l’enthousiasme parmi ses jeunes auditeurs pour les voyages d’outre-mer, beaucoup se destinaient pour la marine, Dabaud, Peccaduc, Phelippeaux, Le Lieur et Buonaparte étaient du nombre. Dans le courant de 1784, il fut question du voyage de M. de la Perouse. MM. Dagelet et Monge sollicitèrent et obtinrent la faveur d’en faire partie, comme astronomes, les aspirants à la marine étaient trop enflammés du désir d’aller parcourir les mers, comme leur professeur, pour ne pas désirer ardemment de le suivre dans cette expédition. Buonaparte aurait bien voulu avoir occasion de déployer son énergie dans une si belle entreprise, mais Darbaud eut seul la préférence, on ne put pas admettre un plus grand nombre d’élèves, il partit avec MM. Dagelet et Monge en 1784. M. Monge ne pouvant supporter la mer, fut obligé de relacher à Madère et de revenir en France. MM Dagelet et Darbaud suivirent le sort funeste de M de la Perouse. Si Buonaparte eut réussi dans ses désirs, comme lui il aurait péri dans une isle éloignée, il lui était réservé de mourir au-delà des mers, mais après avoir tenté bien d’autres voyages.
Cette année, on prévint qu’il n’y aurait pas d’examen de marine, les élèves qui se destinaient à cette partie, pour ne pas perdre une année, dirigèrent leurs études pour entrer dans l’artillerie. Buonaparte fut du nombre ainsi que Peccaduc et Phelippeaux ; me destinant aussi au corps d’artillerie, comme avaient fait mes pères, nous eûmes de plus ce motif de rapprochement. On avait dans cette classe de mathématiques beaucoup de zèle pour cette science, nos professeurs se plaisaient à nous instruire et tous nous efforcions de leur complaire. M. Dagelet venait souvent s’approcher de Buonaparte pour causer avec lui. Il se plaisait à apprécier l’opiniâtreté qu’il mettait à soutenir ses opinions, déjà très avancées. Ces conversations roulaient quelquefois sur les littérateurs, sur la Corse et sur la politique. Les connaissances de Buonaparte n’étaient pas très avancées, il avait plus de facilité à concevoir les propositions qu’à les exprimer. On nous proposait des problèmes à résoudre qui n’étaient pas dans nos cours. Buonaparte venait toujours à bout de les résoudre. Il ne quittait le travail qu’après avoir vaincu les difficultés.
Buonaparte ne réussissait pas aussi bien dans ses autres classes, le maître d’allemand, ne pouvant rien lui faire apprendre, avait fini, après bien des menaces, à lui laisser faire tout autre chose que de l’allemand. Il avait pour cette langue une répugnance invincible et il ne comprenait pas qu’on pût s’en mettre un mot dans la tête. Il profita de cette liberté pour lire pendant toute la classe des livres d’histoire et de politique qu’on lui prêtait de la bibliothèque qui était à disposition des élèves. Il lisait surtout Montesquieu et des histoire de la Corse. Le maître d’écriture avait fait comme celui de l’allemand, il l’avait renvoyé de sa classe, non parce qu’il n’écrivait pas bien, mais parce qu’il voyait qu’il ne pourrait jamais s’assujettir aux plus simples principes de l’écriture. M. Daniel était pourtant un académicien dans cette partie et n’estimait les élèves qu’autant qu’ils écrivaient parfaitement. Buonaparte s’appliquait aux cours d’histoire et de géographie, faits par M. de l’Aiguille, ancien jésuite. Il professait d’une manière admirable, il avait un art admirable pour se faire écouter, il ne lisait jamais ses cahiers, il parlait d’abondance en un très bon style, s’animant lorsque le sujet le demandait. Il conversait avec ses élèves et disputait avec ceux qui n’en avaient pas une conforme à la sienne, je parlerai plus tard d’une discussion au sujet de la Corse avec Buonaparte, et M. de l’Aiguille. Il a été placé par l’Empereur. Je l’ai revu sous l’Empire, il se rappelait encore de la chaleur de son élève dans cette recherche, s’il avait été avantageux pour la Corse d’avoir été soumise à la France. Le professeur en soutenant sa patrie attaquait l’écolier dans ce qu’il avait de plus sensible.
Ses compositions en littérature avaient de l’originalité, mais ne lui attiraient pas d’éloges de M. Domairon, son professeur qui pouvait à peine lire tant elles étaient mal écrites. Lui-même ne pouvait parfois en venir à bout. M. Domairon est l’auteur de plusieurs ouvrages de littératures estimés, il était placé à l’Université. Quant aux étude de dessin de fortification, de dessin d’agrément et de danse, il ne s’en occupait nullement, les trouvant trop futiles et ayant peu de dispositions.
L’exercice qui lui plaisait le plus était celui des armes. Nous avions un excellent maître, Monsieur… Toutes les heures consacrées à la salle d’armes étaient employée à faire assaut. Napoléon s’y mettait en nage, il était dangereux de férailler avec lui, il se mettait en colère lorsqu’il était touché et fondait sur son adversaire sans règle ni mesure ; c’était avec moi qu’il faisait assaut le plus souvent et, lorsque je lui portais une botte, j’avais soin de me retirer en arrière pour lui donner le temps de se calmer.
« Par Saint Pierre, s’écriait-il, je vais me venger », et il allait d’estoc et de taille sans songer à se garantir des coups qu’il se mettait hors d’état de parer et qu’alors il était facile de lui porter. Le maître d’armes venait s’interposer pour faire cesser le combat qu’il poussait à outrance. Il a cassé un grand nombre de fleurets. Je porte encore la marque d’une de ces bottes qui m’a mis plusieurs jours hors de combat avec lui.
Ses récréations se passaient souvent à se promener à grands pas dans les salles de récréation, les bras croisés, à peu près comme il a été représenté depuis dans ses portraits, ayant la tête baissée, défaut pour lequel on le reprenait souvent à l’exercice, il ne faisait aucune attention aux jeux de ses camarades, auxquels il ne prenait aucune part. Il paraisait très occupé de ses reflexions et avait l’air de se réveiller lorsque parfois on le heurtait en courant. Ces méditations lui donnaient un air distrait. On le voyait ainsi s’animer, marcher à plus grands pas et rire ou gesticuler. Cette manière d’agir l’avait fait passer pour singulier, nous nous promenions parfois ensemble et sa conversation était toujours intéressante, elle roulait sur des choses sérieuses, il gémissait sur la frivolité des élèves, les désordres qui régnaient entre eux et le peu de soin qu’on apportait à nous surveiller et nous préserver de la la corruption. Il ne jouait jamais avec ses camarades. Cette réserve a été mal interprétée par les chefs de l’Ecole, qui attribuaient l’isolement qu’il recherchait à de l’éloignement pour la France qui avait subjugué sa patrie. C’était la Corse qui le plus souvent occupait ses pensées et faisait le sujet de nos conversations. Il espérait qu’un jour la Corse deviendrait un état libre et indépendant. Dans son imagination il s’en voyait législateur. Cette idée qui se formulait dans la tête de Buonaparte a été à l’origine de toutes les grandes qualités qui se sont plus tard développées chez lui. Le commencement de la Révolution française lui a fait entrevoir que son rêve pourrait se réaliser.
A la mort de son père en 1785, son confesseur fut chargé de le conduire à l’infirmerie comme c’était l’usage dans ses premiers moments de douleur ; il refusa d’y aller, disant qu’il avait assez de force d’âme pour supporter cette peine sans qu’on prit soin de le consoler. Il n’était pas complètement irreligieux et encore moins athée et cependant il n’était ni catholique ni protestant, les seules circonstances qui tirassent Buonaparte de sa rêverie habituelle était l’attaque ou la défense des redoutes que nous nous amusions à faire avec la neige. Alors, il se mettait à la tête d’un de ces partis et le commandait avec une intelligence remarquable. Un jour de fête publique, un ballon devait être lancé au Champ de Mars, les élèves de l’école étaient sous les armes depuis fort longtemps et le ballon ne partait pas. Buonaparte s’impatienta et, sans me communiquer son projet, il me donna son fusil à tenir, il sort des rangs sans être aperçu et va couper les cordes qui retiennent le ballon. Il fut crevé et Buonaparte puni sévèrement.
août 9, 2007
LA MAISON BONAPARTE – AJACCIO
La Maison historique
La première demeure des Bonaparte s’élevait au bord de la Grande-Rue ; elle a été démolie par les Français lorsqu’ils bâtirent la citadelle vers 1755, et fut certainement celle du premier Bonaparte établi en Corse vers 1490, Francesco, surnommé le Maure de Sarzanne, du nom de la petite ville italienne d’où sa famille était originaire. On ignore où vécurent les Bonaparte de 1555 à 1623, date du mariage de Sebastiano Bonaparte avec Angela-Felice Lubera qui apporte en dot la demeure de son père, le capitaine Troilo Lubera. La « casa Lubera », qui portait sur l’entablement de son portail l’inscription latine « spe mea est in Deo », a été démolie il y a quelques années pour faire place à un petit jardin rue du Conventionnel Chiappe. C’est seulement à la fin du XVIIème siècle que les Bonaparte s’installent dans une partie de la maison qui depuis porte leur nom. Le 20 décembre 1682, Giuseppe Bonaparte épouse Maria Bozzi dont la dot s’élève à 4901 livres et comprend quelques pièces de la casa Bozzi à Ajaccio. A partir de ce moment, les Bonaparte essaieront de s’attribuer cette maison tout entière, étage par étage, demi-étage par demi-étage, voire chambre par chambre : la coutume corse divisait et subdivisait en effet la propriété à un point tel qu’il existait parfois autant de propriétaire que de chambres.
A la mort de Maria Bozzi en 1704 ses trois enfants survivants héritent de sa part : Sebastiano reçoit un appartement, Antonio une pièce et deux chambres au premier étage, et Virginia l’étage supérieur. qu’elle transmettra à ses descendants. Sebastiano meurt dès1720 laissant des enfants en bas âge. Son frère Antonio, resté célibataire, prend en charge les intérêts de ses neveux. En 1734 il achète une chambre supplémentaire à Giovanni-Battista Bozzi qu’il donne avec sa propre part à son neveu Napoleone en 1737. Pour éviter que les dernières pièces échappent à la famille, il lui fait épouser en 1743 Maria Bozzi, fille de Giovanni-Battista, qui apporte en dot la moitié de la maison de la rue Malerba. Lorsqu’Antonio meurt en 1762, la totalité de la maison est entre les mains de ses trois neveux à l’exception de l’étage supérieur qui appartient à la fille de Virginia. Le cadet des neveux, Luciano Bonaparte, est entré dans les ordres et devenu archidiacre à Ajaccio. Tout comme son oncle Antonio, Luciano tente d’empècher la division de la maison dans la descendance de ses deux frères. En 1766 après de longues tractations, sa belle-soeur, née Maria-Rosa Bozzi accepte d’échanger sa part de la maison familiale contre une vigne aux Salines. La « casa » se trouve alors dans un complet état de vétusté ; on accède à l’étage supérieur par une simple échelle mobile, les murs sont décrépis, le toit est à reprendre entièrement. L’archidiacre fait refaire les planchers et les fenêtres, construire un escalier fixe et reprendre le toit et les murs intérieurs, ce qui lui permet de gagner deux chambres ; les travaux lui coûtent 1500 livres en monnaie de Gênes, mais la maison est devenue la importante de le rue Malerba qui prend désormais le nom de rue Bonaparte.
Le seul héritier mâle des Bonaparte, Carlo-Maria, épouse en 1764 Letizia Ramolino ; sur douze enfants, huit survivent, dont sept naissent dans la maison familiale d’Ajaccio, l’aîné Joseph, ayant vu le jour à Corte. Charles de Buonaparte, comme il se nomme à présent lui-même, adhère au rattachement de l’île à la France ; c’est un personnage important, avocat au Conseil Supérieur de la Corse et assesseur de la juridiction royale d’Ajaccio ; en 1771 il est reconnu noble par le roi de France et en 1777 se rend à Versailles comme député de la noblesse de l’île. Pour soutenir ce train de vie il agrandit et embellit la demeure familiale en faisant construire en 1774 sur un emplacement acheté à la famille Ponte une terrasse qui lui coûte 600 F ; il y fait installer une petite cabane de bois pour permettre au jeune Napoléon d’y travailler ; en 1780 Charles dépense 896 F en travaux d’aménagements intérieurs ; il fait tendre sa chambre à coucher d’étoffe cramoisie et y installe une cheminée de marbre de 260 livres ; enfin une grande table de vingt couverts forme le centre de la salle à manger. Charles meurt en 1785 ; l’aîné de ses enfants Joseph n’a que 17 ans et l’archidiacre Luciano reprend les rênes de la famille. Le jeune Napoléon parti pour le collège d’Autun en décembre 1778 ne rentre à Ajaccio qu’après la mort de son père ; de 1786 à 1793 il effectue cinq séjour plus ou moins long sur son île : du 15 septembre 1786 au 12 septembre 1787, du 1er janvier à fin mai 1788, de septembre 1789 à janvier 1791, de fin septembre 1791 à mai 1792 et du 15 octobre 1792 au 11 juin 1793.
En 1790 l’archidiacre agrandit la maison en achetant à Carlo Sapia pour 1660 livres un bâtiment voisin de la casa ; relativement important, il comprend une cuisine, deux chambres, un magasin et deux greniers. Il est possible qu’une partie de ces deux pièces corresponde aux trois salles situées dans le prolongement de la galerie.
Mais la Révolution a éclaté, et les Bonaparte fervents partisans des idées républicaines, doivent céder devant le parti anglais auquel Paoli et Pozzo di Borgo se sont ralliés. En mai 1793 Letizia doit quitter Ajaccio précipitamment avec ses enfants ; le 24 mai les propriétés de la famille sont saccagées et la maison est pillée ; tout disparait y compris les portes et fenêtres. Elle est réquisitionnée par les anglais et le rez-de-chaussée est utilisé comme magasin à fourrage et dépôt d’armes tandis que l’étage sert de logement à des officiers anglais, parmi lesquels a peut-être figuré Hudson Lowe, le futur géôlier de Napoléon à Sainte-Hélène.
A la fin d’octobre 1796 les français chassent les anglais de Corse, et Joseph Bonaparte peut rentrer à Ajaccio en décembre 1796 ; le 10 décembre Napoléon lui écrit : « Mets en ordre nos affaires domestiques surtout notre maison d’habitation que je désire à tout événement voir dans une situation propre et digne d’être habitée. Il faut la remettre comme elle était en y joignant l’appartement d’Ignazio. Fais les petits arrangements pour que la rue soit plus habitable. » L’achat devait être prévu depuis longtemps, car dès le 11 décembre Joseph achète pour 8500 livres l’appartement à Ignazio Pianelli et à son épouse, Artillia-Maria Pozzo di Borgo, petite-fille de Virginia Bonaparte, celle-là même qui avait reçu l’étage supérieur de la maison.
Dès son arrivée, Joseph se préoccupe de trouver un architecte afin de remettre la maison en état. Il choisit un Suisse établi en Corse, Samuel-Etienne Meuron entrepreneur en fortifications de la place d’Ajaccio. Le 16 février 1797 Joseph remet 17457 livres 15 sols à son fondé de pouvoir Francesco Braccini afin de payer les travaux ; lorsque les comptes seront arrêtés le 11 mai 1799, ils s’élèveront à 19776 livres 14 sols. Joseph quitte la Corse le 28 mars 1797 et sa mère le remplace dès la seconde quinzaine de juin. Les moyens de restaurer la maison lui sont fournis par la loi du 31 janvier 1797 qui indemnise les Corses victimes de l’occupation anglaise ; Letizia reçoit 124800 francs dont 16000 francs pour la seule maison d’Ajaccio ; il semble bien qu’elle ait surestimé les dommages subis par le mobilier et le linge puisqu’elle les évaluait à 25000 F. Letizia signe les factures des maçons, des menuisiers, des forgerons et des séruriers entre juin 1797 et juin 17998 ; à cette date, le gros oeuvre et le premier étage sont sur le point d’être achevés, car le serrurier livre les gonds des portes et les mouvements de sonnettes. Le modèle de la rampe d’escalier est envoyé en novembre 1797 à Marseille chez Mme Clary, belle-mère de Joseph, qui la fait exécuter, puis expédier à Ajaccio. La maison semble avoir été reprise entièrement, car Letizia fait venir de Gênes et de Marseille 20000 briques, 5000 tomettes et 3000 tuiles. Enfin il faut tendre les murs de papier peint et complèter le maigre mobilier échappé au pillage. Les achats sont également faits à Marseille ; dès janvier 1797 Elisa fait parvenir à Joseph cinq tentures en papier et une en damas, la chambre étant tapissée en rouge velouté. Elisa fournit également de nombreux sièges, des trumeaux et une table de marbre. En septembre de la même année le marchand Laplane expédie de Marseille 8 fauteuils, 18 chaises et un « bois de lit avec son palanquin ». Enfin en avril 1798, Letizia réclame à Mme Clary des papiers peints de différentes couleurs : rouge et blanc, jonquille, rouge, ponceau avec des roses. Fesch rejoint sa soeur à Ajaccio en octobre 1798 ; il écrit aussitôt à Joseph : « Costa loge dans votre maison ; selon votre ordre, le premier est réparé, mais le second et le toit exigeraient une forte réparation. » En novembre la situation est identique : « Je n’ai pu achever la maison, faute de matériaux qu’on attend de Marseille. » Elle dut être achevée au début de 1799, car en juillet, Letizia, Fesch et le jeune Louis quittent Ajaccio pour toujours, confiant leur maison à Camilla Illari, la nourrice de Napoléon.
Au retour d’Egypte Bonaparte fait escale quelques jours à Ajaccio du 29 septembre au 5 octobre 1799 ; il s’installe dans la maison rénovée, au second étage dans la chambre dite de l’alcôve. Son séjour est marqué par un bal organisé par Murat dans la galerie récemment aménagée et par une promenade aux Milelli, propriété ajaccienne des Bonaparte. Enfin le 4 au soir, il quitte secrètement la maison pour s’embarquer sur la « Muiron » qui le conduira à Fréjus. Il ne devait plus revoir sa maison natale mais se préoccupera de son sort sous l’Empire.
L’Empereur avait conçu le projet de donner la maison Bonaparte à sa vieille nourrice Camilla Illari, qui était venue à Paris après le couronnement. Il chargea le cardinal Fesch de connaître l’avis de Madame Mère. Celle-ci répond que si une demeure ou presque tous ses enfants ont vu le jour cesse d’appartenir à sa famille, elle ne la cédera qu’à son cousin germain André Ramolino.
L’Empereur y consent mais sous la condition expresse que sa nourrice aurait en échange la maison de ce dernier. L’acte est passé devant Maître Raguideau au château de Malmaison le 23 mars 1805.
Le contrat stipule que Ramolino doit créer dans les deux ans une place à ses frais en faisant démolir la maison Pietra-Santa et une partie de la maison Gentile ; c’est l’origine du jardin situé devant la maison. Ramolino meurt dans la maison en 1831 ; quelques semaines auparavant, il reçoit la visite du jeune prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe, à qui il fait don d’un fauteuil « Louis XV ». Après sa mort, sa veuve Madeleine Baciocchi, soeur du Prince de Lucques et Piombino, y habite jusqu’à son décès en 1847.
En 1831, la propriété passe au filleul et parent d’André Ramolino, Napoléon Lévie ; celui-ci reçoit plusieurs propositions d’achat : 500000 F en 1833 par l’ambassadeur Pozzo di Borgo, puis 200000 F un peu plus tard par le duc d’Orléans, fils de Louis-Philippe. Madame Mère qui vit toujours, conteste cet héritage et attaque en nullation la donation de 1805 prétextant la naissance du Roi de Rome, survenue en 1811 ; lorsque ce dernier meurt en 1832, elle assigne Lévie devant le tribunal d’Ajaccio en tant qu’héritière de son petit-fils. Madame Mère meurt en 1836, et suivant ses dernières volontés, le cardinal Fesch reprend l’instance ; il disparaît à son tour en 1839. Son héritier est l’ancien roi d’Espagne Joseph, qui parvient à rentrer en possession de la maison par une transaction du 2 juin 1843. Lévie, autorisé par Louis-Philippe à ajouter à son nom celui de Ramolino, quitte les lieux en juin 1844, emmenant avec lui tout le mobilier. C’est donc d’une demeure vide qu’hérite la fille de Joseph, Zenaïde princesse de Canino, à la mort de son père en juillet 1844.
Elle s’en déssaissit en 1852 en faveur de son cousin Napoléon III, qui ouvre en 1857 un crédit de 20000 F pour la restauration du bâtiment. Les travaux sont menés par l’architecte du palais de Fontainebleau Alexis Paccard ; c’est à cette époque que les plafonds sont peints par Jérôme Maglioli, peintre et architecte de la maison. Il restaure et aménage les caves situées sous la galerie, achetées en 1860 à Mme génie, née Marie-Benoîte Ponte. Dès 1858 le garde-meuble tente de racheter, sans succès, l’ancien mobilier à Lévie-Ramolino ; un devis d’ameublement du premier étage est alors demandé. L’Empereur et l’impératrice visitent la maison en septembre 1860 et sont déçus de la trouver vide. La négociation avec Lévie-Ramolino est relancée, et ce dernier accepte enfin de céder le mobilier pour 15000 F ; il est installé lors de la visite que l’impératrice Eugénie effectue avec son fils en 1869 à l’occasion du centenaire de la naissance de Napoléon. Elle place alors sur la cheminée de la chambre natale de Napoléon 1er un buste du Prince Impérial d’après Carpeaux.
A la chute de l’Empire la maison est confisquée par un décret du 6 septembre 1870 ; elle n’est restituée au Prince Impérial qu’en 1874 ; à sa mort elle passe à sa mère l’impératrice Eugénie, puis au décès de cette dernière, à son héritier le Prince Victor. En 1923, ce dernier offre la maison à l’Etat qui accepte le don l’année suivante ; elle est classée par le Service des Monuments Historiques qui en assure l’entretien jusqu’en 1967. Depuis cette date, la maison Bonaparte est un musée national dépendant du musée de Malmaison.
Elle se dresse à l’angle des rues Saint-Charles (anciennement Malerba) et Letizia (anciennement del Pevero), devant une petite place créée au début du XIXème siècle, puis transformée en jardin. En 1936 à l’occasion du centenaire de la mort de Madamè Mère, on y a érigé un buste en bronze du Roi de Rome, par le sculpteur marseillais Elie-Jean Vezien.
La façade à trois étages est décorée des armes des Bonaparte ; elles avaient été démontées lorsque la plaque de marbre rappelant la naissance de Napoléon avait été posée, puis rescellées en 1899 pour le centenaire du Consulat.
(Bernard Chevallier – Extrait du guide de la Maison Bonaparte – 1986)
août 7, 2007
GENERAL JEAN-PIERRE DU TEIL – AUXONNE
Jean-Pierre du Teil de Beaumont, né le 14 juillet 1722 à Châbons (Isère), volontaire au corps de l’artillerie en mars 1731, cadet (18 décembre 1733), sous-lieutenant de cannooniers (24 août 1735), lieutenant en second (9 novembre 1743) et en premier de cannoniers (24 août 1735), lieutenant en second (9 novembre 1743) et en premier cannoniers (29 mars 1746), capitaine en second de sapeurs (14 avril 1748), capitaine en premier de cannoniers (1er janvier 1757), employé à Schlestadt (1er janvier 1759), avait déjà pour raisons de santé obtenu sa pension de retraite le 21 mai 1760. Mais il rejoignit volontairement l’armée et prit par à la bataille de Warbourg. Il fut réadmis (20 juin 1761), devint capitaine de bombardiers (25 novembre 1761), et après avoir été détaché à La Rochelle (13 août 1765), chef de brigade au régiment de Toul (25 août 1765), avec rang de lieutenant-colonel (29 février 1768), lieutenant-colonel sous-directeur à Collioures (11 avril 1770), lieutenant-colonel du régiment de Toul (27 novembre 1773), colonel du régiment de La Fère (1er janvier 1777), comandant de l’école d’artillerie d’Auxonne (3 juin 1779), brigadier d’infanterie (1er mars 1780), maréchal de camp (1er janvier 1784). Il n’aimait pas la Révolution mais la servit. Inspecteur général d’artillerie (1er avril 1791), commandant en chef l’équpage de l’artillerie à l’armée du Rhin (avril 1792), poste qu’il ne rejoignit pas pour cause de maladie, il était inspecteur général d’artillerie à l’armée des Alpes au mois de septembre 1793. Arrêté par trois membres du comité révolutionnaire de cette ville, il fut envoyé à Lyon aux repésentants du peuple Collot d’Herbois et Fouché, traduit devant le commissaire militaire et fusillé le 27 février 1794.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 6, 2007
LOUIS CHARLES RENE, COMTE DE MARBEUF
Louis-Charles-René, Comte de Marbeuf, fils d’un lieutenant général, était né à Rennes, le 4 novembre 1712. Successivement enseigne au régiment de Bourbonnais (13 octobre 1728), lieutenant (7 juillet 1729), capitaine (23 avril 1732), aide-major général de l’infanterie (1er mai 1747), colonel (15 février 1748), birgadier d’infanterie (3 septembre 1759), maréchal de camp (25 juillet 1762), lieutenant général (23 octobre 1768), il fut nommé le 4 août 1772 commandant en chef des troupes françaises en Corse. Il touchait un traitement de 71 2008 livres, 45 208 livres comme commandant en chef, 15 000 comme lieutenant général, 4 00 comme grand’croix de Saint-Louis, 4 000 sur le département des finances comme gentilhomme de la chambre du roi de Pologne et duc de Bar, 3 000 à titre de pension sur le trésor de guerre. En 178, à l’âge de soixante-douze ans, il se maria : « Mes parents et amis, disait-il, me voyant seul de mon nom, ont exigé que je me marie, pour pouvoir le péerpétuer ». Il mourut le 20 septembre 786 à Bastia et y fut enseveli dans l’église de Saint-Jean-Baptiste.
Sa veuve, fille d’un maréchal de camp, Catherine-Salinguerra-Antoinette de Gayardon de Fenoyl, née le 6 juin 1765, avait reçu par décision du 28 septembre 1783, une pension de 8 000 livres assurée à titre de douaire sur le trésor royal. Napoléon 1er lui donnal, le 22 juillet 1809, une dotation de 15 000 livres et la nomma, le 19 juin 1813, baronne d’Empire. Elle mourut à Paris le 18 mars 1839.
Son fils Laurent-François-Marie né à Bastia le 26 mai 1786, élève pensionnaire de Fontainebleau (22 septembre 1803), caporal (21 avril 1804), sous-lieutenant au 25ème régiment de dragons (16 janvier 1805), lieutenant (21 novmebre 1806) et adjudant-major au même régiement (10 novembre 1807), officier d’ordonnance de l’Empereur (29 octobre 1808), baron de l’Empire (9 décembre 1809), chef d’escadron aux chasseurs à cheval de la garde impériale (6 avril 1810), colonel du 6ème régiment de chevau-légers (14 octobre 1811), mourut de ses ses blessures le 25 novembre 1812, à Marienpol, grand-duché de Varsovie.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 5, 2007
LE PERE BERTON – COLLEGE DE BRIENNE LE CHATEAU
Louis-Sébastien Berton, né à Reims le 6 mars 1746, fit d’assez bonnes études à l’Université de sa ville natale, s’engagea, dit-on, au régiment dur Roi, puis quitta le service pour entrer chez les Minimes. Il fit sa profession le 27 août 1765 au couvent de Reims. Principal du collège de Brienne jusqu’à la Révolution, grand vicaire de l’évêque constitutionnel de Sens, passant la Terreur dans cette dernière ville où il instruisait un jeune homme et cultivait un jardin, il fut nommé par Bonaparte économe du collège de Saint-Cyr : le décret, daté du 20 juillet 1800 et signé par Lucien Bonaparte, ministre de l’intérieur, porte que « Le Breton s’occupera sans délai de l’établissement du régime économique ». Le 28 mars 1801, Berton succédait, comme directeur du collège de Compiègne, à Crouzet, qui venait au collège de Saint-Cyr remplacer Sallior. Proviseur du lycée de Reims en 1803, mis à la retraite en 1808, il mourut le 20 juillet 1811. « Si cet homme, a écrit Lacatte-Joltrois dans sa Biographie rémoise manuscrite, n’eût pas revenu dans son pays, on l’aurait toujours regardé comme un personnage important. Qu’avait-il ou que lui restait-il ? Un ton plus dur que sévère, sans cependant savoir se faire obéir. Les mémoires qu’il fit dans lesquels on remarquait la dureté de son caractère, ne lui donnèrent aucune confiance. Il faut avouer que les discours qu’il prononçait aux distributions des prix étaient toujours bien faits et faisaient admirer son éloquence. Voilà tout. Il négligea sa place, se livra aux plaisirs de la table, et se perdit, et, s’il est vrai qu’il se laissa mourir, comme on dit, en se privant de manger, et ne buvant que de l’eau pendant quarante-deux jours, qu’il allait chercher lui-même dans une cruche à la rivière (il demeurait alors dans la rue du Cerf), que penser de cet homme ? »
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon par Arthur Chuquet)
août 4, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LES GALERIES ET JARDINS DU PALAIS ROYAL
Une rencontre au Palais Royal
Je sortais des Italiens et me promenais à grands pas sur les allées du Palais Royal. Mon âme, agitée par les sentiments vigoureux qui la caractérisent, me faisait supporter le froid avec indifférence ; mais, l’imagination refroidie, je sentis les rigueurs de la saison et gagnai les galeries. J’étais sur le seuil de ces portes de fer quand mes regards errèrent sur une personne du sexe. L’heure, la taille, sa grande jeunesse ne me firent pas douter qu’elle ne fût une fille. Je la regardais : elle s’arrêta non pas avec cet air grenadier des autres, mais un air convenant parfaitement à l’allure de sa personne. Ce rapport me frappa. Sa timidité m’encouragea et je lui parlai… Je lui parlai, moi qui, pénétré plus que personne de l’odieux de son état, me suis toujours cru souillé par un seul regard… Mais son teint pâle, son physique faible, son organe doux, ne me firent pas un moment en suspens. Ou c’est, me dis-je, une personnne qui me sera utile à l’observation que je veux faire, ou elle n’est qu’une bûche.
– Vous aurez bien froid, lui dis-je, comment pouvez-vous vous résoudre à passer dans les allées ?
– Ah ! monsieur, l’espoir m’anime. Il faut terminer ma soirée.
L’indifférence avec laquelle elle prononça ces mots, le flegmatique de cette réponse me gagna et je passai avec elle.
– Vous avez l’air d’une constitution bien faible. Je suis étonné que vous ne soyez pas fatiguée du métier.
– Ah ! dame, monsieur, il faut bien faire quelque chose.
– Cela peut-être, mais n’y a-t-il pas de métier plus propre à votre santé ?
– Non, monsieur, il faut vivre.
Je fus enchanté, je vis qu’elle me répondait au moins, succès qui n’avait pas couronné toutes les tentatives que j’avais faites.
– Il faut que vous soyez de quelques pays septentrionaux, car vous bravez le froid.
– Je suis de Nantes en Bretagne.
– Je connais ce pays-là… Il faut, mademoiselle, que vous me fassiez le plaisir de me raconter la perte de votre p…
– C’est un officier qui me l’a pris.
– En êtes-vous fâchée ?
– Oh ! oui, je vous en réponds. (Sa voix prenait une saveur, une onction que je n’avais pas encore remarquée). Je vous en réponds. Ma soeur est bien établie actuellement. Pourquoi ne l’eus-je pas été ?
– Comment êtes-vous venue à Paris ?
– L’officier qui m’avilit, que je déteste, m’abandonna. Il fallut fuir l’indignation d’une mère. Un second se présenta, me conduisit à Paris, m’abandonna, et un troisième avec lequel je viens de vivre trois ans, lui a succédé. Quoique Français, ses affaires l’ont appelé à Londres et il y est. Allons chez vous.
– Mais qu’y ferons-nous ?
– Allons, nous nous chaufferons et vous assouvirez votre plaisir.
J’étais bien loin de devenir scrupuleux, je l’avais agacée pour qu’elle ne se sauvât point quand elle serait pressée par le raisonnement que je lui préparais en contrefaisant une honnêteté que je voulais lui prouver ne pas avoir…
(Paris le 22 novembre 1787)
août 3, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DES FEMMES
Dialogue sur l’amour
Dans cet écrit, Napoléon Bonaparte se met en scène face à son meilleur ami de jeunesse, son camarade Alexandre des Mazis. Ils y exposent des avis divergents sur la grande question métaphysique qu’est l’amour.
Des Mazis. – Comment, monsieur, qu’est-ce que l’amour ? Eh ! quoi, n’êtes-vous donc pas composé comme les autres hommes ?
Bonaparte. – Je ne vous demande pas la définition de l’amour. Je fus jadis amoureux et il m’en est resté assez de souvenir pour que je n’aie pas besoin de ces définitions métaphysiques qui ne font jamais qu’embrouiller les choses : je vous dis plus que de nier son existence. Je le crois nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes, enfin je crois que l’amour fait plus de mal… et que ce serait un bienfait d’une divinité protectrice que de nous en défaire et d’en délivrer le monde.
Des Mazis. – Quoi ! L’amour nuisible à la société, lui qui vivifie la nature entière, source de toute production, de tout bonheur. Point d’amour, monsieur, autant vaudrait-il anéantir notre existence !
Bonaparte. – Vous vous échauffez. La passion vous transporte. Reconnaissez, je vous en prie, votre ami. Ne me regardez pas avec indignation et répondez. Pourquoi depuis que cette passion vous domine, ne vous vois-je plus dans vos sociétés ordinaires ? Que sont devenues vos occupations ? Pourquoi négligez-vous vos parents, vos amis ? Vos journées entières sont sacrifiées à une promenade monotone et solitaire jusqu’à ce que l’heure vous permette de voir Adélaïde.
Des Mazis. – Eh ! que m’importe à moi, monsieur, vos occupations, vos sociétés ? A quoi aboutit une science indigeste ? Qu’ai-je à faire de ce qui s’est passé il y a mille ans ? Quelle influence puis-je avoir sur le cours des astres ? Que m’importe le minutieux détail des discussions puériles des hommes ?… Je me suis occupé de cela sans doute. Qu’avais-je de mieux à faire ? Il fallait bien par quelque moyen se soustraire à l’ennui qui me menaçait ; mais, croyez-moi, je sentais, au milieu de mon cabinet, le vide de mon coeur. Parfois mon esprit était satisfait, mais mes sentiments !… Oh ! Dieu, je n’ai fait que végéter tant que je n’eus pas aimé. Actuellement au contraire, quand l’aurore m’arrache au sommeil, je ne me dis plus : Pourquoi le soleil luit-il aujourd’hui pour moi ? Non ! le premier rayon de lumière me présente ma chère Adélaïde en habit du matin. Je la vois penser à moi, me sourire. Hier au soir, elle me serrait la main ; elle soupirait, nos regards se rencontraient. Comme ils exprimaient nos sentiments ! Je contemple un portrait qui me ravit l’âme. Cent fois je le remets pour le reprendre aussitôt. Cette promenade, monsieur, que vous appelez monotone, eh ! non, la vaste étendue du globe ne contient pas plus de variété. D’abord, mon esprit repasse les choses qu’elle m’a dites ; je relis le billet qu’elle m’a écrit ; je pense à celui qui doit peindre toute l’étendue de mon amour. Je le refais cent fois. Mon imagination s’élève ; je vois bientôt mes feux couronnés, je regrette tantôt de ne pas avoir une fortune immense à lui sacrifier. Ici même, je voudrais avoir une couronne. Concevez-vous le charme de la proposer à ses parents, la joie que cela lui causerait. Tout ce qui approche d’elle est sacré à mes yeux. Une autre fois, je penserai aux préparatifs des noces qui doivent bientôt nous unir, jusqu’aux présents que je dois lui faire… Mon coeur se dilate à imaginer quelque chose qui puisse l’obliger, lui prouver mon amour. Voyez-vous le château où nous devons passer nos jours, les sombres bosquets, les riantes prairies, les délicieux parterres. Rien ne m’affecte que le plaisir d’être tous les jours à côté d’elle. Mais bientôt elle doit me donner des gages de notre amour… Mais vous riez ! En vérité je vous déteste.
Bonaparte. – Je ris des grandes occupations qui captivent votre âme et plus encore du feu avec lequel vous me les communiquez. Quelle maladie étrange s’est emparée de vous ? Je sens que la raison que je vais appeler à votre secours ne fera aucun effet et, dans le délire où vous êtes, vous ferez plus que de fermer l’oreille à sa voix ; vous la mépriserez. Souvenez-vous que vous n’êtes pas de sang-froid et que mon amitié fut toujours le juge qui vous rappela à vos devoirs. Souvenez-vous que je m’en suis toujours rendu digne. J’aurais besoin de répéter ici les obligations que vous me devez et les marques qui vous sont connues de mes sentiments, car, moi-même, je ne serais pas à l’abri de vos invectives dans les accès de votre délire. Car votre état est pareil à celui d’un malade qui ne voit que la chimère qu’il poursuit et sans connaître la maladie qui la produit, ni la santé qu’il a perdue. Je n’agiterai donc pas si vos plaisirs sont dignes de l’homme, ou même si c’en sont. Je veux croire que ce sexe, roi du monde par sa force, son industrie, son esprit et toutes ses autres facultés naturelles, trouve sa suprême félicité à la languir dans les chaînes d’une molle passion et sous les lois d’un être plus fragile d’entendement comme de corps. Je veux croire, comme vous le dites, que le souvenir de votre Adélaïde, son image, sa conversation, puissent vous dédommager des agréments de vos occupations, de vos sociétés ; mais n’est-il pas vrai que vous désirez toujours la fin de cet état et que votre insatiable imagination voudrait obtenir ce que la vertu d’Adélaïde ne peut accorder. Ma froide tranquillité, je le vois, n’est pas propre à peindre le pesant fardeau qui tourmente l’existence d’un amant dans le moindre échec qui lui survient. Qu’Adélaïde s’absente pour quinze jours seulement, que deviendrez-vous ? Si un autre s’efforce de plaire à cet objet que vous croyez vous appartenir, que d’inquiétudes ! Si une mère alarmée trouve mauvaises de trop fréquentes visites qui font parler un public méchant, enfin, monsieur, que sais-je, cent petites autres choses qui frappent fortement un amant vous agitent. Souvent les nuits se passent sans sommeil, les repas sans manger, la Terre n’a point d’endroit pour contenir votre inquiétude extrême. Votre sang bouillonne, vous marchez à grands pas le regard égaré. Pauvre chevalier, est-ce là le bonheur ?… Je ne doute pas que si, aujourd’hui, dans l’extase que vous a occasionnée un serrement de main, vous ne trouviez cet état la suprême félicité ; je ne doute pas, dis-je, que demain, dans une humeur contraire, vous ne trouviez votre faiblesse insupportable.
Mais, chevalier, voilà votre position. S’il fallait défendre la patrie attaquée, que feriez-vous ? S’il fallait !… Mais à quoi êtes-vous bon ? Confiera-t-on le bonheur de vos semblables à un enfant qui pleure sans cesse, qui s’alarme ou se réjouit au seul mouvement d’une autre personne ? Confiera-t-on le secret de l’Etat à celui qui n’a point de volonté ?
Des Mazis. – Toujours des grands mots vides de sens ! Que fait à moi votre Etat, ses secrets ? En vérité, vous êtes inconcevable aujourd’hui. Vous n’avez jamais raisonné si pitoyablement.
Bonaparte. – Ah ! chevalier, que vous importent l’Etat, vos concitoyens, la société ! Voilà les suites d’un coeur relâché, abandonné à la volupté. Point de force, point de vertus dans votre sentier. Vous n’ambitionniez que de faire le bien et, aujourd’hui, ce bien même vous est indifférent. Quel est donc ce sentiment dépravé qui a pris la place de votre amour pour la vertu ? Vous ne désirez que de vivre ignoré à l’ombre de vos peupliers. Profonde philosophie ? Ah ! chevalier, que je déteste cette passion qui a produit une si grande métamorphose ? Vous ne songez pas que vous tirez vers l’égoïsme et tout vous est indifférent, opinions des hommes, estime de vos amis, amour de vos parents. Tout est captivé au tyran fort de votre faiblesse. Un coup d’oeil, un serrement de main, un baiser, chevalier, et que vous importe alors la peine de la patrie, la mauvaise opinion de vos amis ; un attouchement corporel… mais je ne veux pas vous irriter. Je le veux croire : l’amour a des plaisirs incomparables, des peines encore plus grandes peut-être, mais n’importe, considérons seulement l’influence qu’il a dans l’état de la société. Il est vrai, chevalier, que dans l’état des choses, notre âme, née indépendante, a besoin d’être formée, dégradée si vous voulez par des institutions, que, dès la naissance, l’attention que tous les législateurs ont donnée à l’éducation…, que nous sommes nés pour être heureux, que c’est la loi suprême que la nature a gravée au fond de nous-mêmes. Il est vrai que c’est la base qui nous a été donnée pour servir de règle à notre conduite. Chacun, né juge de ce qui peut lui convenir, a donc le droit de disposer de son corps comme de ses affections, mais cet état d’indépendance est vraiment opposé à l’état de servitude où la société nous a mis.
En changeant d’état, il a donc fallu changer d’humeur. Il a donc fallu substituer au cri de notre sentiment, celui des préjugés. Voilà la base de toutes les institutions sociales. Il a fallu prendre l’homme dès son origine pour en faire s’il se peut une autre créature. Croyez-vous, sans ce changement, que tant d’hommes souffriraient d’être avilis par un petit nombre de grands seigneurs et que des palais somptueux seraient respectés par des hommes qui manquent de pain ? La force est la loi des animaux ; la conviction celle des hommes. On convint, soit pour repousser les attaques des bêtes plus fortes, soit pour ne pas être exposé à se battre à chaque instant, l’on convint, dis-je, des lois des propriétés et chacun fut assuré au nom de tous de la propriété de son champ.
Cette conviction n’existait qu’entre un petit nombre d’hommes. Il fallait donc des magistrats, soit pour repousser les attaques des peuplades voisines, soit pour faire exécuter la convention reçue.
Ces magistrats sentirent le charme du commandement, mais les plus alertes du peuple s’y opposèrent. Ils furent gagnés et ainsi associés aux projets des ambitieux. Le peuple fut subjugué. Vous voyez l’inégalité s’introduire à grands pas ; vous voyez se former la classe régnante de la classe gouvernée. La religion vint consoler les malheureux qui se trouvaient dépouillés de toute propriété. Elle vint les enchaîner pour toujours. Ce ne fut plus par les cris de la conscience que l’homme devait se conduire. Non ! L’on craignit qu’un sentiment que l’on faisait tout au monde pour étouffer reprît le dessus.
Il y eut donc un Dieu. Ce Dieu conduisait le monde. Tout se faisait par acte de sa volonté. Il avait donné des lois écrites… et l’empire des prêtres commença, empire qui probablement ne finira jamais.
Que l’homme donc soit dégradé, triste vérité ! mais que l’état de société ne soit légitime, c’est ce dont l’on ne peut disconvenir. Le silence des hommes là-dessus est une approbation tacite que rien ne peut démentir. Vous avez vingt ans, monsieur, choisissez : ou renoncer à votre rang, à votre fortune et quitter un monde que vous détestez, ou, vous inscrivant dans le nombre des citoyens, soumettez-vous à ses lois. Vous jouissez des avantages du contrat, serez-vous infidèle aux autres clauses ? Ce ne serait pas vous croire honnête homme que d’en douter. Vous devez donc être attaché à un Etat qui vous procure tant de bien-être et, promettant à la fois de faire un digne usage des avantages qu’il vous a accordés, vous devez rendre heureux le peuple au-dessus duquel vous êtes et faire prospérer la société qui vous a distingué. Pour cela faire, mon cher chevalier, il faut que vous soyez toujours maître de votre âme et de vos occupations et il ne faut pas que l’aspect des affaires vous empêche. Pour cela faire, il faut que, guidé toujours par le flambeau de la raison, vous puissiez balancer avec équité les droits des hommes à qui vous devez. Pour cela faire, il faut que, prêt à tout entreprendre pour le service de l’Etat, vous soyez soldat, homme d’affaires, courtisan même si l’intérêt du peuple et de votre nation le demande. Ah ! que votre récompense sera douce ! Défiez alors les malignes vapeurs de la calomnie, de la jalousie ! Défiez hardiment le temps même ! Vos membres décrépits ne seront plus qu’une image imparfaite de ce qu’ils furent jadis et ils attireront cependant le respect de tous ceux qui vous approcheront. L’un racontera, dans sa cabane, le soulagement que vous lui avez apporté. L’autre, en faisant le récit des complots méchants, dira : S’il ne fût pas venu à mon secours, j’eusse péri du supplice des criminels. Chevalier, cesse de restreindre cette âme altière et ce coeur jadis si fier à une sphère aussi étroite ! Toi aux genoux d’une femme ! fais plutôt tomber aux tiens les méchants confondus ! Toi mépriser les peines des hommes ! Sentiment d’honneur, subjugue-le plutôt ! Estimé par tes semblables, respecté, aimé par tes vassaux la mort viendra t’enlever au milieu des pleurs de ceux qui t’entoureront, après avoir coulé une vie douce, oracle de tes proches et père de tes vassaux.
Des Mazis. – Je ne vous entends pas. Comment, monsieur, mon amour pourrait-il m’empêcher de suivre le plan que vous venez de tracer ? Quelle idée vous êtes-vous faite d’Adélaïde ?
Adélaïde, s’il faut pour remplir ses devoirs, soulager les malheureux ; s’il faut pour être vertueux, aimer sa patrie, les hommes, la société, qui plus qu’elle vertueuse ? Croyez-vous que je faisais le bien avec la froideur de la philosophie ? Quand la volonté d’Adélaïde sera le mobile qui me conduira, lui faire plaisir, la récompense… Non, monsieur, vous n’avez jamais été amoureux.
Bonaparte. – Je plains votre erreur. Quoi, chevalier, vous croyez que l’amour est le chemin de la vertu ? Il vous immétrigue à chaque pas. Soyez sincère. Depuis que cette passion fatale a troublé votre repos, avez-vous envisagé d’autre jouissance que celle de l’amour ? Vous ferez donc le bien ou le mal suivant les symptômes de votre passion. Mais, que dis-je, vous et la passion ne font qu’un même être. Tant qu’elle durera, vous n’agirez que pour elle et, puisque vous êtes convenu que les devoirs d’un homme riche consistaient à faire du bien, à arracher de l’indigence les malheureux qui y gémissent, que les devoirs d’un homme de naissance l’obligeaient à se servir du crédit de son nom pour détruire les brigues des méchants, que les devoirs du citoyen consistaient à défendre la patrie et à concourir à sa prospérité, n’avouerez-vous pas que les devoirs d’un bon fils consistent à reconnaître en son père les obligations d’une éducation soignée, à sa mère… Non ! chevalier, je me tairais si j’étais obligé de vous prouver de pareilles évidences…
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DE LA PATRIE
Parallèle entre l’amour de la patrie et l’amour de la gloire
J’ai à peine atteint l’âge de l’aurore des passions ; mon coeur est encore agité de la révolution que cette première connaissance des hommes produit dans nos idées et cependant vous exigez, mademoiselle, que je discute une question qui exigerait une connaissance profonde du coeur humain. Mais vous obéir n’est-il pas le seul titre qui puisse me maintenir digne de cette société intime ? Considérez donc ce discours moins comme un production de l’esprit et des connaissances que comme le tableau fidèle des sentiments qui agitent ce coeur où toute la perversité des hommes n’a peut-être pas encore pénétré.
Si j’avais à comparer les siècles de Sparte et de Rome avec nos temps modernes, je dirais : Régna ici l’amour et l’amour de la patrie. Par les effets opposés que produisent ces passions, on sera autorisé sans doute à les croire incompatibles. Ce qu’il y a de sûr du moins, c’est qu’un peuple livré à la galanterie a même perdu le degré d’energie nécessaire pour concevoir qu’un patriote puisse exister. C’est le point où nous sommes parvenus aujourd’hui. Peu de personnes croient à l’amour de la patrie. Quelle foule d’ouvrages n’a-t-il pas paru en montrer le chimérique ? Sentiments que produit l’action sublime du grand Brutus, n’êtes vous donc qu’une chimère ? Romains, premier peuple de la terre par la simplicité de vos vertus, la force de vos âmes et l’étendue de vos connaissances naturelles, vous vous êtes tous trompés. Vous avez élevé des autels à Brutus comme à un héros. Eh bien ! aprrenez de moi que ce grand homme n’est qu’un fou qu’égara l’amour-propre, lorsque, au milieu de votre place publique, il enfonça dans le sein de ses fils le glaive vengeur des lois. Vous crûtes qu’il était animé de cette passion qui vous transportait tous. Eh bien ! cette passion sublime que vous nous vantez tant n’est que de l’amour-propre, et vous avez été assez peu habiles pour vous laisser séduire ainsi par une férocité sans exemple. L’on vit la vanité de l’emporter sur l’amour paternel. Voilà messieurs, la sensation que j’éprouve à la vue de la question que je dois approfondir. L’amour de la gloire, dit-on, a produit cette foule d’actions que la postérité a célébrées à juste titre, mais auxquelles nos histoires opposent les produits de l’amour de la patrie…
L’amour de l’estime des hommes ou de la gloire peut-il avoir produit cette foule d’actions que la postérité à célébrer sous le nom d’amour de la patrie, ainsi le prétendent nos sophistes modernes. Si cependant nous venons à en démontrer l’insuffisance, que sera-ce donc ? Quel aura donc été le mobile des célèbres patriotes qui tiennent une place si distinguée dans les annales de l’Univers, quelles seront les passions primitives constituant le patriotisme ?
Tel, mademoiselle, serait l’objet des idées que je vais développer sous vos auspices. Puissent-elles en être dignes, heureux toutefois de m’avoir procuré le plaisir de captiver l’attention de la société intime.
Ouvrons les annales des Monarchies. Notre âme s’enflamme sans doute au récit des actions de Philippe, Alexandre, Charlemagne, Turenne, Condé, Machiavelli et tant d’autres hommes illustres qui, dans leur héroïque carrière, eurent pour guide l’estime des hommes ; mais quel sentiment maîtrise notre âme à l’aspect de Leonidas et de ses trois cents Spartiates. Ils ne vont pas un combat, ils courent à la mort pour le sort qui menace leur patrie ; ils affrontent les forces réunies de l’Orient pour obéir, premiers soutiens de la liberté ; mais toi, qui aujourd’hui enchaînes à ton char le coeur des hommes, sexe dont tout le mérite consiste dans un extérieur brillant, considère ici ton triomphe et rougis de ce que tu n’es plus. C’est dans tes annales que je vais trouver la plus grande preuve de l’insuffisance de la gloire. Quelles sont les héroïnes qui triomphent au milieu de Sparte. Je les vois, à la tête des autres citoyens, célébrer par des cris d’allègresse le bonheur de la patrie. « O Thermopyles, vous renfermez le tombeau de mon époux, puissiez-vous rendre le même office à mon fils si des tyrans menaçaient jamais ma patrie. » Quoi ! vous que je vois couronnés de myrthe, vous êtes les efforts sublimes du plus grand héroïsme. Quoi ! ce ne serait donc autre que le vil amour de la gloire ? Mais l’amour de la gloire n’est il pas l’envie d’avoir son nom chanté par la renommée ! Avaient-elles rien de pareil à espérer les femmes spartiates ? N’étaient-ce pas les effets ordinaires que produisait la nouvelle d’une bataille que l’envie de leurs proches d’y être ? Ceux-là, dit Plutarque, se montraient triomphant dans les temples et les places publiques, tandis que les mères et les femmes de ceux qui étaient échappés n’osaient se montrer. Oui, voilà des choses dignes de la patrie. Vous voyez donc bien que l’amour de la gloire ne peut pas avoir été le moteur des Spartiates.
Mais, si l’amour de la gloire a été le principe des actions des républicains et des monarchistes, d’où vient la différence étonnante des sentiments qui nous animent au seul récit, d’où vient la différence même des actions ? Aristide, le plus sage des Athéniens, Thémistocle, le plus ambitieux, encore la terreur du Grand roi, et tous deux sauveurs et restaurateurs de leur patrie, sont récompensés par un exil ignomineux. « O Dieux, puissiez-vous oublier l’injustice de mes compatriotes autant que moi-même je leur pardonne, dit Aristide en jétant un dernier regard sur son ingrate et chère patrie. » -« Dis à mon fils, disait Cimon en subissant son arrêt ignomineux, que, n’étant plus citoyen, je ne lui suis plus rien et que Athènes est toujours sa mère patrie.
Thémistocle préfère avaler la coupe fatale à se voir à la tête de troupes de l’Orient et à se trouver à portée de venger son outrage particulier. Il pouvait espérer sans doute subjuguer la Grèce. Quelle gloire dans la postérité et quelle satisfaction pour son ambition ! Mais non, il vivait au milieu des fastes de la Perse en regrettant toujours son pays. « O mon fils, nous périssions si nous n’avions péri ! » Phrase énergique qui doit être à jamais écrite dans le coeur d’un vrai patriote.
A ces traits d’héroïsme comparerons-nous les actions de Robert d’Artois, de Gaston d’Orléans, du grand Condé et de cette foule de Français qui ne rougirent pas de dévaster les campagnes qui les avaient vu naître. Les uns avaient été nourris dans les préceptes du patriotisme et les autres de l’amour de la gloire. Osez prononcer que le patriotisme n’est rien. Rien ne produisit-il jamais quelque chose ?
Dion possède une grande fortune, une race distinguée, une considération acquise. Que manque-t-il à son bonheur ? Ames énervées, vous pouvez deviner et vous osez parler ! Sa patrie est esclave d’un tyran qui est son allié, d’un tyran qui l’aime et le considère, mais enfin d’un tyran. Les feux brûlants du patriotisme embrasent sa grande âme. Enflammé par le feu brûlant du patriotisme, le disciple du grand Platon, le sévère Dion quitte les lieux fortunés de l’Attique. Adieu, plaisirs qui charmiez sa philosophie. Il sacrifie sa tranquillité. Un tyran règne dans sa patrie. Fuis, Denys, fuis donc ces rives, ci-devant le théâtre de tes cruautés. Dion a déjà arboré dans Syracuse l’étendard de la Liberté, mais l’effet surprenant de la jalousie, ce monstre effroyable que vomirent les enfers dans leurs fureurs se glisse dans le coeur des Syracusains. Les insensés ! Ils osent prendre les armes contre leur sauveur ; ils attaquent de toutes parts la légion qui vient de les délivrer et qui reste fidèle à ce héros qui la conduit. Quels sont cependant les sentiments qui l’animent ? « Etrangers, qui prenez ici la défense de mes jours, s’écrie Dion, ne versez pas, je vous en conjure, le sang de mes compatriotes ! » Est-ce l’amour de la gloire qui lui a dicté cette harangue sublime ? Qu’eût fait le grand Condé ?… Dites, messieurs, que croyez-vous qu’eût fait le grand Condé dans cette circonstance ? Syracuse ! Syracuse, tu aurais porté longtemps la peine de ton ingratitude. Liée à son char, tu eusses servi à jamais de monument à sa gloire et la postérité n’aurait sans doute qu’applaudi sa bravoure. Mais ce ne sont pas là les sentiments qui agitent un coeur où n’est que l’amour de la patrie. Tandis que ses barbares concitoyens font usage, pour lui ravir la vie, de ces armes que lui même leur a fournies : « Etrangers, s’écriait Dion, qui défendez ici mes jours, je vous en conjure ne versez pas le sang de mes concitoyens. » Le protecteur de la liberté n’est plus dans la cité.
Déjà les sattelites des tyrans font couler des flots de sang. La liberté chancelle dans sa dernière forteresse. Dion jouit de son triomphe, voit à ses genoux ces ingrats qui, parjures, en voulaient à sa vie. Mais quoi ! tu pleures ; des larmes ont coulé de tes stoïques yeux ! Quoi ! ces tigres qui, pour prix de ta première défaite, sont altérés de ton sang, ces tigres arrachent tes larmes ! Sentiment de la patrie, que tu es puissant sur les coeurs ! Ainsi que le soleil dissipe le plus épais brouillard, ainsi ô grand Dion, ton aspect dissipa la nombreuse cohorte du tyran. Qu’avec plaisir tu vis couler ton sang ! Il scella pour longtemps la liberté de Syracuse. Vous voulez que l’amour de la goire ait produit ces sublimes larmes ! Vous voulez qu’il ait produit cette courte harangue où règne un sentiment que Jesus-Christ a seul depuis renouvelé ! Mais non ! non ! L’amour de l’immortalité est un sentiment personnel qui céda toujours à l’amour-propre blessé. Turenne, le héros de la France, cède à un intérêt personnel et se rue contre la patrie, -mais que dis-je, cède ? donne une nouvelle force aux effets de la vengeance de l’amour-propre. C’est un sentiment liable avec les passions les plus opposées ! Condé aux Dunes était animé par l’amour de la gloire comme à Rocroy et à Nordlingue.
Faut-il encore chercher des preuves de l’insuffisance de l’amour de la gloire ? Ouvrons les annales de cette petite île trop peu connue sans doute pour l’honneur des temps modernes : un Corse est condamné à périr sur l’échafaud. Ainsi l’ont voulu les lois de la République. Outre les liens du sang, ceux de la reconnaissance et de la plus tendre amitié liait étroitement son neveu à son sort. Dans le transport qui l’anime, il se jette au genoux du premier magistrat, du grand Paoli. « M’est-il permis de plaider pour mon oncle ? Les lois son-elles faites pour faire notre malheur ? Il n’est que trop coupable sans doute, mais nous offrons 2.000 sequins pour le racheter. Jamais il ne rentrera dans l’île. Nous en fournirons 400 tant que durera le siège de Furiani. -Jeune homme, lui répond Paoli, vous êtes Corse. Si vous croyez que cela puisse faire honneur à la patrie, ce jugement va se prononcer et je vous accorde sa grâce. » Ce bon jeune homme se lève. Les convulsions de son visage exprime assez le désordre de son âme. « Non ! non ! Je ne veux pas acheter l’honneur de la patrie pour 2.000 sequins. O mon oncle, je périrais plutôt dans tes bras. Sous quelle face que j’envisage cette héroïque réponse, je ne puis y apercevoir aucune trace de gloire.
Si je continuais, Mademoiselle, à parcourir les annales de cette illustre nation, quels traits de patriotisme n’y trouverai-je pas ? Gaffori, qui joignit à l’âme de Brutus l’éloquence de Cicéron, tu fais au patriotisme le sacrifice de ton amour paternel. Ni l’ambition, ni l’attachement à ses propriétés, ni même ses fils prisonniers des tyrans ne purent tenter Rivorella. « Quand à mes fils, il faudra bien sans doute qu’on me les rende. Je considère le reste comme indigne, m’étant personnel et incomparablement au-dessous des engagements que j’ai contractés avec mes compatriotes ; je meurs content puisque je meurs pour mon pays. Paoli, dans mes bras ! Je serai à côté de Gaffori, et des autres illustres patriotes. » Quelques Amphipolitains firent part à Argileonis de la mort de son fils Brasidas qu’ils avaient vu périr : « sans doute, non, Sparte, n’en a point encore un pareil. -Ne dites point cela, mes amis ; mon fils était un digne citoyen, je veux le croire, mais Sparte en compte dans ses murs encore plus de soixante-dix encore plus dignes d’elle. »
Ce sont les réponses privées où se peint le sentiment. Chaque trait, chaque mot d’un Spartiate peint un coeur embrasé du plus sublime patriotisme. Vous qui prétendez au titre de bons patriotes, qui aspirez à en avoir le sentiment, voici votre baptème. Il n’appartint sans doute qu’à ces âmes privilégiées de la vertu, à ces hommes qui, par la force de leurs organes, peuvent maîtriser toutes leurs passions et par l’étendue de leur vue gouverner les Etats, de marcher sur les traces de Cincinnatus, des Fabricius, des Caton, des Thrasybule ; mais vous, qui prétendez simplement au titre de bons citoyens, méditez Pedaratus. Un vain titre est refusé aux Bouillon et Turenne, le héros de la France, Turenne, le rempart invincible de la patrie, Turenne, qu’elle a comblée de ses faveurs, eh bien ! Turenne réduit en cendres les chaumières qu’il avait si longtemps défendues. Des honneurs refusés à Condé blessent sa gloire, et Condé déploie l’étendard de la révolution. Voilà ce que produisit, dans les deux plus grands hommes de la France, la soif de l’ambition. Que Pedaratus, simple citoyen d’une république célèbre, est dans ce moment au-dessus de ces illustres monarchistes ! Il demande avec instance au tribunal du peuple d’être élu un des Trois Cents, première magistrature de la République. Il est refusé. « Sparte, chère patrie, tu renfermes donc trois cents citoyens plus honnêtes hommes que moi. Dieux soyez témoins de mon allègresse ! Ah ! Puissé-je être le dernier en amour que je consentirai volontiers à ce prix à n’être que citoyen. Demeurez enfin confondus, prôniste de la gloire. Rendez hommage à la vérité. Car les Spartiates affectaient-ils tous ces sentiments sublimes pour s’acquérir de la gloire ? C’était donc un sentiment joué et joué par toute une ville ? Mais pour peu que vous en connaissiez le génie des hommes, vous verrez que cette imposture n’aurait pas duré longtemps. Le ridicule de l’ennui même d’affecter un sentiment que l’on n’a pas aurait bientôt fait que le peuple au moins aurait secoué le joug inutile…
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (5)
VII
Le Comité supérieur céda bientôt la place à l’administration régulière qui fut organisée selon les décrets de l’Assemblée nationale. Mais le maître de la Corse, c’était Paoli. Rappelé de l’exil par la Constitutante, avec tous les Corses qui s’étaient expatriés après la conquête française, imposant encore, malgré ses soixante-six ans, par sa haute taille, par son air résolu et par le regard pénétrant de ses yeux bleus, Paoli avait abordé, le 17 juillet 1790, à Bastia au milieu de l’enthousiasme délirant des insulaires, et dès lors, bien qu’il ne voulût être qu’un simple citoyen, il fut pour les Corses, comme auparavant, le « général, » le « père » ou le Babbo. Napoléon Bonaparte, dans son exaltation juvénile, le nommait le « père de la liberté, » l’ « homme créé pour la consolation commune. » Giubega l’appelait « notre héros », nostro eroe : « Le généreux accueil, écrivait-il, et tous les témoignages d’estime que Paoli reçus à Paris justifient les sentiments de respect et d’attachement que la Corse a toujours eu pour lui. »
Néanmoins Giubega comprenait que Paoli serait le véritable roi de Corse. A vrai dire, c’était la meilleure solution du problème. Pourquoi ne pas se servir de Paoli puisque les Corses voyaient en lui, suivant l’expression d’un de nos fonctionnaires, leur dieu et leur unique ressource ? Mieux valait Paoli que l’anarchie, et Paoli avait mis sincèrement à la disposition de la France son influence et son nom. « Il faut, s’écriait Barère, que Paoli lui-même apprenne à devenir Français. » Et Paoli, ainsi que Napoléon Bonaparte et tous les Corses, était devenu Français. Il ne parlait des Français que comme des compatriotes et des frères ; il vantait le « titre glorieux » de Français que les Corses avaient désormais ; il assurait qu’ils regardaient maintenant le soldat français non comme l’instrument d’une administration arbitraire et le suppôt de la tyrannie, mais comme le défenseur de leur île ; qu’ils seraient dignes de la nouvelle Constitution ; que les lois rendues par l’Assemblée nationale leur retraçaient l’image de leur précédent gouvernement embelli et perfectionné. En toute circonstance, il affirmait sa loyale affection pour le grand pays dont dépendait son petit pays.
Mais la réaction ne pouvait s’éviter. Paoli fut entraîné par les paolistes. Tout pour Paoli et ses amis, tel était le mot d’ordre. Gaffori, mandé à Bastia par le Comité supérieur, se vit arrêté et envoyé en France. D’autres personnages qui passaient pour aristocrates furent embarqués de force ou obligés de s’éloigner. On évinça les français de tous les emplois, et que de maledictions furibondes lancèrent les meneurs du congrès d’Orezza contre le système d’antan ! Giubega était venu, comme électeur du district de l’île Rousse, à cette assemblée qui dura dix-huit jours, du 9 au 27 septembre. Elle n’avait d’autre mission que de nommer les membres du Département et de désigner le chef-lieu. Elle ne nomma que des paolistes avérés, elle ne désigna pas de chef-lieu, et combien de motions illégales elle prit et qui sans nul doute blessèrent Giubega jusqu’au fond du coeur puisqu’elles condamnaient impitoyablement son passé ! Elle ne se borna pas à choisir les administrateurs des districts et parmi eux des bannis qui n’étaient ni propriétaires, ni domicilés dans l’île depuis un an ; à donner au Babbo le commandement de toutes les milices corses ; à décider que les deux députés du tiers, Saliceti et Cesari, seraient, l’un, procureur général syndic, et l’autre, général en second des gardes nationales ; à désapprouver avec éclat la conduite des deux députés de la noblesse et du clérgé, Buttafoco et Peretti. Elle vota la suppression du régime provincial qu n’avait rendu que de « funestes services à la tyrannie. » Elle exprima hautement sa haine contre l’ancien gouvernement royal -ce gouvernement dont Giubega avait été l’un des plus fermes appuis- en déclarant qu’il avait exercé « le plus cruel despotisme. » Elle cassa toutes les délibérations -ces délibérations que Giubega avait souvent inspirées- prises par les Etats en faveur des généraux Marbeuf, Narbonne et Sionville, ces « principaux ennemis de la nation corse qui avaient poursuivi arbitrairement les meilleurs citoyens ! » Elle demanda que la mémoire de tous ceux qui avaient été » les victimes du pouvoir judiciaire et militaire parce qu’il avaient désiré la liberté de la patrie » fût réhabilitée. Elle proposa de révoquer les concessions d’étangs et de terres communales prononcées par la royauté -comme la concession de l’étang de Stagone que Giubega avait désséché pour planter sa pépinière. C’était, a dit Napoléon l’esprit du temps. Joseph Bonaparte ne fit-il pas dans ce congrès d’Orezza la motion d’élever une pyramide qui porterait les noms des héros de 1769 et des martyrs de l’indépendance ainsi que la date de la régénération du peuple corse et le témoignage de l’indignation publique contre les traîtres ? Lui aussi, de même que Napoléon, oubliait l’attitude de son père ; lui aussi oubliait que les résolutions des Etats dénoncées à l’assemblée d’Orezza comme « écrites avec l’encre de la flatterie et de la peur » avaient été approuvées par son père ; lui aussi oubliat que l’inscription latine de Bastia qui rappelait l’amour des Corses pour Marbeuf, avait été votée par son père et qu’elle venait d’être effacée et remplacée ainsi : « Le voilà détruit, ce monument que le vil mensonge et la vénale adualtion ont dédié au tyran de la Corse gémissante ! »
Giubega avait gardé le silence. Il sentait qu’il ne jouerait plus aucun rôle. Les électeurs le nommèrent juge à La Porta ; il refusa la place ; l’ancier greffier en chef des Etats ne pouvait déchoir, et peut être, dans sa maison de Calvi où il se retira, se prenait-il à regretter l’époque où il était l’un des fonctionnaires les plus considérés et les plus influents de son pays natal. Ce qui semble sûr, c’est qu’il crut désormais et à tort- que Paoli n’avait d’autre visée que celle de son intérêt personnel ; d’autre but que la puissance suprême, d’autre désir que de rendre à la Corse son indépendance et de restaurer le gouvernement national. Giubega aurait dit volontiers, comme Buttafoco, que Paoli était un renard qui perdait son poil, mais qui ne perdait pas sa malice. Et Paoli, de son côté, n’aimait pas Giubega. Il lui reprochait ses attaches génoises. Même durant la guerre de l’indépendance, il suspectait son zèle et il ne l’avait employé qu’à son corps défendant et sur les instances du chanoine Salvini. Il lui fit bonne mine en 1790 ; mais aux yeux de Paoli, Giubega était un « rallié », un de ces Corses qui, de même que Charles Bonaparte, de même que Buttafoco et Gaffori, avaient courtisé Marbeuf ou sollicité les faveurs des bureaux et dans le secret des coeurs, il lui en voulait d’avoir servi le despotisme royal. Les Corses que Paoli affectionnait, fort naturellement, et qu’il préférait aux autres, c’étaient ceux qui, selon ses propres termes, avaient sucé les maximes de la liberté avec le lait. Quant aux Giubega, aux Arena, aux Bonaparte, il les nommait, en 1793, des patriotes de quatre jours, des esclaves qui ne s’étaient émancipés que depuis quatre années, des gens dont l’opinion était soumise à l’influence des circonstances et des événements extérieurs.
Quoi qu’il en soit, Giubega combattit les desseins de Paoli sur les forteresses de l’île. Lorsque, dans les premiers mois de 1792, ils formèrent quatre bataillons de volontaires corses, Paoli, ainsi que le Directoire du département, voulu les mettre en garnison dans les quatre présides, à Bastia, à Ajaccio, à Calvi, à Bonifacio, et au château de Corte où il n’y avait que des troupes de lignes. Non que Paoli et le Directoire eussent des projets de révolte contre la France : un des membres du Directoire était Joseph Bonaparte qui professait des sentiments tout français. Mais ils désiraient exercer leur droit. Les volontaires n’était-ils pas destinés à la défense du pays ? Pourquoi la Corse ne serait-elle pas protégée par des milices corses ? Pourquoi les nouveaux bataillons ne prendraient-ils pas contact avec les anciens régiments ? Et Paoli, tout bas, remarquait avec assez de justesse que la fidélité des troupes de ligne pouvait être en défaut et que certains de leurs officiers étaient soupçonnés d’aistocratie, disposés soit à émigrer, soit à trahir. Mais les commandants des forteresses, ne connaissaient que leur consigne, refusèrent d’ouvrir leurs portes. Le Directoire du département demandait que les volontaires du 3e bataillon, commandé par Achille Murati -ce Murati à qui, selon le jeune et exubérant Napoléon de 1791, il ne manquait pour être un Turenne que des circonstances et un théâtre plus vaste- eussent accès à la citadelle de Calvi. Le vieux commandant Maudet répondit rudement qu’il n’obéirait pas aux réquisitions du Directoire, et, lorsque les députés de la Corse joignirent leurs plaintes à celle du département, il répliqua que les vieux renards valaient bien les jeunes et que, grâce à lui, dans le trouble et le désarroi des choses, Calvi était la seule place de l’île où le sang n’avait pas coulé. Giubega encourageait Maudet ; il commandait la garde nationale de la ville, et il avait un grand ascendant sur la municipalité ; sous l’influence de Giubega, tout Calvi vantait la prudence de Maudet et son dévouement à la loi. Vainement Paoli envoyait un Calvais, un de ses meilleurs amis confidents, l’actif et remuant Panattieri, qu’il chargeait de résister aux mesures de Giubega et de gagner la population. Il dut reconnaître qu’il ne pouvait rien contre la « conjuration » et que « l’esprit de Giubega regnait toujours à Calvi » : lo spirito di Giubega regna ancora in Calvi !
C’est que Giubega opposait de solides arguments à Paoli. Il remontrait ques les volontaires corses commettaient de graves désordres et volaient l’argent de la nation, qu’ils étaient indiscipilnés, très mal organisés, le rebut des villes et de la montagne, la garde prétorienne du Directoire, et Paoli, malgré lui, donnait raison à Giubega : « L’assertion de Giubega avait quelque fondement, l’asserzione di Giubega aveva qualche fondamento. » Puisque Paoli, ajoutait à Giubega, voulait mettre des gardes nationales dans les citadelles, pourquoi recourait-il aux volontaires de Corse et non aux volontaires du continent ? Pourquoi les prenait-il dans l’île et non en France ? Si la guerre éclatait, « quelqu’un ne pouvait-il penser à séparer la Corse de la France ? »
Ce quelqu’un, c’était Paoli. Aussi, dans sa correspondance de 1792, Paoli se plaint-il très vivement de Giubega. Il lui reproche d’être un misérable aristocrate, de pactiser avec les gens de Bastia -qui n’étaient nullement paoliste- de renouer avec ses ennemis de jadis, Buttafoco et Gaffori. « Giubega, écrit Paoli, m’accuse de tahison ; si je le rencontre, je veux le rendre plus petit qu’un grain de mil ; c’est encore un de ceux qui, lorsqu’on les montre au doigt, deviennent zéro ! » Et, à son tour, il accuse Giubega d’être un royaliste de la vieille roche : Giubega, prétend Paoli, avait dit dans ses discours que, si la contre-révolution se produisait, la Corse devrait se détacher de ceux qui tenaient ferme pour la liberté et la Constitution ; selon Giubega, le gouvernement précédent, le gouvernement de Marbeuf et des Boucheporn, convenait mieux à l’île que le gouvernement actuel.
Paoli l’emporta ; il fit entrer les volontaires dans les forteresses. Sous la Constituante, sous la Législative et dans les commencement de la Convention, il eut toujours la confiance des ministres et de l’Assemblé, et, comme disait Saliceti, une confiance sans limites. Il n’était pas du tout, à cette époque, le « machiavéliste » qu’ont représenté ses adversaires, et, nous le répétons, il ne pensait aucunement à séparer la Corse de la France. S’il avait l’ambition de faire seul le bien de la nation Corse, cette ambition n’était-elle pas satisfaite ? Il fut, le 11 septembre 1792, nommé par le Conseil exécutif lieutenant-général et commandant de la 23e division militaire, et il présidait en même temps l’administration départementale ; il avait donc tous les pouvoirs, et, au nom de la France, il gouvernait la Corse comme avant la conquête. Jusqu’à sa rébellion, il eut pour la France l’attachement, qu’il lui avait promis ; jusqu’au dernier jour, il sentit et déclara que la force de la Corse venait de son intime union avec la France.
Mais il s’appuya sur Pozzo di Borgo, sur Cesari ; sur Panattieri, sur Leonetti, et un grand parti se forma contre lui. A la tête de ce parti était Saliceti qui voulait dominer l’île : après avoir été l’admirateur de Paoli, Saliceti devint, selon le mot de Volney, son rival, et il trouva des alliés : Gentili, les Arena, les Bonaparte, tous ceux que Paoli avait écartés. Cosas di Corsica ! Paoli, Pozzo et autres souhaitaient de rester fidèles à la France, et ils n’avaient aucune arrière-pensée d’indépendance et de soumission à l’Angleterre. S’ils se révoltèrent, ce fut, comme disait Pozzo, contre Saliceti et compagnie ; ce fut comme disait le Conseil supérieur du département, contre les intrigants qui désiraient « despotiser en Corse » et « accaparer le crédit ; » ce fut, comme disait Paoli, contre la cabale, contre l’arbitraire et les abus de l’autorité. « Mes ennemis, s’écriait Paoli, me qualifient de tyran parce qu’ils voient en moi un obstacle à leurs projets ambitieux ; ma tyrannie n’existe pas, ou, si elle existe, il faudrait qu’il y eût dans chaque département des gens qui l’exercent dans mon style ! »
Le parrain de Napoléon appartenait au parti qui s’était formé contre Paoli. Il n’intervint pas dans la lutte qui s’engagea sourdement d’abord, puis ouvertement, entre Saliceti et Paoli dans les premiers mois de 1793. Pourtant, il eut, dit-on, en septembre ou en octobre 1792, une entreveu avec le Babbo. Pozzo di Borgo avait obtenu du ministre Servan le brevet de lieutenant-général pour Paoli : ce grade, avait dit Pozzo, était nécessaire au babbo qui, fort de son influence et du commandement des troupes, verrait toutes les intrigues se taire en sa présence. Mais Paoli, lieutenant-général, dépendait du ministre de la guerre et du général en chef de l’armée du Midi. Ses ennemis accueillirent donc sa nomination sans déplaisir : ils le « tenaient » ; » Paoli n’était plus au dessus des lois ; il se soumettait du moins aux lois militaires. Telle fut la pensée de Giubega. Lorsqu’il apprit que Paoli avait envie de refuser les fonctions que lui offrait le Conseil exécutif, il courut à Rostino et pria Paoli d’accepter le fardeau et de sacrifier une fois encore son repos personnel à la sécurité publique. N’était-il pas le seul homme qui inspirait la confiance, le seul qui pût dans le danger suprême rallier les Corses et les mener au combat, le seul qui connût les vrais patriotes et sût les employer au salut du pays ? Ne devait-il pas conséquemment avoir en main toutes les forces de l’île ? Giubega, écrit un contemporain, se doutait que Paoli deviendrait bon gré mal gré coupable envers la loi.
On n’a du reste que peu de détails sur les derniers jours de Giubega. Il fit à la fin de 1792 le voyage de Paris, et, le 18 mars 1793, devant des gens qui parlaient de la mission des trois députés, Saliceti, Delcher et Lacombe Saint-Michel, envoyés en Corse par la Convention, il disait tout haut que le conflit ne pouvait s’éviter, que Paoli n’était pas homme à se soumettre ni à se démettre, et n’obéirait pas aux ordres des commissaires. Mais lorsque Giubega revint à Calvi, il déraissonait, tant l’exécution de Louis XVI avait troublé, bouleversé son esprit !
L’événement produisit, en effet, sur tous les Corses une profonde impression d’horreur. Des six députés de l’île, un seul Saliceti, vota la mort du monarque ; les cinq autres demandèrent sa détention, et Chiappe assurait que la fatale sentence annonçait la perte de la République et un nouveau roi après de nouveaux carnages. Paoli ne disait-il pas dans ses conversations intimes que les Corses devaient être les ennemis, et non les bourreaux des rois ? Napoléon Bonaparte ne déplorait-il pas devant Sémonville le grand crime que la Convention avait commis ? Muselli, faisant l’oraison funèbre du frère de Paoli, n’affirmait-il pas que l’acte du 21 janvier avait excité l’indignation de ses compatriotes ? Leonetti, le neveu de Paoli, attaquant les murs de Calvi, ne criait-il pas aux défenseurs de la ville qu’il paieraient cher le sang de leur roi ?
VIII
Ce fut à Calvi, chez les Giubega, au mois de juin 1793, que les Bonaparte vinrent chercher un asile, lorsqu’ils furent chassés d’Ajaccio par les paolistes, lorsque la Consulta de Corte, composée de mille délégués des communes, déclara qu’ils étaient nés de la fange du despotisme, qu’ils avaient été nourris et élevés sous les yeux et aux frais du pacha luxurieux qui commandait dans l’île, qu’ils avaient secondé les efforts et appuyé les impostures des Arena, qu’ils seraient, par suite, ainsi que les Arena, abandonnés à leurs remords et à l’opinion publique, qui, d’ores et déjà , les avait condamnés à une perpétuelle exécration et infamie.
On sait que Napoléon courut quelque danger. Il avait pris la voie de terre, et il s’égara dans le maquis. Selon la tradition, un faiseur de fagots le remit dans le bon chemin et le conduisit à Calvi, chez Laurent Giubega. Depuis, et jusqu’à sa mort, cet homme ne parla que de sa rencontre avec Napoléon et on ne l’appelait plus que Napolino ou le petit Napoléon.
Le frère de Laurent, Damien, reçut Bonaparte avec amitié. Les filles de Mme Letizia étonnèrent, dit-on, la domestique par leurs habitutdes de propreté et leurs petits talents : sur l’ordre de leur mère, elles allaient l’une après l’autre à la cuisine faire le plat doux du dîner.
Laurent mourut au mois de septembre suivant. Il avait épousé durant son séjour à Gênes une demoiselle noble de la ville, Marie Rogliano, à qui Napoléon Bonaparte faisait ses compliments en ces termes à la fin d’une lettre de 1789 : « Permettez que Madame reçoive ici le serment de mon hommage. » Plusieurs enfants étaient nés de ce mariage et morts en bas âge. Une fille avait survécu, Annette, qui devait dit-on épouser le beau Joseph Bonaparte. Pendant le siège de Calvi, en 1794, elle fut blessée à la cuisse par un éclat de bombe. Elle en resta boiteuse : ce qui ne l’empêcha pas de se marier deux fois, la première avec un veuf, le docteur Massoni, la seconde avec un officier de l’administration, nommé Durante. Elle n’avait eu qu’une fille, morte très jeune. Lorsqu’elle décéda, en 1851, à Calvi, elle était dans sa soixante-douzième année, et cette reine manquée aurait connu la misère si ses parents ne l’avaient secourue.
Le frère de Laurent, Damien, député par l’ordre de la noblesse à la cour, en 1779, et, comme nous l’avons vu, assesseur du juge royal Schouller avant la Révolution, exérçait la profession de médecin, et, en 1793, le représentant Lacombe Saint-Michel louait le zèle de sa femme et de sa fille qui servaient d’infirmières et donnaient l’exemple du zèle le plus charitable. Damien était devenu médecin adjoint à l’hopital de Calvi aux appointements de 2.000 livres, et Lacombe assurait qu’il se rendait très utile, qu’il avait sans Calvi la plus grande influence, qu’en Corse un chef de parti est tout et que la masse du peuple ne voit que par ses yeux. Après la capitulation de Calvi, il se rendit à l’armée d’Italie, et Desgenettes qui le vit alors, le compare à un vieux lion. Desgenettes ajoute qu’il avait avec lui une douzaine d’enfants et de petits-enfants, qu’il était était estimé pour son savoir et qu’il se vantait de l’antiquité de sa maison, casa antichissima, et du rôle qu’il avait joué dans la guerre de l’indépendance en défendant Calvi contre les Génois. Damine Giubega fut plus tard sous-prefet de Calvi et président du tribunal civil.
Deux de ses fils, Vincent et Xavier ont laissé quelque réputation. Vincent, docteur en droit civil canonique, attaché à l’envoyé de France près la république de Gênes, puis prêtre et vicaire général de l’évêché de Sagone, fut, lorsque l’île redevint française, juge au tribunal de cassation. Il mourut en 1800 à l’âge de 39 ans, trois mois après que Bonaparte l’eût envoyé siéger au tribunal d’appel d’Ajaccio. Ses poésies italiennes, gracieuses, pleines de naturel et de goût, l’ont fait surnommé l’Anacréon et le Parny de la Corse. Il en détruisit un grand nombre par scrupule religieux. On admire surtout ses sonnets et le poème qui célèbre le retour de Paoli et son débarquement à Bastia en 1790.
Xavier ou François-Xavier, capitaine d’une compagnie franche qui s’appelait la compagnie de Giubega, employé à l’armée d’Italie en 1795 comme adjoint aux adjudants généraux, entré en 1796 dans l’administration des vivres et, de 1798 à 1799, agent général des contributions et finances à la suite de l’armée française à Rome, fut sous-préfet de Calvi et, à la fin de l’Empire, préfet de Corse. Lorsque Napoléon quitta l‘île d’Elbe il nomma Xavier Giubega l’un des douze membres de la junte et, le 6 avril 1815, lui confia de nouveau la préfecture du département. Aussi Xavier Giubega fut-il, après les Cent-Jours, comme « homme dangeureux et intelligent » envoyé en surveillance à Toulon, puis à Montpellier.
Le fils de Xavier, Pascal-Hiacynthe, boursier à Paris au Lycée impérial, secrétaire de son père et délégué par la junte en 1815 pour arborer dans l’arrondissement de Calvi le drapeau tricolore et « dissiper la faction anglo-corse, » secrétaire -général du département de la Corse en 1830, sous-préfet de Sartène, de Corte et de Sisteron sous le règne de Louis-Philippe, révoqué par le commissaire du gouvernement en février 1848, réintégré bientôt sur la recommandation du préfet Aubert, fut, durant, dix ans, du mois d’août 18488 au mois d’août 1858, sous-préfet de Bastia. Il aimait à rappeler q’un lien de parenté religieuse et spirituelle unissait les Giubega aux Bonaparte. Il eut plusieurs enfants : Laurent qui combattit aux journées de février 1848 et « sortit de la lutte avec une main blessée et des vêtements en lambeaux, » Pierre, naguère conseiller à la Cour d’appel d’Aix, et une fille mariée à un Calvais, Pierre-Marie Rossi, cousin germain du prefet Aubert.
août 1, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LA CORSE
C’est aujourd’hui que Paoli entre dans sa soixante-et-unième année. Son père Hiacinto Paoli aurait-il jamais cru, lorsqu’il vint au monde, qu’il serait compté un jour au nombre des plus braves hommes de l’Italie moderne. Les Corses étaient dans ces temps malheureux (1725) écrasés plus que jamais par la tyrannie génoise. Avilis plus que des bêtes, ils traînaient dans un trouble continuel une vie malheureuse et avilissante pour l’humanité. Dès 1715, cependant, quelques pièves avaient pris les armes contre les tyrans, mais ce ne fut qu’en 1729 que commença proprement cette révolution où se sont passés tant d’actes d’une intrépidité signalée et d’un patriotisme comparable à celui des Romains. Eh bien ! Voyons, discutons un peu. Les Corses ont-ils eu droit de secouer le joug Génois ? Ecoutons le cri des préjugés : les peuples ont toujours tort de se révolter contre leurs souverains. Les lois divines le défendent. Qu’ont de commun les lois divines dans une chose purement humaine ? Mais, concevez-vous l’absurdité de cette défense générale que font les lois divines de jamais secouer le joug même d’un usurpateur ? Ainsi, un assassin assez habile pour s’emparer du trône après l’assassinat du prince légitime est aussitôt protégé pas les lois divines et tandis que, s’il n’eût pas réussi, il aurait été condamné à perdre, sur l’échafaud, sa tête criminelle. Ne me dites pas qu’il sera puni dans un autre monde, parce que j’en dirai autant de tous les criminels civils. S’en suivrait de là qu’ils ne doivent pas être punis dans celui-ci. Il est d’ailleurs simple qu’une loi est toujours indépendante du succès du crime qu’elle condamne.
Quant aux lois humaines, il ne peut pas y en avoir dès que le prince la viole.
Ou c’est le peuple qui a établi ces lois en se soumettant au prince, ou c’est le prince qui les a établies. Dans le premier cas, le prince est inviolablement obligé d’exécuter les conventions par la nature même de sa principauté. Dans le second, ces lois doivent tendre au but du gouvernement qui est la tranquillité et le bonheur des peuples. S’il ne le fait pas, il est clair que le peuple rentre dans sa nature primitive et que le gouvernement, ne pourvoyant pas au but du pacte social, se dissout par lui-même ; mais disons plus : le pacte par lequel un peuple établit l’autorité souveraine dans les mains d’un corps quelconque, n’est pas un contrat, c’est à dire que le peuple peut reprendre à volonté la souveraineté qu’il avait communiquée. Les hommes dans l’état de nature ne forment pas de gouvernement. Pour en établir un, il a fallu que chaque individu consentît au changement. L’acte constitutant cette convention est nécessairement un contrat réciproque. Tous les hommes ainsi engagés ont fait des lois. Ils étaient donc souverains. Soit par la difficulté de s’assembler souvent, soit pour toute autre cause, le peuple aura remis son autorité à un corps ou homme particulier. Or, nul n’est tenu aux engagements qu’il contracte contre son gré. Il n’y pas de lois antérieures que le peuple qui, dans quelques gouvernements que ce soit doit être foncièrement regardé comme le souverain, ne puisse abroger. Il n’en est pas de même quant aux liens qu’il peut avoir les peuples voisins.
Ouvrez les Annales de Corse, lisez les Mémoires de ses braves insulaires, ceux de Michele Merello, etc. ; mais, bien plus, lisez les projets de paix proposés par la République même, et, par les remèdes qu’ils y apportent, vous jugerez des abus qui devaient y régner. Vous y verrez ques les accroissements de la République dans l’île furent commencés par la trahison et la violation du droit de l’hospitalité surprise de Bonifacio et des gens les législateurs de Capo Corso. Vous y verrez qu’ils soutinrent par la force de leur marine plusieurs mécontes des habitants des pièves d’stria contre la République de Pise qui en possédait quelque partie. Enfin, si à force de ruse, de perfidie et de bonheur, ils vinrent à faire consentir les ordres de l’Etat à déclarer Prince la République de Gênes, vous y verrez le pacte tant réclamé par les Corses, quelles étaient les conditions qui devaient constituer leur souveraine principauté.
Mais, de quelque nation que vous soyez, seriez-vous même un ex-eunuque du sérail, retenez votre indignation au détail des cruautés qu’ils employèrent pour se soutenir. Paolo, Colombano, Sampietro, Pompiliani, Gafforio, illustres vengeurs de l’humanité, héros qui délivrâtes vos compatriotes des fureurs du despotisme, quelles furent les récompenses de vos vertus, Des poignards, oui, des poignards !
Efféminés, modernes qui languissez presque tous dans un doux esclavage, ces héros sont trop au-dessus de vos lâches âmes ; mais considérez le tableau du jeune Leonardo, jeune martyr de la patrie et de l’amour paternel. Quel genre de mort termina ton héroïque carrière au printemps de tes ans ? Une corde.
Montagnards, qui a troublé votre bonheur ? Hommes paisibles et vertueux qui couliez des jours heureux au sein de votre patrie, quel tyran barbare a détruit vos habitations ? Quatre mille familles furent obligées de sortir en peu de temps. Vous qui n’aviez que votre patrie, par quel événement imprévenant vous-vois je transportés dans des climats étrangers ? Le feu consume vos demeures rustiques et vous n’avez plus l’espoir de vivre avec vos Dieux domestiques. Puissent les furies vengeresses te faire expier dans les plus affreux tourments le meurtre des Zucci, des Rafaelli, et des autres illustres patriotes que tu fis massacrer malgré les lois de l’hospitalité qui les avaient appelés dans ton palais, misèrable Spinola ! Par quel genre de mort la République tarderait-elle de faire périr les soutiens de la liberté corse ?
Si par la nature du contrat social, il est prouvé que, sans même aucune raison, un corps de nation peu déposer le prince, que serait-ce d’un privé qui, en violant toutes les lois naturelles, en commettant des crimes, des atrocités, va contre l’institution du gouvernement ? Cette raison ne vient-elle pas au secours des Corses en particulier, puisque la souveraineté ou plutôt la principauté des Génois n’était que conventionnelle. Ainsi, les Corses ont pu, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des Français. Amen.
(Valence le 26 avril 1786)
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (4)
VI
Pendant que Giubega plaidait subtilement sa cause à Versailles et à Paris, la Corse s’agitait et, selon le mot du commandant en chef, le vicomte de Barrin -qui avait succédé à Marbeuf- l’explosion était à peu près générale et aussi forte qu’on pouvait l’imaginer. Quelques Corses pensaient à restaurer l’ancien gouvernement national. La plupart demandaient que les indigènes eussent toutes les places sans exception et ils rappelaient avec indignation que le traitement des Corses employés dans l’île par l’administration était inférieur d’un tiers à celui des Français. Le vicomte de Barrin qui n’avait pas d’instructions et presque pas de troupes, ne savait que gémir. De toutes parts des comités, des municipalités nouvelles se formaient. Les paysans brûlaient les registres des communes.
Giubega fut consulté par le ministre de la guerre, La Tour du Pin. Le vicomte de Barrin l’avait recommandé comme un homme attaché au service du roi et très instruit des affaires de son pays, fort utile par ses connaissances et son zèle aux principaux administrateurs de l’île, et, de son côté, Giubega assurait que ses sentiments étaient purs, et qu’il se dévouait entièrement à la France et au monarque? Il fit un Mémoire sur l’état actuel de la Corse. La possession de cette contrée, disait-il était onéreuse ; même en temps de paix, les dépenses excédaient les recettes de six cents mille livres pour le moins. Pourtant, il fallait conserver la Corse, ne fût-ce que pour empêcher l’Angleterre d’y prendre pied ? Mais, ajoutait Giubega, les garnisons étaient faibles et, si le peuple courait aux armes, « il ne dépendait que de lui de s’emparer des places ; » la perte d’une forteresse entraînait la perte de toutes les autres ; il fallait donc dépêcher en Corse quelques régiments de plus.
Ce mémoire ne convainquit pas le ministre. Il avait décidé de ne plus envoyer de troupes dans l’île. Pouvait-il dégarnir le midi de la France, Dauphiné, Languedoc, Provence ? La Corse se révoltait-elle contre Sa Majesté ? Renforcer les garnisons, n’était-ce pas aigrir les insulaires, leur inspirer de la défiance, leur faire croire qu’ils paraîssait redoutables ? Ne serait-ce pas provoquer la sédition au lieu de la prévenir ? Mieux valait employer la douceur, et, si des excès se produisaient, puisqu’il était impossible de les punir, pratiquer l’indulgence commandée hélas ! par les circonstances.
Mais Giubega avait vu les députés de l’île, Buttafoco, l’abbé Peretti, l’avocat Saliceti et le capitaine Colonna de Cesari Rocca, ainsi que les principaux Corses qui se trouvaient à versailles et à Paris, et ces hommes, oubliant pendant quelques jours leurs dissentiments personnels, se réunirent pour délibérer sur la situation de leur pays. Buttafoco et Peretti, liés à la cause de l’aristocratie, se retirèrent bientôt en accusant les autres de n’envisager que leur intérêt propre, l’intérêt du parti populaire. Sans se soucier de cette désertion, Saliceti, Cesari et leurs amis cherchèrent, comme disait Giubega, à mettre quelque ordre dans le désordre. Ils adoptèrent le plan de Giubega. Il y aurait un Comité permanent ou Comité national qui comprendrait vingt deux membres, sujets sages et zélés, attachés au roi et à la patrie, » nommés dans l’assemblée de chacune des onze juridictions royales par des députés de chaque commune. Les juridictions de Bastia, d’Ajaccio, de Calvi, de La Porta, d’Ampugnani, auraient trois représentants ; le Cap Corse et Corte, deux ; le Nebbio, Aleria, Vico, Sartène, Bonifacio et Porto-Vecchio, un. Le Comité installerait un inspecteur dans chaque juridiction et un commissaire dans chaque piève ou canton. Chaque inspecteur rendrait compte au Comité qui, après avoir délibéré, enverrait à Paris tous les renseignements nécessaires pour recevoir et exécuter les décrets de l’assemblée. Les commandants des troupes et des milices prêteraient main-forte au Comité sitôt qu’il leur adresserait une réquisition ; une milice bourgeoise serait établie « suivant l’ancien régime de la Corse, » et le Comité seul fixerait le nombre et le mode de levées de ces gardes nationales.
Le projet fut accueilli avec enthousiasme par la plupart des communes, et Napoléon Bonaparte, alors en Corse, jugeait qu’il était inspiré par l’amour de l’ordre, par le patriotisme, par le zèle plus noble. Mais le vicomte de Barrin, l’intendant La Guillaumye, la commission des Douze, le désapprouvaient, et les Douze publièrent un manifeste qui déclarait ce plan de comité et de milices dangereux et impraticable. Napoléon Bonaparte répondit à ce manifeste par une adresse véhémente, et, le 5 novmebre éclatait l’insurrection de Bastia. Le vicomte de Barrin dut accorder aux bastiais la formation d’une milice bourgeoise, et huit semaines plus tard, le 30 novembre, lorsque trois capitaines de cette garde nationale bastiaise demandèrent à l’Assemblée nationale que leur pays ne fût plus soumis au régime militaire, la Constituante décida que tous ses décrets seraient exécutés dans l’île, que la Corse faisait partie intégrante de l’empire, que les insulaires étaient gouvernés par la même constitution que les autres Français. C’était un véritable décret d’incorporation. La Corse devenait réellement française et acquérait les mêmes droits que le reste du territoire. Dès ce moment, les Corses s’attachent sincèrement à la France. Ils ne sont plus Corses ; ils sont Corses-Français, et on peut dire, pour employer une expression de Napoléon Bonaparte, que la Corse est leur pays, et la France leur mère-patrie. « La nation française, s’écriait le jeune lieutenant d’artillerie, nous a ouvert son sein ; désormais nous avons les mêmes intérêts, les mêmes sollicitudes ; il n’est plus de mer qui nous sépare ! » Il fit tendre sur la maison familiale d’Ajaccio, dans la rue Saint-Charles, une banderole qui portait les mots : Vive Paoli et aussi ces mots : Vive Mirabeau, Vive la nation.
Son parrain partage ses idées. Il n’y a plus d’Etat en Corse ; il n’a plus de greffier en chef ; mais bien qu’il perde à la Révolution, Giubega, en bon Corse, l’acclame et l’installe.
A la vérité, le décret de la Constituante n’apaisait pas les esprits. La Corse fut enivrée de sa liberté nouvelle, et Barrin déplorait plus que jamais « l’état de combustion épouvantable » où se trouvait la contrée. Des milices s’organisent partout, sans règles ni principes. Les paysans avaient tous des fusils et ils ne cessaient de tirer au blanc. Barthélemy Arena, qui régnait en maître à l’île Rousse, refusait de recevoir une garnison de troupes de ligne en disant que les milices suffiraient à garder la place, et Napoléon Bonaparte applaudissait cet Arena qu’il condamna plus tard à l’éternel exil : « Arena, disait-il, est venu les armes à la main, les décrets de l’Assemblée nationale de l’autre, et il a fait pâlir les ennemis publics ! »
Par bonheur, le comité que Giubega avait projeté de créer, parvint à s’imposer. Une commission municipale, formée de notables, s’était constituée à Bastia après l’insurrection du 5 novembre 1789. Elle invita au mois de février 1790, toutes les pièves à déléguer chacune un de leurs membres à un Congrès. Ce Congrès se tint à Orezza dans l’église de la Conception, durant huit jours, du 22 février au 1er mars. Il eut pour président un gentilhomme, Petriconi, colonel de la garde nationale bastiaise, ancien député de la noblesse, exilé jadis parce qu’il avait blâmé l’administration de Marbeuf. Ses deux secrétaires furent Louis Benedetti, assesseur du juge royal de Bastia, et Laurent Giubega. Il décréta l’établissement d’un Comité supérieur qui veillait au maintien de l’ordre public et qui siégea successivement à Bastia, à Orezza, à Corte, et enfin à Bastia.
Le Comité supérieur vécut du 2 mars au 1er septembre 1790. Il comptait soisante-six membres, six par juridiction, qui résidaient à Bastia par tiers. Chaque tiers était remplacé tous les quinze jours. Il y avait un président permanent, le frère de Pascal Paoli, ce Clément Paoli que Napoléon Bonaparte nommait un bon guerrier et un vrai philosophe ; mais Clément se faisait vieux et à chaque quinzaine, le tiers qui entrait en fonctions élisait un second et réel président. Les membres hors de tour allaient, en qualité de commissaires, dans les endroits de l’île où une insurrection était sur le point d’éclater.
Bien qu’illégal, le Comité supérieur rendit de grands services et par d’habiles mesures, soit par des sommations réitérées, soit par de envois ou « marches » de la milice, soit par des moyens de douceur, mezzi blandi, il pacifia la Corse, la fit passer sans effusion de sang, et comme insensiblement, du despotisme à la liberté. Il avait raison de dire qu’il était « le seul lien qui pût réprimer et réfréner le peuple; » Dans l’effacement ou l’écroulement de toutes les autorités il tint lieu d’une administration départementale, il fixa les idées des Corses, il donna une interprétation conforme des décrets de la Constituante sur l’organisation des municipalités, il trancha les questions qui provoquaient des troubles, il apaisa des querelles particulières et notamment celle qui divisait les Giubega et les Arena.
Giubega siégea dans le Comité supérieur qui le nommait « un très digne confrère et sage compatriote. » Durant près d’un mois, du 20 avril au 3 mai comme doyen et du 3 au 15 mai comme président, il dirigea les débats, et un jour, l’ancien greffier en chef des Etats écrivit sur un ton impérieux au vicomte de Barrin -ce Barrin dont il exécutait docilement les volontés un an auparavant -qu’il fallait respecter les intentions de l’Assemblée nationale, que le Comité supérieur n’avait d’autre but que l’intérêt de la nation française » à laquelle la Corse avait l’avantage d’être incorporée. »
Il fut un des membres les plus influents du Comité et celui peut-être qu’on écoutait avec le plus de déférence. Ses collègues le prient, dans la séance du 8 mars, de leur rendre compte des décisions de la Constituante sur les élections des officiers municipaux. Ils favorisent les intérêts personnels en statuant que la subvention allouée à sa pépinière de Calvi restera provisoirement la même que par le passé. Ils lui font place dans une commission de quinze « signori » élue le 19 avril et chargée d’examiner et de proposer les moyens qui sont les plus propres au calme et à l’union.
Lui-même déploie autant de fermeté que d’habileté. Dans la séance du 13 avril, il déclare que le Comité supérieur ne fera qu’une besogne inutile tant qu’il ne disposera pas de « moyens coercitifs, » mezzi coattivi. A quoi servent, par exemple, les délibérations tenues jusqu’ici pour obliger les adjudicataires de la subvention à payer l’arriéré de leur dû qui monte à près d’un demi-million ? Il faut, conclut Giubega, former un corps de troupes soldées, Un corpo di truppa pagata, qui contraigne les adjudicataires au paiement de leur dette, qui exécute les résolution du Comité et les décrets de l’Assemblée nationale, arrête les délinquants, maintienne le bon ordre, imprime dans l’île entière le respect des autorités légitimes. Sans doute, il sera malaisé de solder ce corps ; mais « les difficultés ne sont que passagères et tant que le Comité manquera de forces, tout son zèle sera infructeux, les embarras iront se multipliant, les délits seront impunis, et les lois inobservées. » La motion de Giubega fut adoptée.
Mais, si énergique qu’il fût, Giubega ne cessait de recommander la modération. La cour avait, au mois d’août 1789, envoyé en Corse le maréchal de camp Gaffori seconder le vicomte de Barrin, et Gaffori, que Napoléon Bonaparte nommait le sattelite de la tyrannie et le restaurateur du despotisme, n’avait trouvé dans l’île que défaveur et défiance : il avait combattu la formation de la milice nationale et la constitution du Comité supérieur ; il avait couru le pays avec les détachements du régiment provincial dont il était naguère colonel ; il s’était fait à Corte un parti considérable et le régiment de Salis, qui tenait garnison dans cette ville, avait tiré les habitants sans réquisition de la municipalité. Lorsque le Comité supérieur se réunit à Orezza, du 12 au 20 avril 1790, Giubega se joignit à Barbaggi et à plusieurs autres pour demander l’ « union des esprits discordants. » Il proposa d’apaiser toute les « contestations » et d’écrire à Gaffori une lettre conciliante. Son discours que les assistants jugèrent très sensés, sensatissimo, et applaudirent unanimement, fut imprimé aux frais de la nation et la lettre, rédigée par une commission dont Giubega était membre, envoyée à Gaffori : le Comité assurait le général de son respectueux attachement et le chargeait d’exprimer au régiment de Salis ses sentiments d’estime ; Gaffori devait, ainsi que les soldats, « oublier les choses passées et ce qui pouvait avoir provoqué l’irritation; » il devait prendre part aux travaux du Comité. Gaffori vint à Orezza et promit obéissance au Comité, jura de l’aider à former les milices et à rétablir la tranquilité. Sur les instances de Gaffori, le Comité décida même de se fixer à Corte, point central et le plus commode pour toute les provinces.