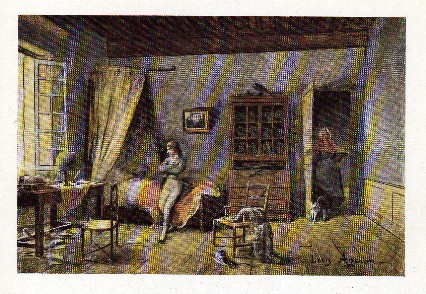août 22, 2007
LES REFUGIES DE LA GORGONA – NAPOLEON BONAPARTE
Je m’étais embarqué à Livourne pour me rendre en Espagne lorsque les vents contraires nous obligèrent de relâcher à la Gorgona. La Gorgona est un rocher escarpé qui peut avoir une demi-lieue de circuit. Il n’y avait aucun bon refuge mais, dans la nécessité où nous étions, nous fîmes comme nous pûmes, vu que notre navire faisait eau de plusieurs côtés.
Il est peu de situations aussi pittoresques que la position de cette île, éloignée de toute terre par des bras de mer immenses, environnée de rochers contre lesquels les vagues se brisent avec fureur. Elle est quelquefois le refuge du pâle matelot contre les tempêtes, mais plus souvent la Gorgona n’est pour eux q’un écueil où bien des navires ont souvent fait naufrage.
Fatigué des tempêtes que nous avions essuyées, je débarquai aussitôt avec des matelots. Ils n’avaient jamais vu cette île et ne savaient pas si elle était habitée. Arrivés à terre, j’emploie le peu de force qui me restait à la parcourir et ne tardai pas à me convaincre que jamais créature humaine n’avait habité un si stérile séjour. Je me trompais toutefois et je revins de mon erreur lorsque j’entrevis des pans de murailles demi-ruinées par le temps. Ils paraissaient avoir été bâtis depuis plusieurs siècles. Le lierre et d’autres arbrisseaux de cette espèce avaient tellement crû à leur abri qu’il était difficile d’apercevoir les pierres.
Je fis dresser une tente dans cette enceinte où avaient été jadis des maisons, pour pouvoir y passer la nuit. Les matelots couchèrent à bord et je me trouvai seul dans cette région. Cette idée m’occupa assez agréablement pendant une partie de la soirée. Je me trouvais, je puis le dire, dans un petit monde où bien certainement il y avait de quoi pourvoir à mon entretien, à l’abri des séductions des hommes, de leurs jeux ambitieux, de leurs passions éphémères. A quoi ne tenait-il que je n’y vécusse sinon heureux, du moins sage et tranquille ?…
Je m’endormis dans ces idées et l’on peut croire que je m’égalai plusieurs fois à Robinson Crusoé. Comme lui j’étais roi de mon île. Je n’avais pas encore achevé on premier somme quand la clarté d’un flambeau et des cris de surprise me réveillèrent. Mon étonnement se changea en crainte quand j’entendis que l’on criait en langue italienne : «Malheureux ! tu périras…»
Je n’avais pour toute arme que ma canne. Je l’empoigne en me jetant en bas de mon matelas. Je cherchais la porte que je trouvais embarrassée. Je réfléchissais au parti que je devais prendre lorsqu’on mit le feu à la tente en s’écriant : «Ainsi périssent tous les hommes !» L’accent avec lequel était prononcée cette horrible imprécation me glaça d’épouvante. Je me fis courage cependant et, demi étouffé par les tourbillons de fumée, je parvins à me débarrasser et à me mettre hors d’atteinte du feu. Je cherchai alors le lâche ennemi qui m’avait voulu sacrifier aussi inhumainement, mais je ne vis personne et n’entendis aucun bruit. Que l’on se figure ma situation !
Le coeur encore saisi du danger auquel je venais d’échapper…, alarmé de ceux que je pouvais encore courir et que je ne pouvais prévoir…, nu, exposé à un vent des plus violents, les maux de ma situation étaient encore augmentés par le mugissement des vagues et l’obscurité de la nuit. Je voyais, à la lueur de la flamme qui consumait mon habitation, les ruines où j’avais assis ma demeure. Elles semblaient me dire que tout périt dans la nature et qu’il fallait que je périsse.
… Je ne restai pas un quart d’heure dans cette situation que j’entendis du bruit et, un moment après, je vis arriver deux hommes. Je l’avoue, sans armes, je me cachai derrière la demeure en attendant que je pusse comprendre pourquoi ils étaient si cruels, car je ne pouvais m’imaginer qu’ils fussent si animés contre les hommes sans quelque forte raison.
Quel fut mon étonnement quand les paroles suivantes frappèrent mes oreilles :
«Ma fille, sur le bord de sa tombe, tu as livré ton père aux cuisants remords. O Dieu ! entends les gémissements de cette déplorable victime. Il invoque l’Eternel qui, depuis tant d’années, soutient notre vie. Ma fille, qu’as-tu fait ? Peut-être as-tu immolé aux mânes de nos compatriotes un compatriote même. Peut-être est-ce un de ces Anglais vertueux qui protègent encore nos fugitifs citoyens… Non ! non ! mon âme ne peut y survivre. J’ai supporté les malheurs de ma patrie, ceux de ma famille, les miens, tant que l’innocence a régné dans mon coeur, mais ces cheveux blancs souillés par le crime… Adieu, ma fille… J’expie ton crime. Oui, flammes ardentes, purifiez… Ma fille, je te pardonne. Vis pour me venger et ne pardonne jamais aux tyrans de la patrie… Impute-leur jusqu’à ce nouveau crime. Impute-leur la mort de ton père».
Ce discours me fit renaître… De pareilles situations sont difficiles à peindre… Je me précipite aux pieds du vertueux vieillard. «Oui, mon père, lui dis-je, je suis Anglais et Anglais de vos amis. Ce que je viens d’entendre me console de l’accident malheureux qui a failli me coûter la vie». Après l’expression d’allégresse, le vieillard me conduisit dans la caverne qu’il habitait : «Sois bienvenu, Anglais. Vous régnez ici. La vertu a le droit d’être vénérée en tous lieux». Je ne finirais jamais si je voulais rapporter tous les récits que nous tînmes. Je lui demandai le récit des événements qui l’avaient porté à fuir la société de l’homme et il commença en ces termes :
«J’ai puisé la vie en Corse et avec elle un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance. Nous languissions alors dans les chaînes des Génois. Agé encore que de vingt ans, je déployai le premier l’étendard de la liberté et mon bras jeune et désespéré remporta sur les tyrans des avantages que mes compatriotes chantaient encore il y a dix ans… Quelques années après, nos tyrans appelèrent à leur secours les Allemands. Qu’avions-nous fait aux Allemands pour qu’ils vinssent nous faire la guerre ? Ils en furent la dupe toutefois et nous vîmes plusieurs fois l’aigle impériale fuir devant nos agiles montagnards… Les méchants dans ce monde ont des amis et les Français vinrent à leur secours. Les Français après avoir été battus nous battirent. Les plaines et les villes se soumirent. Pour moi, je me réfugiais avec ceux de mes compagnons qui avaient juré de ne pas survivre à la liberté de la patrie.
«Après diverses vicissitudes, Paoli di Rostino fut fait premier magistrat et général. Nous chassâmes nos tyrans. Nous étions libres, nous étions heureux, losque les Français, que l’on dit être ennemis des hommes libres, vinrent armés du fer et du flambeau et, en deux ans, contraignirent Paoli de s’en aller et la nation à se soumettre. Quant à moi, avec mes amis et parents nous soutînmes la guerre pendant huit ans. Je vis, pendant cet intervalle, quarante de mes compagnons terminer leur vie par le supplice du criminel. Un jour que nous résolûmes de nous venger, nous descendîmes près de soixante – c’était le triste reste des défenseurs de la liberté ! Dans les plaines nous prîmes plus de cent Français. Nous les conduisions à notre demeure lorsque nous fûmes avertis que les tyrans s’en étaient emparés. Je quittai mes gens pour voler au secours de mon infortuné père que je trouvai nageant dans son sang. Il n’eut que la force de me dire : «Mon fils, venge-moi. C’est la première loi de la nature. Meurs comme moi, n’importe, mais ne reconnais jamais les Français pour maîtres». Je continuais mon chemin pour aller savoir des nouvelles de ma mère lorsque je trouvai son corps nu, chargé de blessures et dans la posture la plus révoltante. Ma femme, trois de mes frères avaient été pendus sur les lieux mêmes. Sept de mes fils, dont trois ne passaient pas cinq ans, avaient eu le même sort. Nos cabanes étaient brûlées, le sang de nos brebis était confondu avec celui de mes parents. Je cherchais ma fille et ne la trouvai pas ; furieux, égaré, transporté par la rage, je voulais voler mourir par les coups de ces brigands qui avaient fait périr tous les miens. Retenu cependant par mes compagnons, nous enterrâmes tous les corps de nos infortunés parents et nous résolûmes… O Dieu ! que ne résolûmes-nous pas !… Mais enfin nous prîmes le parti de quitter une île proscrite où des tigres régnaient. Notre bâtiment débarque à la Gorgona. Je trouvai le paysage conforme à mon humeur et j’y restai. Je ne gardai que trois fusils et quatre barils de poudre. Mes compagnons continuèrent leur cours vers l’Italie. Je vis partir le navire sans chagrin. J’avais des nourritures pour trois jours. Je sais qu’il est peu d’endroits sur la terre où il n’y ait de quoi nourrir l’homme. Les bâtiments où vous étiez sont les ruines d’un ancien monastère et la citerne existe encore. Les poissons et les insectes de la mer, les glands des chênes verts que vous voyez me servent de nourriture. Je me regarde ici comme le dictateur d’une république. Les oiseaux sont nombreux sur ces rochers, mais je n’en tue jamais. Ce sont mes sujets. Mais comment pourrais-je en tuer puisque je n’en vois jamais ?… Les malheurs qui ont empoisonné mes jours m’ont rendu la clarté du soleil importune. Il ne luit jamais pour moi. Je ne respire l’air que la nuit et mes regrets ne sont pas renouvelés par l’aspect des montagnes où vécurent mes ancêtres. La petite forêt de pins que vous voyez ici à côté nous donne du bois plus que nous n’en avons besoin et ce bois nous éclaire.
«C’est à la lueur de ces flambeaux que nous vivons. Nos courses, nos pêches sont éclairées par cet astre, qui, s’il n’est pas aussi brillant que le vôtre, n’éclaire du moins que des actions justes.
«Je passai une année sans aucun événement, lorsque environ à cette heure-ci, un jour, dans le mois de décembre, j’aperçus du côté de la citerne des feux qui m’annonçaient l’arrivée de quelques hommes. Je me glissai avec le moins de bruit qu’il me fut possible et je vis sept Turcs qui tenaient trois hommes enchaînés. Je les vis les délier, en tuer un, et donner la liberté aux autres en ne leur donnant aucune nourriture. Après cet événement, ils se rembarquèrent. Quand je me fus assuré que les deux nouveaux débarquants n’étaient pas Français, je résolus de leur donner refuge. Pour cela faire, je retournai à ma demeure et allumai un grand feu. Attirés par la lueur, ils y vinrent. Quelle fut ma surprise, je reconnus ma fille. L’autre était un jeune Français. En considération de ma fille je lui accordai la vie. «Monsieur, lui dis-je, vous saurez que je suis un ennemi de votre nation, et j’ai juré sur mes autels, par le Dieu qu’ils ont outragé, de venger, de massacrer tous ceux qui tomberaient en ma puissance. je vous exempte toutefois en considération de ma fille. Cherchez une demeure dans cette île qui soit éloignée de celle-ci. Ne sortez jamais que lorsque le soleil est sur l’horizon. Je vous laisse vivre. A défaut de quoi votre mort s’ensuivrait». Trois ans se passèrent ainsi sans que j’eusse eu la curiosité de voir s’il vivait toujours. J’y allai au bout de ce terme et ne trouvai aucun vestige de son corps. J’ignore ce qu’il peut être devenu. Je bénis toutefois le ciel qui m’a délivré de ce méchant homme.
«Il y a six ans que je fus réveillé par le bruit de plusieurs coups de canon et de mousqueterie. Le soleil s’était levé. Je ne voulus pas, quoique j’en eusse bien envie, trahir mon serment et j’attendis la nuit. Elle n’avait pas plutôt répandu ses voiles que j’allumai un grand feu et me mis à faire la tournée de mon royaume. Je vis sept hommes couchés à terre, étendus sur des couvertures, et quatre autres qui les soignaient. Les quatre vinrent à moi. Insensé ! je n’eus pas l’esprit de me défendre. Ils me tirèrent ma barbe, me battirent, me bafouèrent, m’appelèrent sauvage. Ils voulurent m’obliger à dire où il y avait de l’eau. Je ne voulus jamais pour les punir de leurs mauvais traitements. C’étaient d’ailleurs des Français. Ma fille qui me suit presque toujours vint bientôt. Elle ne me vit pas plutôt dans l’état où j’étais tiré qu’elle tua d’un coup de fusil deux de ces brigands. Les deux autres se sauvèrent. La frégate était à une certaine distance. Elle ne pouvait pas approcher à cause des rochers. Je leur criai de venir prendre leurs malades. Ils envoyèrent trois hommes qui vinrent à la nage. Je leur permis à tous de s’embarquer. O ingratitude affreuse ! Ils ne furent pas plutôt arrivés à leur frégate qu’ils tirèrent quelques coups de canon contre les restes des ruines qu’ils prirent pour mon habitation.
«Depuis ce temps-là, j’ai juré de nouveau sur mon autel de ne plus pardonner à aucun Français. Il y a quelques années que j’ai vu périr deux bâtiments de cette nation. Quelques bons nageurs se sauvèrent dans l’île, mais nous leur donnâmes la mort. Après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français.
«L’année passée, un des bateaux qui font la correspondance de l’île de Corse avec la France vint échouer ici. Les cris épouvantables de ces malheureux m’attendrirent. Je me suis souvent reproché cette faiblesse depuis, mais que voulez-vous, monsieur, je suis homme et avant d’avoir le coeur d’un roi ou d’un ministre, il faut bien avoir étouffé ces sentiments qui nous lient à la nature et je n’étais roi que depuis onze ans. J’allumai donc un grand feu vers l’endroit où ils pouvaient aborder et, par ce moyen, je les sauvai. Vous vous attendez peut-être que leur reconnaissance… Eh ! non ! Ces monstres, à peine arrivés ici, tranchèrent des maîtres. Deux cavaliers escortaient un criminel qu’ils laissèrent à bord. Je demandai ce qu’il avait fait. Ils me répondirent que c’était une canaille de Corse, que ces gens méritaient tous d’être pendus. Ma colère fut grande. Mais que devais-je faire ? Ils me reconnurent comme Corse et prétendirent me conduire avec eux. J’étais un coquin qu’il fallait rouer. Ils firent plus : ils m’enchaînèrent. Ils prétendaient que l’on avait promis une récompense pour ceux qui me livreraient. J’étais perdu. J’allais expier par les supplices ma fâcheuse mollesse. Mes ancêtres irrités se vengeaient de ce que j’avais trahi la vengeance due à leurs mânes… Cependant le ciel, qui connaissait mon repentir, me sauva. Le bâtiment fut retenu sept jours. Au bout de ce terme, ils manquèrent d’eau. Il fallait savoir où l’on pourrait en puiser. Il fallut me promettre la liberté. L’on me délia. Je profitai de ce moment et j’enfonçai le stylet de la vengeance dans le coeur de deux de ces perfides. Je vis alors pour la première fois l’astre de la nature. Que sa splendeur me parut brillante mais, ô Dieu ! comment pouvait-il contempler de pareilles trahisons !
«Cependant ma fille était à bord, garrottée ainsi que je l’avais été. Heureusement que ces hommes brutaux ne s’étaient pas aperçus de son sexe. Il fallait aviser au moyen de la délivrer. Après y avoir longtemps rêvé, je me revêtis de l’habit d’un des soldats que j’avais tués. Armé de deux pistolets que je trouvai sur lui, de son sabre, de mes quatre stylets, j’arrivai au bâtiment. Le patron et un mousse furent les premiers qui sentirent le glaive de mon indignation. Les autres tombèrent également sous les coups de ma fureur. Je recueillis tous les meubles qui pouvaient appartenir à l’équipage. Nous traînâmes leurs corps aux pieds de notre autel et là, nous les consumâmes. Ce nouvel encens parut être favorable à la divinité…»
LE MASQUE PROPHETE – NAPOLEON BONAPARTE
L’An 160 de l’hégire, Mikadi régnait à Bagdad ; ce prince, grand, généreux, éclairé, magnanime, voyait prospérer l’empire arabe dans le sein de la paix. Craint et respecté de ses voisins, il s’occupait à faire fleurir les sciences et en accélérait les progrès, lorsque la tranquillité fut troublée par Hakem, qui, du fond du Korassan, commençait à se faire des sectateurs dans toutes les parties de l’empire. Hakem, d’une haute stature, d’une éloquence mâle et emportée, se disait l’envoyé de Dieu ; il prêchait une morale pure qui plaisait à la multitude ; l’égalité des rangs, des fortunes, était le texte ordinaire de ses sermons. Le peuple se rangeait sous ses enseignes. Hakem eut une armée.
Le calife et les grands sentirent la nécessité d’étouffer dans sa naissance une insurrection si dangereuse ; mais leurs troupes furent plusieurs fois battues, et Hakem acquérait tous les jours une nouvelle prépondérance.
Cependant une maladie cruelle, suite des fatigues de la guerre, vint défigurer le visage du prophète. Ce n’était plus le plus beau des Arabes. Ses traits nobles et sévères, ses yeux grands et pleins de feu étaient défigurés ; Hakem devint aveugle. Ce changement eût pu ralentir l’enthousiasme de ses partisans. Il imagina de porter un masque d’argent.
Il parut au milieu de ses sectateurs ; Hakem n’avait rien perdu de son éloquence. Son discours avait la même force ; il leur parla, et les convainquit qu’il ne portait le masque que pour empêcher les hommes d’être éblouis par la lumière qui sortait de sa figure.
Il espérait plus que jamais dans le délire des peuples qu’il avait exaltés, lorsque la perte d’une bataille vint ruiner ses affaires, diminuer ses partisans et affaiblir leur croyance : il est assiégé, sa garnison est peu nombreuse. Hakem, il faut périr, ou tes ennemis vont s’emparer de ta personne ! Il assemble tous les sectateurs et leur dit : «Fidèles, nous que Dieu et Mahomet ont choisis pour restaurer l’empire et regrader notre nature, pourquoi le nombre de vos ennemis vous décourage-t-il ? Ecoutez ; la nuit dernière, comme vous étiez plongés dans le sommeil, je me suis prosterné et ai dit à Dieu : Mon père, tu m’as protégé pendant tant d’années ; moi ou les miens t’aurions-nous offensé, puisque tu nous abandonnes ? Un moment après, j’ai entendu une voix qui me disait : Hakem, ceux seuls qui ne t’ont pas abandonné sont tes vrais amis et seuls sont élus. Ils partageront avec toi les richesses de tes superbes ennemis. Attends la nouvelle lune, fais creuser de larges fossés, et tes ennemis viendront s’y précipiter comme des mouches étourdies par la fumée». Les fossés sont bientôt creusés, l’on en remplit un de chaux, l’on pose des cuves pleines de liqueurs spiritueuses sur le bord.
Tout cela fait, l’on sert un repas en commun, l’on boit du même vin, et tous meurent avec les mêmes symptômes. Hakem traîne leurs corps dans la chaux qui les consume, met le feu aux liqueurs et s’y précipite. Le lendemain, les troupes du calife veulent avancer, mais s’arrêtent en voyant les portes ouvertes ; l’on entre avec précaution et l’on ne trouve qu’une femme, maîtresse d’Hakem, qui lui a survécu. Telle fut la fin de Hakem, surnommé Durhaï, que ses sectateurs croient avoir été enlevé au ciel avec les siens.
Cet exemple est incroyable. Jusqu’où peut pousser la fureur de l’illustration !
août 4, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LES GALERIES ET JARDINS DU PALAIS ROYAL
Une rencontre au Palais Royal
Je sortais des Italiens et me promenais à grands pas sur les allées du Palais Royal. Mon âme, agitée par les sentiments vigoureux qui la caractérisent, me faisait supporter le froid avec indifférence ; mais, l’imagination refroidie, je sentis les rigueurs de la saison et gagnai les galeries. J’étais sur le seuil de ces portes de fer quand mes regards errèrent sur une personne du sexe. L’heure, la taille, sa grande jeunesse ne me firent pas douter qu’elle ne fût une fille. Je la regardais : elle s’arrêta non pas avec cet air grenadier des autres, mais un air convenant parfaitement à l’allure de sa personne. Ce rapport me frappa. Sa timidité m’encouragea et je lui parlai… Je lui parlai, moi qui, pénétré plus que personne de l’odieux de son état, me suis toujours cru souillé par un seul regard… Mais son teint pâle, son physique faible, son organe doux, ne me firent pas un moment en suspens. Ou c’est, me dis-je, une personnne qui me sera utile à l’observation que je veux faire, ou elle n’est qu’une bûche.
– Vous aurez bien froid, lui dis-je, comment pouvez-vous vous résoudre à passer dans les allées ?
– Ah ! monsieur, l’espoir m’anime. Il faut terminer ma soirée.
L’indifférence avec laquelle elle prononça ces mots, le flegmatique de cette réponse me gagna et je passai avec elle.
– Vous avez l’air d’une constitution bien faible. Je suis étonné que vous ne soyez pas fatiguée du métier.
– Ah ! dame, monsieur, il faut bien faire quelque chose.
– Cela peut-être, mais n’y a-t-il pas de métier plus propre à votre santé ?
– Non, monsieur, il faut vivre.
Je fus enchanté, je vis qu’elle me répondait au moins, succès qui n’avait pas couronné toutes les tentatives que j’avais faites.
– Il faut que vous soyez de quelques pays septentrionaux, car vous bravez le froid.
– Je suis de Nantes en Bretagne.
– Je connais ce pays-là… Il faut, mademoiselle, que vous me fassiez le plaisir de me raconter la perte de votre p…
– C’est un officier qui me l’a pris.
– En êtes-vous fâchée ?
– Oh ! oui, je vous en réponds. (Sa voix prenait une saveur, une onction que je n’avais pas encore remarquée). Je vous en réponds. Ma soeur est bien établie actuellement. Pourquoi ne l’eus-je pas été ?
– Comment êtes-vous venue à Paris ?
– L’officier qui m’avilit, que je déteste, m’abandonna. Il fallut fuir l’indignation d’une mère. Un second se présenta, me conduisit à Paris, m’abandonna, et un troisième avec lequel je viens de vivre trois ans, lui a succédé. Quoique Français, ses affaires l’ont appelé à Londres et il y est. Allons chez vous.
– Mais qu’y ferons-nous ?
– Allons, nous nous chaufferons et vous assouvirez votre plaisir.
J’étais bien loin de devenir scrupuleux, je l’avais agacée pour qu’elle ne se sauvât point quand elle serait pressée par le raisonnement que je lui préparais en contrefaisant une honnêteté que je voulais lui prouver ne pas avoir…
(Paris le 22 novembre 1787)
août 3, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DES FEMMES
Dialogue sur l’amour
Dans cet écrit, Napoléon Bonaparte se met en scène face à son meilleur ami de jeunesse, son camarade Alexandre des Mazis. Ils y exposent des avis divergents sur la grande question métaphysique qu’est l’amour.
Des Mazis. – Comment, monsieur, qu’est-ce que l’amour ? Eh ! quoi, n’êtes-vous donc pas composé comme les autres hommes ?
Bonaparte. – Je ne vous demande pas la définition de l’amour. Je fus jadis amoureux et il m’en est resté assez de souvenir pour que je n’aie pas besoin de ces définitions métaphysiques qui ne font jamais qu’embrouiller les choses : je vous dis plus que de nier son existence. Je le crois nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes, enfin je crois que l’amour fait plus de mal… et que ce serait un bienfait d’une divinité protectrice que de nous en défaire et d’en délivrer le monde.
Des Mazis. – Quoi ! L’amour nuisible à la société, lui qui vivifie la nature entière, source de toute production, de tout bonheur. Point d’amour, monsieur, autant vaudrait-il anéantir notre existence !
Bonaparte. – Vous vous échauffez. La passion vous transporte. Reconnaissez, je vous en prie, votre ami. Ne me regardez pas avec indignation et répondez. Pourquoi depuis que cette passion vous domine, ne vous vois-je plus dans vos sociétés ordinaires ? Que sont devenues vos occupations ? Pourquoi négligez-vous vos parents, vos amis ? Vos journées entières sont sacrifiées à une promenade monotone et solitaire jusqu’à ce que l’heure vous permette de voir Adélaïde.
Des Mazis. – Eh ! que m’importe à moi, monsieur, vos occupations, vos sociétés ? A quoi aboutit une science indigeste ? Qu’ai-je à faire de ce qui s’est passé il y a mille ans ? Quelle influence puis-je avoir sur le cours des astres ? Que m’importe le minutieux détail des discussions puériles des hommes ?… Je me suis occupé de cela sans doute. Qu’avais-je de mieux à faire ? Il fallait bien par quelque moyen se soustraire à l’ennui qui me menaçait ; mais, croyez-moi, je sentais, au milieu de mon cabinet, le vide de mon coeur. Parfois mon esprit était satisfait, mais mes sentiments !… Oh ! Dieu, je n’ai fait que végéter tant que je n’eus pas aimé. Actuellement au contraire, quand l’aurore m’arrache au sommeil, je ne me dis plus : Pourquoi le soleil luit-il aujourd’hui pour moi ? Non ! le premier rayon de lumière me présente ma chère Adélaïde en habit du matin. Je la vois penser à moi, me sourire. Hier au soir, elle me serrait la main ; elle soupirait, nos regards se rencontraient. Comme ils exprimaient nos sentiments ! Je contemple un portrait qui me ravit l’âme. Cent fois je le remets pour le reprendre aussitôt. Cette promenade, monsieur, que vous appelez monotone, eh ! non, la vaste étendue du globe ne contient pas plus de variété. D’abord, mon esprit repasse les choses qu’elle m’a dites ; je relis le billet qu’elle m’a écrit ; je pense à celui qui doit peindre toute l’étendue de mon amour. Je le refais cent fois. Mon imagination s’élève ; je vois bientôt mes feux couronnés, je regrette tantôt de ne pas avoir une fortune immense à lui sacrifier. Ici même, je voudrais avoir une couronne. Concevez-vous le charme de la proposer à ses parents, la joie que cela lui causerait. Tout ce qui approche d’elle est sacré à mes yeux. Une autre fois, je penserai aux préparatifs des noces qui doivent bientôt nous unir, jusqu’aux présents que je dois lui faire… Mon coeur se dilate à imaginer quelque chose qui puisse l’obliger, lui prouver mon amour. Voyez-vous le château où nous devons passer nos jours, les sombres bosquets, les riantes prairies, les délicieux parterres. Rien ne m’affecte que le plaisir d’être tous les jours à côté d’elle. Mais bientôt elle doit me donner des gages de notre amour… Mais vous riez ! En vérité je vous déteste.
Bonaparte. – Je ris des grandes occupations qui captivent votre âme et plus encore du feu avec lequel vous me les communiquez. Quelle maladie étrange s’est emparée de vous ? Je sens que la raison que je vais appeler à votre secours ne fera aucun effet et, dans le délire où vous êtes, vous ferez plus que de fermer l’oreille à sa voix ; vous la mépriserez. Souvenez-vous que vous n’êtes pas de sang-froid et que mon amitié fut toujours le juge qui vous rappela à vos devoirs. Souvenez-vous que je m’en suis toujours rendu digne. J’aurais besoin de répéter ici les obligations que vous me devez et les marques qui vous sont connues de mes sentiments, car, moi-même, je ne serais pas à l’abri de vos invectives dans les accès de votre délire. Car votre état est pareil à celui d’un malade qui ne voit que la chimère qu’il poursuit et sans connaître la maladie qui la produit, ni la santé qu’il a perdue. Je n’agiterai donc pas si vos plaisirs sont dignes de l’homme, ou même si c’en sont. Je veux croire que ce sexe, roi du monde par sa force, son industrie, son esprit et toutes ses autres facultés naturelles, trouve sa suprême félicité à la languir dans les chaînes d’une molle passion et sous les lois d’un être plus fragile d’entendement comme de corps. Je veux croire, comme vous le dites, que le souvenir de votre Adélaïde, son image, sa conversation, puissent vous dédommager des agréments de vos occupations, de vos sociétés ; mais n’est-il pas vrai que vous désirez toujours la fin de cet état et que votre insatiable imagination voudrait obtenir ce que la vertu d’Adélaïde ne peut accorder. Ma froide tranquillité, je le vois, n’est pas propre à peindre le pesant fardeau qui tourmente l’existence d’un amant dans le moindre échec qui lui survient. Qu’Adélaïde s’absente pour quinze jours seulement, que deviendrez-vous ? Si un autre s’efforce de plaire à cet objet que vous croyez vous appartenir, que d’inquiétudes ! Si une mère alarmée trouve mauvaises de trop fréquentes visites qui font parler un public méchant, enfin, monsieur, que sais-je, cent petites autres choses qui frappent fortement un amant vous agitent. Souvent les nuits se passent sans sommeil, les repas sans manger, la Terre n’a point d’endroit pour contenir votre inquiétude extrême. Votre sang bouillonne, vous marchez à grands pas le regard égaré. Pauvre chevalier, est-ce là le bonheur ?… Je ne doute pas que si, aujourd’hui, dans l’extase que vous a occasionnée un serrement de main, vous ne trouviez cet état la suprême félicité ; je ne doute pas, dis-je, que demain, dans une humeur contraire, vous ne trouviez votre faiblesse insupportable.
Mais, chevalier, voilà votre position. S’il fallait défendre la patrie attaquée, que feriez-vous ? S’il fallait !… Mais à quoi êtes-vous bon ? Confiera-t-on le bonheur de vos semblables à un enfant qui pleure sans cesse, qui s’alarme ou se réjouit au seul mouvement d’une autre personne ? Confiera-t-on le secret de l’Etat à celui qui n’a point de volonté ?
Des Mazis. – Toujours des grands mots vides de sens ! Que fait à moi votre Etat, ses secrets ? En vérité, vous êtes inconcevable aujourd’hui. Vous n’avez jamais raisonné si pitoyablement.
Bonaparte. – Ah ! chevalier, que vous importent l’Etat, vos concitoyens, la société ! Voilà les suites d’un coeur relâché, abandonné à la volupté. Point de force, point de vertus dans votre sentier. Vous n’ambitionniez que de faire le bien et, aujourd’hui, ce bien même vous est indifférent. Quel est donc ce sentiment dépravé qui a pris la place de votre amour pour la vertu ? Vous ne désirez que de vivre ignoré à l’ombre de vos peupliers. Profonde philosophie ? Ah ! chevalier, que je déteste cette passion qui a produit une si grande métamorphose ? Vous ne songez pas que vous tirez vers l’égoïsme et tout vous est indifférent, opinions des hommes, estime de vos amis, amour de vos parents. Tout est captivé au tyran fort de votre faiblesse. Un coup d’oeil, un serrement de main, un baiser, chevalier, et que vous importe alors la peine de la patrie, la mauvaise opinion de vos amis ; un attouchement corporel… mais je ne veux pas vous irriter. Je le veux croire : l’amour a des plaisirs incomparables, des peines encore plus grandes peut-être, mais n’importe, considérons seulement l’influence qu’il a dans l’état de la société. Il est vrai, chevalier, que dans l’état des choses, notre âme, née indépendante, a besoin d’être formée, dégradée si vous voulez par des institutions, que, dès la naissance, l’attention que tous les législateurs ont donnée à l’éducation…, que nous sommes nés pour être heureux, que c’est la loi suprême que la nature a gravée au fond de nous-mêmes. Il est vrai que c’est la base qui nous a été donnée pour servir de règle à notre conduite. Chacun, né juge de ce qui peut lui convenir, a donc le droit de disposer de son corps comme de ses affections, mais cet état d’indépendance est vraiment opposé à l’état de servitude où la société nous a mis.
En changeant d’état, il a donc fallu changer d’humeur. Il a donc fallu substituer au cri de notre sentiment, celui des préjugés. Voilà la base de toutes les institutions sociales. Il a fallu prendre l’homme dès son origine pour en faire s’il se peut une autre créature. Croyez-vous, sans ce changement, que tant d’hommes souffriraient d’être avilis par un petit nombre de grands seigneurs et que des palais somptueux seraient respectés par des hommes qui manquent de pain ? La force est la loi des animaux ; la conviction celle des hommes. On convint, soit pour repousser les attaques des bêtes plus fortes, soit pour ne pas être exposé à se battre à chaque instant, l’on convint, dis-je, des lois des propriétés et chacun fut assuré au nom de tous de la propriété de son champ.
Cette conviction n’existait qu’entre un petit nombre d’hommes. Il fallait donc des magistrats, soit pour repousser les attaques des peuplades voisines, soit pour faire exécuter la convention reçue.
Ces magistrats sentirent le charme du commandement, mais les plus alertes du peuple s’y opposèrent. Ils furent gagnés et ainsi associés aux projets des ambitieux. Le peuple fut subjugué. Vous voyez l’inégalité s’introduire à grands pas ; vous voyez se former la classe régnante de la classe gouvernée. La religion vint consoler les malheureux qui se trouvaient dépouillés de toute propriété. Elle vint les enchaîner pour toujours. Ce ne fut plus par les cris de la conscience que l’homme devait se conduire. Non ! L’on craignit qu’un sentiment que l’on faisait tout au monde pour étouffer reprît le dessus.
Il y eut donc un Dieu. Ce Dieu conduisait le monde. Tout se faisait par acte de sa volonté. Il avait donné des lois écrites… et l’empire des prêtres commença, empire qui probablement ne finira jamais.
Que l’homme donc soit dégradé, triste vérité ! mais que l’état de société ne soit légitime, c’est ce dont l’on ne peut disconvenir. Le silence des hommes là-dessus est une approbation tacite que rien ne peut démentir. Vous avez vingt ans, monsieur, choisissez : ou renoncer à votre rang, à votre fortune et quitter un monde que vous détestez, ou, vous inscrivant dans le nombre des citoyens, soumettez-vous à ses lois. Vous jouissez des avantages du contrat, serez-vous infidèle aux autres clauses ? Ce ne serait pas vous croire honnête homme que d’en douter. Vous devez donc être attaché à un Etat qui vous procure tant de bien-être et, promettant à la fois de faire un digne usage des avantages qu’il vous a accordés, vous devez rendre heureux le peuple au-dessus duquel vous êtes et faire prospérer la société qui vous a distingué. Pour cela faire, mon cher chevalier, il faut que vous soyez toujours maître de votre âme et de vos occupations et il ne faut pas que l’aspect des affaires vous empêche. Pour cela faire, il faut que, guidé toujours par le flambeau de la raison, vous puissiez balancer avec équité les droits des hommes à qui vous devez. Pour cela faire, il faut que, prêt à tout entreprendre pour le service de l’Etat, vous soyez soldat, homme d’affaires, courtisan même si l’intérêt du peuple et de votre nation le demande. Ah ! que votre récompense sera douce ! Défiez alors les malignes vapeurs de la calomnie, de la jalousie ! Défiez hardiment le temps même ! Vos membres décrépits ne seront plus qu’une image imparfaite de ce qu’ils furent jadis et ils attireront cependant le respect de tous ceux qui vous approcheront. L’un racontera, dans sa cabane, le soulagement que vous lui avez apporté. L’autre, en faisant le récit des complots méchants, dira : S’il ne fût pas venu à mon secours, j’eusse péri du supplice des criminels. Chevalier, cesse de restreindre cette âme altière et ce coeur jadis si fier à une sphère aussi étroite ! Toi aux genoux d’une femme ! fais plutôt tomber aux tiens les méchants confondus ! Toi mépriser les peines des hommes ! Sentiment d’honneur, subjugue-le plutôt ! Estimé par tes semblables, respecté, aimé par tes vassaux la mort viendra t’enlever au milieu des pleurs de ceux qui t’entoureront, après avoir coulé une vie douce, oracle de tes proches et père de tes vassaux.
Des Mazis. – Je ne vous entends pas. Comment, monsieur, mon amour pourrait-il m’empêcher de suivre le plan que vous venez de tracer ? Quelle idée vous êtes-vous faite d’Adélaïde ?
Adélaïde, s’il faut pour remplir ses devoirs, soulager les malheureux ; s’il faut pour être vertueux, aimer sa patrie, les hommes, la société, qui plus qu’elle vertueuse ? Croyez-vous que je faisais le bien avec la froideur de la philosophie ? Quand la volonté d’Adélaïde sera le mobile qui me conduira, lui faire plaisir, la récompense… Non, monsieur, vous n’avez jamais été amoureux.
Bonaparte. – Je plains votre erreur. Quoi, chevalier, vous croyez que l’amour est le chemin de la vertu ? Il vous immétrigue à chaque pas. Soyez sincère. Depuis que cette passion fatale a troublé votre repos, avez-vous envisagé d’autre jouissance que celle de l’amour ? Vous ferez donc le bien ou le mal suivant les symptômes de votre passion. Mais, que dis-je, vous et la passion ne font qu’un même être. Tant qu’elle durera, vous n’agirez que pour elle et, puisque vous êtes convenu que les devoirs d’un homme riche consistaient à faire du bien, à arracher de l’indigence les malheureux qui y gémissent, que les devoirs d’un homme de naissance l’obligeaient à se servir du crédit de son nom pour détruire les brigues des méchants, que les devoirs du citoyen consistaient à défendre la patrie et à concourir à sa prospérité, n’avouerez-vous pas que les devoirs d’un bon fils consistent à reconnaître en son père les obligations d’une éducation soignée, à sa mère… Non ! chevalier, je me tairais si j’étais obligé de vous prouver de pareilles évidences…
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DE LA PATRIE
Parallèle entre l’amour de la patrie et l’amour de la gloire
J’ai à peine atteint l’âge de l’aurore des passions ; mon coeur est encore agité de la révolution que cette première connaissance des hommes produit dans nos idées et cependant vous exigez, mademoiselle, que je discute une question qui exigerait une connaissance profonde du coeur humain. Mais vous obéir n’est-il pas le seul titre qui puisse me maintenir digne de cette société intime ? Considérez donc ce discours moins comme un production de l’esprit et des connaissances que comme le tableau fidèle des sentiments qui agitent ce coeur où toute la perversité des hommes n’a peut-être pas encore pénétré.
Si j’avais à comparer les siècles de Sparte et de Rome avec nos temps modernes, je dirais : Régna ici l’amour et l’amour de la patrie. Par les effets opposés que produisent ces passions, on sera autorisé sans doute à les croire incompatibles. Ce qu’il y a de sûr du moins, c’est qu’un peuple livré à la galanterie a même perdu le degré d’energie nécessaire pour concevoir qu’un patriote puisse exister. C’est le point où nous sommes parvenus aujourd’hui. Peu de personnes croient à l’amour de la patrie. Quelle foule d’ouvrages n’a-t-il pas paru en montrer le chimérique ? Sentiments que produit l’action sublime du grand Brutus, n’êtes vous donc qu’une chimère ? Romains, premier peuple de la terre par la simplicité de vos vertus, la force de vos âmes et l’étendue de vos connaissances naturelles, vous vous êtes tous trompés. Vous avez élevé des autels à Brutus comme à un héros. Eh bien ! aprrenez de moi que ce grand homme n’est qu’un fou qu’égara l’amour-propre, lorsque, au milieu de votre place publique, il enfonça dans le sein de ses fils le glaive vengeur des lois. Vous crûtes qu’il était animé de cette passion qui vous transportait tous. Eh bien ! cette passion sublime que vous nous vantez tant n’est que de l’amour-propre, et vous avez été assez peu habiles pour vous laisser séduire ainsi par une férocité sans exemple. L’on vit la vanité de l’emporter sur l’amour paternel. Voilà messieurs, la sensation que j’éprouve à la vue de la question que je dois approfondir. L’amour de la gloire, dit-on, a produit cette foule d’actions que la postérité a célébrées à juste titre, mais auxquelles nos histoires opposent les produits de l’amour de la patrie…
L’amour de l’estime des hommes ou de la gloire peut-il avoir produit cette foule d’actions que la postérité à célébrer sous le nom d’amour de la patrie, ainsi le prétendent nos sophistes modernes. Si cependant nous venons à en démontrer l’insuffisance, que sera-ce donc ? Quel aura donc été le mobile des célèbres patriotes qui tiennent une place si distinguée dans les annales de l’Univers, quelles seront les passions primitives constituant le patriotisme ?
Tel, mademoiselle, serait l’objet des idées que je vais développer sous vos auspices. Puissent-elles en être dignes, heureux toutefois de m’avoir procuré le plaisir de captiver l’attention de la société intime.
Ouvrons les annales des Monarchies. Notre âme s’enflamme sans doute au récit des actions de Philippe, Alexandre, Charlemagne, Turenne, Condé, Machiavelli et tant d’autres hommes illustres qui, dans leur héroïque carrière, eurent pour guide l’estime des hommes ; mais quel sentiment maîtrise notre âme à l’aspect de Leonidas et de ses trois cents Spartiates. Ils ne vont pas un combat, ils courent à la mort pour le sort qui menace leur patrie ; ils affrontent les forces réunies de l’Orient pour obéir, premiers soutiens de la liberté ; mais toi, qui aujourd’hui enchaînes à ton char le coeur des hommes, sexe dont tout le mérite consiste dans un extérieur brillant, considère ici ton triomphe et rougis de ce que tu n’es plus. C’est dans tes annales que je vais trouver la plus grande preuve de l’insuffisance de la gloire. Quelles sont les héroïnes qui triomphent au milieu de Sparte. Je les vois, à la tête des autres citoyens, célébrer par des cris d’allègresse le bonheur de la patrie. « O Thermopyles, vous renfermez le tombeau de mon époux, puissiez-vous rendre le même office à mon fils si des tyrans menaçaient jamais ma patrie. » Quoi ! vous que je vois couronnés de myrthe, vous êtes les efforts sublimes du plus grand héroïsme. Quoi ! ce ne serait donc autre que le vil amour de la gloire ? Mais l’amour de la gloire n’est il pas l’envie d’avoir son nom chanté par la renommée ! Avaient-elles rien de pareil à espérer les femmes spartiates ? N’étaient-ce pas les effets ordinaires que produisait la nouvelle d’une bataille que l’envie de leurs proches d’y être ? Ceux-là, dit Plutarque, se montraient triomphant dans les temples et les places publiques, tandis que les mères et les femmes de ceux qui étaient échappés n’osaient se montrer. Oui, voilà des choses dignes de la patrie. Vous voyez donc bien que l’amour de la gloire ne peut pas avoir été le moteur des Spartiates.
Mais, si l’amour de la gloire a été le principe des actions des républicains et des monarchistes, d’où vient la différence étonnante des sentiments qui nous animent au seul récit, d’où vient la différence même des actions ? Aristide, le plus sage des Athéniens, Thémistocle, le plus ambitieux, encore la terreur du Grand roi, et tous deux sauveurs et restaurateurs de leur patrie, sont récompensés par un exil ignomineux. « O Dieux, puissiez-vous oublier l’injustice de mes compatriotes autant que moi-même je leur pardonne, dit Aristide en jétant un dernier regard sur son ingrate et chère patrie. » -« Dis à mon fils, disait Cimon en subissant son arrêt ignomineux, que, n’étant plus citoyen, je ne lui suis plus rien et que Athènes est toujours sa mère patrie.
Thémistocle préfère avaler la coupe fatale à se voir à la tête de troupes de l’Orient et à se trouver à portée de venger son outrage particulier. Il pouvait espérer sans doute subjuguer la Grèce. Quelle gloire dans la postérité et quelle satisfaction pour son ambition ! Mais non, il vivait au milieu des fastes de la Perse en regrettant toujours son pays. « O mon fils, nous périssions si nous n’avions péri ! » Phrase énergique qui doit être à jamais écrite dans le coeur d’un vrai patriote.
A ces traits d’héroïsme comparerons-nous les actions de Robert d’Artois, de Gaston d’Orléans, du grand Condé et de cette foule de Français qui ne rougirent pas de dévaster les campagnes qui les avaient vu naître. Les uns avaient été nourris dans les préceptes du patriotisme et les autres de l’amour de la gloire. Osez prononcer que le patriotisme n’est rien. Rien ne produisit-il jamais quelque chose ?
Dion possède une grande fortune, une race distinguée, une considération acquise. Que manque-t-il à son bonheur ? Ames énervées, vous pouvez deviner et vous osez parler ! Sa patrie est esclave d’un tyran qui est son allié, d’un tyran qui l’aime et le considère, mais enfin d’un tyran. Les feux brûlants du patriotisme embrasent sa grande âme. Enflammé par le feu brûlant du patriotisme, le disciple du grand Platon, le sévère Dion quitte les lieux fortunés de l’Attique. Adieu, plaisirs qui charmiez sa philosophie. Il sacrifie sa tranquillité. Un tyran règne dans sa patrie. Fuis, Denys, fuis donc ces rives, ci-devant le théâtre de tes cruautés. Dion a déjà arboré dans Syracuse l’étendard de la Liberté, mais l’effet surprenant de la jalousie, ce monstre effroyable que vomirent les enfers dans leurs fureurs se glisse dans le coeur des Syracusains. Les insensés ! Ils osent prendre les armes contre leur sauveur ; ils attaquent de toutes parts la légion qui vient de les délivrer et qui reste fidèle à ce héros qui la conduit. Quels sont cependant les sentiments qui l’animent ? « Etrangers, qui prenez ici la défense de mes jours, s’écrie Dion, ne versez pas, je vous en conjure, le sang de mes compatriotes ! » Est-ce l’amour de la gloire qui lui a dicté cette harangue sublime ? Qu’eût fait le grand Condé ?… Dites, messieurs, que croyez-vous qu’eût fait le grand Condé dans cette circonstance ? Syracuse ! Syracuse, tu aurais porté longtemps la peine de ton ingratitude. Liée à son char, tu eusses servi à jamais de monument à sa gloire et la postérité n’aurait sans doute qu’applaudi sa bravoure. Mais ce ne sont pas là les sentiments qui agitent un coeur où n’est que l’amour de la patrie. Tandis que ses barbares concitoyens font usage, pour lui ravir la vie, de ces armes que lui même leur a fournies : « Etrangers, s’écriait Dion, qui défendez ici mes jours, je vous en conjure ne versez pas le sang de mes concitoyens. » Le protecteur de la liberté n’est plus dans la cité.
Déjà les sattelites des tyrans font couler des flots de sang. La liberté chancelle dans sa dernière forteresse. Dion jouit de son triomphe, voit à ses genoux ces ingrats qui, parjures, en voulaient à sa vie. Mais quoi ! tu pleures ; des larmes ont coulé de tes stoïques yeux ! Quoi ! ces tigres qui, pour prix de ta première défaite, sont altérés de ton sang, ces tigres arrachent tes larmes ! Sentiment de la patrie, que tu es puissant sur les coeurs ! Ainsi que le soleil dissipe le plus épais brouillard, ainsi ô grand Dion, ton aspect dissipa la nombreuse cohorte du tyran. Qu’avec plaisir tu vis couler ton sang ! Il scella pour longtemps la liberté de Syracuse. Vous voulez que l’amour de la goire ait produit ces sublimes larmes ! Vous voulez qu’il ait produit cette courte harangue où règne un sentiment que Jesus-Christ a seul depuis renouvelé ! Mais non ! non ! L’amour de l’immortalité est un sentiment personnel qui céda toujours à l’amour-propre blessé. Turenne, le héros de la France, cède à un intérêt personnel et se rue contre la patrie, -mais que dis-je, cède ? donne une nouvelle force aux effets de la vengeance de l’amour-propre. C’est un sentiment liable avec les passions les plus opposées ! Condé aux Dunes était animé par l’amour de la gloire comme à Rocroy et à Nordlingue.
Faut-il encore chercher des preuves de l’insuffisance de l’amour de la gloire ? Ouvrons les annales de cette petite île trop peu connue sans doute pour l’honneur des temps modernes : un Corse est condamné à périr sur l’échafaud. Ainsi l’ont voulu les lois de la République. Outre les liens du sang, ceux de la reconnaissance et de la plus tendre amitié liait étroitement son neveu à son sort. Dans le transport qui l’anime, il se jette au genoux du premier magistrat, du grand Paoli. « M’est-il permis de plaider pour mon oncle ? Les lois son-elles faites pour faire notre malheur ? Il n’est que trop coupable sans doute, mais nous offrons 2.000 sequins pour le racheter. Jamais il ne rentrera dans l’île. Nous en fournirons 400 tant que durera le siège de Furiani. -Jeune homme, lui répond Paoli, vous êtes Corse. Si vous croyez que cela puisse faire honneur à la patrie, ce jugement va se prononcer et je vous accorde sa grâce. » Ce bon jeune homme se lève. Les convulsions de son visage exprime assez le désordre de son âme. « Non ! non ! Je ne veux pas acheter l’honneur de la patrie pour 2.000 sequins. O mon oncle, je périrais plutôt dans tes bras. Sous quelle face que j’envisage cette héroïque réponse, je ne puis y apercevoir aucune trace de gloire.
Si je continuais, Mademoiselle, à parcourir les annales de cette illustre nation, quels traits de patriotisme n’y trouverai-je pas ? Gaffori, qui joignit à l’âme de Brutus l’éloquence de Cicéron, tu fais au patriotisme le sacrifice de ton amour paternel. Ni l’ambition, ni l’attachement à ses propriétés, ni même ses fils prisonniers des tyrans ne purent tenter Rivorella. « Quand à mes fils, il faudra bien sans doute qu’on me les rende. Je considère le reste comme indigne, m’étant personnel et incomparablement au-dessous des engagements que j’ai contractés avec mes compatriotes ; je meurs content puisque je meurs pour mon pays. Paoli, dans mes bras ! Je serai à côté de Gaffori, et des autres illustres patriotes. » Quelques Amphipolitains firent part à Argileonis de la mort de son fils Brasidas qu’ils avaient vu périr : « sans doute, non, Sparte, n’en a point encore un pareil. -Ne dites point cela, mes amis ; mon fils était un digne citoyen, je veux le croire, mais Sparte en compte dans ses murs encore plus de soixante-dix encore plus dignes d’elle. »
Ce sont les réponses privées où se peint le sentiment. Chaque trait, chaque mot d’un Spartiate peint un coeur embrasé du plus sublime patriotisme. Vous qui prétendez au titre de bons patriotes, qui aspirez à en avoir le sentiment, voici votre baptème. Il n’appartint sans doute qu’à ces âmes privilégiées de la vertu, à ces hommes qui, par la force de leurs organes, peuvent maîtriser toutes leurs passions et par l’étendue de leur vue gouverner les Etats, de marcher sur les traces de Cincinnatus, des Fabricius, des Caton, des Thrasybule ; mais vous, qui prétendez simplement au titre de bons citoyens, méditez Pedaratus. Un vain titre est refusé aux Bouillon et Turenne, le héros de la France, Turenne, le rempart invincible de la patrie, Turenne, qu’elle a comblée de ses faveurs, eh bien ! Turenne réduit en cendres les chaumières qu’il avait si longtemps défendues. Des honneurs refusés à Condé blessent sa gloire, et Condé déploie l’étendard de la révolution. Voilà ce que produisit, dans les deux plus grands hommes de la France, la soif de l’ambition. Que Pedaratus, simple citoyen d’une république célèbre, est dans ce moment au-dessus de ces illustres monarchistes ! Il demande avec instance au tribunal du peuple d’être élu un des Trois Cents, première magistrature de la République. Il est refusé. « Sparte, chère patrie, tu renfermes donc trois cents citoyens plus honnêtes hommes que moi. Dieux soyez témoins de mon allègresse ! Ah ! Puissé-je être le dernier en amour que je consentirai volontiers à ce prix à n’être que citoyen. Demeurez enfin confondus, prôniste de la gloire. Rendez hommage à la vérité. Car les Spartiates affectaient-ils tous ces sentiments sublimes pour s’acquérir de la gloire ? C’était donc un sentiment joué et joué par toute une ville ? Mais pour peu que vous en connaissiez le génie des hommes, vous verrez que cette imposture n’aurait pas duré longtemps. Le ridicule de l’ennui même d’affecter un sentiment que l’on n’a pas aurait bientôt fait que le peuple au moins aurait secoué le joug inutile…
août 1, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LA CORSE
C’est aujourd’hui que Paoli entre dans sa soixante-et-unième année. Son père Hiacinto Paoli aurait-il jamais cru, lorsqu’il vint au monde, qu’il serait compté un jour au nombre des plus braves hommes de l’Italie moderne. Les Corses étaient dans ces temps malheureux (1725) écrasés plus que jamais par la tyrannie génoise. Avilis plus que des bêtes, ils traînaient dans un trouble continuel une vie malheureuse et avilissante pour l’humanité. Dès 1715, cependant, quelques pièves avaient pris les armes contre les tyrans, mais ce ne fut qu’en 1729 que commença proprement cette révolution où se sont passés tant d’actes d’une intrépidité signalée et d’un patriotisme comparable à celui des Romains. Eh bien ! Voyons, discutons un peu. Les Corses ont-ils eu droit de secouer le joug Génois ? Ecoutons le cri des préjugés : les peuples ont toujours tort de se révolter contre leurs souverains. Les lois divines le défendent. Qu’ont de commun les lois divines dans une chose purement humaine ? Mais, concevez-vous l’absurdité de cette défense générale que font les lois divines de jamais secouer le joug même d’un usurpateur ? Ainsi, un assassin assez habile pour s’emparer du trône après l’assassinat du prince légitime est aussitôt protégé pas les lois divines et tandis que, s’il n’eût pas réussi, il aurait été condamné à perdre, sur l’échafaud, sa tête criminelle. Ne me dites pas qu’il sera puni dans un autre monde, parce que j’en dirai autant de tous les criminels civils. S’en suivrait de là qu’ils ne doivent pas être punis dans celui-ci. Il est d’ailleurs simple qu’une loi est toujours indépendante du succès du crime qu’elle condamne.
Quant aux lois humaines, il ne peut pas y en avoir dès que le prince la viole.
Ou c’est le peuple qui a établi ces lois en se soumettant au prince, ou c’est le prince qui les a établies. Dans le premier cas, le prince est inviolablement obligé d’exécuter les conventions par la nature même de sa principauté. Dans le second, ces lois doivent tendre au but du gouvernement qui est la tranquillité et le bonheur des peuples. S’il ne le fait pas, il est clair que le peuple rentre dans sa nature primitive et que le gouvernement, ne pourvoyant pas au but du pacte social, se dissout par lui-même ; mais disons plus : le pacte par lequel un peuple établit l’autorité souveraine dans les mains d’un corps quelconque, n’est pas un contrat, c’est à dire que le peuple peut reprendre à volonté la souveraineté qu’il avait communiquée. Les hommes dans l’état de nature ne forment pas de gouvernement. Pour en établir un, il a fallu que chaque individu consentît au changement. L’acte constitutant cette convention est nécessairement un contrat réciproque. Tous les hommes ainsi engagés ont fait des lois. Ils étaient donc souverains. Soit par la difficulté de s’assembler souvent, soit pour toute autre cause, le peuple aura remis son autorité à un corps ou homme particulier. Or, nul n’est tenu aux engagements qu’il contracte contre son gré. Il n’y pas de lois antérieures que le peuple qui, dans quelques gouvernements que ce soit doit être foncièrement regardé comme le souverain, ne puisse abroger. Il n’en est pas de même quant aux liens qu’il peut avoir les peuples voisins.
Ouvrez les Annales de Corse, lisez les Mémoires de ses braves insulaires, ceux de Michele Merello, etc. ; mais, bien plus, lisez les projets de paix proposés par la République même, et, par les remèdes qu’ils y apportent, vous jugerez des abus qui devaient y régner. Vous y verrez ques les accroissements de la République dans l’île furent commencés par la trahison et la violation du droit de l’hospitalité surprise de Bonifacio et des gens les législateurs de Capo Corso. Vous y verrez qu’ils soutinrent par la force de leur marine plusieurs mécontes des habitants des pièves d’stria contre la République de Pise qui en possédait quelque partie. Enfin, si à force de ruse, de perfidie et de bonheur, ils vinrent à faire consentir les ordres de l’Etat à déclarer Prince la République de Gênes, vous y verrez le pacte tant réclamé par les Corses, quelles étaient les conditions qui devaient constituer leur souveraine principauté.
Mais, de quelque nation que vous soyez, seriez-vous même un ex-eunuque du sérail, retenez votre indignation au détail des cruautés qu’ils employèrent pour se soutenir. Paolo, Colombano, Sampietro, Pompiliani, Gafforio, illustres vengeurs de l’humanité, héros qui délivrâtes vos compatriotes des fureurs du despotisme, quelles furent les récompenses de vos vertus, Des poignards, oui, des poignards !
Efféminés, modernes qui languissez presque tous dans un doux esclavage, ces héros sont trop au-dessus de vos lâches âmes ; mais considérez le tableau du jeune Leonardo, jeune martyr de la patrie et de l’amour paternel. Quel genre de mort termina ton héroïque carrière au printemps de tes ans ? Une corde.
Montagnards, qui a troublé votre bonheur ? Hommes paisibles et vertueux qui couliez des jours heureux au sein de votre patrie, quel tyran barbare a détruit vos habitations ? Quatre mille familles furent obligées de sortir en peu de temps. Vous qui n’aviez que votre patrie, par quel événement imprévenant vous-vois je transportés dans des climats étrangers ? Le feu consume vos demeures rustiques et vous n’avez plus l’espoir de vivre avec vos Dieux domestiques. Puissent les furies vengeresses te faire expier dans les plus affreux tourments le meurtre des Zucci, des Rafaelli, et des autres illustres patriotes que tu fis massacrer malgré les lois de l’hospitalité qui les avaient appelés dans ton palais, misèrable Spinola ! Par quel genre de mort la République tarderait-elle de faire périr les soutiens de la liberté corse ?
Si par la nature du contrat social, il est prouvé que, sans même aucune raison, un corps de nation peu déposer le prince, que serait-ce d’un privé qui, en violant toutes les lois naturelles, en commettant des crimes, des atrocités, va contre l’institution du gouvernement ? Cette raison ne vient-elle pas au secours des Corses en particulier, puisque la souveraineté ou plutôt la principauté des Génois n’était que conventionnelle. Ainsi, les Corses ont pu, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des Français. Amen.
(Valence le 26 avril 1786)
juillet 31, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LE SUICIDE
Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd’hui ? Du côté de la mort. Dans l’aurore de mes jours je puis espérer encore vivre longtemps. Je suis absent depuis six à sept ans de ma patrie. Quels plaisirs ne goûterai-je pas à revoir dans quatre mois et mes compatriotes et mes parents ! Des tendres sensations que me fait éprouver le souvenir des plaisirs de mon enfance, ne puis-je pas conclure que mon bonheur sera complet ? Quelle fureur me porte donc à vouloir ma destruction ? Sans doute, que faire dans ce monde ? Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? Si j »avais déjà passé soixante ans, je respecterais le préjugé de mes contemporains et j’attendrais patiemment que la nature eut achevé son cours ; mais puisque je commence à éprouver des malheurs, que rien n’est plaisir pour moi, pourquoi supporterais-je des jours que rien ne prospère ? Que les hommes sont éloignés de la nature ! Qu’ils sont lâches, vils, rampants ! Quel spectacle verrai-je dans mon pays ? Mes compatriotes chargés de chaînes et qui baisent en tremblant la main qui les opprime ! Ce ne sont plus ces braves Corses qu’un héros animait de ses vertus, ennemi des tyrans, du luxe des vils courtisans. Fier, plein d’un noble sentiment de son importance particulière, un Corse vivait heureux s’il avait employé le jour aux affaires publiques. La nuit s’écoulait dans les tendres bras d’une épouse chérie ? La raison et son enthousiasme effaçaient toutes les peines du jour. La trendresse, la nature rendaient ses nuits comparables à celle des Dieux. Mais, avec la liberté, ils se sont évanouis comme des songes, ces jours heureux ! Français, non contents de nous avoir ravis tout ce que nous cherissions, vous avez encore corrompu nos moeurs. Le tableau actuel de ma patrie et l’impuissance de le changer est donc une nouvelle raison de fuir une terre où je suis obligé par devoir de louer des hommes que je dos haïr par vertu. Quand j’arriverai dans ma patrie, quelle figure faire, quel langage tenir ! Quand la patrie n’est plus, un bon patriote doit mourir. Si je n’avais qu’un homme à détruire pour délivrer mes compatriotes, pe partirais au moment même et j’enfoncerais dans le sein des tyrans le glaive vengeur de la patrie et des lois violées. La vie m’est à charge parce que je ne goûte aucun plaisir et que tout est peine pour moi. Elle m’est à charge parce que les hommes avec qui je vis et vivrai probablement toujours ont des moeurs aussi éloignées des miennes que la clarté de la lune diffère de celle du soleil. Je ne peux donc pas suivre la seule manière de vivre qui pourrait me faire supporter la vie, d’où s’ensuit un dégoût pour tout.
(Valence le 3 mai 1786)