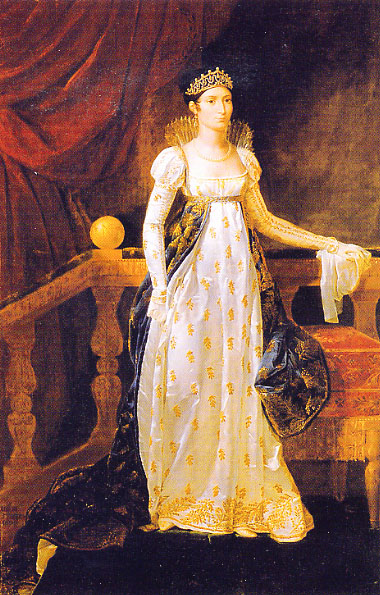juillet 10, 2008
ALEXANDRE-FLORIAN-JOSEPH COLONNA-WALEWSKI (1810-1868), COMTE D’EMPIRE
Je désire qu’Alexandre Walewski soit attiré au service de la France dans l’armée.
[extrait du testament de l’Empereur]
WALEWSKI (Alexandre-Florian-Joseph COLONNA, comte), littérateur et homme politique français, né au château de Walewice en Pologne) le 4 mai 1810, mort à Strasbourg en septembre I868. Il était fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Walewska, fut élevé à Genève, puis à Varsovie et montra durant toute son éducation une grande précocité d’esprit. Dès l’âge de dix neuf ans, il s’enfuit de son pays pour aller à Londres solliciter les hommes d’Etat les plus éminents de l’Angleterre en faveur de la Pologne. De Londres il vint en France, où il se trouvait au moment de la Révolution de juillet 1830. Il fut amicialement accueilli par le duc d’Orléans, qui, devenu roi, le chargea d’une mission en Pologne. Lorsque, en 1831, les Polonais se soulevèrent contre les Russes, Walewski devint aide de camp du général en chef de l’armée nationale et prit part à la bataille de Grochow. Député à Londres par le gouvernement insurrectionnel, il ne put accomplir sa mission désormais sans but, les Russes ayant repris Varsovie, et il vint de nouveau chercher un refuge en France. Il se fit naturaliser Français et, grâce à ses hautes relations, prit rang dans l’armée en qualité d’officier d’ordonnance du maréchal Gérard. Ensuite il devint capitaine dans la légion étrangère, passa au 4e régiment de hussards et fut chargé des fonctions de directeur des affaires arabes à Oran. Rappelé en France et fatigué de la vie oisive des garnisons, désireux d’ailleurs de briller dans le monde, il donna sa démission en 1837, acheta le Messager des Chambres et entreprit de se faire connaître dans la société parisienne de cette époque comme homme élégant, comme publiciste et comme auteur dramatique. Après avoir écrit quelques brochures politiques, Un mot sur la question d’Afrique (1837, in-32) et l’Alliance anglaise (1838, in-32), il voulut aborder le théâtre, ou il passa pour avoir collaboré avec M. Alexandre Dumas à Mademoiselle de Belle-Isle (1839). Le 8 janvier 1840, il fit jouer au Théâtre-Français, avec un, luxe d’ameublement peu ordinaire sur cette scène, l’Ecole du monde ou la Coquette sans le savoir comédie en cinq actes, à laquelle Anaïs Aubert, selon Quérard (la France littéraire), aurait apporté une très active collaboration. Lue au comité par cette actrice, reçue avec empressement, soutenue, vantée, protégée par de hautes influences, par des célébrités littéraires qui en suivaient avec complaisance les répétitions, par Victor Hugo, par Casimir Delavigne, l’Ecole du monde n’obtint pas grâce devant le parterre ; jamais cependant plus brillante assemblée ne s’était réunie pour entendre une œuvre de l’esprit humain. « Voilà donc, s’écriait Théophile Gautier dans la Presse du 14 janvier, la pièce d’un homme du monde ! Assurément aucun de nous ne l’aurait faite plus mauvaise ; il est plus aisé d’avoir de beaux chevaux, des équipages splendides, des toilettes somptueuses, d’être un lion qu’un auteur comique. Cela n’est pas donné au meilleur gentilhomme d’être poëte quand il veut ; un poëte deviendrait plutôt gentilhomme au besoin… Et puis, s’il faut vous le dire, illustres gentilshommes, lions à tous crins , très précieux fashionables, il vous manque une chose pour être poètes… Pour être des poètes, il faut avoir beaucoup souffert, et vous n’avez pas souffert. Le mal passe sous vos pieds et ne vous atteint pas ; il n’y a d’autre malheur pour vous que de mourir, de recevoir un coup de fleuret dans la figure ou de faire une comédie en cinq actes et en prose ! » Cet échantillon de la critique de ne saurait donner qu’une faible idée des attaques dont fut l’objet cette Ecole du monde, que le grand monde parisien avait proclamée à l’avance un chef-d’œuvre. Le feuilleton de Jules Janin fut très-spirituel, très méchant et très remarqué. Nestor Roqueplan s’écria : « On n’a pas écouté mes avis ; j’avais recommandé à l’auteur d’inonder le second acte de traits d’esprit. » Une polémique ardente, où les horions ne furent pas ménagés, s’éleva pour prouver que la critique et les journaux avaient eu le plus grand tort de méconnaître l’œuvre d’un homme du monde, d’un gentilhomme, lequel était journaliste cependant. Quoi qu’il en soit, les comédiens en furent pour leurs frais d’étude ; le public s’obstina à ne rien comprendre aux personnages qui s’agitaient et parlaient sur la scène ; il ne voulut pas croire que ce monde qu’on lui représentait était réellement celui qui existe, et l’ouvrage tomba. L’auteur, qui avait gardé l’anonyme, répondit aux sifflets par une préface a sa pièce. Il y ajouta même une dédicace à Victor Hugo, qu’il signa bravement. Attristé, mais non pas découragé par l’insuccès de l’Ecole du monde, il voulut aborder le théâtre une seconde fois avec les Dandys. De petites intrigues, auxquelles il n’était pas indifférent, agitaient alors la maison de Molière. La muse comique et la muse tragique, Anaïs et Rachel, se disputaient le cœur du jeune écrivain homme du monde. Scribe, un bon juge, étant consulté sur ces Dandys, proposa de prendre sa part dans la pièce à la condition qu’elle n’aurait que trois actes, qu’elle serait donnée au Gymnase et que lui, Scribe, en écrirait le dialogue. « Ainsi faite, dit le jeune comte Walewski, ma comédie ne serait plus mienne, elle serait vôtre. Elle aurait un grand succès, j’en conviens ; mais je n’oserais pas, cette fois moins que jamais, me départir de mon incognito. » Plus tard, Scribe, ayant gardé bon souvenir des Dandys, les voulut revoir; il soumit à Walewski, tout-puissant personnage alors, un nouveau projet dans lequel il lui laissait une plus g’rande part de collaboration ; mais dans l’intervalle étaient survenues les grandes affaires ; le doux loisir des choses littéraires avait gagné le pays des songes. L’auteur des Dandys remit cependant sa pièce à Scribe. On a retrouvé le manuscrit sur la table du célèbre écrivain dramatique, et ce fut Mme Scribe elle-même qui le renvoya au comte Walewski après la mort de son mari. La même année 1840, Walewski entra dans la carrière diplomatique, où la réussite est plus facile que dans les lettres pour un jeune élégant, ami du luxe et de la richesse. M. Thiers, devenu président du cabinet du 1er mars, acheta le Messager des Chambres et donna à son rédacteur une mission en Egypte. Il s’agissait de se rendre auprès du pacha Méhémet-Ali pour conjurer l’effet produit par un grave événement, le traité de Londres. Sous le ministère Guizot, plusieurs autres missions lui furent encore confiées, II était attaché à la légation de Buenos-Aires, lorsque la Révolution de février éclata. Après l’élection de Louis-Napoléon à la présidence de la trop confiante République, Walewski vint grossir le nombre de ceux qui étaient décidés à greffer leur fortune politique sur le rameau impérial. D’anciennes relations avec quelques-uns des intimes de l’Elysée lui valurent d’être enrégimenté parmi les hauts employés sur qui l’on pourrait compter le moment venu. Dès 1849, le prince-président, comme on disait à cette époque, nomma Walewski ministre plénipotentiaire à Florence, puis ambassadeur a Naples, Madrid, et enfin à Londres. Ses relations personnelles avec lord Palmerston l’avaient fait désigner par Louis-Napoléon pour ce poste important. Il s’agissait de préparer l’Angleterre à reconnaître le gouvernement nouveau aussitôt après le coup d’Etat, de façon à amener les autres cabinets européens au même acte diplomatique, complicité presque indispensable à un ordre de choses qui veut s’établir par la violence et l’illégalité. Lord Palmerston fut averti amicalement par le comte Walewski des préparatifs faits par le futur empereur pour dissoudre l’Assemblée nationale et proclamer la dictature du président. Tout fut préparé au Foreign Office dans le but de hâter les lenteurs bien connues des chancelleries. Et lorsque le télégraphe apporta a l’ambassadeur la nouvelle de l’attentat du décembre, il en informa sur le champ, d’une façon officielle, le chef du cabinet de Saint-James, qui, sans retard et sans même consulter ses collègues, donna son approbation au coup d’Etat. Cet acte extraparlementaire amena une crise ministérielle ; il y avait violation des traditions britanniques ; lord Palmerston perdit son portefeuille, mais il n’en resta pas moins l’ami fidèle du comte Walewski, qu’il a précédé dans la tombe. Cet acte de compérage resta inconnu en France, ce qui a permis plus tard a certains panégyristes de faire honneur au comte Walewski de n’avoir point pris part au coup d’Etat. Il est vrai qu’étant absent de Paris, loin du lieu d’exécution, il n’a pas, comme les Morny, les Maupas, les Saint-Arnaud, les Canrobert et d’autres personnages dont l’histoire se souviendra pour les flétrir, imprimé à son nom la tache ineffaçable du sang répandu. Il n’a pas contre-signé la trahison, le guet-apens, l’état de siège ; il n’a pas décrété la fusillade, la proscription, l’exil. Son parafe n’existe pas au bas de ces ordres froidement impitoyables qui semèrent la ruine, la terreur et la mort, qui glacèrent les veines de la patrie, qui coupèrent, dans le pur élan de sa sève nouvelle, le fier, libre et joyeux esprit national ; qui firent de la France de Voltaire la terre du silence, de la peur et du découragement. Grâce à son éloignement de Paris au 2 décembre, il apparaît plutôt comme un homme d’Etat frotté de libéralisme, honnête et loyal dans son bonapartisme naturalisé polonais, incapable au demeurant de tous ces mensonges politiques dont les soutiens du trône nous ont donné de si curieux spécimens. Le mépris et la haine voués à tous les premiers sujets de la douloureuse tragédie de décembre laissent quelque place à la bienveillance pour les comparses, les doublures et les utilités dont les noms ne figurèrent pas sur l’affiche. Mais si l’on doit la vérité aux morts et s’il est vrai que la justice, un instant obscurcie, reprenne tôt ou tard inévitablement ses droits, que pensera l’avenir de ce diplomate qui, soutenu à grands frais par la République, a servi, dans l’ombre des chancelleries, une entreprise ayant pour but de renverser cette même République, à laquelle il avait promis fidélité ? A quel mobile obéissait-il ? Son devoir n’était-il pas de démasquer la trahison, ou tout au moins de se refuser à cette complicité dont il lui faut aujourd’hui rendre compte devant l’histoire ? Cette complicité, ignorée du plus grand nombre, lui fut toujours légère à porter. il n’eut jamais à se justifier de l’œuvre de décembre, circonstance qui lui permettait une action plus libre, qui lui ouvrait un champ plus large dans la politique. Nommé au Sénat le 26 avril 1855, la comte Walewski fut, le 7 mai de la même année, appelé à remplacer aux affaires étrangères le ministre Drouin de Lhuys, qui venait de donner sa démission. Il fut, en cette qualité, chargé de régler toutes nos relations avec les différentes puissances européennes, pendant la dernière période de la guerre d’Orient, présida, comme plénipotentiaire de la France, les conférences du congrès de Paris et signa le traité du 30 avril 1856. Il présida aussi les nombreuses conférences qui eurent lieu de nouveau à Paris, pour régler les détails de l’application du traité en juillet 1858. Au mois de janvier 1860, il fut remplacé au ministère par M. Thouvenel, entra au conseil privé, et, le 24 novembre suivant, reçut le portefeuille de ministre d’Etat, avec la direction des beaux-arts. Il a contre-signé, comme ministre d’Etat, le décret remaniant, dans un sens un peu moins étroit, l’organisation du Corps législatif. Son administration, dans ce nouveau poste, fut signalée par l’élaboration et la présentation de la loi sur la propriété littéraire et artistique. Le 3 mars 1856, il avait été nommé grand-croix de la Légion d’honneur. En juin 1863, le comte Walewski résigna ses fonctions ministérielles ; en 1865, il quitta le Sénat pour se présenter, comme candidat officiel à la députation dans le département des Landes. Dans la pensée du gouvernement, il devait remplacer M. de Morny à la présidence du Corps législatif. On en répandit le bruit à dessein avant l’élection et il fut nommé. Aussitôt et avant même que ses pouvoirs eussent été vérifiés et validés par la Chambre, un décret l’appela au fauteuil, et il occupa tout de suite le palais de la présidence. Une question de légalité constitutionnelle fut, à ce propos, soulevée par les journaux. La cordialité conciliante qui était le fond de son caractère privé, Walewski l’apporta dans ses nouvelles fonctions ; mais il n’avait pas l’habileté, le savoir-faire, l’audace sans scrupule de son prédécesseur de Morny, ni la bourgeoise médiocrité de son successeur Schneider. La Chambre n’était pas sous sa main ; cela ne pouvait plaire en haut lieu et on gourmanda sa longanimité envers les orateurs qui se permettaient de n’être pas les claqueurs du régime impérial. La majorité intrigua sourdement ; un complot s’organisa contre lui. D’ailleurs l’opinion publique lui attribuait l’inspiration des lois sur la presse et sur le droit de réunion, et c’était là un crime que ne pouvaient lui pardonner les muets du sérail de M. Rouher. Fit-on naître l’occasion qui devait le faire succomber ? Lui tendit-on un piège ? On serait tenté de le croire : « Les rôles étaient trop bien distribués, a dit un journaliste, pour que la pièce n’eût pas été répétée d’avance. » Un tumulte de discussion provoqué par une imprudence ou une adresse du gouvernernent éclata ; le président refusa de rappeler à l’ordre M. Thiers, et la question de cabinet fut posée, dit-on, par le ministre Rouher. Walewski se crut obligé de descendre du fauteuil ; il se retira volontairement ; mais blessé dans sa dignité et presque honni par une droite servile et inepte. La gauche entière se leva pour le saluer et l’accompagner jusqu’aux appartements présidentiels, qu’il quittait une heure après. Ceci se passait eu 1867. Cet échec bouleversa Walewski. Il avait dignement quitté un poste où il n’était pas libre, il ne lui restait plus qu’à aller s’asseoir à son banc de député. Mais il manquait de fermeté ; il se laissa réintégrer au Sénat, et au lieu de jouer ouvertement la partie libérale qu’il s’était déterminé à tenter, il la joua comme conseiller intime. « II paraît avoir été le seul confident et presque l’inspirateur de la lettre du 19 janvier, dit M. J. Richard ; il est certain qu’il avait hérité de M. de Morny d’une certaine prédilection pour M. Emile Ollivier ; on pense même que certains projets manuscrits, rédigés en 1862 par M. de Morny, étaient arrivés entre ses mains, et que le nom de M. Emile Ollivier y était relaté avec des appréciations favorables. M. Walewski le présenta à l’Empereur, qui l’accueillit avec bienveillance. M. Ollivier, non-seulement parce qu’il était M. Ollivier, mais aussi parce qu’il était amené par M. Walewski, ne trouva que morgue et défiance chez les ministres. La fusion, qui eût peut-être réussi, menée par M. de Morny, échoua sous la direction de M. Walewski. La vérité est qu’il n’était pas de ces habiles, de ces retors, de ces statégistes froids et égoïstes qui savent se maintenir par n’importe quel moyen pendant quinze ou vingt ans au pouvoir. Il n’a guère fait qu’y passer ; mais y a toujours passé avec assez d’à-propos. En septembre 1868, le comte Walewski voyageait en Allemagne avec sa femme et sa fille. S’il faut en croire certaines rumeurs accréditées, il reprenait à toute vapeur le chemin de Paris pour y recevoir de nouveau le portefeuille des affaires étrangères lorsque, revenant de Munich, il mourut subitement à Strasbourg, dans l’hôtel où il venait de descendre. Dans l’heureux temps où nous vivons, disait à cette époque M. Hervé dans le Journal de Paris, il suffît d’une dose moyenne d’intelligence et de jugement, d’une certaine habitude des affaires et d’un peu de modération et d’honnêteté, pour mettre un homme fort au-dessus du commun. Ces qualités, M. Walewski les possédait. Il lui manquait, il est vrai, d’autres qualités qui lui auraient été peut-être plus utiles encore dans, sa carrière politique. Il n’avait ni cet heureux détachement de toutes les opinions, qui permet de plaider tour à tour le pour et le contre avec une égale chaleur, et de défendre à trois heures, dans la Chambre, les mesures que l’on a combattues à midi dans le cabinet ; ni ce mélange d’étourderie et de pédantisme par lequel on se donne si facilement des airs de réformateur, en se bornant le plus souvent à remplacer : Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour, par : Belle marquise, mourir me font d’amour vos yeux beaux. Aussi, n’a-t-il pas fait une de ces fortunes politiques devant lesquelles les badauds restent confondus. »
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Comte Alexandre Walewski sur wikipedia
mars 30, 2008
LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – LE PRINCE IMPERIAL « NAPOLEON IV »
(16 mars 1856 – 1er juin 1879)
Prince Impérial
(16 mars 1856 – 4 septembre 1870)
Lien : Le Prince Impérial sur wikipedia
LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – NAPOLEON III (1808-1873)
(20 avril 1808 – 9 janvier 1873)
Empereur des Français
(2 décembre 1852 – 4 septembre 1870)
Lien : Napoléon III sur wikipedia
mars 29, 2008
LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – NAPOLEON II (1811-1832)
(20 mars 1811 – 31 juillet 1832)
Empereur des Français
(22 juin – 7 juillet 1815)
Lien : Napoléon II sur wikipedia
mars 15, 2008
L’IMPERATRICE JOSEPHINE, VEUVE DE BEAUHARNAIS (1763-1814)
Joséphine avait donné le bonheur à son mari et s’était constamment montrée son amie la plus tendre, professant – à tout moment et en toute occasion – la soumission, le dévouement et la complaisance la plus absolue.
JOSÉPHINE (Marie-Josèphe-Rose TASCHER DE LA PAGERIE), impératrice des Français, née aux Trois-Ilets (Martinique) le 23 juin 1763, morte à la Malmaison (Seine-et-Oise) le 29 mai 1814. Elle appartenait à une famille originaire du Blaisois. Elle fut amenée en France à l’âge de quinze ans, et y épousa, en 1779, le vicomte Alexandre de Beauharnais, dont elle eût deux enfants, le prince Eugène et la reine Hortense. Son mari ayant été emprisonné pendant la Terreur, Joséphine lui rendit en prison les soins les plus affectueux, essaya vainement de l’arracher à l’échafaud, fut arrêtée elle-même et ne dut son salut qu’au 9 thermidor. Mise en liberté par le crédit de Tallien, qui lui fit rendre une partie de ses biens, elle acquit ensuite l’amitié et la protection de Barras, et ce fut celui-ci qui lui proposa d’épouser le général Bonaparte, que les manières distinguées de Joséphine, sa grâce et sa douceur eurent bientôt captivé. Le mariage purement civil eut lieu le 9 mars 1796. Le mariage religieux ne fut célébré que la nuit qui précéda la cérémonie du sacre, huit ans plus tard. Elle partagea dès lors la fortune de Bonaparte, qui, malgré de fréquents accès d’une jalousie trop motivée, ne cessa point de l’aimer beaucoup. Pendant l’expédition d’Egypte, Joséphine s’établit à la Malmaison, et, aux approches du coup d’Etat du 18 brumaire, elle rendit les plus grands services au futur empereur par sa dextérité et l’influence que sa grâce irrésistible exerçait sur les principaux personnages de l’époque. Le 2 décembre elle fut sacrée impératrice par le pape Pie VII en même temps que Napoléon. Cinq années s’écoulèrent, et l’union de Joséphine avec Napoléon étant demeurée stérile, l’Empereur, qui tenait à avoir un héritier, résolut de faire rompre son mariage.Ce fut en dînant tête à tète avec sa femme qu’il lui apprit sa résolution de divorcer avec elle. En l’entendant, Joséphine s’évanouit. Aussi effrayé qu’ému de l’effet qu’il venait de produire, dit M. d’Haussonville, Napoléon entr’ouvrit la porte de son cabinet et appela à son aide le chambellan de service, M. de Bausset. L’évanouissement durant toujours, il demanda au chambellan si, pour éviter toute esclandre, il se sentait la force de porter l’impératrice jusque dans ses appartements, qui communiquaient avec les siens par un escalier dérobé. M. de Bausset prit l’impératrice dans ses bras, et l’Empereur, marchant le premier, à reculons, lui soutint soigneusement les pieds. Ils descendirent ainsi l’escalier. Rien n’avait paru feint ni arrangé à M. de Bausset dans la triste scène dont il était le témoin involontaire ; cependant, ses jambes s’étant un moment embarrassées dans son épée, tandis qu’il descendait cet escalier étroit, comme il se roidissait pour ne pas laisser tomber son précieux fardeau, sa surprise fut assez grande d’entendre Joséphine lui dire tout bas : « Prenez garde, monsieur, vous me serrez trop fort. » Malgré les supplications et les larmes de Joséphine, la volonté du maître s’accomplit. Le divorce fut prononcé le 16 décembre et Joséphine se retira à la Malmaison. Napoléon lui fit de magnifiques dotations, lui constitua une rente de 2 millions de francs et entretint même avec elle une correspondance dont Marie-Louise se montra plus d’une fois jalouse. Joséphine mourut d’une esquinancie, après six jours de maladie, juste au moment où Napoléon tombait, entraînant dans sa chute l’honneur de la France dont l’étranger foulait le sol. Elle put deviner les malheurs que l’insatiable ambition et la folie guerrière dû despote de brumaire, dont elle s’était faite la complice et l’associée, faisaient fondre sur nous.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Liens : Douce et incomparable Joséphine – Rose Tascher de la Pagerie sur wikipedia
mars 5, 2008
FRANCOIS Ier (1768-1835), EMPEREUR D’AUTRICHE
Ce squelette de François II, que le mérite de ses ancêtres a placé sur le trône.
Je croyais l’empereur François un bon homme ; je me suis trompé ! C’est un imbécile, un paresseux sans cervelle et sans coeur. Il est dépourvu de tout talent. Il ignore l’affection, la sensibilité et la gratitude. En fait, les bonnes qualités lui font complètement défaut.
FRANÇOIS II (Joseph-Charles), empereur d’Allemagne, puis FRANÇOIS 1er, empereur d’Autriche, né en 1768, mort en 1835. Il succéda, en 1792, à Léopold II, son père. C’était un prince d’une nullité à peu près complète. Il ne régna que de nom, sous la tutelle de Metternich. A son début, il entra en lutte avec la Révolution française, et, jusqu’en 1809 cette lutte ne fut pour lui qu’une série de désastres. En 1797, le traité de Campo-Formio lui enlève la Lombardie ; mais, par une condescendance coupable du Directoire, François reçoit Venise en dédommagement. La perte de la bataille de Marengo lui coûte plusieurs provinces (14 juin 1800). Défait à Austerlitz, il cède la Vénétie (1805). L’établissement de la Confédération du Rhin l’oblige à abdiquer le titre d’empereur d’Allemagne pour prendre celui d’empereur d’Autriche (1806) ; une nouvelle levée de boucliers, qu’il fait en 1809,lui coûte la Gallicie et les provinces illyriennes. Enfin, pour comble d’humiliation, il se voit obligé de donner sa fille aînée, Marie-Louise, à son heureux vainqueur (1810). L’alliance qu’il a contractée, il se hâte de la rompre dès que Napoléon est abandonné par la fortune (1813). Les succès de la coalition le remettent en possession de tous les Etats qu’il a perdus depuis vingt ans. François Ier se montra dur dans la répression des tentatives insurrectionnelles de la Lombardie eu 1821 : les tortures du Spielberg pèseront éternellement sur sa mémoire.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : François Ier d’Autriche sur wikipedia
janvier 18, 2008
LA FAMILLE DE NAPOLEON – CHARLES BONAPARTE (1746-1785)
Si mon père qui est mort avant quarante ans, eût vécu, il eût été nommé député de la noblesse de Corse à l’Assemblée constituante. Il tenait fort à la noblesse et l’aristocratie ; d’un autre côté il était très chaud dans les idées généreuses et libérales ; il eût donc été ou tout à fait du côté droit, ou au moins dans la minorité de la noblesse. Dans tous les cas quelles qu’eussent été mes opinions personnelles, j’aurais suivi sa trace, et voilà ma carrière entièrement dérangée et perdue.
Bonaparte (Charles-Marie). Père de Napoléon, né à Ajaccio le 29 mars1746, fut envoyé à Pise pour étudier le droit, et épousa à son retour Laetitia Ramolino. C’est de ce mariage que naquit toute une génération de rois. En 1768, Charles Bonaparte fut du nombre des patriotes qui secondèrent les deux Paoli dans leur lutte armée pour l’indépendance de la Corse. Non seulement il se distingua par son courage, mais c’est lui qui rédigea, dit-on, l’adresse à la jeunesse corse, publiée à Corte en juin 1768. Sa femme l’accompagna partout, bien qu’elle fût enceinte de sept mois de Napoléon, et partagea avec lui tous les périls delà guerre, jusqu’au moment où Paoli s’éxila. Alors, après l’établissement définitif de la domination française, Charles Bonaparte revint s’établir dans ses foyers, et, grâce à la protection du comte de Marbeuf, gouverneur de l’Ile, fut reconnu noble et nommé successivement assesseur de la ville et province d’Ajaccio en 1774, député de la noblesse de Corse à la cour de France en 1777, et enfin, en 1781, membre du conseil des douze nobles de l’île. Pendant qu’il remplissait à Paris sa mission, il obtint trois bourses : une pour Joseph, son fils aîné, au collège d’Autun ; la seconde, pour Napoléon, à l’école de Brienne ; la troisième, à la maison royale de Saint-Cyr, pour sa fille Marie-Anne-Elisa. Charles Bonaparte mourut en à Montpellier, où il était venu pour se faire traiter d’un squirre à l’estomac. Ses restes furent transportés plus tard à Saint-Leu, par les soins de son fils Louis. Il eut de son mariage treize enfants, dont huit lui survécurent, cinq fils et trois filles, savoir : 1° Joseph Bonaparte; 2° Napoléon Bonaparte ; 3° Marie-Anne-Elisa Bonaparte ; 4° Lucien Bonaparte ; 5° Louis Bonaparte ; 6° Marie-Pauline Bonaparte ; 7° Marie-Annonciade-Caroline Bonaparte ; 8° Jérôme Bonaparte.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Liens : Charles Bonaparte sur Wikipedia & Biographie de Charles Bonaparte par Nasica
LA FAMILLE DE NAPOLEON – LAETITIA BONAPARTE (1750-1836), MADAME MERE
Madame Mère était trop parcimonieuse ; c’en était ridicule… c’était excès de prévoyance ; elle avait connu le besoin, et ces terribles moments ne lui sortaient pas de la pensée… mais chez elle le grand l’emportait toujours sur le petit : la fierté, la noble ambition marchait avant l’avarice.
Bonaparte (Mme Marie-Laetitia Ramolino). Epouse de Charles Bonaparte, mère de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 24 août 1750, d’une famille patricienne. Bien qu’au milieu des discordes civiles qui déchiraient son pays, elle n’eût pu recevoir qu’une éducation médiocre, elle se fit toujours remarquer par la pénétration de son esprit et la rectitude de son jugement, autant que par l’élévation de son caractère. Elle, était d’une beauté pleine d’éclat, dont la gravité mélancolique et la dignité sévère rappelaient à l’esprit le type idéal de la matrone romaine. En 1767, elle épousa Charles Bonaparte, dont elle partagea les périls lors de la résistance armée contre la conquête française ; elle le suivait à cheval, même pendant ses grossesses, dans ses expéditions et ses fuites à travers les montagnes. Devenue veuve en 1785, elle déploya le plus ferme caractère et veilla seule à l’éducation de ses enfants. Lorsque, en 1793, la Corse eut été livrée aux Anglais, elle fut obligée de fuir au milieu de mille dangers, et se réfugia avec son fils Lucien et ses trois filles à Marseille, où elle fut réduite aux subsides que la République accordait aux patriotes réfugiés, et où elle vécut dans un dénùment extrême jusqu’au moment où Bonaparte, devenu général en chef de l’armée d’Italie, put améliorer le sort de sa famille. Dès lors, elle suivit la fortune extraordinaire de son illustre fils ; reçut, en 1804, le titre de Madame Mère, eut un palais, une cour, dont les charges étaient remplies par les plus grands noms de l’ancienne monarchie ; mais conserva, au milieu de cette grandeur inouïe de sa race, l’austère simplicité de sa vie passée. Il paraît même que, malgré le désir de l’Empereur, elle poussait sa répugnance pour le faste et l’éclat jusqu’à la parcimonie, et qu’elle s’attachait moins à jouir du présent qu’à se prémunir contre les éventualités de l’avenir. Par une prévoyance de mère de famille dont la vie avait été douloureusement éprouvée, elle disait parfois, avec une gaieté pleine de mélancolie : Qui sait si je ne serai pas un jour obligée de donner du pain à tous ces rois ? On sait qu’en effet, plus tard, les économies accumulées par la sollicitude maternelle ne furent pas inutiles à tous ces rois devenus des proscrits. Après les désastres de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, Madame Mère se relira à Rome, où elle vécut dans une retraite profonde, protégée par le respect et la sympathie de toute l’Europe, portant avec une dignité admirable, et pendant plus de vingt ans encore, le poids de ses souffrances physiques (elle s’était cassé la cuisse), de ses angoisses morales et de ses immenses douleurs. Elle mourut en 1836, âgée de plus de quatre-vingt-cinq ans, d’une fièvre gastrite, emportant dans sa tombe la déchirante pensée que la France était à jamais fermée à tous les siens, et exprimant le désir qu’ils n’y rentrassent jamais qu’appelés par la volonté nationale. Quelques dissidences passagères avaient existé entre le fils et la mère. Napoléon se rappelait avec une certaine amertume qu’elle s’était vivement opposée à ce qu’il prît le titre d’Empereur, et oubliait difficilement sa préférence pour Lucien, qu’elle avait sans cesse soutenu, en disant avec une grandeur d’âme toute cornélienne : « Celui de mes enfants que j’aime le plus, c’est toujours le plus malheureux. » II se montrait aussi blessé de son aversion pour Marie-Louise. Cependant, en 1820, lorsque les fautes de la Restauration suscitèrent des révolutions en Espagne et en Italie, et qu’il se forma une conspiration bonapartiste, accusée de répandre des millions pour fomenter un mouvement en faveur de son fils, elle répondit noblement : « Je n’ai pas de millions ; mais si je possédais les trésors qu’on me suppose, je les emploierais à armer une flotte pour enlever mon fils de l’île de Sainte-Hélène, où la plus odieuse déloyauté le retient prisonnier. » En effet, quoi qu’on ait dit de ses immenses richesses, elle ne laissa qu’une fortune de 80.000 fr.ancs de rente et environ 500.000 francs de bijoux. Le plus bel héritage qu’elle légua à ses enfants fut l’exemple de sa modération dans la prospérité, de sa grandeur d’âme dans l’adversité.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Madame Mère sur Wikipedia & Souvenirs de Madame Mère
janvier 16, 2008
LA FAMILLE DE NAPOLEON – HORTENSE DE BEAUHARNAIS (1783-1837), REINE DE HOLLANDE
Hortense, si bonne, si généreuse, si dévouée, n’est pas sans avoir quelques torts avec son mari ; j’en dois convenir, en dehors de toute l’affection que je lui porte et du véritable attachement que je sais qu’elle a pour moi.
Beauharnais (Eugénie-Hortense de). Reine de Hollande, connue sous le nom de la reine Hortense, née à Paris en 1783, morte à Arenenberg en 1837. Fille d’Alexandre de Beauharnais et de Rose Tascher de la Pagerie, que devait épouser Napoléon, elle fut emmenée, à l’âge de quatre ans, à la Martinique, d’où elle revint en 1790. La jeune Hortense avait onze ans lorsque son père monta sur l’échafaud. Sa mère fut jetée en prison, et elle-même gardée à vue dans l’hôtel de Salm avec son frère Eugène. Lorsque l’horizon se fut éclairci et que Joséphine, sans prévoir sa future grandeur, eut, malgré les conseils de ses amis, épousé en secondes noces (9 mars 1796) le général Bonaparte, connu seulement par le siège de Toulon et la journée du 13 vendémiaire, Hortense fut mise en pension chez Mme Campan. Elle en sortit à dix-sept ans, et, deux, ans plus tard, le 13 janvier le premier consul lui fit épouser son frère Louis. Ni l’un ni l’autre des deux époux, n’avait désiré cette union ; mais elle servait la politique de Napoléon : il fallut obéir. Cette union fut néanmoins promptement féconde, car Hortense de Beauharnais mit au monde, le 10 octobre 1802, un fils, Napoléon-Charles, et le 10 octobre 1804, un second lils, Napoléon-Louis. En 1806, elle partit pour aller rejoindre son mari placé sur le trône de Hollande, et, l’année suivante, elle perdit son fils aîné, enlevé par le croup. Frappée au cœur, elle alla passer quelque temps au village d’Arrens, dans la vallée d’Azan, au milieu, des Pyrénées, puis retourna à Paris, à son hôtel de la rue Cerutti. Là, entourée d artistes et de littérateurs, elle demandait des distractions à la peinture et à la musique. Tantôt elle dessinait des fleurs et des paysages, tantôt elle chantait des romances, dont elle se plaisait à composer l’accompagnement. Une de ces romances est devenue un chant national sous le Second Empire, c’est le fameux air : Partant pour la Syrie, dont M. Laborde avait versifié les paroles. C’est à la reine Hortense qu’est due l’idée ingénieuse de faire placer avant chaque romance un dessin qui se rapporte au sujet. Elle aimait encore à cultiver des fleurs de ses propres mains. Le 20 avril 1808, elle mit au monde, à Paris, un troisième fils, Charles-Louis-Napoléon, qui devait être un jour Napoléon III. Lors du divorce de Napoléon avec Joséphine, qui n’aurait peut-être pas eu lieu si la mort du fils aîné d’Hortense n’eût pas déconcerté les projets de l’Empereur, qui voulait l’adopter, cette princesse plaida, mais inutilement, la cause de sa mère avec l’éloquence du cœur. Elle dut se faire violence, dévorer ses larmes, et, comme les autres reines de sa famille, soutenir, aux cérémonies du mariage, le manteau de la nouvelle impératrice. S’autorisant de l’exemple de l’Empereur, elle lui demanda la permission de divorcer, ce qui lui fut refusé. La simple séparation de corps lui fut même interdite. Obligée d’aller partager avec son mari le poids de la couronne de Hollande, la reine Hortense ne dissimula pas sa préférence pour les Français et ne fut pas étrangère, dit-on, à l’acceptation, par le roi Louis, du traité qui cédait à l’Empereur une province hollandaise. Lors de l’abdication de son mari, elle gouverna quelque temps comme régente, jusqu’à la réunion de la Hollande à l’Empire. Comme compensation, l’Empereur l’autorisa alors à se séparer du roi Louis, à garder ses deux enfants, et lui assura un douaire de 2 millions de revenu. Devenue reine honoraire, elle se fixa alors à Paris, et son salon fut bientôt le rendez-vous de la bonne société et de toutes les illustrations. Mais elle préférait à l’éclat du monde, l’amitié sincère d’une de ses amies de pension, Adèle Augulé, sœur cadette de la maréchale Ney, qu’elle eut la douleur de voir se noyer dans un précipice à Aix, en Savoie, sans pouvoir lui porter secours. La reine Hortense se mêla cependant encore une fois de politique. Lors de l’invasion de la France par les alliés, elle fit de courageux efforts pour empêcher le départ de l’impératrice pour Blois ; puis, après avoir rendu visite à sa mère, à Evreux, elle rejoignit Marie-Louise, prisonnière à Rambouillet, et ne la quitta que lors de son départ pour Vienne, bien qu’elle n’eût pas à se louer de sa réception. Elle retourna alors à la Malmaison, où les souverains alliés, outre une pension de 400.000 francs, lui formèrent un duché de tous les biens environnant la terre de Saint-Leu, duché qui devait lui donner un revenu à peu près égal (30 mai 1814). Deux jours auparavant, Hortense avait recueilli le dernier soupir de sa mère, dont elle fit déposer les restes dans l’église de Rueil. Après être allée se reposer de ses fatigues et de ses douleurs aux eaux de Plombières et de Bade, où sa cousine, la grande-duchesse: Stéphanie, la reine de Bavière, Caroline, et l’impératrice de Russie Elisabeth, la traitèrent en reine, Hortense revint à Saint-Leu. On l’accusa d’y conspirer, à cause de la société de mécontents qu’elle recevait, et ces mécontents l’accusèrent à leur tour d’être portée pour la Restauration, qui lui témoignait un grand intérêt. C’est à ce moment que le tribunal de la Seine la condamna à rendre au roi Louis, son fils aîné; Napoléon-Louis, arrêt que les Cent-Jours lui permirent d’éluder. L’Empereur l’accusa, à son retour, d’avoir pactisé avec ses ennemis, puis lui rendit justice et même, à sa prière, il accorda à la duchesse douairière d’Orléans une pension de 200.000 francs avec la permission de rester à Paris. Après Waterloo, Hortense accueillit avec un respect pieux Napoléon à la Malmaison et le soigna comme une fille dévouée. Elle le força même à accepter un collier de 800.000 francs, en échange duquel Napoléon lui donna sur le trésor une délégation qui n’eut aucun effet. Lorsqu’il fut parti, elle retourna à Paris, d’où on lui intima l’ordre de sortir dans les deux heures. Suivie de ses deux enfants, elle résida successivement à Aix en Savoie, où elle avait fondé un hôpital, à Constance et àThurgovie. Là, elle se mit à écrire ses mémoires, tout en surveillant avec les soins d’une mère digne de ce nom l’éducation de .son second fils, auquel elle, enseignait elle-même les beaux-arts. Le château d’Arenenberg, sur les bords du lac de Constance, lui ayant plu, elle l’acheta (1817), et, tandis qu’on l’embellissait, elle passa l’hiver a Augsbourg, où son frère Eugène vint la voir. Elle quitta cette résidence à la mort de ce dernier, en 1824, et, autorisée par le pape Léon XII à habiter l’Italie, elle passait l’hiver à Rome et l’été à Arenenberg. Lorsque éclata la Révolution de 1830, elle fit, tous ses efforts pour empêcher ses fils de se compromettre dans l’insurrection italienne ; mais l’aîné partit malgré elle, et fut emporté par la rougeole à Forli, l’année suivante, le mars 1831, sans qu’elle pût recueillir son dernier soupir. Pour sauver le fils qui lui restait, elle se rendit à Paris avec un passeport anglais et obtint une audience du roi Louis-Philippe, qui ne put que lui donner un vague espoir. Hortense retourna à Arenenberg, après un séjour de trois mois en Angleterre, et vécut tranquille jusqu’à la tentative de Louis-Napoléon à Strasbourg, le 30 octobre 1836. L’amour maternel l’entraîna de nouveau à Paris, pour solliciter la grâce de son fils. Le sort du prince était déjà décidé ; elle en reçut la nouvelle, avec l’ordre de quitter la France. Le gouvernement la faisait prier en même temps d’engager son fils à rester dix ans aux Etats-Unis. La déportation du prince Louis acheva de détruire la santé d’Hortense, si cruellement éprouvée. Elle lui écrivit le 3 avril de venir lui fermer les yeux. Quittant aussitôt l’Amérique, Louis-Napoléon arriva à temps en Suisse pour recevoir son dernier soupir, le 5 octobre 1837. Selon sou désir, la reine Hortense fut inhumée à Rueil, près de sa mère. Son fils, pendant sa détention au fort de Ham, fit élever à sa mémoire un monument funèbre, inauguré le 20 avril 1848. La reine Hortense était une femme pleine de bonté de cœur. L’adversité, en mûrissant sa raison, la rendit plus respectable aux yeux de tous et l’on fut obligé de reconnaître qu’en la jugeant d’après les apparences, on s’était montré trop sévère à son égard ; si d’ailleurs elle a eu des torts, elle les a cruellement expiés et noblement rachetés par son dévouement à l’empereur, qui l’avait rendue malheureuse en la forçant à contracter un hymen vers lequel elle ne se sentait pas attirée, et par son amour maternel, toujours prêt à tout sacrifier au bonheur de ses enfants. Aujourd’hui, que les passions se sont éteintes ou tout au moins assoupies, la reine Hortense occupe avec l’impératrice Joséphine, sa mère, une grande place dans le cœur reconnaissant de tous les Français et surtout des Françaises.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Hortense de Beauharnais sur wikipedia
LA FAMILLE DE NAPOLEON – MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1791-1847), IMPERATRICE DES FRANCAIS
C’était une bonne petite femme timide qui avait toujours peur en se voyant au milieu des Français qui avait assassiné sa tante.
Marie-Louise. Impératrice des Français, fille de l’empereur d’Autriche François 1er, née à Vienne en 1791, morte en 1847. « C’était, dit Lamartine, une belle fille du Tyrol, les yeux bleus, les cheveux blonds, le visage nuancé de la blancheur de ses neiges et des rose de ses vallées, la taille souple et-svelte, l’attitude affaissée et langoureuse de ces Germaines qui semblent avoir besoin de s’àppuyer sur le cœur d’un homme ; les lèvres un peu fortes, la poitrine pleine de soupirs et de fécondité, les bras longs, blancs, admirablement sculptés et retombant avec une gracieuse langueur… Nature simple, touchante, renfermée, en soi-même, muette au dehors, pleine d’échos au dedans, faite pour l’amour domestiqué dans une destinée obscure. » Ce fut-sur cette princesse, âgée de dix-huit ans, élevée par sa famille dans la haine de la France et du souverain qui la gouvernait, que Napoléon jeta les yeux lorsque, désireux d’avoir un héritier, il résolut de divorcer avec Joséphine. Vainqueur de l’Autriche à Wagram, maître de Vienne, il demanda ou plutôt exigea la main de l’archiduchesse, qui lui fut accordée. Le 1er avril 1810, le mariage civil de Napoléon et de Marie-Louise fut célébré à Saint-Cloud, et, le lendemain, eut lieu dans la grande galerie du Louvre le mariage religieux. Bien que cette union parût offrir une chance de plus pour la conclusion de la paix générale que la France désirait ardemment depuis si longtemps, elle fut mal accueillie par le peuple, très attaché à Joséphine et qui voyait avec regret une Autrichienne monter sur le trône. Après les fêtes splendides auxquelles donna lieu ce mariage, Napoléon fit visiter à sa jeune épouse la Belgique et la Hollande. « Les premiers temps de cette union furent assez heureux, dit Mme de Brady. L’empereur, très moureux, négligeait tout pour sa nouvelle épouse ; l’impératrice, toujours réservée, fut d’abord sensible à ce tendre sentiment ; mais les mœurs françaises n’étaient point faites pour lui plaire et elle inspira bientôt à ceux qui l’entouraient et à la nation entière l’indiffèrence qu’elle-même ressentait. Dans la conversation, sa réserve allait jusqu’à la froideur et elle avait un air constamment ennuyé. » Le 20 mars 1811, Marie-Louise, à la grande joie de Napoléon, lui donna, un fils, salué du nom de roi de Rome. Nommée régente toutes les fois que son époux s’absentait pour une campagne, elle montra dans l’exercice de ses hautes fonctions une nullité absolue. Le 23 janvier 1814, Napoléon embrassa pour la dernière fois Marie-Louise et son fils, et marcha contre les armées coalisées qui venaient d’envahir la France. Lorsque, le 29 mars, les alliés approchèrent de Paris, Marie-Louise, obéissant aux instructions péremptoires de Napoléon, qui avait déclaré qu il aimerait mieux voir sa femme et son fils au fond de la Seine qu’entre les mains de l’ennemi, quitta la capitale, gagna Blois avec le roi de Rome, refusa de suivre Joseph et Jérôme au delà de la Loire, se rendit, après l’abdication de Napoléon, à Orléans, d’où elle gagna Rambouillet avec le prince Esterhazy, y reçut la visite de son père l’empereur François 1er, et partit pour l’Autriche le 25 avril. Pendant les Cent-Jours, on la garda à vue dans son palais et on la sépara de son fils, qu’elle ne devait plus revoir qu’au moment de la mort. Elle eut, pour la dédommager du trône qu’elle perdait, la souveraineté viagère des principautés de Parme, Plaisance et Guastalla, dont elle prit possession en 1816 et qu’elle gouverna avec modération. Marie-Louise entretint des intrigues avec un obscur général autrichien, le comte de Neipperg, se maria, secrètement avec lui après la mort du captif de Sainte-Hélène, et en eut trois enfants. En 1831, une insurrection la força de quitter ses Etats, où, grâce à l’intervention de l’Autriche, elle revint quelque temps après. Le duc de Lucques lui succéda après sa mort. Jusqu’à l’a fin de sa vie, Napoléon se fit une illusion complète sur les sentiments de Marie-Louise à son égard. « Soyez bien persuadés, disait-il quelque temps avant de mourir, que si l’impératrice ne fait aucun effort pour alléger mes maux, c’est qu’on la tient environnée d’espions qui l’empêchent de rien savoir de tout ce qu’on me fait souffrir, car Marie-Louise est la vertu même. » Il disait un autre jour: «J’ai été occupé en ma vie de deux femmes très différentes ; l’une (Joséphine) était l’art et les grâces ; l’autre (Marie-Louise), l’innocence et la simple nature. » En prononçant ces paroles, il ne se doutait guère que Marie-Louise, après avoir consenti sans murmurer à se séparer complètement de son fils, oubliait dans d’indignes affections celui qui expiait son despotisme et son ambition démesurée sur le rocher de Sainte-Hélène.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Marie-Louise sur wikipedia
janvier 15, 2008
LA FAMILLE DE NAPOLEON – NAPOLEON II (1811-1832), ROI DE ROME ET EMPEREUR DES FRANCAIS
Je l’envie ! La gloire l’attend, alors que j’ai dû courir après elle. Pour saisir le monde il n’aura qu’à tendre les bras. J’aurais été Philippe, il sera Alexandre.
Napoléon II (François-Charles-Joseph-Napoléon Bonaparte, roi de Rome, duc De Reichstadt), né aux Tuileries le 20 mars 1811, mort à Schonbrunn (Autriche) le 22 juillet 1832. Comme pour Louis XVII, la légende d’abord, puis les faits ont consacré ce nom de Napoléon II, qu’il n’a jamais légalement porté. La destinée de ce jeune homme, qui fut salué roi de Rome en naissant, à qui Napoléon comptait bien laisser son vaste empire et qui mourut simple prince autrichien, a quelque chose d’étrange et de mystérieux qui a fasciné les poètes ; mais l’historien pourrait presque la laisser de côté, tant elle a peu d’importance. Sa naissance fut saluée avec un enthousiasme dont les écrivains contemporains et même ceux de la génération suivante se sont plu à se faire l’écho ; ils nous montrent toute la capitale comme en suspens et retenant son haleine, tandis que le canon des Invalides annonçait la délivrance de l’impératrice Marie-Louise, un peuple immense autour des Tuileries, comptant les coups de canon et laissant enfin échapper une joie qui tenait du délire lorsque le vingt-deuxième annonça qu’un enfant mâle était l’héritier de César. L’accouchement de Marie-Louise avait été laborieux ; on fut obligé d’employer le forceps, et la vie de l’enfant fut un moment menacée. Aussitôt qu’il’ eut jeté un cri, il fut créé roi de Rome, grand-aigle de la Légion d’honneur, grand-croix de la Couronne de fer et il reçut la Toison d’or. Casimir Delavigne et Michaud sentirent l’inspiration des cendre sur leur front et composèrent chacun un dithyrambe. La ville de Paris offrit, pour berceau du jeune prince, ce magnifique vaisseau de vermeil, emblème de Lutèce, que l’on a vu longtemps au musée des Souverains ; puis, après tant de marques d’enthousiasme, réel ou simulé, le silence se fit autour du roi de Rome ; On sut seulement que Napoléon lui avait donné pour gouvernante Madame de Montesquiou, afin de suivre les royales traditions, et les feuilles officielles racontèrent, suivant l’habitude, quelques traits enfantins de l’altesse au maillot. Le 6 septembre 1812, sur les bords de la Moskova, la veille de la terrible bataille de ce nom, Napoléon, qui était justement en train de perdre, par ses gigantesques folies, son trône et celui de son fils, reçut de Paris, des mains de M. de Beausset, préfet du palais, le portrait du roi de Rome, peint par Gérard. Le grand artiste l’avait représenté à demi couché dans son berceau, jouant, en guise de hochets, avec le sceptre et le globe du monde. L’empereur s’interrompit au milieu de ses dispositions pour la bataille du lendemain et montra, tout joyeux, ce portrait à son état-major ; il le fit saluer par sa garde. Il ne revit son fils que deux fois, à son retour de la Bérézina et après Leipzig ; il le présenta alors aux officiers de la garde nationale parisienne, réunis aux Tuileries pour le premier jour de l’an 1814, et le confia à leur patriotisme, dans une de ces scènes théâtrales qu’il affectionnait. La frontière était alors envahie de toutes parts. Paris allait être menacé, et Napoléon, revenant peu de temps après sur ses dispositions premières, prescrivit à son frère Joseph de faire retirer l’impératrice et le roi de Rome au sud de la Loire. Marie-Louise et son fils, accompagnés du roi Jérôme et d’une fiable escorte de cavaliers, arrivaient à Blois en même temps que les alliés entraient à Paris (30 mars 1814) ; quelque temps après, ils étaient à Orléans, où, ils logèrent à l’évêché. Là, il se passa un fait odieux que les historiens bonapartistes ont laissé de côté. Le roi Jérôme, qui savait qu’un des fourgons renfermait des diamants pour une somme énorme et quatre millions en or, résolut de laisser là l’impératrice et de sauver la caisse. Au milieu de la nuit, il essaya d’enlever le fourgon laissé à la garde d’une seule sentinelle, sur le parvis de la cathédrale, et comme la sentinelle, qui ne connaissait que sa consigne, menaça d’appeler aux armes, Jérôme lui cassa la tête d’un coup de pistolet ; le poste accourut au bruit et l’on arrêta le voleur. C’était une affaire manquée. Tel était pourtant le trouble qui régnait alors qu’on le relâcha, malgré le flagrant délit, et qu’il continua le voyage jusqu’à la frontière. Cet épisode scabreux de l’histoire des Bonaparte est raconté par Vaulabelle Histoire des deux restaurations, et les pièces justificatives existent aux archives d’Orléans. On sait que Maubreuil a aussi prétendu avoir été chargé par divers personnages, entre autres par Talleyrand, d’assassiner le roi de Rome pendant ce voyage, s’il en trouvait l’occasion, ou tout au moins d’enlever le fameux fourgon aux diamants, but, comme on le voit, de Bien des convoitises. Ce ne fut donc pas sans danger que l’impératrice et son fils réussirent à gagner le Rhin, qu’ils franchirent près de Huningue à la fin d’avril. Dans l’acte d’abdication de Fontainebleau, Napoléon avait réservé les droits du roi de Rome, proclamé empereur sous le nom de Napoléon II, avec Marie-Louise comme régente. Cette clause fut considérée comme non avenue par les alliés, maîtres de la France et décidés à rétablir les Bourbons. Ce fut également en vain qu’à son départ pour l’île d’Elbe, il demanda que sa femme et son fils pussent l’accompagner ; les alliés décidèrent que le jeune prince serait confié à son grand-père, l’empereur d’Autriche, et qu’il porterait, dès lors, le titre de duc de Reichstadt, Durant les Cent-Jours, Napoléon renouvela réclamation ; il ne lui fut même pas fait de réponse, et l’issue de la bataille de Waterloo coupa court aux négociations. Quelques membres de la Chambre proclamèrent une seconde fois Napoléon II, en vertu de la seconde abdication ; les manœuvres du duc d’Otrante empêchèrent toute action efficace jusqu’à ce que les alliés fussent dans Paris, et alors on trouva qu’il était trop tard. Pendant ce temps, le jeune prince, entouré d’une garde soupçonneuse et objet de précautions infinies, était retenu à Vienne et confié à un gouverneur qui prit le nom de grand maître, le comte de Dietrischtein, spécialement chargé d’empêcher qu’il n’eût la moindre communication avec le dehors, surtout avec des Français. Cet enfant inquiétait l’Europe ; et, en effet, l’alliance des républicains et des bonapartistes, devenus alliés en face des Bourbons, la force encore redoutable des débris de l’armée réunie derrière la Loire offraient des points d’appui sérieux à ceux qui auraient voulu prolonger l’Empire. De plus, il est certain que, aux mains de l’Autriche et de ses alliés, Napoléon II était un épouvantail qui leur servait à tenir en respect les Bourbons, à exiger d’eux une plus dure rançon de la France ; à la moindre velléité de résistance, ils menaçaient de le reconnaître. Après la conclusion des traités, les alliés ne songèrent plus qu’à se garantir eux-mêmes et à empêcher à tout prix que le fils suivît jamais les traces de son père. Par une première convention, le duché de Parme avait été donné en souveraineté à Marie-Louise, avec réversibilité au duc de Reichstadt (11 juin 1817) ; la clause de réversibilité fut annulée quelques années après, sur la demande des Bourbons, qui voyaient avec terreur qu’un jour, une fois souverain, il pourrait vouloir compter avec eux. Afin de mater ce qu’il pouvait avoir d’intelligence, on négligea son éducation au point qu’à seize ans il ne savait rien de l’histoire de France. Retenu comme prisonnier dans les palais impériaux, principalement à Schonbrunn, objet d’une surveillance qui ne se relâchait pas un instant, il ne vit jamais que des personnes étrangères à son entourage domestique ; dom Manuel de Portugal, qui était de séjour à Vienne et grand ami du comte de Metternich, et, dans ses dernières années, Marmont, duc de Raguse, chassé de France par la Révolution de 1830, Aucun écrit ne lui parvenait sans avoir été scrupuleusement examiné par ses gardiens ; jamais, surtout, on ne permit qu’il reçût des nouvelles de son père, qui, de son côté, était laissé à son égard dans la plus complète ignorance. Quand il eut quinze ou seize ans, on lui fit apprendre l’histoire, réduite à une simple chronologie, et quelques théorèmes de géométrie. On prétend que, surpris de tant de précautions, il se serait écrié un jour : « Mais que veulent-ils donc faire de moi ? Pensent-ils que j’aie la tête de mon père? » Rarement on put le voir en public ; c’était un beau jeune homme, d’une taille élevée, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, très bon écuyer et se plaisant à monter à cheval. L’empereur François le créa colonel d’un régiment, puis gouverneur de Gratz, en Styrie, une ville qu’il ne connaissait même pas. Depuis la mort de Napoléon, le parti libéral en France tournait volontiers les yeux vers lui ; il ne paraît pourtant pas qu’aucune tentative sérieuse ait été faite pour le délivrer. Son nom servait de signe de ralliement à l’opposition. Béranger en fit le thème d’une de ses chansons, les deux cousins, où il supposait une épître adressée par le duc de Reichstadt au duc de Bordeaux. Barthélémy fit le voyage de Vienne pour lui remettre un exemplaire de son poème, Napoléon en Egypte, et ne put parvenir à le voir ; il composa à ce sujet, sous le titre du Fils de l’homme (1829), une si éloquente apologie de Napoléon II, qu’il se vit condamner à trois mois de prison pour écrit séditieux. On trouve dans les notes de ce poème quelques détails assez curieux sur le jeune prince, entre autres cette réponse que fit le comte de Dietrichstein à sa demande d’audience : « Ne savez-vous pas que la politique de l’Autriche et celle de la France s’opposent à ce qu’aucun étranger et surtout un Français soit présenté au prince ?… Est-il bien vrai que vous soyez venu à Vienne pour le voir ? On se fait en France des idées bien fausses et bien ridicules sur ce qui se passe ici. Le prince n’est pas prisonnier, mais il se trouve dans une position toute particulière. Soyez bien persuadé qu’il ne voit, ne lit et n’entend que ce que nous voulons. S’il recevait une lettre, un livre qui eût trompé notre surveillance, il ne le lirait pas sans que nous lui eussions dit qu’il peut le faire sans danger. Son premier soin serait de nous le remettre. » Tenu dans cet état de sujétion, le fils de Napoléon ne tarda pas à s’étioler ; sa tristesse et sa pâleur maladive frappaient les quelques personnes qui purent l’apercevoir et firent même conjecturer qu’on le soumettait à un régime particulier, renouvelé des empoisonnements lents du moyen âge. Barthélémy, qui put apercevoir le jeune prince au théâtre, s’est fait l’écho de ce bruit : A la cour de Pyrrhus j’ai vu le fils d’Hector ! ». Quel germe destructeur, sous l’écorce agissant, A sitôt défloré ce fruit adolescent ? Ce qui est certain, c’est que, accablé à vingt ans de la plus grande lassitude ; indifférent à tout et même à la vie, il s’écriait sans cesse : Qu’on me laisse mourir en paix. « Au lendemain de la Révolution de 1830, une fraction du parti libéral, qui avait fait son idole du fils de Napoléon, songea à l’appeler au trône ; Talleyrand, ce ténébreux artisan de toutes les trames de 1814 et de 1815, se chargea même de faire agréer cette proposition à l’Autriche ; mais il fut accueilli si froidement qu’il repartit de Vienne le soir même de son arrivée. Les bonapartistes s’agitèrent plus secrètement ; la comtesse Camerata, fille de la princesse Bacciochi, fit remettre au duc de Reichstadt deux lettres dans lesquelles elle lui rappelait la mort de son père à Sainte-Hélène et l’exhortait à le venger. Il refusa dans des termes qui prouvent que sa réponse lui fut dictée. En 1831, lorsqu’il fut question de donner un roi à la Belgique, quelques enthousiastes mirent encore en avant le nom du duc de Reichstadt. Ce fut alors à Louis-Philippe d’avoir peur : « Nous ne souffrirons jamais, s’écria Casimir Périer, qu’un membre de la famille Bonaparte règne aux portes de la France, ni que Bruxelles soit un foyer de révolutions. » II est bien probable que le prince ne sut jamais l’honneur qu’on avait voulu lui faire ; l’année suivante, il délivra d’inquiétude tous les souverains en mourant, suivant les uns, du cancer d’estomac héréditaire dans sa famille, et, suivant d’autres, de phthisie. Il avait’un peu plus de vingt et un ans. On lui fit des funérailles magnifiques et son corps fut inhumé dans la cathédrale de Vienne. Sa mort a inspiré à Victor Hugo une de ses plus belles odes, Napoléon II, dans le recueil intitulé Feuilles d’autonme.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Napoléon II sur Wikipedia
janvier 13, 2008
LA FAMILLE DE NAPOLEON – CAROLINE BONAPARTE (1782-1839), REINE DE NAPLES
Dans sa petite enfance, on la regardait comme la sotte et la cendrillon de la famille ; elle en a bien rappelé ; elle a été une très belle femme et elle est devenue très capable. La reine de Naples s’était beaucoup formée dans le événements. Il y avait chez elle de l’étoffe, beaucoup de caractère et une ambition désordonnée.
BONAPARTE (Caroline-Marie-Annonciade). Troisième sœur de Napoléon, née à Ajaccio le 25 mars 1782, avait à peine onze ans, lorsqu’elle quitta la Corse pour venir habiter Marseille. Elle y resta jusqu’en 1796, époque à laquelle Mme Laetitia vint se fixer à Paris. Napoléon, qui l’aimait tendrement, lui fit épouser l’un de ses plus braves lieutenants, Joachim Murat, le 20 janvier de l’année 1800. Successivement grande-duchesse de Berg et de Clèves et placée sur le trône de Naples le juillet 1808, Caroline se montra digne de sa haute position par son intelligence, ses talents, le tact fin qu’elle montra dans les affaires. Radieuse de grâce et de beauté, douée d’un esprit cultivé, elle exerça un grand ascendant sur son époux, suppléa aux qualités qui manquaient à ce vaillant soldat pour l’exercice de la souveraineté, et tint elle-même, en qualité de régente, les rênes de l’Etat avec une remarquable habileté. Son avènement au trône fut signalé par des actes de justice et d’humanité. Elle fit rappeler les exilés et rendre la liberté aux condamnés politiques. Prenant une part très active au gouvernement du royaume, pendant un règne de sept années seulement, elle réalisa à Naples d’immenses progrès, fonda des établissements utiles qui subsistent encore, protégea les sciences, les lettres et les arts, appela à la direction des affaires des hommes éminents, et veilla avec sollicitude à l’extension de l’instruction populaire. Douée d’une grande fermeté d’âme et de caractère, on la vit, après le combat naval de Milucola, pour ranimer ses sujets, se promener impassible sur le quai de la Chiaja au milieu d’une pluie de boulets anglais. Chargée en 1810 par son frère d’organiser la maison de Marie-Louise, Caroline se rendit au-devant d’elle à Braunaw, mais ne tarda pas à s’aliéner ses bonnes grâces par ses prétentions orgueilleuses. Elle regarda comme un outrage d’avoir été obligée de porter le manteau de l’impératrice aux cérémonies du mariage, et retourna à Naples mal disposée contre la cour de Paris. Aussi, en 1813, lorsque la fortune commença à se lasser de favoriser Napoléon, caressa-t-elle l’ambition de Murat, qui rêvait la couronne des rois lombards et la souveraineté de la péninsule italique, et ne s’opposa-t-elle point aux traités des 6 et 11 janvier 1814, conclus avec l’Autriche et l’Angleterre, traités qui jetaient son mari dans les rangs ennemis de la France et de son bienfaiteur. Cette ingratitude révolta d’autant plus l’opinion publique que Caroline abandonnait son frère, elle qui n’avait eu qu’à se louer de lui, et cela au moment des revers, lorsque les membres de sa famille qui avaient eu le plus à se plaindre de son despotisme se rapprochaient de lui spontanément. Aussi Madame mère irritée ne voulait plus la voir et l’écrasa de ces énergiques et généreuses paroles : « Vous avez trahi votre bienfaiteur, votre frère ; il aurait fallu que votre mari passât sur votre cadavre avant d’arriver à une félonie pareille. » Joseph Bonaparte prétendit même que, chargée par le général Miollis d’une somme considérable pour l’empereur captif à l’île d’Elbe, elle négligea dei lui faire passer. La défection de l’ancien volontaire de 1792 ne sauva pas son trône. Murat parut néanmoins revenir à de plus nobles sentiments ; en il voulut seconder le retour de l’Empereur, mais il fut battu et forcé de se réfugier eu France. L’énergie de Caroline ne l’abandonna pas dans les péripéties de cette catastrophe. Victime de la trahison à son tour, menacée par les lazzaroni, dont elle essayait de réprimer les violences, et par les partisans de Ferdinand IV, elle stipula, avant de partir, avec le commodore Campbell, chef de la flotte anglaise, la conservation des propriétés de ses anciens sujets, et ne s’occupa de ses intérêts personnels qu’après avoir obtenu des garanties pour les intérêts du pays. Elle s’embarqua sur le Tremendous, vaisseau anglais, qui salua de vingt et un coups de canon le retour de Ferdinand. Au mépris de la capitulation, elle fut dépouillée de ses propriétés et emmenée prisonnière a Trieste avec ses quatre enfants, qu’elle avait été chercher à Gaëte. On lui permit de se fixer au château de Haimbourg, près de Vienne, où elle apprit par un journal la fin tragique de son malheureux époux, fusillé au château de Pizzo. Elle obtint plus tard l’autorisation d’habiter près de sa sœur Elisa, à Trieste, avec le titre de comtesse de Lipona, anagramme de Napoli, nom italien de Naples. Là elle éleva ses enfants avec peine, n ayant plus aucune fortune, et épousa secrètement le général Macdonald, ancien ministre de son mari. En 1830, Madame mère étant tombée malade à Rome, la princesse Caroline alla la soigner, puis retourna à Trieste. Après la Révolution de Juillet, ses deux fils, Achille et Lucien, se réfugièrent aux Etats-Unis, où ils embrassèrent la profession d’avocat, et elle revint en Italie, auprès de ses deux filles, la marquise de Pepoli et la comtesse de Rosponi. Caroline fit un voyage à Paris pour réclamer une indemnité au sujet de l’Elysée-Bourbon et du château de Neuilly, dont Murat avait été dépossédé par l’Empereur sans compensation. Les chambres lui votèrent, le 2 juin 1838, une pension viagère clé cent mille francs, dont elle ne jouit pas longtemps, car, à son retour de Paris, elle mourut à Florence d’un cancer à l’estomac, le 18 mai 1839, entre les bras de la comtesse de Rosponi et de Jérôme Bonaparte. Née avec une tète forte, un esprit souple et délié, de la grâce, de l’amabilité, séduisante au delà de toute expression, il ne lui manquait que de savoir cacher son amour pour la domination. « C’était, dit M. de Talleyrand, la tête de Cromwell sur le corps d’une jolie femme. » La princesse Caroline avait eu de son mariage avec Murat quatre enfants : 1° Napoléon-Achille-Charles-Louis Murat ; 2° Laetitia-Josèphe, née le 25 avril 1802, mariée au marquis de Pepoli à Bologne ; 3° Lucien-Charles-Joseph-François-Napoléon Murat ; 4° Louise-Julie-Caroline, née le 22 mars 1805, mariée au comte de Rosponi, à Ravenne.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Caroline Bonaparte sur Wikipedia
LA FAMILLE DE NAPOLEON – ELISA BONAPARTE (1777-1820), PRINCESSE DE LUCQUES ET DE PIOMBINO, GRANDE DUCHESSE DE TOSCANE
Maîtresse femme, elle avait de nobles qualités, un esprit recommandable et une activité prodigieuse, connaissant les affaires de son cabinet aussi bien qu’eût pu le faire le plus habile diplomate. Il n’y a pas eu d’intimité entre nous, nous caractères s’y opposaient.
Bonaparte (Marie-Anne-Elisa). Sœur de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 3 janvier 1777. Son père, dans un voyage qu’il fit la même année comme député de la noblesse corse à la cour, obtint pour elle une bourse à la maison royale de Saint-Cyr, qu’elle ne quitta qu’après l’achèvement de son éducation pour retourner en Corse, à l’âge de quinze ans. Lorsque son pays natal fut tombé au pouvoir des Anglais, elle l’abandonna avec le reste de sa famille, et alla se fixer à Marseille. Elle y fit la connaissance d’un compatriote dénué de toute fortune,’mais de famille noble, le capitaine d’infanterie Félix Bacciochi, avec lequel elle se maria le 5 mai 1797. Napoléon, qui se vengeait sur les Vénitiens de leur conduite équivoque après le traité de Leoben, n’apprit ce mariage qu’après sa conclusion : moins puissant à cette époque qu’en 1805, lorsqu’il fit annuler celui de Jérôme avec Melle Paterson, il laissa seulement deviner son mécontentement. L’année suivante, Mme Bacciochi vint à Paris, et se déclara la protectrice des lettres et des arts, qu’elle aimait avec passion. Son salon devint un terrain neutre où les hommes marquants de tous les partis se donnaient rendez-vous : Chateaubriand et Lemercier s’y rencontraient avec Legouvé, La Harpe, Boufflers et Fontanes. Lorsque, en 1805, Napoléon fit sa distribution de couronnes dans sa famille, il érigea en principauté, pour sa sœur Elisa, Lucques et Piombino. La nouvelle princesse se montra digne sœur de Napoléon, et déploya des talents et une dignité en rapport avec sa haute position. Bacciochi, couronné en même temps qu’elle, régna, mais ne gouverna pas. Eclipsé par l’esprit supérieur de sa femme, il eut le bon esprit de lui laisser la direction des affaires, et ne fut pour ainsi dire que le premier de ses sujets. Elisa. se sentant à la hauteur de sa tâche, gouverna par elle-même, présida le conseil de ses ministres, simplifiant les rouages administratifs avec un tact, une fermeté et un esprit d’organisation rares, même chez un homme. Elle porta surtout son attention sur la réparation des routes, les travaux d’utilité publique et l’établissement de nouvelles fortifications. L’empereur, en récompense du talent dont elle avait fait preuve, lui conféra, le 5 mars 1809, le titre de grande-duchesse de Toscane, avec le gouvernement général de cette province. Son mérite sembla grandir avec son pouvoir, et elle continua de marcher hardiment dans la voie du progrès. La princesse Elisa, tout en protégeant les arts et les lettres, imprima une nouvelle impulsion à l’agriculture en lui accordant habilement des primes, développa l’instruction populaire et ht construire des établissements utiles. Un des plus grands services qu’elle rendit à la Toscane fut de la purger des bandes de brigands qui infestaient les routes. Aussi le surnom de Sémiramis de Lucques, qui lui fut donné par les adulateurs de Premier Empire, ne parut-il pas une épigramme. Ses connaissances politiques, administratives et militaires lui avaient assuré un certain crédit auprès de l’Empereur, qui se montrait flatté de trouver dans une femme de sa famille un caractère assez énergique, pour s’identifier pleinement avec sa politique ambitieuse. Quant à son mari, excellent homme d’ailleurs, ce n’était guère que son aide de camp, même quand elle passait les troupes en revue. Lorsque, en 1814, l’empereur fut accablé sous les coups de l’Europe coalisée contre nous, la princesse Elisa se retira à Bologne, d’où elle partit en 1815 pour se rendre à Trieste, puis près de sa sœur Caroline, la veuve de Murat, au château de Haimbourg. Elle quitta ce château pour celui de Brunn, et enfin résida près de Trieste, au château de Santo-Andrea, où elle mourut à quarante-trois ans d’une fièvre nerveuse, sous le nom de comtesse de Campignano, le 7 août 1820. Mme Bacciochi laissa deux enfants : 1° Charlés-Jérôme, né le 3 juillet 1810, mort à Rome, d’une chute de cheval, à l’âge de vingt ans, 2° Napoleone-Elisa, née le 3 juin 1806, mariée au comte Camerata. L’empereur Napoléon III lui a donné rang à la cour avec les titres de princesse et d’altesse. Elle partageait le goût de sa mère pour l’agriculture, à laquelle, dans un magnifique château qu’elle possèdait en Bretagne, elle se plaisait à consacrer ses loisirs.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Elisa Bonaparte sur Wikipedia
LA FAMILLE DE NAPOLEON – PAULINE BONAPARTE (1780-1825), PRINCESSE BORGHESE, DUCHESSE DE GUASTALLA
Pauline était trop prodigue ; elle avait trop d’abandon. Elle aurait dû être immensément riche par tout ce que je lui ai donné ; mais elle donnait tout à son tour, et sa mère la sermonnait souvent à cet égard, lui prédisant qu’elle pourrait mourir à l’hôpital.
Bonaparte (Marie-Pauline). Deuxième sœur de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 20 septembre 1780, suivit en 1793 sa famille à Marseille, où le conventionnel Fréron demanda sa main, qui lui fut refusée. Le général Duphot, assassiné à Rome dans une émeute, le 29 décembre, ainsi que Junot, qui en était passionnément épris, ne furent pas plus heureux. Elle aimait le général Leclerc, qu’elle épousa à Milan en 1801; mais leur bonheur fut de courte durée. Le général, après avoir soumis le Portugal, fut chargé parle premier consul, l’année même de son mariage, de faire rentrer sous la domination française l’île de Saint-Domingue, où il fut envoyé avec le titre de capitaine général. Pauline, à peine relevée de couches, s’ernbarqua à Brest avec son enfant et son mari, au mois de décembre. L’expédition avait été menée a bonne fin ; la conquête était presque achevée, lorsque les noirs, auxquels s’adjoignit un terrible auxiliaire, la fièvre jaune, se révoltèrent. Le général voulut faire embarquer sa femme et son fils, mais elle adressa cette noble réponse aux dames de la ville qui la pressaient de partir : « Vous pouvez pleurer, vous ; vous n’êtes pas, comme moi, sœur de Bonaparte. Je ne m’embarquerai qu’avec mon mari ou je mourrai. » On voulait la sauver de force, lorsqu’un aide de camp arriva annonçant la compression de la révolte : « Je savais bien, dit-elle sans s’émouvoir, que je ne m’embarquerais pas ; retournons à la résidence. » Mais le vainqueur, atteint de la fièvre jaune, dut partir pour l’île de la Tortue, où il expira, le 2 novembre 1802, entre les bras de sa femme, qui ramena en France sa dépouille mortelle. Leur fils mourut deux ans après. Le 28 août 1803, Napoléon maria sa sœur avec le prince Camille Borghèse, le chef d’une des plus illustres familles de Rome, mais d’une déplorable faiblesse de caractère. Cédant à des insinuations malveillantes, il ne tarda pas à se séparer de sa femme, et se retira à Florence jusqu’en juillet 1807, époque où Napoléon, après la paix de Tilsit, l’établit à Turin avec le titre de gouverneur général des départements français au delà des Alpes. Nommée duchesse de Guastalla, Pauline, abandonnée de son mari, habita tantôt la France, tantôt l’Italie, dans un magnifique château à Neuilly, ou à la fameuse villa Borghèse, dont son époux lui avait laissé la jouissance. En 1810, la princesse Pauline, ayant manqué publiquement à l’impératrice Marie-Louise à Bruxelles, fut éloignée de la cour par son frère, encore plus affligé qu’irrité. L’abdication de Napoléon, en 1814, fit partir la princesse de Nice pour Rome, et de là pour l’ île d’Elbe, où, avec Mme Laetitia, elle adoucit par sa présence les douleurs de l’exil de son frère. C’est à ses instances que Murat dut son pardon, et le prince Lucien sa réconciliation avec l’empereur déchu. Pendant les Cent-Jours, la princesse Pauline séjourna à Naples, puis à Rome, d’où elle envoya tous ses bijoux à l’empereur, dont les finances étaient épuisées. Ils furent trouvés à Waterloo dans une des voitures de Napoléon ; les alliés s’en emparèrent, et on ignore qui, parmi eux, se les est appropriés. Malgré les bontés du pape, reconnaissant des soins que la princesse avait eus pour lui lors de sa captivité en France, elle se disposait à rejoindre sa famille à Paris, lorsque Napoléon, vaincu, fut relégué sur le rocher de Sainte-Hélène. Elle tomba dans une maladie de langueur, qu’activa encore la nouvelle de la mort de Napoléon, que les puissances coalisées n’avaient pas voulu l’autoriser à aller soutenir de son amitié dans son triste exil. Le juin 1825 elle expira à Florence entre les bras de son mari, avec lequel elle s’était réconciliée depuis sa maladie. Sa dépouille mortelle fut inhumée à Rome en l’église Sainte-Marie-Majeure, dans la chapelle de la famille Borghèse, Le prince acquitta généreusement tous les legs qu’elle avait faits à son lit de mort, sans réfléchir à l’insuffisance de sa fortune. Elle ne lui laissait point d’enfants. La princesse Pauline se faisait remarquer par une inépuisable bienfaisance. Une partie de sa fortune passa entre les mains des malheureux ou fut employée à l’établissement de maisons de charité pour l’éducation des orphelins. Elle était passionnée pour les arts et les lettres, aimait le luxe et les plaisirs, et sa prodigalité avait tellement épuisé ses ressources que, après la chute de l’Empire, sans la bienfaisance de son mari, dont elle s’était rapprochée, elle aurait risqué de justifier les prédictions de sa mère en mourant à l’hôpital.
(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)
Lien : Pauline Bonaparte sur Wikipedia
novembre 30, 2007
LES GENERAUX DE NAPOLEON – GENERAL LECLERC (1772-1802)
L’arrivée du capitaine-général Leclerc fut suivie d’un succès complet [Expédition de Saint-Domingue] ; mais il ne sut pas s’en assurer dans la durée. S’il avait suivi les instructions secrètes que je lui avais dressées moi-même, il eût sauvé bien des malheurs et se fut épargné de grands chagrins.
Leclerc (Charles-Victor-Emmanuel). Officier général, né à Pontoise (Seine-et-Oise), le 17 mars 1772, de « Jean-Paul Leclerc et de Marie-Jean-Louise Musquinet », mort à l’île de la Tortue (Saint-Domingue) le 2 novembre 1802 ; était employé en 1793, comme adjudant général au siège de Toulon et contribua à reprendre cette ville aux Anglais ; devint général de brigade et fut envoyé aux armées du Nord et du Rhin, fit la campagne d’Italie en l’an IV, puis fit partie de l’armée d’Egypte, revint avec Bonaparte et aida ce dernier à perpétrer le coup de force du 18 brumaire. Ce fut lui qui, à la tête d’un piquet de grenadiers, chassa, de la salle, les députés opposants ; il était devenu le beau-frère du Premier Consul. Il fut chargé du commandement en chef de l’expédition de Saint-Domingue ; il avait déjà contribué à pacifier une grande partie de cette colonie quand il fut emporté par la cruelle épidémie qui fit tant de ravages dans les rangs de l’armée française. Il était capitaine-général de la colonie de Saint-Domingue.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Général Leclerc sur Wikipedia
octobre 3, 2007
LA FAMILLE DE NAPOLEON – JERÔME BONAPARTE (1784-1860), ROI DE WESTPHALIE
Jerôme en mûrissant, eût été propre à gouverner ; je découvrais en lui de véritables espérances.
Bonaparte (Jérôme-Napoléon, roi de Westphalie), officier de marine, roi et législateur, né à Ajaccio (Corse) le 15 novembre 1784, de « Charles-Marie de Buonaparte et de Marie Laetitia Ramolino« , mort à Villegrins (Seine-et-Marne) le 24 juin 1860 ; débuta dans la marine après le coup d’Etat de brumaire, et partit pour Saint-Domingue avec son beau-frère, le général Leclerc, en qualité de lieutenant, d’où il revint promptement porteur de dépêches importantes, devint commandant de la frégate l’Epervier, et partit pour l’Amérique, fut chargé en l’an X, d’établir une croisière devant l’île de Tabago, et se retira à New-York, puis épousa la fille d’un riche négociant de Baltimore, Mlle Patterson. Ce mariage gêna quelque peu les visées politiques de son frère Napoléon, empereur. Ce dernier autorisa son frère à rentrer en France, mai sans sa femme. Quelques jours après, Jérôme rejoignit son frère au Piémont et se réconcilia avec lui, consentit à divorcer bien qu’ayant déjà un enfant de son mariage, fut nommé capitaine de frégate et se présenta devant Alger à la tête d’une excadre de six vaisseaux, puis obtint du dey la délivrance des esclaves d’origine française et génoise, en fut récompensé par le grade de capitaine de vaisseau, commanda ensuite à la Martinique une escadre de huit vaisseaux de ligne, puis rentra en France ; il fut promu contre-amiral et général de division le 14 mars 807 ; se maria, le 12 août, avec la princesse Frédérique-Catherine, fille du roi de Wurtemberg, puis six jours après, fut proclamé roi de Westphalie. On raconte qu’il montra plus d’ardeur pour les plaisirs que pour les affaires. En 1812 il commanda un corps d’armée allemand et prit part aux combats de d’Ostrawa et de Mohilew, puis abandonna Cassel à la suite des troupe françaises (1813). En mars 1814, il accompagna l’impératrice Marie-Louise à Blois, rejoignit la reine Catherine à la cour de Stuttgard, se rendit ensuite en Italie, espérant y fixer son séjour, apprit à Trieste le retour de l’île d’Elbe, s’embarqua en secret et gagna Paris. Son frère le nomma, le 2 juin 1815, pair de France ; il se battit à Waterloo et y fut blessé. Après la seconde abdication il retourna près de son beau-père, qui lui donna le château d’Elvangers et le titre de prince de Montfort (juillet 1816). Sous la Restauration, il resta complètement en dehors de la politique. La princesse Catherine était morte en 1836, Jérôme dut vivre d’une pension que lui fit sa fille la princesse Mathilde, mariée au comte Demidoff. Ayant écrit à Louis-Philippe, en 1847, pour lui demander l’autorisation de rentrer en France, elle lui fut accordée pour trois mois, le 22 décembre. Le lendemain de la Révolution de février 1848, on trouva sur le bureau du roi deux ordonnances qui n’attendaient que la signature royale : l’une accordait au prince Jérôme une pension de 100.000 francs, l’autre le nommait pair de France. Le 26 février Jérôme écrivit au gouvernement provisoire la lettre suivante : « La nation vient de déchirer les traités de 1815. Le vieux soldat de Waterloo, le dernier frère de Napoléon, rentre dès ce moment au sein de la grande famille. Le temps des dynasties est passé pour la France ! La loi de proscription qui me frappait est tombée avec le dernier des Bourbons. Je demande que le gouvernement de la République prenne un arrêté qui déclare que ma proscription était une injure à la France et a disparu avec tout ce qui nous a été imposé par l’étranger. » Le 27 décembre 1848 il fut promu gouverneur des Invalides ; puis le 1er janvier 1850, maréchal de France. Le coup d ‘Etat de 1851 le surprit tout d’abord, il fut très perplexe sur le rôle qu’il devait jouer, craignant surtout les remontrances habituelles de son fils siégeant à la Montagne, mais il finit par accepter le poste de président du Sénat et le titre de premier prince du sang. Atteint d’une bronchite pulmonaire, il mourut dans son château de la Villegrins et fut inhumé aux Invalides.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Jérôme Bonaparte sur Wikipedia
LA FAMILLE DE NAPOLEON – LOUIS BONAPARTE (1778-1846), ROI DE HOLLANDE
Il a de l’esprit et n’est point méchant, mais avec ces qualités un homme peut faire bien des sottises et causer bien du mal. Dès son arrivée en Hollande, il n’imaginait rien de beau comme de faire dire qu’il n’était plus qu’un bon Hollandais. Jamais un homme ne s’égara plus complètement avec de bonnes intentions ; jamais l’honnêteté sans intelligence ne fit plus de mal.
Bonaparte (Louis, roi de Hollande, comte de Saint-Leu), roi, ambassadeur, officier général, grand connétable et pair des Cent-Jours, né à Ajaccio (Corse) le 4 septembre 1778, quatrième fils de Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino, mort à Livourne (Italie) le 25 juillet 1846 ; vint de bonne heure en France et embrassa la carrière militaire dès que son frère fut devenu général en chef de l’armée d’Italie ; fit quelques campagnes avec lui sans se faire remarquer, et obtint, à son retour d’Egypte, le commandement du 9e régiment de dragons. Peu de temps après il fut promu général de brigade et, sur l’ordre formel de son frère il épousa Hortense de Beauharnais (an X). A l’établissement de l’Empire, il fut nommé grand connétable, colonel général des carabiniers, suivit son frère en Italie et devint gouverneur du Piémont. Au commencement de 1806, il fut promu général de division, puis général en chef de l’armée du Nord, et le 5 juin de la même année, il fut proclamé roi de Hollande. Louis se consacra entièrement aux intérêts de ses nouveaux sujets, qui, du reste n’étaient guère d’accord avec l’Empereur sur la question du blocus continental. Les soupçons qu’il conçut sur la conduite de la reine Hortense, enfin sa résistance, comme roi de Hollande, aux injonctions de l’Empereur, lui firent trouver la couronne trop lourde ; il abdiqua, se retira auprès de son frère Jérôme, et de là se rendit aux eaux de Toeplitz en Bohême. De cette résidence il écrivit à sa mère le 7 août 1810 : » Je suis aussi bien que possible et hors des affaires, pour n’y jamais rentrer, je vous en réponds bien. J’espère que mon frère permettra que je reste avec vous et un de mes enfants le reste de mes jours, mais je vous prie de ne plus lui parler de moi. » Lors de la chute de l’Empereur en 1814, l’ex-roi Louis était à Rome, et, pendant les Cent-Jours, il fut nommé pair de France, mais il refusa de siéger. La seconde chute de son frère ne changea rien à sa position. Il intenta à cette époque un procès à la reine Hortense, sa femme, pour avoir auprès de lui son fils et se retira plein de dégoût, dans la solitude, s’adonnant à la littérature comme suprême consolation. on a de lui un roman : Marie ou les peines de l’amour ; documents historiques sur le gouvernement de Hollande, et un Essai sur la versification.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Louis Bonaparte sur Wikipedia
LA FAMILLE DE NAPOLEON – LUCIEN BONAPARTE (1775-1840), PRINCE DE CANINO ET MUSIGNANO
Beaucoup d’esprit, des connaissances, et beaucoup de caractère… ornement de toute assemblée politique.
Bonaparte (Lucien, prince de Canino et Musignano), législateur, ministre et ambassadeur, né à Ajaccio (Corse), le 21 mars 1775, de « Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino« , mort à Viterbe (Italie) le 29 juin 1840, frère cadet de l’Empereur ; se réfugia à Marseille lors du soulèvement de la Corse provoqué par Paoli, entra dans l’administration et devint garde-magasin à Saint-Maximin (Var) ; se fit alors appeler Brutus Bonaparte, citoyen sans-culotte, devint le chef du parti révolutionnaire de l’endroit, épousa la soeur de son aubergiste Catherine Boyer, et, ajoute le Dictionnaire des Parlementaires, « aussi illettrée que jolie ». Quelques temps après, nommé inspecteur des charrois à Saint-Chamans, il fut arrêté et relâché aussitôt après les journées de prairial, vint à Marseille où par l’influence de son frère Napoléon, il fut envoyé à l’armée du Rhin comme commissaire en Corse et le 25 germinal an VI, nommé député au Conseil des Cinq-Cents par le département de Liamone, en faveur de la liberté de la presse, et en fut nommé président. Il profita de cette situation pour aider son frère à faire le 18 brumaire. Le 4 nivôse an VIII, Lucien succéda à Laplace comme ministre de l’intérieur, le 15 brumaire an IX, échangea ce poste contre celui d’ambassadeur à Madrid, et son frère, qui ne savait rien lui refuser, le fit entrer au Tribunat (6 germinal an X) ; fut nommé grand officier de la Légion d’honneur (10 pluviôse an XII), comme prince de sang devint sénateur de droit, fut ensuite pourvu de la sénatorie de Trèves. De cette époque date de profonds dissentiments qui devaient éclater entre les deux frères ; ce fut surtout son second mariage avec Mme Jouberthon qui irrita profondément l’Empereur et qui fut cause que Lucien partit en Italie prendre possession de sa terre de Canino devenue principauté. En 1807, l’Empereur ayant fait une nouvelle tentative pour faire divorcer Lucien d’avec sa seconde femme, ce dernier prit le parti de partir pour l’Amérique et le 1er août il s’embarqua avec sa famille, à Civita-Vecchia, fut pris par un croiseur anglais et conduit à Naples, et enfin amené en surveillance en Angleterre, à Dudlow, où il séjourna trois ans. Le 13 mai 1815, élu, par l’Isère, représentant à la chambre des Cent-Jours, il refusa ce mandat, ayant été nommé pair de France. Le 2 juin de la même année, le Dictionnaire des Parlementaires nous apprend encore que, dans un conseil privé tenu au moment du départ de l’Empereur pour l’armée, Lucien proposa d’accepter l’abdication offerte par Napoléon et d’instituer la régence de Marie-Louise ; le conseil fut du même avis, mais Napoléon qui avait adhéré, refusa le lendemain et partit pour Waterloo. Ayant échoué dans ses combinaisons, Luciens e retira à Neuilly, reprit le chemin de l’Italie où il s’installa près de Viterbe. On a de lui : Charlemagne ou l’église délivrée ; la Cyrneide ou la Corse délivrée.
(Extrait du du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Lucien Bonaparte sur Wikipedia
octobre 2, 2007
LA FAMILLE DE NAPOLEON – JOSEPH BONAPARTE (1768-1844), ROI D’ESPAGNE
Joseph, c’est un fort bon homme. Je ne doute pas qu’il ne fît tout au monde pour moi ; mais toutes ses qualités tiennent uniquement de l’homme privé. Dans les hautes fonctions que je lui avais confiées, il a fait ce qu’il a pu, mais dans les circonstances bien grandes la tâche s’est trouvée peu proportionnée avec ses forces.
Bonaparte (Joseph-Napoléon, roi de Naples puis d’Espagne, comte de Survilliers), commissaire de guerre, législateur, ministre plénipotentiaire, officier général, et roi, né à Corte (Corse), le 7 janvier 1768, de « Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino« , mort à Florence (Italie), le 28 juillet 1844, fut obligé en 1793 de partir de la Corse par suite de la révolte de Paoli, et vint se réugier à Marseille, devint secrétaire de Saliceti, puis en l’an V fut nommé commissaire des guerres à l’armée d’Italie, sous les ordres de son frère. Elu, le 23 germinal an V, député du Golo, au Conseil des Cinq-Cents, il vit sont élection contestée par le parti clichyen, qui ne pardonnait pas depuis le 13 vendemiaire, à Bonaparte d’avoir mitraillé leurs amis et le considérait comme entaché de jacobinisme, mais après le 18 fructidor il put siéger et fut nommé ambassadeur à Parme, puis à Rome. Arrivant dans cette ville, il eut à lutter contre les réactionnaires de l’entourage du pape et fit remettre en liberté les patriotes emprisonnés, fut attaqué dans sa résidence au palais Corsini et vit tomber à côté de lui le général Duphot, lâchement assassiné par les séides du pape. De retour à Paris, le Directoire approuva sa conduite. Réélu, par le même département, le 23 germinal en VI, député aux Cinq-Cents, il en devint secrétaire le 2 pluviôse an VII, donna sa démission de député le 8 pluviôse an VIII et fut nommé, le 13 ventôse suivant, ministre plénipotentiaire en Bohême, fut promu grand électeur le 28 floréal an XII, puis connétable et sénateur de droit le 22 thermidor suivant, grand officier de la Légion d’honneur le 10 pluviôse an XIII. Le 3 janvier 1806, il fut nommé général de division, et enfin accepta, le 31 mars suivant, la couronne de Naples et des Deux Siciles, ne fut pas très heureux comme roi de ce pays, quitta Naples pour aller s’assoir à Madrid sur le trône occupé autrefois par Charles Quint, ne sut pas davantage se faire aimer à Madrid, et en fut plusieurs fois chassé, quitta définitivement ce trône en 1813, et entra en France à la suite de l’armée française, puis reçut en compensation le titre de lieutenant général de l’Empire et le grade de commandant de la garde nationale en janvier 1814. Il engagea énergiquement les Parisiens à la résistance contre les alliés, mais prit personnellement le soin de se mettre à l’abri du danger en abandonnant Paris le 30 mars pour accompagner à Blois l’impératrice Marie-Louise. Après l’abdication de son frère, Joseph partit pour la Suisse où il acheta la terre de Prangins, puis au retour de l’île d’Elbe, il fut nommé, le 2 juin 1815, membre de la chambre des pairs. Après Waterloo, Joseph quitta Paris et s’embarqua à Rochefort pour les Etats-Unis. Il prit sa résidence près de Philadelphie, sous le nom de comte de Survilliers. Après la Révolution de 1830, il protesta contre l’établissement du gouvernement de Louis-Philippe, et vint habiter en Angleterre. Sur la fin de sa vie, il obtint en du grand-duc de Toscane l’autorisation de venir résider à Florence où il mourut en 1844.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Joseph Bonaparte sur Wikipedia
septembre 20, 2007
LES MARECHAUX DE NAPOLEON – MARECHAL MURAT (1767-1815), PRINCE, ROI DE NAPLES
Le roi de Naples était vraiment sublime au feu, le meilleur officier de cavalerie au monde. Au combat c’était un “césar”, mais, hors de là, “presqu’une femme”… Murat avait un très grand courage et fort peu d’esprit. La trop grande différence entre ces deux qualités l’explique en entier.
Murat (Joachim, Prince, Grand duc de Berg et de Clèves, puis roi de Naples), élu le 2 fructidor an XII, député du Corps législatif pour le département du Lot ; roi de Naples le 15 juillet 1808, né à la Bastide-Fortunière (Lot), le 25 mars 1767, fusillé à Pizzo (Italie) le 13 octobre 1815 ; fils du « sieur Pierre Murat, négociant (aubergiste), et de demoiselle Jeanne Loubières » ; fit ses études comme boursier dans le collège de sa ville natale ; étant destiné à l’état ecclésiastique, il se rendit à Toulouse pour étudier la théologie, fut reçu sous-diacre, mais s’étant fait renvoyer du séminaire, il retourna dans sa famille, qui lui fit un mauvais accueil. Aussitôt il s’engagea au 12e régiment de chasseurs à cheval, y parvint au grade de maréchal des logis et revint en congé à l’auberge paternelle. Au bout de peu de temps J-B. Cavaignac, député de son département, lui fit obtenir son admission dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, et le 30 mai 1791, il était promu sous-lieutenant au21e régiment de chasseurs à cheval, dans lequel il fit les campagnes de Champagne et des Pyrénéees-Occidentales ; officier d’ordonnance du général d’Urre, chef d’escadron, ayant écrit aux Jacobins de Paris, lors de l’assassinat de Marat, qu’il voulait échanger son nom contre celui de Marat, il fut dénoncé après le 9 thermidor, et ce fut encore par la faveur de J-B. Cavaignac, que la dénonciation portée contre lui fut annulée par le Comité de Salut public, mais il perdit son grade et resta sans emploi jusqu’au 13 vendemiaire an IV, date à laquelle Bonaparte lui donna mission, lors de l’insurrection des sections de Paris, de ramener des Sablons aux Tuileries 40 pièces de canons. Il fit cette opération avec rapidité et en fut récompensé par le grade de chef de brigade. Devenu général en chef de l’armée d’Italie, Bonaparte en fit son aide de camp ; il se distingua par sa bravoure et fut chargé avec Junot d’aller porter à Paris les drapeaux pris sur l’ennemi. Peu après son retour, il passa général de brigade (14 pluviôse an V), continua la campagne d’Italie jusqu’à la paix de Léoben, et le 19 mai 1798 il accompagna Bonaparte dans l’expédition d’Egypte. Partout il fit des prodiges de vaillance et mérita d’être représenté sur un bas-relief de l’Arc de Triomphe se faisant rendre le cimeterre de Mustapha-Pacha. En octobre 1799 il était général de division ; à la rentrée de Bonaparte en France, il le suivit, l’accompagna le 18 brumaire au Conseil des Cinq-Cents et quelques jours après, le 20 janvier 1800, il épousait la plus jeune soeur du Premier Consul, Caroline-Annonciade Bonaparte. Ayant le commandement de la garde consulaire, il fit la campagne de Marengo, à la suite de laquelle il reçut un sabre d’honneur. En janvier 1801, il prit le commandement de l’armée avec laquelle il chassa les Napolitains de Etats pontificaux, s’empara de l’île d’Elbe, où il commença le siège de Porto-Ferrajo, interrompu par le traité d’Amiens. C’est à son retour en France qu’il fut élu président du collège électoral du Lot, gouverneur de Paris, et en cette qualité, il institua la commission chargée de juger le duc d’Enghien ; il fut alors et successivement promu : maréchal de l’Empire le 30 floréal an XII, prince, grand-amiral le 12 pluviôse an XIII et le lendemain grand-aigle de la Légion d’honneur et chef de la 12e cohorte. Il se couvrit de gloire dans la grande armée qui s’avançait vers le danube et dont il avait le commandement de la réserve de cavalerie. Après la bataille d’Austerlitz, Napoléon le créa Grand duc de Berg et de Clèves, le 15 mars 1806 ; lors de la reprise des hostilités contre la Prusse au mois d’octobre suivant, il eut le commandement de la cavalerie indépendante.
En 1807, il fit campagne de Pologne, assista à l’entrevue des deux empereurs et après la paix, au mois de novembre de la même année, il entrait en Espagne à la tête d’un corps d’armée de 80.000 hommes pendant que Junot envahissait le Portugal ; on lui donna le titre de lieutenant-général de ce royaume, dont il ambitionnait la dignité royale ; néanmoins le 15 juillet 1808, après une vive discussion avec l’Empereur, la couronne de Naples, qui était devenue vacante, à la suite du départ de Joseph-Napoléon, fut donnée à Murat, son beau-frère, lequel fut proclamé roi de Naples sous le nom de Joachim-Napoléon ; à peine monté sur le trône, il s’empara de l’île de Capri et força Hudson Lowe, le futur garde-chiourme de son beau-frère, à capituler. En juin 1809, une flotte anglo-sicilienne tenta de soulever la Napolitaine, Murat organisa aussitôt une expédition contre la Sicile ; mais n’y put débarquer que la division sous les ordres du général Cavaignac ; il attribua son insuccès au mauvais vouloir de Napoléon et lui en garda une certaine rancune jusqu’au moment de la guerre de Russie, où l’Empereur lui confia le commandement de la cavalerie de la grande armée et celui de l' »escadron sacré », chargé de sa garde personnelle pendant la retraite.
A la rentrée en France de l’Empereur, celui-ci remit le commandement en chef à Murat le 5 décembre 1812, qu’il conserva jusqu’au 8 janvier 1813 ; à ce moment, il le transmit au prince Eugène, pour rentrer précipitamment à Naples, où de concert avec l’Autriche et l’Angleterre, suivant les conseils de Fouché et de Caroline, sa femme, il signait, les 6 et 11 janvier 1814, un traité avec les alliés, par lequel il s’engageait à leur fournir 30.000 hommes, en échange de la garantie de la possession de son royaume. Immédiatement il se mit en campagne et força l’armée du prince Eugène à se retirer derrière l’Adige. L’adication de Napoléon ne fit qu’augmenter ses embarras, les princes de la maison de Bourbon se refusant à le reconnaître. Au retour de l’île d’Elbe, il assura l’Empereur de son dévouement et de sa fidélité, organisa la garde nationale napolitaine et confia la régence à la reine Caroline, puis se rendit avec son armée à Ancône, malgré les avis des Autrichiens sur les bonnes dispositions de l’Angleterre à son égard, il était trop tard pour reculer le 30 mars 1815, de son quartier général de Rimini, il lançait une proclamation aux Italiens, les appelant à la guerre de l’indépendance, et en peu de temps s’emparait de Modène et de Florence ; le 2 mai il se fit battre à Tolentino, rentra presque seul à naples le 18, mais, sentant l’insurrection gronder sous ses pas le 19, il se retira à Gaëte ; à ce moment, Ferdinand reprit possession de son trône. Murat s’embarqua le 21 avec sa famille sur un bâtiment français qui le conduisit à Cannes. De nouveau il se mit à la disposition de Napoléon ; celui-ci ne lui répondit pas, mais chargea Fouché de lui interdire le séjour de Paris. En route pour Lyon, il apprit le désatre de Waterloo, revint à Toulon, tenta de s’embarquer pour Le Havre, mais le mauvais état de la mer ne lui permit pas de rejoindre et il apprit alors que sa tête était mise à prix, pendant huit jours il resta caché dans une cabane au bord de la mer et parvint enfin à se rendre à Bastia, où des agents napolitains, trompant sa confiance, lui firent entendre qu’il n’avait qu’à paraître, pour que la Napolitaine saluât son autorité, négligeant les conseils du comte Marcirone, son aide de camp, qui lui apportait des passeports pour se rendre en Autriche, où on lui garantissait la vie sauve en échange de son abdication, il partit le 28 septembre avec 6 barques et 250 hommes, conduit par un certain Barbara, qui s’était engagé à le livrer à la cour de Naples. En raison du mauvais temps les barques se dispersèrent, Murat donna l’ordre de mettre le cap sur Trieste, Barbara, prétextant des réparations urgentes, le fit consentir à entrer dans le port du Pizzo. Descendu sur la plage avec 30 hommes, près de Montelleone, un capitaine de gendarmerie donna l’ordre à des paysans armés de faire feu sur son escorte. Quand il revint au rivage, Barbara avait levé l’ancre. Murat fut bientôt fait prisonnier, conduit au fort du Pizzo, traduit devant une commission militaire et condamné à mort le 13 octobre 1815, la sentence fut exécutée une demi-heure après.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Liens : Maréchal Murat (1767-1815) – Maréchal Murat sur Wikipedia
septembre 16, 2007
LA FAMILLE DE NAPOLEON – PRINCE EUGENE DE BEAUHARNAIS (1781-1824), VICE-ROI D’ITALIE
Eugène est une tête carrée, un administrateur habile, c’est un homme de mérite supérieur, mais ce n’est pas un homme de génie. Il n’a pas ce caractère qui distingue les grands hommes.
Beauharnais (Eugène-Pierre, Prince de), officier général et législateur, né à Paris, le 3 septembre 1781, de « Alexandre-François-Marie, vicomte de Beauharnais, et de Rose Tascher de la Pagerie« , mort à Munich (Bavière) le 21 février 1824 ; entra après l’exécution de son père, en apprentissage chez un menuisier, mais Hoche l’ayant pris sous sa protection, en fit son officier d’ordonnance. En l’an IV il alla en Italie et servit sous les ordres de Masséna, passa sous-lieutenant et devint l’aide de camp du général en chef. En l’an VI, il fit partie de l’expédition d’Egypte et fut nommé aide de camp de Bonaparte, qui était alors son beau-père, et se signala particulièrment à la prise de Suez et au siège de Sain-Jean-d’Acre. Il rentra en France avec le général en chef, repartit avec lui pour la campagne d’Italie et fut nommé chef d’escadron en l’an VIII ; colonel deux mois après, il obtint la décoration de la Légion d’honneur, et enfin fut promu général de brigade en l’an XII. Après la proclamation de l’Empire, l’Empereur nomma Beauharnais vice-roi d’Italie. En 1809, l’Autriche, profitant de la guerre d’Espagne, qui absorbait une partie des forces françaises, voulu prendre sa revanche en envahissant l’Italie ; l’Empereur chargea alors Eugène de Beauharnais de tenir en échec les forces autrichiennes ; il n’y réussit que médiocrement et parvint, à l’aide de Macdonald et de Grenier, à faire sa jonction à Vienne, avec la grande armée et de prendre part à la bataille de Wagram. Plus tard il alla rejoindre la grande armée en Russie et assista au combat d’Ostrowno, de Witepk, de Smolensk et à la bataille de la Moskowa. Au passage de la Bérésina, il perdit la plupart de ses hommes, contribua ensuite à la victoire de Lutzen. Cependant l’Italie était menacée de nouveau par l’Autriche ; l’Empereur l’envoya en toute hâte pour repousser cette nouvelle invasion, mais les défections du roi de Bavière et de Murat le forcèrent à se réfugier derrière le Mincio ; c’est pendant ce temps qu’il apprit l’abdication de Napoléon. Il gagna alors le Tyrol pour se rendre en Bavière, emportant avec lui la somme de 30 millions ; il fut doté par le roi Maximilien du duché de Leuchtenberg et de la principauté d’Eischtaedt. Il prit alors la résolution de se rendre à Paris et à présenter ses devoirs à Louis XVIII, qui l’accueillit fort bien. Au retour de l’île d’Elbe, l’Empereur le nomma pair de France, et, après Waterloo, il se décida à quitter la France pour se retirer à Munich, où il fit valoir, jusqu’à sa mort, l’immense fortune qu’il possédait.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)
Lien : Prince Eugène de Beauharnais sur Wikipedia
septembre 2, 2007
NAPOLEON ET JOSEPHINE – LA GENERALE BONAPARTE
Si je gagne les batailles, c’est toi qui gagnes les coeurs.
Rien ne prédestinait la veuve Beauharnais à devenir la première dame de France. Le 6 août 1794, à la suite de la chute de Robespierre, elle sort de la prison des Carmes après cent huit jours d’emprisonnement. Elle doit alors tout reconstruire ; veuve avec deux enfants de treize et onze ans, elle n’a de cesse que de récupérer les biens de son mari, Alexandre de Beauharnais, afin de s’assurer un semblant d’aisance. Multipliant les expédients, elle loue un charmant petit hôtel, rue Chantereine dans le quartier à la mode, où elle reçoit tout ce que Paris compte de personnalités importantes. Très rapidement, Joséphine devient l’une des égéries de cette société thermidorienne qui gravite autour du plus influent des Directeurs, Barras. Il est indéniable qu’une forte complicité les unit sans que l’on sache réellement la nature de leurs liens ; Joséphine, qui a l’époque portait le prénom de Rose, a toujours été proche du pouvoir quelqu’il soit, non pas pour l’exercer, mais pour en tirer les avantages matériels qu’il procure. Son destin va basculer à la suite de l’insurrection royaliste de vendémiaire écrasée par Bonaparte ; c’est vers la mi-octobre 1795 qu’elle rencontre ce jeune général victorieux qui gravite dans le cercle de Barras ; elle lui rend une première visite pour le remercier d’avoir autorisé son fils, Eugène de Beauharnais, à conserver le sabre de son père, alors qu’il était interdit aux particuliers de garder des armes sous peine de mort.
A force de la revoir, Bonaparte finit par tomber sous le charme de cette femme qui représente pour lui cette aristocratie d’ancien régime à laquelle il n’appartient pas vraiment et dont il sait qu’il peut tirer parti pour sa carrière. D’autre part, général en chef de l’armée de l’Intérieur depuis le 26 octobre, il fait partie de ces militaires du premier rang dont l’avenir ouvre des perspectives de sécurité à cette femme toujours désargentée. Il y a dans cette relation une véritable communauté d’intérêts ; mais peu à peu leur liaison va prendre un tour passionnel ; elle s’en amuse, flattée d’inspirer une telle passion à ce jeune général de vingt-six ans alors qu’elle en compte six de plus. Puis tout va aller très vite comme le confirme cette lettre de décembre 1795 : « Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l’enivrante soirée d’hier n’ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ! » C’est le moment où Bonaparte, abandonnant le prénom de Rose, décide de l’appeler Joséphine en féminisant le second prénom de sa bien-aimée, Joseph. L’idée d’un mariage se précise assez rapidement, car les bans sont publiés dès le 7 février 1796 et le contrat signé le 8 mars. Le mariage civil est célébré dès le 9 à la mairie du IIè arrondissement, cette précipitation s’expliquant par la nomination du mari le 2 mars comme commandant en chef de l’armée d’Italie en remplacement du général Schérer.
Mais la nouvelle générale Bonaparte ne va pas pouvoir profiter bien longtemps de la vie conjugale ; en effet, dès le surlendemain, 11 mars, le mari quitte Paris en chaise de poste pour rejoindre ses troupes. Commence alors pour Joséphine cette vie chaotique et aventureuse qui lui sera tant reprochée. D’un côté les lettres enflammées pleines de fougue du mari, lettres dont l’intensité croît au fur et à mesure qu’il s’éloigne d’elle, et de l’autre la presque indifférence d’une femme à la mode qui entend bien jouir des plaisirs de Paris et qui s’amuse de cette passion dont elle est l’objet. Elle réagit en femme d’Ancien Régime pour qui un mariage est toujours arrangé et dans lequel l’amour n’a pas sa place ; alors comment s’étonner qu’étant encore à Nice, Bonaparte s’échauffe dans une de ses missives lui écrivant « dans ta lettre du 23, du 26 ventôse, tu me traites de vous. Vous toi-même. Ah ! Mauvaise ! comment as-tu pu écrire cette lettre ? qu’elle est froide ! ». Il la désire auprès de lui en Italie alors qu’elle est entourée à Paris d’une cour d’admirateurs au premier rang desquels figure ce jeune Hippolyte Charles, jeune lieutenant et beau garçon, sorte de chevalier servant qui la suit pas à pas et dont l’assiduité auprès d’elle prête à médisance. Alors, au début de mai elle se décide à annoncer à Bonaparte un début de grossesse, ce qui réjouit et attriste à la fois cet époux impatient : « Il est donc vrai que tu est enceinte ; Murat me l’écrit, mais il me dit que cela te rend malade, et qu’il ne croit pas prudent que tu entreprennes un aussi grand voyage ». S’agit-il d’une manœuvre pour rester à Paris ou d’une réelle grossesse ? Nul ne saurait le dire et l’on doit se contenter des quelques billets écrits par Joséphine à cette époque dans lesquels elle évoque une forte fièvre, un violent point de côté et une santé chancelante. Mais Bonaparte n’y tient plus ; le 15 juin il confie à Joseph « Ma femme, tout ce que j’aime dans le monde est malade. Ma tête n’y est plus…. Tu sais que je n’ai jamais aimé, que Joséphine est la première femme que j’adore. Sa maladie me met au désespoir. » Il finit par menacer de rentrer à Paris ayant écrit la veille, 14 juin, à Joséphine : « Si ta maladie continue, obtiens-moi une permission de venir te voir une heure. Dans cinq jours je suis à Paris, et le douzième je suis à mon armée ». Les Directeurs s’affolent de cet éventuel retour et adressent à Bonaparte cet étonnant document signé de Carnot : « Le Directoire qui s’était opposé au départ de la citoyenne Bonaparte dans la crainte que les soins que lui donnerait son mari ne la détournassent de ceux auxquels la gloire et le salut de la patrie l’appellent, était convenu qu’elle ne partirait que lorsque Milan serait pris. Vous y êtes ; nous n’avons plus d’objections à faire. Nous espérons que le myrte dont elle se couronnera ne dépassera pas les lauriers dont vous a déjà couronné la victoire ».
Enfin, le 26 juin, elle quitte Paris accompagnée de Joseph Bonaparte et Nicolas Clary son beau-frère, de Junot et de l’indispensable Hippolyte Charles dont les calembours, souvent d’un goût douteux, font son bonheur. Lorsqu’elle arrive à Milan le 10 juillet, Bonaparte n’y est pas et il la retrouve seulement le 13 pour ne rester que deux jours avec elle, devant rallier très vite son poste de combat ; depuis leur mariage il y a plus de quatre mois, les deux époux ne sont restés ensemble que quatre jours ! Loin de Paris, Joséphine va beaucoup s’ennuyer pendant les 453 jours que durera son absence ; elle s’en confie à Térésa Tallien dans une lettre du 23 juillet : « J’ai fait le voyage le plus pénible qu’il soit possible de faire. J’ai été dix-huit jours en route. J’ai eu la fièvre en montant en voiture et une douleur de côté. La fièvre est passée mais les douleurs de côté durent encore. Je n’ai vu Bonaparte qu’un moment. Il est très occupé au siège de Mantoue. Je pars demain au soir pour aller à Brescia. Cela me rapprochera du quartier général. Je m’ennuie ici à la mort au milieu des fêtes superbes que l’on me donne. Je regrette sans cesse mes amis de Chaillot [les Tallien], celui du Luxembourg [Barras]. Joseph me tient fidèle compagnie. Nous nous entretenons toujours avec plaisir de Thérésita, et mon refrain est : « Ah ! si elle était ici, je serais bien plus heureuse. » Mon mari ne m’aime pas : il m’adore. Je crois qu’il deviendra fou. Il est impossible d’être plus heureuse que je ne suis de ce côté….. Arrivée à Milan, la municipalité a voulu me traiter comme une archiduchesse et non comme une républicaine. Elle m’avait logée dans la plus belle maison de Milan. On avait composé ma maison de garde de trente domestiques, de cinq cuisiniers. Comme je ne suis qu’une républicaine, par conséquent simple particulière à Milan comme à Paris, j’ai pris la liberté de renvoyer tout ce monde et de me restreindre à mon petit ménage de la rue Chantereine. »
Cette année et demi passée en Italie va lui donner l’occasion d’acquérir cette aisance de souveraine qu’elle saura si bien mettre en application lorsqu’elle sera devenue impératrice. Les usages du monde qu’elle a appris dans sa jeunesse lui permettent de se sentir à l’aise en représentation. Désormais le ton de ses lettres change ; elle ne supplie plus ses correspondants, mais les prie aimablement d’intervenir en faveur de ses protégés ; elle se met à écrire d’égal à égal aux ministres ; n’est-elle pas après tout la femme de celui qui décide ? Tous les princes d’Italie lui donnent des fêtes et elle est même reçue par le grand-duc de Toscane, frère de l’Empereur et oncle d’une petite archiduchesse de cinq ans qui lui succédera un jour dans la couche de Napoléon.
Elle se rapproche donc du théâtre des combats en partant pour Brescia, puis Vérone, mais le 30 juillet, en tentant de regagner Brescia, elle essuie le feu des armées autrichiennes en longeant le lac de Garde ; elle confie à Joseph : « que j’ai été poursuivie par les uhlans, qu’on m’a fait passer dans les ruines de Mantoue, que les boulets me pleuvaient sur la tête, qu’à cinq pas de moi un dragon qui m’escortait a eu un cheval tué sous lui, et un autre a été blessé. Jugez, mon cher Joseph, les dangers que j’ai courus. » Furieux, Bonaparte promet au général autrichien Wurmser de lui faire chèrement payer les larmes versées par Joséphine. De fait, il le bat à Castiglione quelques jours plus tard puis l’obligera à abandonner Mantoue, place jugée jusque là imprenable. Ce « fait d’armes » de Joséphine connaîtra même les honneurs du Salon de 1806 où le peintre Hippolyte Lecomte présentera une toile montrant la voiture de Joséphine canonnée sur les rives du lac de Garde ; le tableau ornera sous l’Empire l’appartement de son fils, Eugène de Beauharnais, au palais des Tuileries (aujourd’hui au musée de Versailles)
Il n’est plus question pour Bonaparte après cet incident d’exposer sa femme aux risques de la guerre, d’autant que celle-ci considère que sa place n’est pas d’être aux armées. Elle s’installe donc à Milan au palais Serbelloni et les deux époux restant séparés, la correspondance du mari reprend, faite de reproches, de déclarations enflammées et de cris de jalousie assaisonnés de nouvelles militaires. Jusqu’à la fin de 1798 alterneront ainsi des séparations et des séjours en commun à Milan, à Bologne ou à Passariano près d’Udine. C’est dans la villa de Mombello, au nord de Milan, que les deux époux président le 14 juin 1797 le double mariage religieux d’Elisa et de Pauline Bonaparte avec Baciocchi et Leclerc. Enfin, à la fin du mois de novembre 1797 Joséphine quitte Milan pour remonter vers Paris au moment où Bonaparte se dirige vers Rastadt afin de traiter avec les plénipotentiaires de l’empereur. Joséphine mettra un mois pour rentrer, passant par Venise où on lui donne de grandes fêtes, par Turin et par Lyon qui la célèbre par des bals et des réceptions ; enfin, le 30 décembre, elle rentre dans sa petite maison de la rue Chantereine qui depuis deux jours a été débaptisée et s’appelle désormais rue de la Victoire ou rue des Victoires-Nationales, en l’honneur des victoires de son mari qui était lui-même à Paris depuis le 5 du mois.
Va s’ouvrir alors pour les deux époux une période de vie conjugale particulièrement longue de quatre mois et demi jusqu’au départ de la flotte pour l’Egypte à Toulon le 19 mai 1798. A peine rentré à Paris, Bonaparte reçoit un accueil enthousiaste et les autorités célèbrent son retour avec faste. Le 3 janvier 1798 il assiste avec Joséphine à une grande fête donnée en leur honneur par Talleyrand dans les salons de l’hôtel de Gallifet, fête retardée trois fois par suite du retard de l’épouse du général ! Quelques jours plus tard, Bonaparte qui s’était fortement enrichi pendant la campagne d’Italie, décide de visiter le château de Malmaison en vue de son achat ; très vite, il y renonce, trouvant le prix bien trop élevé. En revanche, le 26 mars, il se rend acquéreur de l’hôtel de la rue de la Victoire qui était simplement loué depuis 1795. Avant de rejoindre l’armée, Bonaparte confie son patrimoine à son frère Joseph et lui demande d’acheter le château de Ris, au sud de Paris, ainsi qu’une terre en Bourgogne. Enfin, le 3 juin les époux quittent Paris à trois heures du matin et arrivent à Toulon le 9. Joséphine assiste donc au départ de la flotte le 19 au matin, mais elle ne suit pas son mari en Egypte ainsi qu’elle en informe Barras dans une lettre du 26 mai : « Je suis restée à Toulon, mon cher Barras. Bonaparte a craint de rencontrer les Anglais. Il n’a point voulu m’exposer. Si je ne pars pas sous quinze jours, j’irai à Plombières pour y prendre les eaux et j’irai dans deux mois rejoindre Bonaparte en Egypte. » Mais le mari persiste dans son projet de faire venir son épouse auprès de lui, car depuis Malte il confie à Joseph le 18 juin : « J’écris à ma femme de venir me joindre, si elle est à portée de toi, je te prie d’avoir des égards pour elle ».
Joséphine quitte Toulon aux environs du 5 juin en direction de Plombières où elle arrive le 14. Elle y restera trois mois, espérant que les eaux, réputées traiter la stérilité féminine, la soulagerait des douleurs qui l’assaillent. A nouveau loin de Paris, Joséphine s’ennuie, se sait entourée d’ennemis et ne tarde pas à prendre Barras comme confident se plaignant de ne pas avoir de nouvelles de Bonaparte ; elle lui écrit seulement quatre jours après son arrivée : « J’ai besoin d’en avoir [des nouvelles]. Je suis si chagrine d’être séparée de lui que j’ai une tristesse que je ne puis vaincre. D’ailleurs, son frère [Joseph], avec lequel il a une correspondance si suivie, est tellement abominable pour moi que je suis toujours inquiète loin de Bonaparte. Je sais qu’il a dit à un de ses amis, qui me l’a répété, qu’il n’aurait de tranquillité que lorsqu’il m’aurait brouillé avec mon mari. C’est un être vil, abominable, que vous connaîtrez un jour ». Et de fait, le poison fait son œuvre chez le mari qui confie à Joseph dans une lettre du 25 juillet : « J’ai beaucoup de chagrin domestique car le voile est entièrement levé ». Le fait est corroboré par Eugène qui confie à sa mère le 24 juillet, soit trois jours après la victoire des Pyramides : « Bonaparte, depuis cinq jours, paraît bien triste, et cela est venu à la suite d’un entretien qu’il a eu avec Julien, Junot et même Berthier ; il a été plus affecté que je ne croyais de ces conversations. Tous les mots que j’ai entendus reviennent à ce que Charles est venu dans ta voiture jusqu’à trois postes de Paris, que tu l’as vu à Paris, que tu as été aux Italiens avec lui dans les quatrièmes loges [qui étaient des loges grillées], qu’il t’a donné ton petit chien, que, même en ce moment, il est près de toi ; voilà, en mots entrecoupés, tout ce que j’au pu entendre. Tu penses bien, Maman, que je crois pas cela, mais ce qu’il y a de sûr, c’est que le général est très affecté ». Bonaparte avait pris désormais la décision de divorcer dès son retour d’Egypte et affiche ostensiblement sa liaison avec Pauline Fourès.
Installée dans une belle demeure de la Grand’Rue de Plombières, la vie de Joséphine s’y serait déroulée sans histoire sans le pénible accident survenu le 20 juin ; occupée à divers travaux dans son salon et appelée par Mme de Cambis, elle se précipite vers le balcon avec deux de ses compagnons afin de voir passer un petit chien ; le plancher du balcon, en mauvais état, cède sous le poids et tout le monde se retrouve sur le trottoir quatre mètres plus bas. Joséphine, tombée assise, éprouve une violente commotion. Ce accident met toute la France en émoi et tous les jours, Barras reçoit des bulletins de santé de la malade rédigés dans la langue des médecins de Molière ; voici l’un d’eux : « Aujourd’hui 6 messidor, la citoyenne Bonaparte a pris un léger purgatif : trois onces de manne dans une légère décoction de tamarin. Ce purgatif a évacué beaucoup de bile, et la malade s’en trouve bien ». Le malheur de l’épouse du général en chef intéresse les autorités au plus haut point ; elle doit les recevoir, supporter leurs discours, écouter les vœux qu’on forme pour sa santé et pour la gloire de son époux. Plombières est vraiment la ville d’eaux à la mode ; on y voit arriver Mme de Montesson, veuve du duc d’Orléans, ou bien le directeur Reubell qui se montre aimable et empressé auprès la femme du général en chef. Les journées se passent en réunions mondaines, en promenades, en jeux ou en concerts. La saison touchant à sa fin, Joséphine pense qu’il est grand temps de rentrer ; elle quitte Plombières le 12 septembre et arrive à Paris dans la nuit du 15.
Rentrée rue de la Victoire, elle reprend très vite ses habitudes parisiennes, rendez-vous avec Hippolyte Charles et dîners chez Barras qu’elle assaille de billets de recommandation pour ses protégés. L’hiver arrivant, sans nouvelles de son mari et Joseph ne se pressant pas d’acheter les propriétés désirées par Bonaparte, elle reprend l’initiative et fait approcher à nouveau les propriétaires de Malmaison. Il va sans dire qu’elle n’a pas un sous vaillant en poche et qu’elle compte sur le retour du mari pour régler la transaction. Elle va même jusqu’à emprunter 15 000 francs au régisseur des vendeurs afin de régler le premier acompte ! L’acte est signé le 21 avril 1799 et Joséphine s’y installe aussitôt. Elle s’y plait beaucoup, avouant à Barras : « Depuis que j’habite la campagne, je suis devenue si sauvage que le grand monde m’effraie ». Hortense dans une lettre à son frère confirme ce besoin de solitude : « Maman a acheté la Malmaison, qui est près de Saint-Germain. J’y suis presque toutes les décades ; elle y vit très retirée, n’y voit que Mme Campan et Mlles Auguié qui y viennent souvent avec moi ».
C’est dans ce contexte qu’elle prépare un éventuel retour de son mari en donnant deux grands dîners aux membres du Directoire dans la salle à manger de sa nouvelle demeure. Elle cajole Gohier, nommé récemment Directeur et se réjouit de l’arrivée au Directoire de Sieyès, un vieil ami. Avec Barras, cela fait trois Directeurs qu’elle rallie à sa cause. Aussi lorsque le 9 octobre, à l’heure du dîner, on apprend le débarquement de Bonaparte à Fréjus, Joséphine ne perd pas un instant et décide de le rejoindre au plus vite, redoutant avec raison que ses beaux-frères n’arrivent avant elle et ne la dénigrent auprès du général. Accompagnée d’Hortense, elle court vers le Midi, passant par la route de Bourgogne, tandis que Bonaparte remonte en empruntant celle du Bourbonnais. Aussi, arrivé rue de la Victoire au matin du 16, trouve-t-il une maison vide. Immédiatement le clan Bonaparte lui démontre que le divorce s’impose ; Bonaparte s’enferme dans son cabinet, jurant de ne pas ouvrir sa porte à sa femme. C’est le surlendemain, 18 octobre, qu’a lieu la fameuse scène de réconciliation au cours de laquelle, après avoir vainement tenté de franchir la porte de son appartement, Joséphine se décide à faire intervenir ses enfants qui pleurèrent et prièrent avec elle. Bonaparte n’y résista point et le lendemain matin, Lucien Bonaparte eut la désagréable surprise de trouver les deux époux dans le même lit !
La réconciliation acquise, Joséphine reçoit dans son salon tous ces militaires qu’il faut bien rallier à la cause de Bonaparte car les événements vont s’accélérer. En effet, le 9 novembre, le coup d’Etat lui donne les pleins pouvoirs avec le titre de Premier Consul. Le 11 les époux abandonnent leur petite maison de la rue de la Victoire pour s’installer au Luxembourg. La générale Bonaparte prend alors le titre de consulesse et devient la première dame de France. Consciente de son nouveau rôle, elle suit désormais l’étoile de Napoléon, abandonnant la vie aventureuse de la générale Bonaparte.
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
septembre 1, 2007
JOSEPHINE, LES PREMIERS PAS D’UNE IMPERATRICE
Si je la fais impératrice, c’est par justice ! J’ai un coeur d’homme et je suis surtout un homme juste ; si j’avais été jeté dans une prison au lieu de monter sur le trône, elle aurait partagé mes malheurs. Il est juste qu’elle participe à ma grandeur.
C’est à Saint-Cloud, où Joséphine et Bonaparte résident depuis le 10 avril 1804, que se déroulent les différentes étapes qui mèneront à la création de l’Empire. Après avoir adopté le principe de l’hérédité et décidé de donner le titre d’empereur au général Bonaparte, puis après avoir discuté du sénatus-consulte sur la création de l’Empire, le Sénat, conduit par Cambacérès, se rend le 18 mai au palais afin de proclamer Napoléon empereur des Français. Sa harangue terminée, Cambacérès se tourne vers Joséphine qui s’entend donner pour la première fois le titre d’impératrice : « Nous venons de présenter à votre auguste époux le décret qui lui donne le titre d’Empereur, et qui, établissant dans sa famille le gouvernement héréditaire associe les races futures au bonheur de la génération présente. Il reste au Sénat un devoir très doux à remplir, celui d’offrir à Votre Majesté Impériale l’hommage de son respect et l’expression de la gratitude des Français. Oui, Madame, la renommée publie le bien que vous ne cessez de faire. Elle dit que toujours accessible aux malheureux, vous n’usez de votre crédit auprès du chef de l’Etat que pour soulager leur infortune ; et qu’au plaisir d’obliger, Votre Majesté ajoute la reconnaissance plus douce, et le bienfait le plus précieux. Cette disposition présage que le nom de l’Impératrice Joséphine sera le signal de la consolation et de l’espérance : et, comme les vertus de Napoléon serviront toujours d’exemple à ses successeurs pour leur apprendre à gouverner les Nations, à la mémoire vivante de votre bonté, apprendre à leurs augustes compagnes que le soin de sécher les larmes est le moyen le plus sûr de régner sur tous les cœurs. Le Sénat se félicite de saluer le premier Votre Majesté Impériale, et celui qui a l’honneur d’être son organe, ose espérer que vous daignerez le compter au nombre de vos plus fidèles serviteurs. » Naturellement superstitieuse, Joséphine ne peut s’empêcher de songer qu’elle venait d’être saluée du titre d’impératrice à l‘endroit même où le dernier des Valois, Henri III, avait été assassiné ; elle en restera longtemps affectée.
Première dame de France depuis le coup d’Etat de Brumaire, Joséphine s’était habituée peu à peu à ce rôle de représentation qu’elle allait assumer avec bonheur pendant deux lustres entiers. Déjà comme épouse du Premier Consul, elle avait pris l’habitude de recevoir les autorités partout où elle se rendait, fut-ce en cure à Plombières. Elle avait accompagné Bonaparte dans ses voyages à Lyon, en Normandie ou en Belgique et peu à peu elle avait franchi avec lui les étapes qui allaient les mener ensemble vers l’Empire. Les honneurs n’étaient donc pas nouveaux pour Joséphine et à ses qualités de tact, d’aménité et de bonté se joignait une très grande dignité dont elle ne départit jamais. La tâche fut moins aisée pour les nouveaux courtisans, mais ils s’y mirent peu à peu comme le général Thiébault, farouche républicain, qui se rappelle qu’il lui était « impossible d’employer le mot d’impératrice et celui de Majesté à propos de Joséphine, qui, malgré la transformation de son mari et sa communauté d’honneurs, restait pour moi Mme Bonaparte… Peu à peu, cependant, je me mis au ton du jour, et bientôt il n’y eut plus rien d’impérial que je ne trouvasse en Joséphine », allant même jusqu’à déclarer « On ne l’approchait qu’avec admiration ; on ne l’écoutait qu’avec délices ; on ne la quittait qu’enchanté d’elle et de ses manières ».
La proclamation de l’Empire à Saint-Cloud est aussitôt suivie de plusieurs cérémonies ; c’est tout d’abord une adresse faite le 27 mai par le Tribunat à l’Impératrice, puis le 9 juin la cour de Cassation la célèbre à son tour. C’est le lendemain, 10 juin, que Joséphine intervient pour tenter de sauver quelques uns des complices de Cadoudal qui viennent d’être condamnés à mort. Chacun dans la famille impériale ayant décidé d’obtenir la grâce d’une des victimes, la nouvelle impératrice se charge de M. de Rivière et des frères Polignac, Armand et Jules ; elle fait entrer les soeurs du premier et les parentes du second qui se jettent aux pieds de Napoléon ; sans attendre un instant, il leur fait grâce ainsi qu’à quatre autres condamnés, tous nobles, les autres subissant immédiatement leur supplice.
Dès qu’elle le peut, Joséphine accompagne l’Empereur dans ses déplacements, aussi ne manque-t-elle sous aucun prétexte le court voyage qu’il entreprend à Fontainebleau dans ce même mois de juin ; parti de Saint-Cloud dans la journée du 27, le couple impérial arrive à 23 heures dans l’antique cité des rois. Le lendemain, Napoléon inspecte d’abord l’Ecole Militaire, puis il chasse en forêt ; c’est lors de ce court séjour qu’il donne ses ordres pour rétablir le château afin d’y recevoir le Pape pour la fin novembre. Quittant le palais dès le 29, l’empereur et l’impératrice prennent la route de Melun vers le début de l’après-midi et s’en vont dîner chez Augereau en son château de la Houssaye-en-Brie. Cette visite d’un tout nouvel empereur à un nouveau maréchal d’Empire se termine tard dans la nuit, et tout le monde est rendu à l’aube à Malmaison.
Mais il s’agit là d’un simple voyage d’ordre privé, car la première apparition en public des nouveaux souverains n’a lieu que le 15 juillet lorsqu’ils se rendent le matin à Notre-Dame pour entendre la messe dite par le cardinal légat, messe suivie d’un Te Deum ; de là, ils vont directement aux Invalides pour assister à la cérémonie de prestation de serment des membres de la Légion d’honneur ; l’impératrice, accompagnée de ses dames, se tient dans une tribune drapée de soie bleue, faisant face au trône de l’empereur. Le soir, après avoir assisté au feu d’artifice tiré depuis le Pont Neuf, le couple impérial visite aux flambeaux les salles du musée Napoléon, notre actuel musée du Louvre.
Si l’empereur part pour le camp de Boulogne trois jours après le 18 juillet, l’impératrice quitte Saint-Cloud le 23 pour un long voyage de cent neuf jours dont elle ne rentrera que le 8 octobre. Ce premier voyage, qu’elle effectue en grande partie seule pour la première fois comme impératrice, revêt une grande importance aux yeux de l’empereur, même si le prétexte en est une cure aux eaux d’Aix-la-Chapelle. Il ne s’agit plus du déplacement d’une riche particulière, mais du voyage officiel de la plus puissante souveraine d’Europe : aussi rien ne doit être laissé au hasard, et les dépenses qu’il occasionne sont à la hauteur des visées politiques de l’empereur : on achète quarante-sept chevaux, huit voitures et nombre de schalls, tabatières ou bijoux à offrir en présent aux autorités locales. Afin que l’impératrice ne descende pas à l’auberge, l’empereur fait acquérir, avec ses meubles, la maison du conseiller de préfecture Jean-Frédéric Jacobi, l’un des plus beaux hôtels d’Aix qui est depuis l’été 1800 le chef-lieu du département français de la Roer. Plus de cinquante personnes accompagnent Joséphine, parmi lesquelles son premier écuyer, deux chambellans, la dame d’honneur entourée de trois dames du palais et le secrétaire des commandements. Devant un tel déploiement, les mauvaises langues ne peuvent s’empêcher de raconter qu’à peine formée, la nouvelle cour impériale se rend près des vieux murs du palais de Charlemagne afin de faire des répétitions de solennités et d’étiquette !
Le parcours semble bien long, car les entrées et les sorties de ville sont marquées par vingt-cinq coup de canon, généralement accompagnés de discours de bienvenue auxquels Joséphine répond selon les notes laissées par l’empereur; ses réponses sont encore plus gracieuses lorsque sa mémoire en défaut l’oblige à improviser ses remerciements. Après avoir couché le premier soir à Reims, la petite caravane passe la nuit suivante à Sedan et, rien n’ayant été préparé, trouve refuse pour le troisième soir dans une modeste auberge de Marche-en-Famenne, en Belgique, après être passé par des chemins quasi inexistants où il faut maintenir les voitures en équilibre avec des cordes! Enfin, après avoir traversé la Meuse par le bac, on arrive à Liège, chef lieu du département de l’Ourthe, au soir du 26 juillet où l’on couche à la préfecture. Mais le plus difficile reste à venir : la route de Liège à Aix n’est qu’une suite de précipices où chacun laisse quelque débris de sa voiture en passant ; aussi bouche-t-on de toute urgence avec du sable les trous dans lesquels s’engloutissent les roues des véhicules. Joséphine arrive enfin à Aix le 27 à cinq heures et demi du soir après cinq jours d’un voyage éprouvant, confiant à sa fille Hortense : « Tu sais le pénible voyage que j’ai fait ; je n’entreprendrai pas de t’en donner des anecdotes qui seraient trop longues à te raconter ». Elle s’installe aussitôt dans la maison que l’empereur avait acquise pour découvrir qu’elle est petite, laide et peu convenable pour de tels hôtes. Toujours soumise aux ordres de son époux, elle attend avec résignation l’autorisation de l’empereur pour accepter l’offre du préfet Méchin d’occuper l’hôtel de la préfecture ; elle va y résider pendant un mois et demi. La petite cour s’organise selon une étiquette encore balbutiante ; l’impératrice prend ses repas sont avec toutes les personnes qui l’accompagnent, y compris l’officier de gendarmerie commandant l’escorte dont le rôle est de fournir à l’empereur des rapports de police quotidiens ; ainsi la petite cour est-elle au complet, car il n’y manque pas même un espion !
Les bains sont le prétexte du voyage ; aussi l’impératrice ne manque-t-elle pas de s’y rendre et d’en prendre cinq en huit jours, précisant à Hortense « J’ignore encore l’effet que me produiront les eaux, qu’il faut prendre avec infiniment de prudence ». Sa femme de chambre, Mlle Avrillion, ne semble guère les apprécier « ce qui n’est pas agréable, c’est le résultat pour l’odorat des salutaires eaux qui font la fortune d’Aix-la-Chapelle. Les eaux thermales sont si abondantes qu’elles s’écoulent en ruisseaux brûlants exhalant une odeur sulfureuse ». Le 1er août, visitant le trésor de la cathédrale, on présente à Joséphine une petite boîte de vermeil appelée Noli me tangere accompagnée d’un manuscrit précisant qu’elle avait été ouverte pour la dernière fois en 1356 et qu’elle ne devait l’être à nouveau que lors d’une circonstance exceptionnelle ; la serrure qui avait résisté aux doigts courtisans des chanoines, s’ouvre alors comme par miracle sous ceux de l’impératrice. Mais il faut bien passer le temps, aussi décide-t-elle de visiter les vieux châteaux carolingiens des environs et d’autres autres fois une mine de charbon ou une manufacture d’épingles. La réputation de bonté de Joséphine lui fait un devoir de se rendre à l’Institut des Pauvres de la ville où elle fait montre de cette générosité habituelle que Napoléon fustigera dans un moment d’humeur à Sainte-Hélène et que relate Las Cases dans le Mémorial : « Elle donnait. Mais se serait-elle privée de quelque chose pour donner ? Non. Aurait-elle fait un sacrifice pour aider quelqu’un ? Voilà la vraie bonté. Elle donnait, mais elle puisait dans le sac ». Les soirées sont longues, aussi fait-on venir de Paris la troupe dirigée par l’auteur dramatique Picard qui joue devant elle une pièce nouvelle, la femme aux quarante-cinq ans, dont le sujet laissa un goût amer chez celle qui venait de passer la quarantaine… Mais la grande affaire du voyage reste la remise des croix de la Légion d’honneur destinées au département de la Roer par l’impératrice elle-même ; dans une sorte d’esquisse de ce que sera plus tard le couronnement, Joséphine revêt pour la première fois son manteau de cour accompagné d’une traîne de moire blanche brodée d’or, et la tête coiffée d’un superbe diadème en diamants, elle fait son entrée solennelle dans la cathédrale où vingt empereurs allemands avaient été couronnés. Assise sur un trône qu’on lui a préparé dans le chœur, elle remet les décorations aux nouveaux chevaliers venus s’incliner devant leur nouvelle souveraine.
Depuis son camp de Boulogne, Napoléon instruit Joséphine de ses projets d’invasion de l’Angleterre. Le ton des lettres qu’il lui adresse est celui d’un empereur à son épouse ; aussi s’exprime-t-il dans le langage des cours et toutes ses missives commencent invariablement par une formule très inhabituelle chez lui, « Madame et chère femme » ; parfois il les ponctue de mots piquants, la prévenant de sa future arrivée sur un ton mi sérieux mi badin : « Comme il serait possible que j’arrivasse de nuit, gare aux amoureux. Je serai fâché si cela les dérange. Mais l’on prend son bien partout où on le trouve ». De fait, Napoléon venant du camp de Boulogne, arrive à Aix-la-Chapelle dans l’après-midi du 2 septembre. Aussitôt la présence de l’empereur renforce cette étiquette que Joséphine tente toujours d’atténuer lorsqu’elle est seule, disant à qui veut l’entendre qu’elle est bonne pour les princesses nées sur le trône et habituées à la gêne qu’elle impose. Les cérémonies succèdent aux cérémonies et le 7 septembre, après un nouveau Te Deum célébré à la cathédrale, les chanoines lui offrent, malgré les réticences de l’empereur, un bijou connu sous le nom de talisman de Charlemagne, qui aurait été trouvé au cou de l’empereur carolingien lors de l’exhumation de son corps en 1166. Conservé par Joséphine comme un porte-bonheur, il passa à la reine Hortense, puis à Napoléon III dont la veuve, l’impératrice Eugénie, l’offrit à l’archevêque de Reims après l’incendie de la cathédrale. Joséphine doit soutenir ce train d’impératrice, se soumettre aux cérémonies en grand costume, même si parfois son écrin ne répond pas à la hauteur de sa situation ; elle en est même contrainte d’écrire le 8 septembre à Hortense : « Tu me feras plaisir, si tu ne portes pas tes diamants, de me les envoyer… Dis à Marguerite [son joaillier], dans le cas ou mon ajustement d’émeraudes serait prêt, de me l’envoyer par la même occasion ». Quittant Aix le 12, elle se rend à Cologne d’où elle remonte le Rhin en bateau, tandis que Napoléon prenant la voie terrestre, tous deux arrivent le même jour à Mayence, chef-lieu du département du Mont-Tonnerre. Ils y séjourneront treize jours, du 20 septembre au 2 octobre, habitant la Deutsches Haus, ancien palais du commandeur de l’ordre des chevaliers teutoniques, bâti le long du Rhin, mais jugé petit et malcommode pour de si puissants souverains ! Les princes allemands viennent faire leur cour à l’empereur ; on voit ainsi défiler les princes de Bade de Bavière, de Hesse-Darmstadt ou de Nassau. Pour soutenir ce train de vie somptueux, il faut posséder une garde-robe variée et donc coûteuse ; Elisabeth de Vaudey, l’un des dames du palais de l’impératrice, se rappelait que « Le matin, à 10 heures, on s’habille pour déjeuner ; à midi, on fait une autre toilette pour assister à des représentations ; souvent ces représentations se renouvellent à différentes heures et la toilette doit toujours être en rapport avec l’espèce de personnes présentées : en sorte qu’il nous est arrivé quelquefois de changer de toilette trois fois dans la matinée, une quatrième pour le dîner et une cinquième pour le bal. »
Mais le proche accouchement d’Hortense décide Joséphine à rentrer à Paris, et à laisser l’empereur continuer seul son voyage en Allemagne. Elle quitte Mayence le 2 octobre, faisant étape le soir à Saverne, à Nancy et à Châlons-sur-Marne avant d’arriver le 7 au matin à Paris, après avoir roulé toute la nuit. Elle rentre juste à temps pour assister aux couches de sa fille qui ont lieu le 11. A deux heures et demi de l’après-midi, Hortense donne naissance, dans son hôtel de la rue Cerutti, à son second fils Napoléon-Louis, faisant ainsi Joséphine grand-mère pour la deuxième fois, alors qu’elle-même tentait encore désespérément de donner un héritier à l’empereur à quarante ans passés!
Napoléon la rejoint le lendemain 12 octobre à Saint-Cloud ; l’empereur et l’impératrice partagent les mois d’octobre et de novembre entre les Tuileries et Saint-Cloud, tout aux préparatifs du prochain couronnement. C’est là où, se confiant à Roederer à propos des tensions entre Joséphine et la famille Bonaparte, il lui dit « Ma femme est une bonne femme qui ne leur fait point de mal. Elle se contente de faire un peu l’impératrice, d’avoir des diamants, de belles robes, les misères de son âge ! Je ne l’ai jamais aimée en aveugle. Si je l’ai faite impératrice, c’est par justice. Je suis surtout un homme juste. Si j’avais été jeté dans une prison au lieu de monter sur le trône, elle aurait partagé mes malheurs. Il est juste qu’elle participe à ma grandeur ». Mais il s’agit maintenant de recevoir dignement le Pie VII venu couronner Napoléon à Fontainebleau. Après une rapide remise en état, l’ordre de remeubler le vieux château est donné le 6 novembre et dès le 22, après avoir déployé des trésors d’imagination, tout est fin prêt. L’empereur, l’impératrice, les officiers et les dignitaires arrivent dans des appartements mal chauffés où flotte encore l’odeur de neuf et de peinture fraîche. C’est vraisemblablement au soir du 26 que Joséphine avoue en secret au Pape qu’elle n’est pas mariée religieusement ; elle s’interroge de savoir si son union n’existant pas devant Dieu, elle peut être couronnée par le souverain pontife. Atterré, Pie VII promet d’en parler à Napoléon, car pour lui pas de sacre sans mariage. Joséphine est soulagée ; à ses yeux cette bénédiction nuptiale éloigne définitivement l’ombre du divorce. Le retour aux Tuileries se fait au soir du 28 et le 1er décembre, veille du Sacre, le cardinal Fesch célèbre en secret aux Tuileries le mariage religieux de Napoléon et de Joséphine. Elle conservera toujours comme un véritable trésor le certificat établi le 27 décembre par Fesch, et jamais, quelques efforts que l’empereur ait pu faire pour le lui reprendre, elle ne consentit à s’en séparer.
Enfin le grand jour arriva. En ce 2 décembre, le temps était froid et brumeux. Joséphine est resplendissante et paraît selon les témoins plus jeune que son âge. Souriante et radieuse, elle était l’élégance et la majesté mêmes, et « jamais reine ne sut mieux trôner sans l’avoir appris ». Personne mieux que Mme Junot, la future duchesse d’Abrantès, n’a sur rendre le moment d’intense émotion qui passa entre ces deux êtres qui s’étaient élevés ensemble jusqu’au trône. Placée dans une travée du maître-autel, à l’étage supérieure, rien ne lui échappa : « Il [Napoléon] jouissait en regardant l’impératrice s’avancer vers lui et, lorsqu’elle s’agenouilla, lorsque les larmes, qu’elle ne pouvait retenir, roulèrent sur ses mains jointes qu’elle élevait bien plus vers lui que vers Dieu, dans ce moment où Napoléon, ou plutôt Bonaparte, était pour elle sa véritable providence, alors il y eut entre ces deux êtres une de ces minutes fugitives dans toute une vie et qui comblent le vide de bien des années. L’empereur mit une grâce parfaite à la moindre des actions qu’il devait faire pour accomplir la cérémonie. Mais ce fut surtout lorsqu’il s’agit de couronner l’impératrice. Cette action devait être accomplie par l’empereur, qui, après avoir reçu la petite couronne fermée et surmontée de la croix, qu’il faisait placer sur la tête de Joséphine, devait la poser sur sa propre tête, puis la mettre sur celle de l’impératrice. Il mit à ces deux mouvements une lenteur gracieuse qui était remarquable. Mais lorsqu’il fut au moment de couronner enfin celle qui était pour lui, selon un préjugé, son étoile heureuse, il fut coquet pour elle, si je puis dire ce mot. Il arrangeait cette petite couronne qui surmontait le diadème en diamants, la plaçait, la déplaçait, la remettait encore ; il semblait qu’il voulût lui promettre que cette couronne lui serait douce et légère ! ».
Hélas ! Cette couronne ne devait ni douce ni légère, car après cinq années d’un règne glorieux, comme se souvient Bausset, préfet du Palais, « elle descendit du premier trône du monde, mais elle n’en tomba pas, et présenta à l’Europe étonnée le spectacle d’un inconnu dévouement sans ostentation, et d’un oubli de soi-même le plus noble et le plus pur. Jamais elle ne fut entourée de plus d’hommages et de respects que lorsque, satisfaite d’avoir fait volontairement le sacrifice le plus pénible, elle vint se retirer sous les ombrages de la Malmaison ».
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
août 29, 2007
DOUCE ET INCOMPARABLE JOSEPHINE, IMPERATRICE DES FRANCAIS (1763-1814)
Joséphine était une femme des plus agréables. Elle était pleine de grâce, et femme dans toute la force du terme, ne répondant jamais d’abord que « non » pour avoir le temps de réfléchir. Elle mentait presque toujours, mais avec esprit. Je puis dire que c’est la femme que j’ai le plus aimée.
« Douce et incomparable Joséphine », l’expression est de Napoléon lui-même qui l’utilise dans une des toutes premières lettres qu’il lui adresse en 1795 ; lui seul réellement pouvait juger si elle était aussi « douce et incomparable » qu’il l’imaginait.
Il convient avant tout de faire une mise au point sur son nom réel. La plupart des gens la connaissent de nos jours sous le nom de Joséphine de Beauharnais, or stricto sensu, Joséphine de Beauharnais n’a jamais existé ! Cette affirmation demande une explication : elle est baptisée en 1763 sous le nom de Marie-Joseph-Rose de Tascher de la Pagerie et Rose est son prénom usuel qu’elle portera jusqu’à sa rencontre avec le futur empereur en 1795. Mais bien évidemment personne ne sait de nos jours qui est Rose de Beauharnais. C’est Napoléon lui-même qui décide de féminiser son prénom de Joseph en Joséphine et elle devient alors Joséphine Bonaparte, puis l’impératrice Joséphine. Au moment de son décès en 1814, les journaux royalistes annoncent la mort de Mme veuve de Beauharnais, comme si l’empereur n’avait jamais existé. On évacue alors le patronyme Bonaparte pour ressusciter celui de Beauharnais tout en conservant le prénom que Napoléon lui avait donné : ainsi naquit Joséphine de Beauharnais ! Je vous engage donc à ne plus la nommer ainsi, mais Joséphine Bonaparte ou l’impératrice Joséphine.
Elle naît à la Martinique en 1763, c’est-à-dire seulement huit ans seulement après la reine Marie-Antoinette, et lorsqu’elle épouse Napoléon, elle a déjà trente-trois ans et a vécu plus de la moitié de sa vie. Elle est donc une femme ancrée dans le XVIIIè siècle, ce qui lui permettra plus tard de jouer un rôle important dans la fusion des deux sociétés, celle issue de l’Ancien Régime et celle générée par la Révolution.
La famille de Tascher est d’antique noblesse, certains de ses membres ayant été chevaliers croisés auprès de Saint-Louis ; c’est en 1726 qu’une branche Tascher de la Pagerie vient s’installer à la Martinique. La petite Marie-Joseph-Rose trouve son île trop étroite et rêve d’aller à Paris. Ce rêve prend corps lorsqu’on la marie à l’âge de seize ans à Alexandre de Beauharnais, un époux qu’elle n’a quasiment jamais vu et qui va lui donner deux enfants, d’abord un fils, Eugène, en 1781, puis une fille, Hortense, en 1783. La suspicion et la jalousie maladive du mari débouchent très rapidement sur la séparation du couple qui intervient après la naissance d’Hortense ; Joséphine s’installe alors dans l’abbaye de Panthémont, rue de Grenelle, où les religieuses mettent des appartements à la disposition des femmes de distinction ; elle conserve alors la garde de sa fille. En 1788, elle décide de retourner en Martinique avec Hortense pour tenter de récupérer quelque argent auprès de son père. Elle y reste deux ans, lorsque les mouvements révolutionnaires ayant atteint les Antilles, elle rentre précipitamment en France en octobre 1790 pour découvrir qu’Alexandre est devenu un personnage en vue, bientôt Président de la Constituante. Sans reprendre la vie commune, elle se rapproche de cet époux influent, cherchant comme elle le fera toute sa vie à se rapprocher du pouvoir, non pas pour le plaisir de l’exercer, mais pour les facilités matérielles qu’il apporte. Dès lors, elle fréquente avec une grande insouciance les milieux politiques les plus contrastés, cherchant toujours à rendre service à son entourage. Mais la loi des suspects de septembre 1793 ordonnant l’arrestation des gens jugés dangereux, Alexandre est d’abord emprisonné, puis est rejoint par Joséphine en avril 1794. S’il est guillotiné quelques jours avant la chute de Robespierre, Joséphine échappe de justesse au supplice, mais restera marquée à tout jamais par cet enfermement, au cours duquel elle s’attendait chaque matin à entendre prononcer son nom sur la liste des condamnés.
A sa sortie de prison, elle devient avec Mme Tallien l’une des gloires de la société thermidorienne, se rapprochant du plus influent des directeurs, Barras dans le salon duquel elle rencontre un jeune général corse répondant au nom de Napoléon Bonaparte. Elle pense qu’à trente-deux ans passés, il serait convenable de se remarier pour assurer son avenir et celui de ses enfants. Ce jeune général semble avoir de l’avenir ; de plus il l’amuse et la croit très riche, ce qu’elle lui laisse croire. A ses yeux, ce n’est qu’un mariage de convenance, célébré un peu rapidement par un beau jour de mars 1796, dans lequel Joséphine trouve un protecteur et Napoléon une femme influente qui lui ouvre les portes de la société directoriale. Mais il s’avère que le mari est follement amoureux de son épouse, chose étrange pour une femme d’Ancien Régime, et qui lui semble du dernier bourgeois ! Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et s’amuse des lettres enflammées que lui envoie son mari. Elle y répond de temps à autre, mélangeant le « tu » et le « vous », ce qui ne manque pas d’irriter notre amoureux qui lui répond rageusement « vous toi-même » !
La vie agitée qu’elle mène à Paris la fait hésiter à le rejoindre en Italie, mais peu à peu elle se fait à l’idée que ce mari qu’elle a épousé un peu vite a un véritable avenir devant lui. Elle en prend réellement conscience lorsque le coup d’état de brumaire fait d’elle la première dame de France à l’âge de trente-six ans, avec le titre peu gracieux de consulesse, mais sans imaginer un seul instant qu’elle deviendra un jour impératrice.
Dès cette époque, l’épouse du Premier Consul s’investit dans de multiples tâches. D’abord sa grande connaissance des milieux aristocratiques lui permet d’aider au retour des émigrés et elle organise quasiment le bureau des radiations ; c’est grâce à son action qu’une grande partie de la noblesse d’Ancien Régime va se rallier à Bonaparte. Devenue impératrice des Français le 18 mai 1804, elle se glisse alors avec une aisance déconcertante dans ses nouveaux habits impériaux. Elle comprend immédiatement qu’elle succède à la reine Marie-Antoinette dans ce rôle, tient sa cour avec beaucoup de tact et de distinction et se met à protéger les artistes.
Elle aide d’abord les jeunes peintres et active le goût pour le Moyen-Age en leur commandant des tableaux retraçant l’histoire nationale. On fait généralement commencer la naissance de ce mouvement romantique avec la publication de Notre-Dame de Paris ou bien avec le patronage de la duchesse de Berry, alors que c’est Joséphine qui l’initie dès le début des années 1800. La plupart des thèmes abordés sont tristes et mélancoliques, liés à la mort, la séparation ou l’abandon, et se retrouvent dans sa collection de peintures modernes.
Elle développe également sa passion pour les antiques, réunissant une magnifique collection de deux cent cinquante vases grecs ou de bronzes provenant des fouilles d’Herculanum et de Pompéi, qui lui sont offerts par les souverains napolitains.
Pour enrichir ses collections, elle n’hésite pas à se servir dans les collections nationales, les limites du domaine public et du domaine privé n’étant pas alors aussi clairement définies que de nos jours. Aussi lui arrive-t-il de se servir parfois aussi bien dans les collections du musée des Monuments Français que dans celles du musée Napoléon, notre actuel musée du Louvre ! Elle n’hésite pas non plus à faire ôter les bas-reliefs de la laiterie de Rambouillet pour garnir sa chère Malmaison. Nous jugeons sévèrement ces comportements avec nos yeux du XXIè siècle, mais de telles pratiques étaient alors monnaie courante.
Joséphine recherche également des objets ayant appartenus à Louis XVI ou à Marie-Antoinette, comme des plaques en porcelaine de Sèvres provenant de leurs appartements de Versailles ; elle entre aussi en possession du guéridon livré par Sèvres à Mme du Barry. On retrouve là son attachement pour l’art de sa jeunesse, celui de la fin du XVIIIè siècle qui a marqué si fortement son goût.
Elle n’omet pas non plus de patronner la musique à l’instar de Marie-Antoinette. Afin de régénérer l’opéra français, la reine avait appelé à Paris le chevalier Gluck qui livra son premier opéra français, Iphigénie en Aulide ; parallèlement, Joséphine impose l’italien Spontini qui lui dédie la Vestale, premier grand opéra à la française, ancêtre des œuvres lyriques de la première moitié du siècle jusqu’à Berlioz.
Mais sa vraie passion va aux sciences naturelles, d’abord à la botanique, puis à la zoologie. La légende veut que le nom de Joséphine soit attaché aux roses. Tout ceci repose sur un malentendu qui s’appelle Redouté ! Le succès de son ouvrage sur les Roses, en a répandu la célébrité sur la terre entière, allant jusqu’à fasciner les Japonais qui en font un véritable mythe. En réalité, aux yeux de Joséphine, sa collection de roses n’a pas plus d’importance que ses pélargoniums ou ses bruyères. Et qui plus est, elle n’avait pas de roseraie ! Cette notion de roseraie ne remonte guère au-delà de la fin du XIXè siècle lorsque Jules Gravereaux réalise la première roseraie moderne à l’Haÿ-les-Roses. Sous l’Empire, les rosiers n’étant pas remontants et ne fleurissant donc qu’une fois l’an en mai et juin, sont placés dans des pots, sortis juste le temps de leur floraison. En vraie passionnée, elle connaît les noms latins des plantes qu’elle cultive, et ne dédaigne pas de correspondre directement avec les professeurs du Museum d’histoire naturelle qui la considèrent un peu comme faisant partie des leurs. Dans ses serres de Malmaison qui sont construites à grand frais, plus de deux cents plantes nouvelles fleurissent pour la première fois en Franc comme le camélia, le phlox ou le dahlia. Pour moitié avec un pépiniériste londonien, elle engage un jeune botaniste écossais qui herborise dans la région du Cap, en Afrique du sud, afin de lui fournir des plantes jusqu’alors inconnues comme les proteas et les erikas.
La zoologie ne la laisse pas indifférente. Elle profite de l’expédition aux Terres australes envoyée par le Premier Consul en 1800 et conduite par le capitaine Baudin, pour littéralement rafler les plus beaux sujets lorsqu’ils arrivent au port de Lorient. Le partage est inégal avec le Museum et Joséphine s’approprie le seul couple de cygnes noirs alors connus en Europe ; il s’acclimatera et se reproduira à Malmaison.
Les dettes sont intimement liées à la vie de Joséphine. Ses rapports avec l’argent ont toujours été à l’origine de terribles colères de la part de Napoléon. Elle oublie aussitôt ce qu’elle vient d’acheter, ce que Bourrienne relate joliment en écrivant que son plaisir n’était pas de posséder, mais d’acquérir. Combien de caisses réglées à force de larmes et jamais ouvertes, que ce soit à Malmaison ou à Saint-Cloud ; on en a même retrouvé sous Napoléon III dans cette dernière résidence, laissées là depuis un demi-siècle !
Joséphine a certes coûté très cher à la France, et certainement plus que la reine Marie-Antoinette, mais sa grande bonté et sa qualité de française lui ont épargné les foudres de ses sujets. On peut évaluer à cinquante millions de francs ce qu’elle a coûté à notre pays, sachant qu’à la même époque un garçon jardinier gagnait six cents francs par an ! Mais elle était la souveraine du pays le plus puissant et Napoléon avait souhaité que le commerce de luxe dépassât le niveau qui était le sien avant la Révolution. En réalité, il a été entendu au-delà de toute espérance et connaissant la propension de Joséphine à dépenser sans compter, il aurait dû être plus méfiant et ne s’en prendre qu’à lui-même.
Elle ne suit pas la mode, mais elle la créée, dépensant sans compter tant pour ses toilettes que pour ses bijoux. Son écrin est le plus riche d’Europe.
Tous les moyens lui sont bons pour se procurer de l’argent. Si Bonaparte avait accepté que les généraux s’enrichissent au moment du Directoire, il n’admet plus de malversations dès qu’il devient le chef de l’Etat. Or, Joséphine ne le comprend pas et continue de s’enrichir par des moyens peu honnêtes. Elle continue à s’impliquer dans les fournitures aux armées, n’hésitant pas à vendre des chevaux borgnes au prix de purs sangs. Elle va jusqu’à commettre ce qu’on appellerait de nos jours un délit d’initié ; informée avant tout le monde que la paix allait être signée avec l’Angleterre, elle s’acoquine aussitôt avec un agent de change, lui promettant de partager les bénéfices, ce qu’elle se gardera bien de faire. C’est seulement après la mort de l’Impératrice que le pauvre agent de change osa réclamer son dû au prince Eugène qui s’empressa de régler la dette de sa mère. Napoléon ne l’apprit jamais. Elle ne lui avouait d’ailleurs jamais la vérité, lui disant d’abord non pour se laisser le temps de la réflexion. Ensuite, elle consentait à lui révéler généralement la moitié de sa dette, ce qui le faisait immanquablement crier ; alors elle pleurait et il finissait toujours par payer, ne sachant pas résister aux larmes de Joséphine.
Le divorce a toujours été son épée de Damoclès ; il en est déjà question dès 1798 au moment de sa liaison probable avec le jeune Hippolyte Charles, puis peu à peu elle se rend compte qu’elle ne peut pas donner d’héritier à Napoléon. Elle avait réussi à le convaincre de sa stérilité, arguant la naissance de ses deux enfants, Eugène et Hortense. Si l’Empereur avait déjà eu un fils naturel en 1806, le futur comte Léon, il n’était pas totalement certain de sa paternité, la jeune femme ayant probablement partagé en même temps que Napoléon les faveurs de Murat. Mais sa rencontre avec Marie Walewska et la naissance de leur fils, Alexandre Walewski, le convainc définitivement de sa faculté de procréer. Il faut un héritier à l’Empire et sa décision de divorcer est alors arrêtée. Cette séparation est vécue comme une véritable épreuve par les deux époux ; le temps et des moments difficiles partagés ensemble avaient renforcé leur complicité ; ils s’étaient élevés ensemble jusqu’aux marches du trône. Elle partageait ses habitudes depuis si longtemps, et Napoléon savait qu’il allait devoir affronter une nouvelle épouse qui ne le connaissait pas. Cette séparation par consentement mutuel reste unique dans l’histoire de notre pays. Le jour de la cérémonie, devant la cour et la famille impériale assemblée, Napoléon fait cette déclaration stupéfiante lors d’un divorce : « Elle a embelli quinze ans de ma vie ».
Consciente de s’être sacrifiée au bonheur de la France, Joséphine vit ses dernières années dans une triste solitude. Elle conserve son titre d’impératrice, et Napoléon ne manque jamais de venir lui rendre visite, généralement une fois l’an, et toujours dans le jardin afin d’être vus de tous. Elle occupe son temps en voyageant beaucoup, principalement en Suisse et en Savoie où elle n’hésite pas à monter sur la mer de glace à Chamonix, accompagnée d’une véritable caravane d’environ quatre-vingts personnes ! Une autre année, elle se rend à Milan pour les couches de sa belle-fille, l’épouse d’Eugène, et surtout pour faire la connaissance de ses petits-enfants qu’elle n’a jamais vus. Les enfants d’Eugène feront de splendides mariages : l’un épousera la reine du Portugal, l’une sera impératrice du Brésil, et une autre deviendra reine de Suède en épousant le fils de Bernadotte. De cette dernière descendent actuellement les rois des Belges, de Norvège et de Suède, les reines des Hellènes et du Danemark et le grand-duc de Luxembourg, qui né prince de Bourbon-Parme, descend aussi bien de Joséphine que de Louis XIV !
A la fin de sa vie, Joséphine devient une grand-mère attentive et aimante ; ses petits-enfants comptent beaucoup pour elle, principalement les deux fils d’Hortense Napoléon-Louis et Louis-Napoléon qu’elle voit très souvent et qui passent régulièrement l’été à Malmaison. Le dernier, qui deviendra Napoléon III, fait sa joie ; surnommé Oui-Oui, il la ravit par ses bons mots et elle l’autorise même à couper les cannes à sucre de la serre chaude pour les sucer. Ces souvenirs d’enfance l’avaient tant marqués qu’il rachètera Malmaison en 1861 afin d’en faire un premier musée napoléonien.
Rentrée de Milan à l’automne 1812, elle apprend les nouvelles désastreuses de la campagne de Russie ; désormais, elle se terre à Malmaison et ne voyage plus. Elle part seulement quelques jours dans sa terre de Navarre, aux portes d’Evreux, à l’approche des armées alliées et y apprend l’abdication de Napoléon. Désormais l’épopée est terminée, elle ne peut compter que sur elle-même. Elle rentre alors à Malmaison, respectée de tous et principalement du tsar Alexandre ; ayant toujours besoin d’un protecteur, elle s’en rapproche comme elle l’avait fait précédemment plusieurs fois au cours de sa vie avec Alexandre de Beauharnais, Barras ou Napoléon. Le tsar sépare le sort des Beauharnais de celui des Bonaparte ; l’attitude de Joséphine et de ses deux enfants a toujours forcé son admiration tant par leur éducation que par leur fidélité à Napoléon, et de plus, le beau-père d’Eugène, le roi de Bavière, a épousé la sœur de la tsarine. La Restauration lui ayant conservé son titre d’impératrice, elle reçoit à Malmaison les souverains alliés comme le roi de Prusse ou le tsar de Russie et éclipse la cour des Tuileries ; Louis XVIII est veuf depuis longtemps et les Tuileries rappellent trop de souvenirs pénibles à sa nièce, la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, pour qu’elle y tienne une cour brillante. Ces mois d’avril et mai 1814 voient donc l’apothéose de Joséphine et elle a le bonheur de disparaître au bon moment, en pleine gloire, n’ayant certainement pas pu résister au-delà de la première Restauration. Au retour de Napoléon de l’île d’Elbe, elle n’aurait pu se tenir à l’écart des Cent-Jours, et elle aurait tout perdu après Waterloo, devant vraisemblablement s’exiler et quitter sa chère Malmaison. Elle a été le grand amour de Napoléon qui se rappelait à Sainte-Hélène que « c’était une vraie femme » et ajoutant que « Joséphine était la grâce personnifiée ».
© Bernard CHEVALLIER, directeur des châteaux de Malmaison et Bois Préau, du musée napoléonien de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à Ajaccio, conservateur général du patrimoine.
juillet 27, 2007
SOUVENIRS DICTES PAR MADAME MERE – LAETITIA BONAPARTE
Madame Mère, à la fin de sa longue existence dicta son autobiographie abrégée à sa dame de compagnie, mademoiselle Rosa Mellini. La dictée de ces souvenirs n’est d’ailleurs, que le récit sommaire de certains événements de la vie de la mère de l’empereur Napoléon Bonaparte, rappelés par elle avec une naïve et touchante simplicité. Ses courts Souvenirs comportent aussi de petites erreurs surprenantes (comme l’âge du décès de Charles Bonaparte).
A trente-deux ans, je restai veuve et Charles mourut à l’âge de trente-cinq ans, à Montpellier, victime de douleurs d’estomac, dont il se plaignait toujours, surtout après qu’il avait dîné.
Il avait été trois fois député en France, car ses rares qualités lui avaient attiré l’affection et l’estime de ses concitoyens.
En dix-neuf ans de mariage, je fus mère de treize enfants dont trois moururent en bas âge (et deux en naissant).
Charles était fils unique comme moi, lorsque nous nous mariâmes ; il avait sa mère et trois oncles, savoir l’archidiacre Lucien, Joseph, et Napoléon.
Devenue mère de famille, je me consacrai entièrement à la bonne direction de celle-ci et je ne sortais de chez moi que pour aller à la messe. J’entends qu’une des obligations du vrai chrétien soit d’aller à l’église, tous les jours et indispensablement des jours de fêtes ; mais je crois pourtant que l’église n’exige pas, dans les jours de travail, que les personnes qui se trouvent à la tête des affaires et surtout les mères de famille doivent perdre la plus grande partie du jour, hors de chez elle. Ce serait interrompre le cours régulier des affaires et se rendre coupable envers Dieu des graves inconvénients qui surviennent, bien souvent dans les familles, en l’absence du chef.
D’ailleurs ma présence était nécessaire pour mettre un frein à mes enfants tant qu’ils furent petits.
Ma belle-mère et mon mari étaient si indulgents à leur égard, qu’au moindre cri, la moindre réprimande, ils accouraient à leur aide, faisant mille caresses. Pour moi, j’étais sévère et indulgente, en temps voulu. Aussi étais-je obéie et aimée de mes enfants, qui, même après avoir grandi, m’ont toujours témoigné, dans tous les temps, le même amour et le même respect.
Ma belle-mère était si bonne que, toutes les fois que je relevais de couches, elle se faisait l’obligation d’entendre une messe de plus, de sorte qu’elle en arriva au point d’entendre neuf messes par jour !
De tous mes enfants, Napoléon, dès ses premières années, était le plus intrépide. Je me souviens que, pour donner un foyer à leur ardeur extraordinnaire, j’avais dû démeubler une grande chambre, où, dans les heures de récréation et de mauvais temps, il leur était permis de s’amuser, à leur gré.
Jérôme et les trois autres s’occupaient à sauter ou à dessiner des pantins sur le mur. Napoléon, à qui j’avais acheté un tambour et un sabre de bois, ne peignait que des soldats toujours rangés en ordre de bataille.
Dès ses premières années, il montra un goût particulier pour l’étude des nombres, au point que certaines soeurs ou béguines lui donnèrent le nom de mathématicien et le régalaient toujours de confitures. Un jour qu’il les rencontra sur la place Saint-François, il se mit à courir vers elles, en s’écriant Celui qui veut savoir où est mon coeur, le trouvera au milieu des seins des soeurs. La soeur Orto, femme grasse, avec de mauvaises jambes, la réprimanda, mais, à la fin, elle dut céder et lui adoucir la bouche, pour le faire taire.
Devenu un peu plus grand, je le faisais accompagner à l’école des jésuites et je lui donnais un morceau de pain blanc pour son déjeuner. Un jour on vint me rapporter que M. Napoléon avait été rencontré, plus d’une fois, dans la rue, en mangeant du pain de munition, chose qui ne convenait pas à un enfant de sa condition. Je le réprimandai fortement et il me répondit que, tous les matins, il échangeait son morceau de pain contre celui d’un soldat, puisque devant, lui aussi, être soldat, il était convenable qu’il s’accoutumât à manger de ce pain, que d’ailleurs il préférait au pain blanc.
A huit ans, il prit tellement goût à l’étude et particulièrement à l’arithmétique, qu’il fallut lui construire une espèce de petite chambre, en planches, sur la terrasse de la maison, où il se retirait tout le jour, afin de ne pas être troublé par ses frères. Le soir, seulement, il sortait, un moment et marchait en distrait, dans les rues, sans avoir fait sa toilette et oubliant toujours de remonter ses bas tombants. D’où vient le dicton répété aujourd’hui même, quelquefois, à Ajaccio : Napoléon à la michaussette, fait l’amour à Jacquelinette.
A ce même âge de huit ans (c’était un jour de fête, le 5 mai), notre fermier d’affaires étant venu en ville, avec deux jeunes et vigoureux chevaux, Napoléon attendit le moment du départ, monta lui-même sur l’un de ces deux chevaux et, nouvel Alexandre, galopait toujours en avant du fermier, qui tremblant de frayeur, l’exhortait à s’arrêter. Il arriva ainsi à destination et descendit de cheval, en riant beaucoup de la peur du fermier.
Avant de partir, il observa attentivement le mécanisme d’un moulin, alors en mouvement ; il alla reconnaître le volume d’eau qui le mettait en mouvement, demanda au fermier quelle était la quantité de blé moulue, pendant une heure, et prenant des notes sur tout, il ajouta, peu de temps après, que son moulin devait moudre, en un jour, une telle quantité de blé et, en une semaine, une telle autre quantité. Le fermier fut étonné par l’exactitude du calcul et, revenu en ville avec Napoléon, il me dit que si Dieu accordait longue vie au petit monsieur, il ne manquerait pas de devenir le premier homme du monde.
Je ne me suis jamais laissé faire illusion sur les grandeurs et les flatteries de la cour, et si mes fils avaient donné plus d’attention à mes paroles, ils se trouveraient mieux qu’ils ne le sont actuellement.
Tout le monde m’appelait la mère la plus heureuse de l’univers, tandis que ma vie a été une continuité de chagrins et de martyres. A chaque courrier qui arrivait, je craignais toujours qu’il m’apportât la funeste nouvelle de la mort de l’empereur, sur le champ de bataille.
Lorsque nous étions à Porto-Ferrajo, l’empereur me parut un soir, plus gai que de coutume ; il m’invita, ainsi que Pauline, à faire une partie d’écarté. Un moment après, il nous quitta et alla se renfermer dans son cabinet. Voyant qu’il ne revenait plus, j’allai chez lui, pour l’appeler et le chambellan me dit qu’il était descendu dans le jardin. je me souviens que nous étions dans une des plus douces soirées du printemps ; la lune brillait au dessus des arbres, et l’empereur se promenait seul, à pas précipités, le long des allées du jardin. Tout à coup il s’arrêta et, appuyant sa tête contre un figuier : Et pourtant il faudra bien que je le dise à ma mère !… s’écria-t-il. A ces mots, je m’avance et avec l’accent de la plus vive impatience : Et bien, lui dis-je, Qu’avez-vous donc, ce soir, car je vous vois beaucoup plus pensif qu’à l’ordinaire ?
L’empereur la main sur le front et, après un moment d’hésitation, me répond : Oui, il faut que je vous le dise, mais je vous défends de le répéter à qui que ce soit, ce que je vais vous confier, pas même à Pauline. Il sourit, m’embrasse et reprend : Et bien, je vous préviens que je pars, cette nuit. -Pour aller où ?- A Paris, mais, avant tout, je vous demande votre avis ? -Ah ! permettez que je m’éfforce d’oublier, pour un instant, que je suis votre mère. Je réfléchis et j’ajoutai : Le ciel ne permettra pas que vous mouriez, ni par le poison, ni dans un repos indigne de vous, mais l’épée à la main.
Marie-Louise était insipide à voir de près, ou à entendre, lorsqu’elle parlait ; mais elle écrivait très bien. Il est inexact que l’empereur ait fait préparé pour elle, à Paris, un appartement identique à celui qu’elle occupait à Vienne. Ce fut Caroline qui alla au devant d’elle et l’accompagna en France. L’empereur alla à a rencontre et ce fut moi qui l’a reçu, pour la conduire à son appartement. Le cardinal, mon frère, les unit par mariage.
Au baptème du petit Napoléon, l’empereur d’Autriche fut le parrain et je fus la marraine.
A notre dernier départ de Paris, Marie-Louise me dit : Je désire que vous veniez avec moi en Autriche. Je la remerciai et lui répondis que je ne me séparais jamais de mes enfants. A la mort du petit Napoléon, elle m’écrivit une lettre de condoléance, mais je ne lui ai pas répondu.
Ma vie finit avec la chute de l’empereur. A dater de ce moment, je renonçai à tout, pour toujours. plus de visites dans aucune société ; plus de théâtre, qui avait été mon unique distraction, dans les moments de mélancolie. Mes enfants et mes neveux m’ont toujours prié d’aller au théâtre, je m’y suis toujours refusée, en regardant leur invitation comme une injure. Ils n’ont jamais pu comprendre, comme moi, la profondeur de l’humiliation dans laquelle ils sont tombés par la mort de l’empereur.
Lien : Biographie de Madame Mère
juillet 25, 2007
CHARLES BONAPARTE PAR NASICA (2)
Charles Bonaparte depuis la conquête de l’île de Corse jusqu’à sa mort (1785)
Fiers et impétueux sur le champ de bataille, les français sont magnanimes et indulgents après la victoire. Satisfaits d’avoir vaincu des ennemis dignes sous tant de rapports de se mesurer à eux, ils accordèrent une amnistie ample et loyale à tous ceux qui ne refusèrent pas de se soumettre à la nouvelle domination.
La politique ombrageuse et cuelle de Gênes avait soigneusement exclu les Corses de tous les emplois de leur pays ; la politique sage et généreuse de la France voulut obtenir le concours des plus notables de l’île en les y appelant. Charles Bonaparte entre autres fut nommé assesseur à la justice royale d’Ajaccio. Il hésita d’abord à accepter cette place par suite d’une répugnance patriotique, mais les sollicitations de ses amis et de ses parents prévalurent.
Cependant la frayeur de la domination française se dissipait de jour en jour. Les illusions de l’indépendance nationale s’évanouirent avec le temps ; le sentiment de la liberté se refroidissait dans les coeurs ; le joug de l’étranger paraissait s’adoucir insensiblement par l’habitude de le porter, par l’impuissance de le sécouer et par la grandeur du nom de la France. Charles pourtant en gémissait au fond de son âme ; il voyait avec peine la résignation trop facile de ses concitoyens. Dans un moment de dégoût et de noble indignation, il composa la chanson satirique Pastorella infida sei, ou Paoli, sous l’allégorie d’un berger, se plaint amèrement de la Corse, comme d’une maîtresse infidèle. La jeunesse de l’ïle apprit la chanson et resta française.
En dépit de ses regrets cachés et de son amitié constante pour Paoli, Charles se concilia l’estime des Français. Le comte de Marbeuf surtout le traita toujours avec une bienveillance toute particulière. Ses talents, ses manières, sa position sociale et la haute réputation dont il jouissait lui valurent cette flatteuse distinction. Charles ne pouvait pas être insensible à tant d’égards ; il paya de retour le gouverneur français. On a pris texte de cette cette liaison pour répandre les calomnies les plus absurdes : un simple rapprochement des dates suffit pour en faire justice.
Charles Bonaparte, qui aimait le luxe et la représentation, dépensait parfois au delà de ses revenus. Cependant sa famille devenait chaque jour plus nombreuse, et, comme s’il en pressentait déjà la grandeur future, il se proposait de donner une éducation soignée à tous ses enfants. Prêt à s’imposer tous les sacrifices possibles pour atteindre un but si légitime, et si sage, il songeait sérieusement à envoyer dans des établissements d’instruction publique l’aîné et le cadet de ses fils, qui étaient assez avancés en âge pour commencer régulièrement leurs classes. Ce fut alors que Marbeuf voulut lui donner une preuve certaine de l’attachement qu’il lui avait voué. Il lui suggéra l’idée de faire des démarches afin d’obtenir les bourses du gouvernement pour Joseph et pour Napoléon. Il appuya lui-même fortement sa demande, et les bourses furent accordées.
Charles avait toujours espéré pouvoir améliorer sa fortune par la revendication de la succession Odone, qui lui était dévolue et dont on avait injustement disposé en faveur des Jésuites. Il avait fait plusieurs réclamations, du temps de Paoli, mais toujours sans succès. Après la conquête de l’ïle, qui entraîna l’explusion des jésuites, ces biens furent affectés à l’instruction publique. Charles renouvela ses réclamations qui ne furent pas plus heureuses. Comme il l’a dit lui-même, il continua de s’épuiser en démarches inutiles.
En 1777, Charles fut nommé député de la noblesse pour aller à Paris. Il passa par Florence, où il obtint une lettre du Grand-duc Léopold pour la reine de France, sa soeur. Cette recommandation lui valut l’honneur d’être admis à la cour et un libre accès au ministère. Monseigneur Santini, qui, par son rang aurait dû conduire la députation corse, se trouva en seconde ligne. Il eut le bon esprit de ne pas s’en fâcher.
Charles profita de la faveur dont il jouissait pour faire de nouvelles démarches au sujet de la succession Odone. Il présenta au ministère de la guerre un mémoire détaillé sur les droits qu’il avait à cette succession. Des ordres précis furent donnés ; il aurait obtenu enfin la justice qu’il réclamait depuis longtemps, sans les difficultés que lui suscitèrent en Corse quelques fonctionnaires intéressés personnellement à faire éliminer sa demande.
Dans cette intervalle, les premiers symptômes de la maladie qui devait conduire au tombeau Charles Bonaparte se déclarèrent. Il se rendit à Montpellier pour consulter la faculté de médecine et revint à Paris mieux portant, ce qui lui fit croire qu’il était sauvé. Vaine espérance qui devait bientôt être détruite !
Ce fut pareillement à cette époque que Charles acquis de nouveaux titres à la bienveilance du Comte de Marbeuf. Des mésintelligences existaient entre ce dernier et le comte de Narbonne. Les Corses, dont la destinée se ressentira toujours des caprices, des haines et des vengeances mutuelles de leurs chefs, étaient partagés entre deux factions ; car ils ignoraient alors, comme ils semblent ignorer encore aujourd’hui, que ce qu’ils ont de mieux à faire, c’est de demeurer étrangers aux démélés de leurs gouvernants, d’avoir autant de respects pour les lois que de mépris pour ceux qui les foulent aux pieds et les font servir à leurs mauvaises passions.
Les choses en étaient au point que la cour jugea à propos de rappeler l’un des deux ; mais elle aurait voulu rappeler celui qui avait le plus de torts à se reprocher, et qui, dans tous les cas, était le moins agréable aux Corses. Charles fut consulté, et le rappel de Narbonne arrêté. En cela Charles ne fut que l’interprète des sentiments bien prononcés de ses commettants, qui, tous, ou presque tous, préféraient les manières affables, insinuantes et populaire de Marbeuf, aux manières franches, loyales si l’on veut, mais rudes et hautaines de Narbonne.
Cependant, si celui-ci avait un faible parti en Corse, il en avait en revanche un bien puissant à la cour : Marbeuf, qui le savait, s’attendait à lui être sacrifié. Victorieux, il sentit toute l’étendue de l’obligation qu’il avait envers celui qui le faisait triompher d’un rival redoutable. La famille de Marbeuf lui fut dès ce moment très attachée, et trouva plus d’une fois l’occasion de lui être agréable.
L’archevèque de Lyon lui écrivit pour le remercier de ce qu’il avait fait en faveur de son oncle et lui envoya en même temps une lettre de recommandation pour M. de Brienne, sachant qu’il avait un de ses enfans à l’Ecole militaire de Brienne. Cette recommandation fut très utile à Napoléon, puisque la famille Brienne eut pour lui un attachement tout particulier : elle ne contribua pas peu à le faire remarquer de bonne heure aux inspecteurs, qui tous les ans visitaient l’école.
Les relations de la famille Bonaparte avec la famille Marbeuf furent dès lors plus intimes, plus amicales. Ceux qui ne voient les choses que de loin, ou se soucient fort peu de les voir de près, font remonter cette intimité à une époque à laquelle ces deux familles ne se connaissaient nullement, et se trouvaient d’ailleurs, par leurs positions respectives, placées dans des rangs opposés. Napoléon disait lui-même dans son exil, sur le rocher de Sainte-Hélène, que c’était de cette époque que daitait la bienveillance des familles Marbeuf et Brienne envers les enfants Bonaparte.
Charles fut obligé de rentrer en Corse plus tôt qu’il n’aurait désiré, la maladie dont il était atteint faisaint des progrès effrayants sous le ciel de Paris. Les médecins qu’il consulta pour la seconde fois, lui conseillèrent de rentrer au plus vite chez lui ; l’air natal pouvait seul lui apporter quelque soulagement. Il ramena avec lui Joseph, qui était placé dans le séminaire d’Autun, et pour lequel il venait d’obtenir une place à l’école militaire de Metz. Napoléon qui l’attendait à Brienne, en fut d’abord désolé ; mais il ne s’en plaignit point et fut au contraire satisfait du prompt retour de son père à Ajaccio, dès qu’il sut que l’état de sa santé l’avait empêché de venir le voir à Brienne, comme il le lui avait promis.
Quoique Charles fût après son retour lié plus que jamais au comte de Marbeuf, aussi puissant en Corse qu’il l’était à la cour, il ne cessa d’éprouver des désagréments de la part des créatures du comte de Narbonne, qui ne pouvaient lui pardonner la préférence qu’il avait accordé au premier. Ils lui suscitaient toute sorte de difficultés pour le faire échouer dans la revendication des biens de la succession Odone. Ils étaient d’autant plus à craindre, qu’étant du continent, ils avaient tous des patrons à Paris, qui les soutenaient en dépit des réclamations les plus vives et les plus fondées.
Voyant enfin qu’il ne pouvait pas venir à bout de surmonter les obstacles qu’une chicane déloyale élevait sans cesse contre lui, il se détermina, pour en finir, à demander à bail emphytéotique une portion des biens de la succession Odone. Cette demande parut d’abord déjouer les intrigues et les cabales de ses ennemis ; mais elle fut bientôt paralysée par les retards que la mauvaise volonté mit à en règler la redevance.
Toutes ces tracasseries incitèrent Charles à partir pour Paris, et à porter lui-même ses réclamations au ministère, au pied du trône s’il le fallait. La traversée fut pénible, sa maladie s’éveilla tout à coup, s’annonçant avec des symptômes alarmants. Il fut obligé de s’arrèter à Montpellier, mais il se hâta, quoique dangereusement malade, d’adresser au ministère un Mémoire contenant ses griefs.
Ce Mémoire, fait pour ainsi dire au lit de mort, ne sera pas tout à fait indifférent pour ceux qui attachent un certain intérêt à connaître le père de Napoléon.
MEMOIRE : Pour régler la redevance du bail elmphytéotique de la campagne dite Les Milelli, et la maison La Badine, appartenant autrefois aux Jésuites d’Ajaccio en Corse.
Monseigneur, Charles de Bonaparte, d’Ajaccio en Corse, a l’honneur de vous représenter qu’ayant été prévenu par une lettre de l’Intendance du 12 novembre dernier qu’il vous avait plu d’ordonner une expertise des biens ci-dessus demandés par le suppliant en bail emphytéotique, il attendait d’en être instruit par le sieur Souiris, économe sequestre et subdélégué de monsieur l’Intendant ; mais voyant que, malgré les ordres reçus, le sieur Souiris observait le plus profond silence pour conserver le plus longtemps possible la possession et jouissance des biens dont il se regarde comme propriétaire depuis tant d’années, il prit le parti de lui présenter une requête de la teneur suivante :A monsieur Souiris, économe des bien de l’Instruction publique et subdélégué de la juridiction d’Ajaccio.
Monsieur, Charles de Buonaparte a l’honneur de vous représenter que, depuis l’année 1779, il présenta un Mémoire au ministère de la guerre, en lui exposant qu’il était le seul héritier de Virginie Odone ; que ladite Virginie, ses enfants et héritiers, étaient appelés à la succession de Pierre Odone, son père, qui par son testament avait substitué tous ses biens à ladite Virginie, sa fille, et à ses enfants, au cas que Paul-Emile, son fils, vint à mourir sans enfants, ou que les enfants nés du dit Paul-Emile mourussent eux-même sans laisser de postérité ; que le cas prévu par le testament était arrivé ; que Paul-François Odone, méconnaissant le droit de la nature; enivré d’un faux principe de religion, avait donné aux Jésuites d’Ajaccio les biens grévés de la dite substitution fidéi-commissaire, dévolus de toute justice à la famille Bonaparte ;
Que la prise de possession faite par les Jésuites dénotait assez les biens considérables dont la dite famille avait été privée ; que l’Instruction publique était à la vérité censée propriétaire des dits biens, mais que l’utilité d’une pareille destination ne pouvait pas couvrir le vice de son titre ;
Que pour éviter les suites toujours funestes d’un procès en justice réglées vis-à-vis des économes qui plaideraient aux frais de l’Instruction, il s’était borné à demander une indemnité proportionnée à sa privation, justifiée par les titres qu’il avait produits ;
Que Monseigneur le prince de Montbarey avait renvoyé la requête et les titres aux commissaires du roi en Corse, et qu’après trois années de débats avec l’économe général, le suppliant, pour voir la fin de ses démarches, s’était restreint, du consentement de monsieur l’Intendant, à demander la préférence d’un bail emphytéotique de la campagne dite de Milelli, et de la maison La Badine, moyennant une légère redevance ;
Que monsieur l’Intendant, en 1782, avait formé son rapport, et que finalement il vous avait plu, Monseigneur, d’accorder au suppliant, par préférence, le bail emphytéotiquedes biens dont il s’agit, vous réservant d’en fixer la redevance après en avoir reconnu la valeur ; que le remontrant vous avait réitéré ses instances pour obtenir la jouissance provisoire, afin de procéder aux réparations urgentes, mais que monsieur le Changeur subdélégué général venait de lui faire part qu’il vous avait plu de décider qu’il était plus expédient de le mettre en possession des dits biens, que d’en accorder la jouissance provisoire ; que vous aviez autorisé à cet effet monsieur l’Intendant à faire procéder à l’estimation, le chargeant de faire terminer cette opération le plus promptement possible ;
Qu’il paraîssait nécessaire de faire procéder par des experts publics à l’estimation des biens fonds, en faisant détailler leur état, soit par rapport aux deux maisons délabrées et menaçant ruine, soit par rapport à la campagne, qui était exposée aux incursions des bestiaux et remplie de makis de toutes parts ; comme aussi de faire procéder à la liquidation des fruits et revenus, année commune, déduction faite des frais de culture et entretien, qui absorbent la meilleure partie du revenu ;
D’avoir égard au défaut du moulin à huile de la dite campagne, qui a été aliéné et qui occasionnera une dépense de deux mille livres pour en faire venir un de Marseille, comme aussi que les maisons sont presque sans portes, sans fenètres, san planchers, et sans crépissage ;
Qu’il est nécessaire, eu égard à la situation des biens, d’achever cette opération le plus promptement possible, pour mettre le suppliant à portée de recueillir le fruit de la justice que vous aviez eu la bonté, Monseigneur, de lui rendre et qu’il espérait obtenir complète au moyen d’une redevance légère et proportionnée aux privations dont sa famille avait été la victime ;
Finalement, il le priait de joindre la requête au procès-verbal d’expertise, pour qu’il pût en prendre une copie légale et en faire part au ministère ;
Que cette requête, Monseigneur, au lieu de produire l’effet qu’on devait en attendre, décida le sieur Souiris à s’acharner plus fortement contre le suppliant, qui s’est épuisé en démarches inutiles pour parvenir à faire exécuter votre volonté ;
Qu’enfin les experts nommés, le sieur Souiris, jouant le rôle de juge et partie, ne voulut point des experts publics, mais il nomma le médecin Grecque, son intime ami, auquel il délivra une instruction secrète sur la manière dont on devait rédiger l’expertise, afin de n’être jamais d’accord ;
Que les experts n’ayant pas été d’accord, le suppliant laissa au sieur Souiris le choix du troisième, pourvu qu’il fût pris parmi les gens du métier ; mais il répondit qu’il fallait en écrire à Bastia au subdélégué général. Cette réponse de Bastia ne venait jamais, et à force de réclamations, le sieur Changeur nomma pour troisième le sieur Frère, géomètre du terier, absent d’Ajaccio.
Le suppliant, voyant alors qu’il était joué de toute part, se décidé à s’embarquer pour venir à Paris se jeter à vos pieds, et il a eu le malheur de tomber malade dans la traversée de la mer, et d’être obligé de s’arrêter à Montpellier pour le rétablissement de sa santé.
Il s’est efforcé de vous adresser le présent Mémoire, parce qu’il est persuadé qu’aussitôt qu’on aura su qu’il est tombé malade, on fera achever l’opération au gré du sieur Souiris, qui espère que les biens finiront pas lui être adjugés, si on règle une redevance au delà du produit.
Ce Mémoire produisit son effet. Le ministère ordonna que l’exposant fût mis en possession des biens réclamés ; mais Charles n’existait plus lorsque cet ordre fut mis à exécution par ses ennemis : il était mort à Montpellier d’un squirre à l’estomac, cause de ses souffrances depuis plusieurs années.
Joseph, que Charles avait amené avec lui pour le conduire à Metz, fut le seul qui l’assista dans ses derniers moments. Son beau-frère, l’abbé Fesch, accouru à son secours du séminaire d’Aix, n’arriva que pour pleurer avec Joseph sur son cerceuil. Pendant son agonie, Charles appelait souvent napoléon, son fils, le conjurant d’aller à son secours avec sa grande épée.
Après lui avoir rendu les derniers devoirs, Fesch revint à Aix, Joseph rentra en Corse. Napoléon reçut la fatale nouvelle à Paris, où il avait été transféré par les inspecteurs, qui avait apprécié de bonne heure ses talents et son génie. Lorsque sa douleur fut un peu calmée, il écrivit à son oncle l’archidiacre Lucien, et à sa mère les deux lettres suivantes.
Paris, le 28 mars 1785
Mon cher oncle,
Il serait inutile de vous exprimer combien j’ai été sensible au malheur qui vient de nous arriver. Nous avons perdu en lui un père, et Dieu sait quel était ce père, sa tendresse, son attachement ; hélas ! tout nous désignait en lui le soutien de notre jeunesse. Vous avez perdu en lui un neveu obéissant, reconnaissant… ah ! mieux que moi vous sentez combien il vous aimait. La patrie même, j’ose le dire, a perdu par sa mort un citoyen zélé, éclairé et désintéressé. Cette dignité dont il a été plusieurs fois honoré marque assez la confiance qu’avaient en lui ses concitoyens. Et cependant le ciel l’a fait mourir ; en quel endroit ? à cent lieues de son pays, dans une contrée étrangère, indifférente à son existence, éloigné de ce qu’il avait de plus précieux. Un fils, il est vrai, l’a assisté dans ce moment terrible ; ce dut petre pour lui une consolation bien grande, mais certainement pas comparable à la triste joie qu’il aurait éprouvée s’il avait terminé sa carrière dans sa maison, près de son épouse et au sein de sa famille. Mais l’Être Suprême ne l’a pas ainsi permis : sa volonté est immuable, lui seul peut nous consoler. Hélas ! du moins, s’il nous a privé de ce que nous avions de plus cher, il nous a encore laissé les personnes qui seules peuvent le remplacer.
Daignez donc nous tenir lieu du père que nous avons perdu. Notre attachement, notre reconnaissance seront proportionnés à un service si grand. je finis en vous souhaitant une santé semblable à la mienne.
Votre très humble et très-obéissant serviteur et neveu.
NAPOLEONE DE BUONAPARTE
Paris, le 29 mars 1785
Ma chère mère,
C’est aujourd’hui, que le temps a un peu calmé les premiers transports de ma douleur, que je m’empresse de vous témoigner la reconnaissance que m’inspirent les bontés que vous avez toujours eues pour nous. Consolez-vous, ma chère mère ; les circonstances l’exigent. Nous redoublerons nos soins et notre reconnaissance, et heureux si nous pouvons, par notre obéissance, vous dédommager un peu de l’instimable perte d’un époux chéri. Je termine, ma chère mère ; ma douleur me l’ordonne, en vous priant de calmer la vôtre. Ma santé est parfaite et je prie tous les jours que le ciel vous en gratifie d’une semblable. Présentez mes respects à Zia Geltrude, Minana Saveria, Minana Fesch, etc.
PS : La reine de France est accouchée d’un prince, nommé le duc de Normandie, le 27 mars, à 7 heures du soir.
Votre très humble et affectionné fils,
NAPOLEONE DE BUONAPARTE
Charles méritait bien les regrets de son fils; il emportait ceux de ses concitoyens et de tous ceux qui l’avaient connu. Il était bon patriote, bon époux, excellent père, loyal, franc et sincère ami. Il ne laissa pas à ses enfants une grande fortune, mais il leur léguait en revanche une réputaiton pure et intacte. Sa passion pour la dépense avait sans doute un peu dérangé ses affaires, mais elle ne l’avait pas ruiné comme on a osé le dire.
Madame Bonaparte sentit plus que personne la perte qu’elle avait faite. Sa douleur fut extrême ; cependant elle n’oublia pas qu’elle était la mère d’une nombreuse famille, qu’elle se devait tout entière à ses enfants. Ses larmes coulèrent longtemps, mais son parti fut bientôt pris. Quoique à la fleur de l’âge, elle avait donné donné le jour à treize enfants, dont cinq garçons et trois filles avaient survécu. Jérôme était encore au berceau.
Le monde n’eut plus de charmes pour elle ; le souvenir de son époux et l’éducation de ses enfants remplirent toute son existence. Elle vécut dans la retraite et n’eut d’autres soins que le retablissement de ses affaires domestiques. Son guide, son appui, son soutien, c’était l’archidiacre Bonaparte, son oncle. Ce respectable vieillard s’était dessaisi depuis plusieurs années de l’administration des affaires de la famille pour se livrer entièrement à son ministère ; mais, dans une telle conjoncture, il n’hésita pas à en reprendre le fardeau. La maison Bonaparte ne tarda pas à se ressentir de l’habilité de la main qui la dirigeait.
Une bonne partie de la fortune de la famille Bonaparte se composait de gros et menu bétail ; l’autre de vignes, enclos et maisons. Les colons, bergers, les locataires, furent mandés ; l’archidiacre prit connaissance de tout et rétablit le plus grand ordre dans ces affaires.
Madame Bonaparte trouva dans les soins affectueux de son oncle un adoucissement à ses chagrins. La mort, qui avait empoisonné sa vie en moissonnant trop tôt celle de son mari, respecta aussi longtemps qu’il fallait les jours de son mentor. Lorsqu’il descendit dans la tombe, ses larmes coulèrent à nouveau, son coeur saigna encore, sa situation de fortune singulièrement améliorée : elle se résigna et attendit.
juillet 24, 2007
CHARLES BONAPARTE PAR NASICA (1)
Ecrite entre 1821 et 1829 (mais publiée qu’en 1852), cette Notice sur la vie de Charles Bonaparte père de Napoléon 1er est la première ébauche de « biographie » réalisée sur le géniteur du plus célèbre personnage de l’Histoire. Elle est proposée dans l’ouvrage de Tomaso Nasica : Mémoire sur l’enfance et la jeunesse de Napoléon 1er. Ce petit livre est désormais quasi introuvable et présente un certain intérêt de par la proximité temporelle de son auteur avec les contemporains de Charles Bonaparte. Cependant il ne peut être considéré comme une source totalement fiable. La légende hagiographique teintée de naiveté l’emporte sur les aspects scientifiques par trop absents de l’ouvrage. Malgré ses défauts, ce récit bien écrit, fort agréable à lire, est assez instructif si l’on sait le manier avec précautions.
Charles Bonaparte et sa famille avant la conquête de la Corse par la France (1769).
Les Bonaparte étaient considérés comme une des familles les plus distinguées d‘Ajaccio à l’époque où Charles Bonaparte, père de Napoléon, attira sur lui l’attention de ses concitoyens par ses qualités morales et par ses talents. Né en 1746, il commencça ses études à Corte et se fit remarquer par son intelligence, sa modestie, et son amour du travail. Privée de tout établissement scientifique par les Génois, dont l’esprit ombrageux redoutait les effets de l’éducation sur un peuple qui supportait déjà si impatiemment leur joug, la Corse envoyait les plus nobles de ses enfants faire leurs études en Italie. La proximité de la ville de Pise, et peut être aussi la sympathie douloureuse que font naître entre les peuples des infortunes qui se ressemblent, attiraient les Corses vers l’Université célèbre qui avait fondée Côsme de Medicis. Pise était alors l’Athènes de la péninsule italienne. Comme la célèbre ville grecque, elle gisait à demi morte sous ses marbres, au milieu des restes magnifiques d’une grandeur qui n’était plus. La fameuse république de Pise, qui avait subjugué la Sardaigne, pris Carthage et enlevé Palerme aux Sarrasins, qui avait défait des armées royales en bataille rangée, et envoyé une flotte de quarante vaisseaux au secours d’Amaury, roi de Jérusalem ; Pise enfin, qui avait fait longtemps avec succès la guerre aux Génois, ces ennemis mortels et détestés des Corses, avait fini par être vendue et livrée. Les Pisans avaient tellement pris à coeur la perte de leur liberté qu’ils s’étaient expatriés de colère ; aussi cette pauvre cité se trouvait-elle si dépeuplée à l’époque dont nous parlons, que l’herbe croissait dans ses larges rues. Tel était à peu près le sort que la Corse avait eu elle-même à subir.
C’est donc à Pise que Charles Bonaparte fut envoyé pour terminer ses études. Il trouva sur les bords de l’Arno l’élite de la jeunesse corse, jeunesse impétueuse et fière qui sympathisait avec celle de Pise et qui avait acquis, au contact des douces moeurs italiennes, ce poli d’urbanité qu’on ne trouve aisément dans les montagnes.
Ces pauvres insulaires, forcément économes, vivaient de peu dans une ville où tout était bon marché, et quelquefois éprouvaient, malgré cela, des moments de gêne. Mais lorsque les galions de quelques étudiants arrivaient, comme disait plaisamment l’Empereur en parlant de quelques cent francs que Junot recevait de sa famille, l’heureux possesseur du petit trésor se hâtait d’en faire part à ceux qui attendaient encore cette pluie d’or qui devait venir des rives de la Corse, et Charles Bonaparte n’était pas de caractère à poser en exception à la règle. Au contraire, il ouvrait si largement sa bourse à ses condisciples dans l’embarras, qu’il s’acquit bientôt l’estime et l’amitié de cette jeunesse studieuse et désintéressée qui serrait ses rangs sur la terre de l’étranger. A leur retour du continent, les amis de Charles, disséminés sur tous les points de l’île, le vantaient comme un savant distingué, un ami généreux, un étudiant modèle, et jetaient ainsi les premières bases de sa réputation naissante.
Sa famille, heureuse du bien qu’elle entendait dire, ne regardait pas aux sacrifices qu’elle faisait pour l’entretenir sur le continent, quoique ces sacrifices fussent onéreux dans une île qui a toujours été fort pauvre en numéraire.
Lorsque Charles Bonaparte eut terminé son droit, il fit ses dispositions pour retourner dans sa patrie. De l’embouchure de l’Arno, et tandis que les molles brises de la Toscane l’embaumaient encore du parfum de leurs orangers, il découvrit au loin sous la forme d’un rocher nu, dont la cime blanchie de neige se dessinait sur l’azur profond de la Méditérranée. Le jeune Corse, qui avait quelquefois sacrifié aux muses, dut alors éprouver ce sentiment louable et si naturel qui faisait dire au fils d’Ulysse : « Dans mon Ithaque, il n’y a que des rochers, des buyères, des terres arides, et pourtant mon coeur la préfère aux plus riches plaines de Grèce. »
Précédé de sa bonne renommée, regardé comme l’honneur de sa famille et l’espoir de sa patrie, Charles reçut de ses concitoyens un accueil empressé. Son éloquence, son patriotisme, ses manières nobles et simples achevèrent de lui concilier tous les coeurs . Enfin, l’estime dont on l’entourait devint si générale qu’elle fixa les regards de Paoli, qui voulut que le jeune Bonaparte lui fût présenté.
Paoli, dont la mémoire est encore adorée des Corses, était alors à l’apogée de sa puissance et règnait de fait sur ce peuple qu’on disait si difficile à gouverner. Fils de Giacinto Paoli qui avait commandé les Corses dans les dernières guerres contre les Génois ; frère de Clément paoli, l’homme le plus brave de son temps et l’un des premiers magistrats de l’île, Pascal Paoli avait été proclamé général de la Corse et rappelé de Naples, où il servait avec distinction. Courageux, éclairé, politique habile, mettant toute sa gloire à sauver sa patrie et à la rendre heureuse, il marchait noblement vers ce grand but. Après avoir battu les génois, il avait profité du calme qui suivit sa victoire pour réorganiser sa justice et faire fleurir l’agriculture. Investi par la nation d’un pouvoir absolu, il l’avait balancé lui-même en créant un conseil suprème composé d’hommes très capables, et, au dessus- de ce conseil, il avait établi un syndicat chargé de surveiller tous les magistrats de l’ïle, sans faire d’exception pour lui. Afin d’occuper Gênes de ses propres affaires, il avait armé en course des bâtiments légers qui poursuivaient le long des côtes de la Ligurie des navires marchands de la république. Ces corsaires, par des prises heureuses qu’ils ramenaient en Corse, faisaient reparaître l’argent dans ce pays que des siècles de guerre avaient épuisé. Paoli battait monnaie, fondait une Université, créait des imprimeries, et, chose qui ne s’était jamais vue, ont eut alors un journal en Corse. Paoli, quoique partisan rigide des moeurs austères et simples de sa nation, voulut la distraire un instant des graves préoccupations de la guerre, en donnant des fêtes auxquelles il conviait les personnes les plus éminentes de l’île ; il se faisait ainsi une sorte de cour, et ce luxe inusité enchantait les Corses.
C’est à cette époque que Charles Bonaparte, encore fort jeune, lui fut présenté. Le général, qui se connaissait en hommes et qui cherchait à s’entourer de gens de coeur, le traita avec tant d’égards que Charles conçut pour lui un vif attachement, une admiration sincère qu’il conserva jusqu’au tombeau. Si l’état de sa fortune le lui eût permis, il fût resté auprès du général ; mais sa famile exigea qu’il utilisât dans sa ville natale les connaissances qu’il avait acquises en Italie, et il devint bientôt un des premiers avocats d’Ajaccio.
Les talents et les qualités de Charles Bonaparte lui permettaient d’aspirer aux plus hauts partis, et sa famille, dont il était l’unique espoir, eût vivement désiré qu’il fit un mariage opulent. Charles n’entra pas dans ces vues et ne consulta que son coeur, en enlevant à l’admiration passionnée de toute la jeunesse de la ville, mademoiselle Letizia Ramolino, qui était d’une rare beauté, et qui à peine âgée de quatorze ans, possédait tous les charmes de son sexe.
La première année de se son mariage ne fut marquée que par un événement bien triste : il perdit son premier enfant. L’année suivante, il voulut mettre à exécution un projet qu’il avait conçu pendant son séjour à Pise ; il partit pour Rome afin de visiter la patrie des Scipions, des Césars, et de se perfectionner dans la science si difficile des lois anciennes.
Il y passa une année scolaire et revint en Corse, peu satisfait de Rome et des Romains.
Il débarqua à bastia, et, en traversant l’ïle pour se rendre à Ajaccio, il voulut voir Paoli qui était alors à l’abbaye de Rostino, dont le général aimait le séjour parce qu’il était né pour ainsi dire à l’ombre de son clocher. Le jeune voyageur traversa Pontenovo qui devait être le dernier champ de bataille de l’indépendance, gravit la montagne du village de Pastoreccia où était née la mère du général et dont quelques bois d’oliviers faisaient partie de son patrimoine. Sur le versant opposé, il découvrit bientôt, dans le petit hameau de la Stretta dépendant de la commune de Morosaglia, la maison paternelle de Paoli, qu’entouraient des châtaigniers gigantesques et qu’accompagnait une petite chapelle dédiée à a Madone. Non loin de cette modeste maison du chef de la Corse, s’élevait le superbe monastère des Franciscains où se rendait Charles. Lorsqu’il demanda Paoli, on l’introduisit dans son salon en le priant d’attendre, le général étant enfermé dans on cabinet où il s’occupait de quelques dépêches importantes qu’il allait faire partir pour l’Italie. « Je reviendrai quand il sera visible » dit le jeune Corse qui se mit en devoir de se retirer. Mais à ce moment la porte du cabinet s’ouvre, et Paoli paraissant sur le seuil, s’écrie : « c’est toi Charles ? Je t’ai bien reconnu , viens donc que je t’embrasse. » Et, sans écouter les excuses du voyageur qui craignait de le déranger : « Tu n’es pas de trop ici, dit-il en le faisant entrer dans son cabinet ; au contraire, tu arrives de l’Italie et j’ai besoin de savoir ce qui s’y passe ; viens donc. » Il le garda toute la journée, le fit souper avec lui et ne lui laissa reprendre sa route que le lendemain, après lui avoir fait promettre de quitter Ajaccio pour s’établir à Corte, ville centrale, où le général avait fixé le siège de son gouvernement.
Cette promesse, que Charles Bonaparte voulut tenir, souleva une petite tempête au sein de sa famille. Madame Bonaparte, dont les parents habitaient la ville maritime qu’il fallait quitter, refusa d’abord d’échanger les brumes de la côte, et surtout le doux parfum des orangers d’Ajaccio, pour l’air vif et pur des montagnes, alléguant pour gagner sa cause toutes les raisons que put lui suggérer sa logique de dix-sept ans. Mais quelques touchantes que fussent les prières d’une femme aimée et d’un oncle vénéré à l’égal d’un père, elles ne pouvaient balancer dans le coeur d’un Corse l’influence irresistible de Paoli ; Charles se rendit suel à Corte, conformément à sa promesse, et sa jeune femme ne tarda pas à l’y rejoindre.
A Corte, Charles se révéla sous un nouveau jour : à son économie primitive succéda l’amour du faste et de la dépense ; ses relations s’étendirent sur toute l’ïle, où il s’acquit bientôt une grande popularité, et il se posa en homme politique. Son caractère ardent, son éloquence passionnée, son instruction et sa connaissance des lois le firent rechercher par les principaux personnages de l’Etat. Il était admis dans la confidence de tous les secrets de la nation ; ses avis étaient écoutés, et, sans avoir de place ostensible dans le gouvernement, il exerçait une véritable influence sur la conduite des affaires.
Cerpendant la situation de la Corse devint bientôt très alarmante. Dès l’an 1764, les français, appelés par la république de Gênes, étaient débarqués en Corse sous les ordres du Comte de Marbeuf et s’étaient mis en possession des lieux que les Génois possédaient encore sur le littoral. Cette occupation française avait inquiété Paoli ; mais déguisant habilement ses alarmes, il était demeuré en bons termes avec les nouvelles garnisons, tout en continuant de faire la guerre aux Génois. Pendant près de quatre ans, les Français se bornèrent au simple rôle de spectateurs. Mais ensuite la république de Gênes, à bout d’efforts, céda au roi de France ses prétendus droits sur cette île, à condition qu’elle pourrait la reprendre, après la conquête, en payant les frais de l’expédition.
Lorsque cette effrayante nouvelle arriva aux oreilles des Corses, un cri de fureur s’éleva d’un bout de l’île à l’autre. Paoli, qui n’osait assumer la responsabilité d’une guerre si périlleuse, convoqua les députés des communes à Corte afin de connaître, disait-il, le voeu de la nation.
Charles Bonaparte assista à cette consulte extraordinaire, et, après le discours de Paoli qui en était le président, il prit la parole et s’exprima en ces termes :
« Vaillante jeunesse corse !
Toutes les nations qui ont aspiré à la conquête de la liberté ont été exposées aux grandes vicissitudes qui déterminent le triomphe des peuples. Il y en a eu de moins vaillantes, de moins puissantes que nous ; cependant à force de constance elles ont atteint le grand but qu’elles se proposaient.
Si le désir suffisait pour obtenir la liberté, tout le monde serait libre : mais il faut pour cela une vertu persévérante, supérieure à tous les obstacles, qui ne se nourrit point d’apparence, mais de réalité. Cette vertu, il n’est que trop vrai, se trouve rarement parmi les hommes ; aussi ceux qui la possèdent sont-ils considérés comme des demi-dieux.
Les droits et la condition d’un peuple libre sont trop inappréciables pour qu’on puisse en parler d’une manière digne de leur importance. Je me borne donc à vous rappeler qu’ils excitent l’envie et l’admiration des plus grands hommes de l’univers.
Je voudrais me tromper, mais je crois que la plupart de ceux qui se préparent à nous attaquer ne veulent qu’effacer de la carte une nation qui, ayant le coeur plus grand que sa fortune, semble reprocher à l’Europe son insouciance, et lui rendre plus sensible la honte de s’endormir au bruit de ses chaînes.
Vaillante jeunesse, voici le moment décisif. Si nous ne triomphons de la tempête qui nous menace, c’en est fait tout à la fois de notre nom et de notre gloire. En vain aurions-nous montré jusqu’ici des sentiments d’héroïsme ; en vain nos pères auraient combattu pour la liberté et nous l’auraient transmise au prix de leur sang : tout serait perdu… Mais non ! ombres honorées de tant de braves, qui siégez au temple immortel de la gloire, ne craigniez pas d’avoir à rougir : vos enfants ont hérité de votre courage et de vos vertus. ils sont inébranlables dans la résolution de suivre votre exemple ; ils seront libres, ou ils sauront mourir !
Si nous en croyons nos ennemis, nous aurons à combattre les troupes françaises. Nous ne pouvons nous persuader que le roi Très-Chrétien, qui a été médiateur entre nous et les Génois, qui connaît la justice et nos griefs, veuille maintenant épouser la querelle de la république pour exterminer un peuple qui a toujours espéré en sa puissante protection. Mais enfin, s’il est arrêté dans le livre des destins que le plus grand monarque du monde doive se mesurer avec le plus petit peuple de la terre, nous ne pouvons être que fiers. Nous sommes, dans ce cas, certains de vivre avec honneur ou de mourir avec gloire.
Quand à ceux qui manquent de courage pour affronter le trépas, qu’ils ne s’inquiètent point ; ce n’est pas eux que l’on parle : c’est aux hommes de coeur, c’est aux vrais braves. Oui, jeunes Corses, c’est à vous que la patrie s’adresse ; c’est à vous de vous montrer dignes de vous-mêmes, digne du nom que vous portez.
On prétend que des armées étrangères viennent courir les chances de la guerre, pour protéger les intérêts et soutenir les injustes prétentions de la République ; et nous, qui combattons pour nos propres intérêts, pour nos personnes, pour nos enfants; nous, qui avons le nom et la gloire de nos pères à défendre, pourrions-nous balancer un moment à exposer notre vie ?
Chacun est persuadé, valeureuse jeunesse, que votre courage ne vous permettrait pas de survivre à la perte de la liberté. Surpassez donc par votre promptitude l’attente générale, et apprenez à nos enenmis qu’il n’est pas si aisé d’accomplir leurs criminels desseins.
Vivez heureux pour la patrie et pour vous-mêmes. »
Ce discours électrisa l’assemblée, et l’entraîna, par un mouvement unanime et spontané, à accepter la guerre contre la France.
Il arriva ce qui était facile à prévoir : accablés par le nombre, n’ayant pas même d’artillerie pour pouvoir défendre avec des chances de succès leurs gros villages ainsi que les défilés de leurs montagnes, les corses furent vaincus ; mais ils ne le furent pas sans gloire. Ils disputèrent leur île hameau à hameau, rocher à rocher, tuant aux français le plus de monde qu’il était possible avec leurs misérables munitions ; enlevant quelquefois des régiments entiers et forçant, à l’affaire de Borgo, une grosse garnison française à capituler ; ils firent enfin, sous les ordres de Clément Paoli, l’Achille de cette courte et sanglante Iliade, de vrais prodiges de valeur. Les français ne revenaient pas de leur étonnement en se voyant aux prises avec ces hommes qui, éprouvés par des siècles de lutte et quoiqu’étrangers aux leçons de la stratégie, connaissaient parfaitement toutes les ruses de la guerre. Ces patriotes intrépides, après avoir invoqué à genoux Dieu et la Sainte Vierge, s’élançaient contre eux au bruit de leurs conques marines, en poussant des cris aigus, et visaient avec une si terrible justesse qu’une foule d’officiers de marque tombaient sous les balles de leurs carabines. C’était quelque chose de touchant que l’abnégation héroïque de ce pauvre peuple qui, manquant de tout, hors de courage, pour se défendre, n’avait pas même d’ambulances pour recueillir ses blessés.
Charles Bonaparte avait payé de sa personne dans cette guerre de l’indépendance. Après la défaite de Pontenovo, qui frappa au coeur la nationalité insulaire, il fut d’avis de tenter encore la fortune des combats. On pouvait en effet continuer à opposer une vive resistance aux troupes d’invasion. Il n’était pas difficile de rallier à Corte les débris des patriotes. Dans cette ville et dans les pièves des alentours, on brûlait de reprendre l’offensive, et le comte Vaux se trouvait constamment harcelé par d’infatigable tirailleurs. Dans la Balagne, on luttait avec énergie contre de Lucker et le marquis d’Arcambal, qui avait plus de quatre mille hommes sous leurs ordres. Jacques-Pierre Abbatucci, Jules Foata, le curé de Guagno, et d’autres chefs aussi intelligents que braves, tenaient vigoureusement en échec, dans le pays d’outre-monts, les nombreux soldats que commandait Narbonne. Tout n’était donc pas perdu pour la Corse : tant de ressources habilement employées, devait au moins en retarder la conquête. Telle était l’opinion de Charles ; mais Paoli appréciait autrement l’état des choses. Dans sa sagesse, il crut devoir épargner de nouveaux malheurs à ses concitoyens : il prit la douloureuse résolution de cesser la lutte et de s’éloigner.
Dès lors, le projet de défendre Corte fut abandonné ; et quand on apprit que les Français avançaient pour s’en emparer, une foule de familles de distinction, qui s’étaient réunies dans ce dernier sanctuaire de la liberté, se réfugièrent sur le Monte Rotondo, dont la cime atteint la région des neiges éternelles.
Charles Bonaparte et sa jeune femme, alors enceinte de Napoléon, étaient parmi ces fugitifs. Après avoir franchi les montagnes boisées de pins qui sont posées en contreforts aux flancs du Rotondo, il fallut gravir encore des sentiers étroits et rocailleux pour arriver au terme du voyage.
Lorqu’on eut atteint les plateaux élevés de cette montagne haute et nue, d’où l’on découvre la mer Méditérranée, les côtes de Sardaigne, et, dans un éloignement vaporeux, les rivages de l’Italie et même de la France, les femmes s’abritèrent sous quelques roches avancées ; les soldats de l’indépendance se groupèrent un peu plus loin, et agitèrent les questions douloureuses que soulevait la situation du moment : Fallait-il mourir les armes à la main, ou quitter leur île natale ? Mourir, oui ; mais les femmes, mais les enfants !… Oh ! Si l’ange tutélaire de la Corse leur eût dit en désignant tour à tour la France et l’Italie : Voilà l’empire, volà le royaume d’un de ces enfants qui causent vos alarmes ; le vainqueur futur de l’Europe est sur cette montagne, où vous pleurez l’asservissement de votre patrie ; la défaite qui vous désole entrait dans les vues de la Providence : sans elle vous ne pourriez pas vous vanter d’avoir mis au monde Napoléon.
Et ils accusaient Dieu de les avoir abandonnés. L’impatience humaine ne laissera-t-elle donc jamais à la Providence le temps de mûrir ses dessins ? Il est vrai que les folles colères de l’homme ne l’émeuvent pas !
Ces fiers patriotes étaient tous décidés à ne pas sortir de la triste alternative qui faisait depuis vingt-quatre heures le sujet de leur délibération. Mais le comte de vaux fut assez habile pour les porter à changer d’avis. Le lendemain de son entrée dans Corte, ayant à coeur de hater la complète pacification de la Corse, il détacha, en parlementaires, ses aides de camp auprès d’eux, et les fit prier de lui envoyer une députation pour s’entendre avec lui.
La députation fut aussitôt formée. Charles Bonaparte en faisait partie. Le général reçut avec beaucoup d’égards ceux qui la composaient, et leur dit que l’ïle entière était soumise et que Paoli et son frère venait de la quitter. Il leur tint, du reste, un langage si conciliant, si rassurant sur les intentions de la France, « qui allait être avec la Corse une seule nation, » qu’ils acceptèrent, pour eux et pour leurs compagnons, les sauf-conduits offerts par le comte, et chacun rentra dans ses foyers.
Cependant Charles Bonaparte, en retournant à Ajaccio avec sa famille, voulut éviter autant que possible la rencontre des troupes françaises qui occupaient la route de Vizzavona, et suivit celle de Niolo, Vico, et Cinarca. Il fallut à madame Bonaparte son tempérament robuste et toute la trempe de son caractère pour ne pas succomber aux fatigues d’un voyage si long et pénible. Elle dut marcher plus d’une demi-journée à pied, par des chemins détournés, tenant presque toujours sur ses bras son enfant Joseph qui était né à Corte l’année précédente et ne voulait pas la quitter. Au passage du Liamone, elle faillit se noyer : son cheval perdit pied et fut entrainé par le courant. Son mari et les pâtres que l’abbé Acquaviva leur avait donnés pour guides, épouvantés du péril qu’elle courait, se jetèrent à la nage pour la sauver, en lui criant de se laisser tomber dans la rivière. Mais la courageuse jeune femme s’affermit au contraire sur sa selle et dirigea si habilement son cheval qu’elle parvint à gagner la rive opposée. La Providence veillait déjà sur Napoléon.
Paoli, quoi qu’en eût dit le comte de Vaux, n’avait pas encore quitté la Corse. Il se trouvait alors à quelques pas de Porto-Vecchio, et se préparait à partir pour la Toscane avec son frère et plusieurs autres patriotes, sur deux navires anglais que l’amiral Smittoy avait mis à sa disposition. Charles s’était également proposé de le suivre ; mais il ajourna l’exécution de ce louable projet, dans le but de reconduire sa femme et son enfant au sein de sa famille.
Le lendemain de son arrivée à Ajaccio, il se disposa à partir pour le rejoindre et pour partager avec lui toutes les souffrances de l’exil. Son oncle, l’archidiacre Lucien Bonaparte, et sa femme conjurèrent les larmes aux yeux de ne pas les abandonner dans une circonstance si périlleuse, de différer encore du moins son départ pour voir quelle direction on donnerait aux affaires, lui promettant de l’accompagner si les Français voulaient abuser de la victoire. Charles ne put resister aux prières d’un oncle pour lequel il avait le respect d’un fils ; il se laissa toucher par les larmes de son épouse qu’il chérissait de tout son coeur.