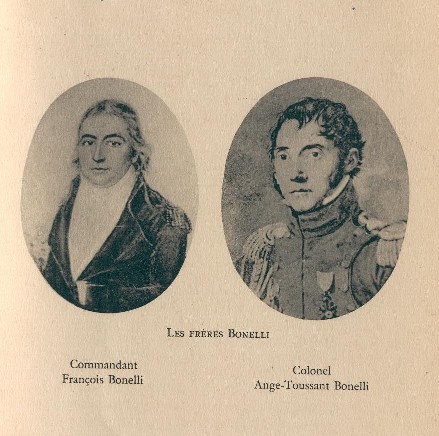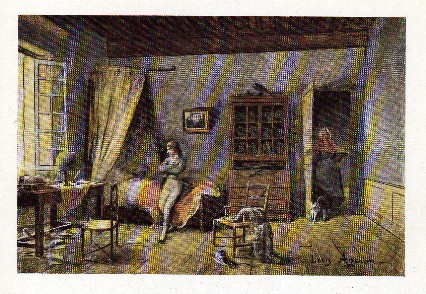septembre 18, 2007
NAPOLEON ET POZZO-DI-BORGO
Au cours de sa prodigieuse carrière, Napoléon rencontra devant lui un ennemi implacable, un compatriote, le diplomate Charles-André Pozzo-di-Borgo ; l’inimitié de ces deux corses a peut-être modifié le cours de l’Histoire.
Charles-André Pozzo-di-Borgo est né à Alata, petit village à 10 kilomètres d’Ajaccio, le 8 mars 1764 ; après de brillantes études à l’université de Pise, il se fit inscrire comme avocat à Ajaccio ; Joseph Bonaparte, qui avait pris; à la mort de son père, la direction des affaires de la famille, se lia d’amitié, en 1786, avec ce jeune avocat « fort habile dans sa profession » qui lui prêta souvent son appui dans ses intérêts de famille ». Napoléon Bonaparte, lieutenant en second au régiment de la Fère, arriva à Ajaccio le 15 septembre 1786, et ne quitta la Corse, pour aller rejoindre son régiment à Auxonne, que le 1er juin 1788 ; au cours d’un séjour de près de deux ans à Ajaccio, il eut des relation suivies avec Pozzo-di-Borgo. « Nous avons lu ensemble, dit Pozzo, Montesquieu et d’autres livres de politique et de legislation. Il saisissait toutes le grandes idées avec une impatience incroyable… »
Après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, un mouvement révolutionnaire éclate en France, gagne la Corse. Le lieutenant d’artillerie Bonaparte, rentré à Ajaccio à la fin de septembre 1789, et Charles André Pozzo-di-Borgo, se montrent des enthousiastes des idées nouvelles, se signalent à l’attention publique. « Napoléon et moi, disait Pozzo, nous causions de ce qui était et de ce qui pouvait arriver. Nos têtes se montaient ; je puis dire que la sienne avait, à cet égard, la supériorité ».
Mais Paoli vient de rentrer en Corse, en juillet 1790, après 20 ans d’exil ; il est frappé par la parole éloquente, l’intelligence déliée de Pozzo ; il le fait désigner comme député extraordinaire, le 23 septembre 1790, pour présenter à l’Assemblée Nationale, avec Antoine Gentili, les adresses votées au Congrès d’Orezza, puis le 13 septembre 1791, il le fait élire député à la Législative.
Le lieutenant Bonaparte prit-il ombrage de ce que Pozzo avait été nommé député à la Législative plutôt que son frère Joseph ? C’est fort probable. Mais un dissentiment sérieux allait bientôt se produire entre les Pozzo et les Bonaparte. Le 1er avril 1792, le lieutenant Bonaparte se faisait élire lieutenant-colonel des gardes nationales de la Corse, en ayant recours à un coup de force, contre Mathieu Pozzo-di-Borgo, le frère du député à la Législative. Dans ses notes de 1838, Pozzo paraît n’avoir gardé aucune amertune de cet incident. « Je reçus à Paris, dit-il, des protestations et des actes qui pouvaient faire annuler l’élection à cause des irrégularités qui l’avaient accompagnée. Loin d’y avoir égard, je donnai tort aux miens d’avoir voulu opposer le moindre obstacle à Napoléon et je les priai de se réconcilier ».
En tout cas, la cordialité et la confiance avaient disparu. Bonaparte s’était rendu à Paris, le 28 mai, pour obtenir sa réintégration dans l’artillerie, il rencontra Pozzo à l’Hôtel des Patriotes hollandais, et ils eurent, tous deux, « l’air contraint, cependant ami » ; Pozzo promit, par la suite, de faire une démarche en sa faveur, mais n’en fit rien. Néanmoins, le 19 juillet, Bonaparte était nommé capitaine au 4° d’artillerie.
Le dissentiment entre Pozzo et Bonaparte n’allait pas tarder à prendre une tournure violente. Le champ d’action qu’offrait la Corse était trop étroit pour ces jeunes ambitieux.
Joseph Bonaparte avait posé sa candidature, le 22 septembre 1792, au quatrième siège de député à la Convention, et il s’était heurté, entre autres, à l’hostilité sourde de Pozzo ; or, Paoli était nommé par décret du 11 septembre, commandant des forces militaires de la Corse, avec le concours, disait-on, de Pozzo, qui était en excellents termes avec Servan, ministre de la guerre ; ce garçon actif, ambitieux, séduisant, avait réussi à s’imposer à l’esprit de Paoli, un vieillard de soixante-huit ans, fatigué et malade, qui le faisait élire, fin décembre 1792, procureur général syndic, c’est à dire chef réel de l’Administration en Corse, malgré l’opposition violente que lui avaient faite les Bonaparte ; ceux-ci avaient de réels motifs de ressentiment contre Paoli qui les tenait en suspicion, avait refusé d’agréer Lucien comme secrétaire, n’avait pas consenti à réserver une place à Joseph dans la nouvelle administration ; les Bonaparte attribuaient l’attitude de Paoli à leur égard aux menées de Pozzo-di-Borgo qui disposait d’un pouvoir sans limites. Il en convint lui-même dans ses Notes : Le général Paoli était l’objet de la vénération publique et la force du parti, mais j’en étais l’action. « Egli capo, io mano ».
Les Bonaparte n’étaient pas gens à se laisser barrer la route sans réagir ; ils liaient partie avec les jacobins, les Arena, les Saliceti, les pires ennemis de Paoli, qui débitaient des infamies sur son loyalisme ; en attaquant Paoli, ils visaient à ruiner le crédit de Pozzo ; or, par décret du 2 avril 1793, Paoli et Pozzo-di-Borgo étaient mis en accusation et traduits à la barre de la Convention ; le Directoire du département interceptait une lettre de Lucien Bonaparte, dans laquelle il se vantait d’avoir provoqué le décret du 2 avril, et où il avouait, avec cynisme : « Paoli et pozzo décrétés d’accusation et notre fortune est faite. » Pozzo faisait imprimer cette lettre, la rendait publique ; il était à ce moment animé d’une haine violente contre les Bonaparte ; il déployait une activité fébrile pour déjouer les manoeuvres des ennemis de Paoli ; sous son inspiration, celui-ci convoquait une Assemblée des Communes, à Corté, le 26 mai 1793, et la Corse se mettait en révolte contre la Convention ; à la séance du 29 mai, Pozzo faisait voter, entre autres, une flétrissure contre « les Bonaparte, nés dans la fange du despotisme, élevés sous les yeux et au frais d’un pacha luxurieux (Marbeuf) qui commandait dans cette île… qui s’étaient faits de vils agents de la faction tyrannique qui avait conjuré de réduire la Corse à l’esclavage… » ; Pozzo en bon Corse assoiffé de vengeance, ne s’en tenait pas à des blâmes platoniques infligés dans un Congrès ; il expédiait des détachements armés en divers points de la Corse pour châtier les ennemis de Paoli ; une troupe armée fut envoyée à Ajaccio pour s’emparer des Bonaparte ; Letizia Bonaparte, prevenue à temps, réussit à quitter la ville nuitamment avec ses enfants, et, après avoir érré dans le maquis, elle put prendre passage sur une des frégates françaises qui étaient venues mettre le siège davant Ajaccio ; tandis que les Bonaparte quittaient la Corse pour se soustraire aux fureurs des Paolistes, tous leurs biens étaient dévastés ou brûlés.
Pozzo, engagé dans une politique contre la France, était entraîné à placer la Corse sous la souveraineté de l’Angleterre (juin 1794) ; il en fut récompensé par la nomination de Président du Conseil d ‘Etat du gouvernement anglo-corse.
Bonaparte, de son côté, devenait, en moins de trois ans, après son départ de Corse, le glorieux général en chef de l’armée d’Italie ; son premier soin fut de délivrer la Corse de l’occupation anglaise (octobre 1796) « il ordonnait au général Gentilli (17 octobre1796) de faire arrêter et juger par une commission militaire les quatre députés qui avaient porté la couronne au roi d’Angleterre, les membres du Gouvernement et les meneurs de cette infâme trahison, entre autres les citoyens Pozzo-di-Borgo, etc… » Mais Pozzo avait réussi à quitter la Corse pour l’Angleterre, le 20 octobre 1796.
L’antagonisme de ces deux Corses allait se déployer désormais sur un théâtre plus vaste.
Tandis que Bonaparte atteignait l’apogée de la puissance, devenait Empereur de Français, maître de l’Europe, le proscrit Pozzo, sans famille, sans fortune, sans patrie, ne cessait pas un instant de le poursuivre de sa haine. Il écrit mémoires sur mémoires, se met au service de la Russie, se rend à Londres, à Vienne, Saint-Pétersbourg, aux Dardanelles, suggérant, provoquant contre « son ennemi personnel Bonaparte » les coalitions les plus fatales « quittant alternativement les cours qui se rapprochaient de la France pour se rendre auprès de celles qui s’en éloignaient, revenant auprès des premières quand elles rompaient avec nous et toujours soufflant l’ardeur dont il était animé (1) ». Les victoires les plus éclatantes de Napoléon, Ulm, Austerlitz, Iéna, Wagram et les traités de paix qui s’en suivent ne découragent pas Pozzo, n’entament pas son énergie.
C’est Pozzo qui décide Bernadotte à prendre parti contre Napoléon ; c’est lui qui pousse les alliés à marcher sur Paris, qui fait reléguer Napoléon à l‘île d’Elbe, et, plus tard, à Sainte-Hélène.
Ce n’est pas moi, sans doute, dit-il à Talleyrand, après Waterloo, qui ait tué politiquement Bonaparte ; mais c’est moi qui lui ait jeté la dernière pelletée de terre. »
Au cours de ces quatorze années de lutte, Napoléon s’efforça, mais en vain, d’atteindre son redoutable ennemi ; il demanda même, après le traité de Vienne, son extradition, sans pouvoir l’obtenir.
« C’est Pozzo-di-Borgo, croit-on, dit Napoléon à Sainte-Hélène, qui a conseillé à l’Empereur Alexandre de marcher sur Paris ; il a, par ce seul fait, décidé des destinées de la France, de celle de la civilisation européenne, de la face et du sort du monde. »
On s’est souvent demandé d’où venait la haine atroce de Pozzo contre Napoléon. Dans une curieuse conversation que Pozzo a eue avec Alfred de Vigny, le 10 juillet 1830, il ne cesse de se représenter « l’antagonisme de Bonaparte » et il trouve moyen de lui dire « que la source de sa haine contre Bonaparte avait été la dénonciation de Lucien en 1793, qu’il avait lutté toute sa vie et avait fini par lui porter le dernier coup ; que, lorsque Alexandre l’avait abandonné, il avait demandé un firman au Grand Seigneur pour traverser ses terres et se retirer. Vienne, après le mariage de Bonaparte, ne le livra pas, mais l’abandonna. Ce fut alors qu’il se retira en Angleterre ; de là, il écrvit à l’Empereur Alexandre : « Je ne suis plus votre sujet, mais serai toujours votre serviteur. Vous ferez la guerre à Bonaparte, et je vous servirai alors. Bonaparte est perdu s’il vise à l’infini ».
Pozzo a toujours eu la préoccupation de faire bonne figure devant la postérité ; il se pourrait qu’il n’ait pas avoué la raison secrète de sa haine contre Napoléon. Il est probable que Lucien Bonaparte a été la cause déterminante du décret du 2 avril 1793, qui traduisait Pozzo à la barre de la Convention. Mais la dénonciation de Lucien, dont il avait, d’ailleurs, tiré vengeance, a plutôt favorisé son ambition. Elle l’a amené à exercer pendant deux ans, sous le titre de Président du Conseil d’Etat du Gouvernement anglo-corse, les fonctions offcielles deVice-Roi de la Corse. Il était mieux fonder à donner comme motif de sa haine l’expédition du général Bonaparte en Corse en 1796, qui l’avait précipité du pouvoir, et l’avait obligé à mener une vie errante de proscrit.
Les événements de 1793, au contraire, autorisaient Napoléon à garder une haine sourde contre Pozzo. Il ne pouvait pas oublier que, dans la journée du 29 mai 1793, en présence de délégués de toutes les communes de la Corse, Pozzo avait jeté l’opprobre sur sa famille, et oser porter atteinte à l’honneur de sa mère.
La haine de Pozzo contre napoléon ne nous paraît donc pas se rattacher aux incidents de 1793. Thiers l’attribue à l’envie.
Pozzo avait connu Bonaparte à Ajaccio petit lieutenant d’artillerie ; il lui avait apparu comme un jeune ambitieux effréné, à l’esprit fiévreux, prompt à toutes les audaces pour réussir ; il avait fréquenté la famille Bonaparte et n’ignorait pas qu’elle se débattait péniblement au milieu des difficultés de la vie ; Bonaparte était plus jeune que lui de cinq ans ; il l’avait nettement dominé dans toutes les circonstances où ils s’étaient trouvé en compétition, et il a dû s’imaginer qu’il lui était supérieur en finesse, en sens politique. Il est vraisemblable que lorsque Bonaparte devenait, en très peu d’années, général en chef glorieux, Premier Consul, Empereur, il a dû être stupéfait, attribuer son élévation à un concours de circonstances inouïes, et ne cesser de voir en lui le petit politicien d’Ajaccio, et fils de Letizia, au cerveau tumultueux dont la fortune invraisemblable ne pouvait durer.
Cette hypothèse se trouve corroborée par une observationde Miot sur la mentalité des contemporains de Napoléon. Miot, se trouvait à Ajaccio au moment où Napoléon fut nommé Consul à vie, et il a constaté les « dispositions envieuses de la population » qui, à cette nouvelle, ne se livra « à aucune démonstration de joie ou de sympathie. En général, il y eut plus d’étonnement que d’enthousiasme. On ne savait comment concilier cette fortune surprenante avec les souvenirs trop récents de la famille Bonaparte, que tous les habitants d’Ajaccio avaient connue dans un état si éloigné de sa grandeur actuelle.
(1) Thiers – Histoire du Consulat et de l’Empire, XVII, 105
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 14, 2007
LA FORMATION CORSE DE NAPOLEON A SON DEPART DEFINITIF DE LA CORSE
Je mesurais mes rêveries au compas de mon raisonnement.
Le capitaine d’artillerie Bonaparte avait, à cette époque, vingt-quatre ans. Comme les Corses d’autrefois, les assises de ses idées étaient la famille et la patrie ; comme eux il ne concevait que l’idéal militaire et les réalités de la politique ; comme eux enfin, il avait l’orgueil de soi, l’impatience de toute autorité, l’énergie indomptable, l’ambition immodérée, l’esprit vif et l’âme ardente.
Il s’est développé librement, en suivant la pente natuelle de son esprit. Aux école royales, il avait vécu en Corse irréductible, replié sur lui-même. Ensuite, au régiment, il avait refait, tout seul, son éducation, avec une frénésie de savoir. Prédisposé par atavisme à ne goûter que les réalités de la vie politique et sociale, du métier des armes, il avait pasionnément et presque exclusivement alimenté son cerveau de connaissances exactes sur les institutions des peuples et des gouvernements, l’art militaire. Sa curiosité d’esprit avait été sans cesse en éveil. Mais, si étendues et variés que fussent ses connaissances, il les avait absorbées tout naturellement. Son esprit étant, par essence, clair, net et précis, elles s’étaient ordonnées dans son cerveau, gravées en traits ineffaçables dans sa mémoire, sous forme de chiffres, de faits, de renseignements essentiels.
Certes, dans les premiers moments d’ivresse intellectuelle, il avait subi la séduction de Rousseau, il s’était laissé subjuguer par les héros de l’antiquité, les grands hommes de la Corse ; il pensait, alors, que le patriotisme était le moteur unique des grandes actions humaines, que la liberté politique était la suprême faculté de l’homme, que la patrie devait tenir lieu de tout, et il s’abandonnait dans la sincérité de son âme, à toute la fougue de son enthousiasme pour ces nobles idées ; or, au contact de la vie, il avait aperçu le côté chimérique des théories humanitaires des idéologues, rectifié ses idées premières sur l’homme et la société. Jeté en pleine tourmente révolutionnaire, et mêlé dans une fièvre d’action, à tous les mouvements politiques de son île, il avait, d’un esprit clairvoyant, jugé de quelle pâte étaient faits les grands hommes, apprécié les idées exactes que représentaient les grands mots de Liberté, Peuple, Révolution. Son cerveau était devenu incompressible aux influences d’autrui, et il n’acceptait plus de connaissances que celles qu’il tirait de l’observation directe. Il paracheva ainsi son éducation. Son coup d’oeil était prompt, lucide, pénétrant. Chaque jour de nouvelles cristallisations se formaient dans son cerveau sur les hommes et les choses ; elles venaient éclairer ou modifier les notions initiales qu’il avait puisées dans les livres. La vie ne lui apparût pluis que comme un conflit de passions et d’intérêts où le succès appartenait au plus rusé, au plus habile, au plus fort. Dans l’ardent milieu corse, surtout, elle n’était qu’une furieue mêlée de clans. Chacun voulant parvenir, on avait recours, dans un déchaînement de passions, à tous les moyens, à la ruse, à la force, pour triompher !
Cette terrible concurrence vitale lui fit acquérir l’expérience pratique du maniement des hommes ; pour déjouer les astuces d’adversaires sans scrupule, il fallait d’abord commencer par être maître de soi ; son esprit gagna donc en lucidité, en pénétration, en souplesse et il apprit à contenir son enthousiasme, à dompter la fougue de son tempérament(1), à subordonner ses actes à sa froide raison. Les passions actives qui l’agitaient furent canalisées ; elles lui imprimaient des décisions soudaines, le maintenait dans l’inquiétude, ne le laissaient point inactif ; c’est ainsi qu’il était en proie à une activité dévorante, qu’il accomplissait tout travail sans effort, avec volupté, dans un perpétuel besoin de savoir. Son esprit, bien équilibré, était toujours alerte, clair, précis, et on cerveau, à vingt-quatre ans, était en quelque sorte dans sa fleur : les idées, les jugements sur les hommes et les choses, les projets, les plans, s’y formaient instantanément, avec abondance, dans une vigoureuse montée de sève…
(1) Devenu Empereur, et n’ayant plus à dissimuler avec des rivaux, il laissait éclater sa fougue de Corse impétueux : « J’ai plutôt péché, di-il dans le Mémorial (IV, 238) par une audacieuse franchise et par un excès d’énergie que par des détours et supercherie ».
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
LES BONAPARTE PROSCRITS DE LA CORSE
Un homme n’est qu’un homme. Ses moyens ne sont rien si les circonstances et l’opinion ne le favorisent pas.
Les ennemis de Paoli ne manquèrent pas d’imputer à ses menées secrètes l’échec de l’expédition de Sardaigne ; Aréna l’accusait ouvertement, à Nice, d’être hostile à la République, de vouloir donner la Corse à l’Angleterre ; les Marseillais de la phalange propagèrent dans les clubs de Provence des calomnies contre Paoli et les Corses qu’ils rendaient responsables de la honteuse retraite des troupes.
Saliceti, le seul représentant de la Corse qui avait voté la mort du Roi, qui s’était créé une situation en vue dans le groupe des Montagnards, manoeuvrait habilement, depuis quelques mois, pour dépouiller Paoli de son pouvoir ; le 17 janvier 1793, il avait fait rattacher la 23e division de l’armée du Var, et plaçait ainsi Paoli sous les ordres du général Biron, commandant en chef de l’armée d’Italie ; le 30 janvier, la Convention ayant déclaré la guerre à l’Angleterre, il faisait porter des soupçons du Comité public sur Paoli, qui avait été pendant vingt ans pensionné par cette nation, et obtenait l’envoi de trois commissaires extraordinaires en Corse « pour mettre ses ports en état de sûreté ».
Clavière, ministre des contributions, à la tribune de la Convention, et Volney, dans le Moniteur des 20 et 21 mars, donnaient une publicité retentissante aux suspicions jetées par Aréna et Saliceti contre Paoli.
Le Directoire du département, dans de nombreux appels, s’efforçait de réfuter les calomnies répandues contre Paoli. « Venez, disait-il dans une adresse, venez, citoyens commissaires, et vous verrez le patriotisme et l’ardeur du peuple, vous le verrez Français, non pas parce qu’on offre des emplois, mais parce que les Français sont libres et que les Corses veulent l’être avec eux ».
Les commissaires de la Convention, Delcher, Lacombe Saint-Michel, Saliceti, arrivés à Toulon le 2 mars, furent retenus par le mauvais temps au Golfe Juan jusqu’au 31 mars ; ils débaquèrent à Saint-Florent le 5 avril, et, le 6 avril, ils étaient rendus à Bastia ; ils furent l’objet d’ovations enthousiastes, et accompagnés jusqu’à leur demeure aux cris de : « Vive la République ! ».
Ils étaient fêtés, entourés, circonvenus, par les ennemis avérés de Paoli, les Bonaparte, les Pompéi, les Giubega, les Galeazzini, les Massoni et le haineux Aréna.
La confusion était extrême, l’anxiété grande dans l’île. Les ennemis de Paoli, aveuglés par l’esprit de parti, affirmaient que le vieux patriote voulait livrer la Corse à l’Angleterre ; ses fidèles et dévoués partisans, au contraire, se plaignaient que les commissaires de la Convention fussent venus en Corse provoquer des troubles et désordres.
Or, ceux-ci s’appliquaient à faire la conciliation. Le 10 avril, ils adressaient une circulaire aux Corses pour les engager à faire cause commune avec le peuple français, attaqué dans sa liberté par « tous les despotes couronnés de l’Europe ».
Saliceti espérait qu’on pourrait s’entendre avec Paoli, qui était victime, à cause de son grand âge, des intrigues de son entourage, entre autres du procureur général syndic Pozzo-di-Borgo ; celui-ci n’avait délégué personne pour recevoir les commissaires de la Convention, et il paraissait méconnaître leur autorité. Il eut une entrevue avec Paoli à Corté, le 14 avril ; il le conjura de se rendre à Bastia pour travailler, d’un commun accord, à la défense de la Corse et à l’apaisement du pays. Paoli, gagné par la chaude affection que lui témoignait le rusé Saliceti, promit de se rendre à son invitation dès que sa santé le lui permettrait.
Sur ces entrefaites, le 17 avril, les Commissaires de la Convention recevaient par un courrier extraordinaire une nouvelle qui les jetait dans la consternation. Par décret du 2 avril, Paoli, et Pozzo-di-Borgo étaient décrétés d’accusation et traduits à la barre de la Convention ; ils devaient s’assurer de leurs personnes par tous les moyens possibles.
Dès qu’on eut connaissance du décret de la Convention, la surprise, la colère et l’indignation furent extrêmes en Corse ; les sociétés populaires, les municipalités adressèrent des appels à la Convention pour protester contre cet « acte foudroyant » qui atteignait un homme qui avait jusque là « joui de l’estime de la Patrie et de celle de l’Europe entière ».
A Ajaccio, où le décret de la Convention était connu officieusement le 21 avril, le capitaine Bonaparte partageait l’émotion générale, et il rédigeait une adresse à la Convention pour la prier de rapporter, en ce qui concernait Paoli, le décret du 2 avril ; certes, il avait applaudi aux attaques contre Paoli, parce qu’elles étaient destinées à ruiner le crédit de ses ennemis personnels, les Pozzo-di-Borgo, les Peraldi, les Colonna-Césari, tous les familiers, du grand homme, mais ordonner au Père de la Patrie, à un vieillard septuagénaire, accablé d’infirmités, de comparaître à la barre de la Convention, comme un « scélérat conspirateur », ou un « coupable ambitieux » c’était une criminelle folie.
Il adressait d’autre part, une pétition à la municipalité pour l’engager à rallier tous les citoyens d’Ajaccio dans une même pensée d’union envers la France ; mais la municipalité refusa d’organiser la manifestation patriotique qu’il sollicitait.
On se méfiait des Bonaparte, notés comme des adhérents de Saliceti, et des ennemis irréductibles de Peraldi et Pozzo-di-Borgo, les représentants de Paoli à Ajaccio. Depuis quelques jours, d’étranges soupçons pesaient sur le capitaine Bonaparte qui se livrait à des études mystérieuses sur le Golfe d’Ajaccio. On l’accusait de tramer une conspiration pour s’emparer de la Citadelle et en chasser les gardes civiques dévoués à Paoli, qu’on venait d’y établir. Ayant voulu se rendre aux îles Sanguinaires pour inspecter la tour de la Parata, on le prévint secrètement, chemin faisant, que des sicaires étaient postés le long de la route pour l’assassiner. Il dut retourner sur ses pas. Les soupçons des Peraldi et des Pozzo ameutaient contre lui la population ; son séjour à Ajaccio n’étant plus tenable, il prit le parti de se rendre à Bastia.
Le 3 mai, il se mit en route, accompagné de Santo Bonelli, dit Santo Ricci, un des dévous partisans de Bocognano. Arrivé à Corté, son parent Arrighi le prévint que le Directoire du département avait intercepté une lettre de Lucien Bonaparte dans laquelle il avouait avoir provoqué le décret du 2 avril contre Paoli et Pozzo et qu’on ne manquerait pas de l’arrêter, si sa présence en ville était connue ; il rebroussa chemin ; arrivé à Bocognano, le 4 mai, il passa la nuit chez un de ses parents Tusoli, au hameau de Poggiolo ; le 5 mai, les Morelli, informés de la présence du capitaine Bonaparte à Corsacci, où il avait donné rendez-vous à Santo-Ricci, le mirent en état d’arrestation ; Santo Ricci et Vizzavona, soutenus par de nombreux parents en armes, le délivrèrent des mains des paolistes ; Santo Ricci et Bonaparte firent halte à Tavera, chez Mancini ; le soir, ils reçurent l’hospitalité chez Poggioli, maire d’Ucciani ; le lendemain soir, 6 mai, à la nuit tombante,, Bonaparte se faufilait, furtivement, dans la maison de son parent Jean-Jérôme Levie qui habitait le faubourg, le Borgo ; l’arrivée de Bonaparte avait transpiré en ville ; le 8 mai il y eut une alerte ; des gendarmes vinrent enquêter si Bonaparte n’était pas caché dans la maison Lévie ; dans la nuit du 9 mai, il s’embarqua sur la gondole du patron Ucciani, et, le lendemain, il débarquait à Macinaggio. De là, il allait rejoindre à Bastia les commissaires de la Convention.
Le conflit entre Paoli et les commissaires de la Convention paraissait inévitable. Des troubles, des désordres, se produisaient en Balagne et à Cervione ; le Directoire du département laissait brûler et saccager les demeures et propriétés des adversaires de Paoli.
Les commissaires de la Convention répondirent à ces tentatives d’émeute par la suspension du Conseil Général et du Directoire du département, la révocation de Léonetti, colonel de gendarmerie, la dissolution des quatre bataillons de volontaires nationaux.
Cependant Paoli, effrayé de la tournure grave que prenaient les événements, voulut tenter un dernier appel à la conciliation ; il demandait aux commissaires de la Convention, le 15 mai, le renvoi de Saliceti qui était en Corse « pour se faire un parti », qui « avait la maladie insensée de vouloir être le gouverneur de la Corse. » ; il les prévenait que Saliceti les tenait dans « l’ignorance des faits », qu’il les faisait entourer « du petit nombre de personnes intéressées à le tromper », les « Bonaparte, les Pompéi, et autres de cette trempe dont la vile intrigue était suffisamment connue ». Il terminait en leur donnant l’assurance que tout rentrerait dans l’ordre après le départ de Saliceti.
Les commissaires de la Convention ayant dédaigné de répondre, le Conseil Général adopta la convocation d’une Assemblée des Communes à Corté, le 26 mai 1793, afin « d’aviser aux moyens les plus propres pour préserver la Corse de l’anarchie et des désordres dont elle était menacée ».
Les réunions de la Consulte eurent lieu du 26 au 29 mai et les délégués Corses arrêtaient que Saliceti, Delcher et Lacombe Saint-Michel cessaient d’être reconnus comme commissaires de la Convention ; que le Conseil Général et le Procureur Général Syndic étaient maintenus dans leurs fonctions ; que Paoli était invité à veiller au maintien de la sûreté et la tranquillité publiques ; que les députés de la Convention étaient déchus de leurs pouvoirs, et enfin que « le peuple corse prenait sous la sauvegarde de sa bravoure et de sa loyauté la conservation et la défense de son territoire contre toute invasion ennemie et étrangère ». La rupture avec la France était ainsi consommée. A la séance de clôture, l’Assemblée votait, à l’unanimité une motion « infligeant aux individus composant les deux familles Bonaparte et Arena une flétrissure éternelle qui rendit leur nom et leur mémoire détestables aux patriotes du département ».
A Ajaccio, la famille Bonaparte vivait dans les transes. Le 25 mai, Costa, de Bastelica, l’informait qu’un détachement de paolistes se dirigeait vers Ajaccio, et qu’il avait ordre de s’emparer des Bonaparte. Letizia, Fesch, et les enfants, à l’exception de Jérôme et Caroline, escortés par des hommes en armes, quittèrent Ajaccio pendant la nuit et se réfugièrent aux Milelli.
A Bastia, le capitaine Bonaparte avait proposé aux commissaires de la Convention une expédition pour délivrer Ajaccio qui était au pouvoir des insurgés. L’escadrille destinée à opérer à Ajaccio appereilla à Bastia dans la nuit du 23 mai ; une forte tempête l’ayant secouée en mer, elle ne peut rentrer dans la golfe d’Ajaccio que le 29 mai ; Bonaparte inquiet sur le sort de sa famille, avait pris les devants sur un chabeck et était allé relâcher à Provenzale ; il débarqua à terre, se mit en communication avec des bergers qui lui annoncèrent que sa famille était en fuite, que sa maison et ses propriétés avaient été saccagées ; il leur demanda de battre la campagne dans tous les sens et de dire à sa mère d’aller le rejoindre à la tour du Capitello.
L’escadrille alla mouiller à la tour de Capitello, les commissaires de la Convention, Saliceti et Lacombe Saint-Michel, qui se trouvaient à bord de la Belette, firent des signes de ralliement aux troupes françaises et aux amis de la France. Personne ne bougea. Dans ces conditions, une attaque devenait inutile.
Le 3 juin, ils donnèrent l’ordre du départ. La famille Bonaparte, l’abbé Coti et quelques autres partisans de la France avaient pris passage sur les frégates françaises.
Les Bonaparte reçurent à Calvi, où ils arrivaient dans la soirée, l’hospitalité la plus affectueuse dans la famille Giubega. Le 10 juin, ils partaient pour la France. Ils se trouvaient dans le dénuement le plus complet.
Le capitaine Bonaparte arriva à Toulon, avec sa famille, le 13 juin 1793.
Il ne devait plus revoir la Corse qu’une seule fois, à son retour d’Egypte.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 13, 2007
BONAPARTE, LIEUTENANT-COLONEL DES GARDES NATIONALES DE LA CORSE
Dans le monde il n’y a qu’une alternative : commander ou obéir. On prétend que, pour bien savoir commander, il a fallu d’abord bien savoir obéir. Quelle erreur ! Je n’ai jamais obéi, moi, j’ai toujours commandé.
Le lieutenant Bonaparte arriva à Ajaccio vers la mi-septembre 1791 ; le 15 octobre, il avait la douleur d’assister à la mort, à l’âge de soxante-treize ans, de son grand-oncle, l’archidiacre Lucien, qui avait été pour les siens un véritable père ; il y avait nécessité pour lui, maintenant à rester en Corse. Dans ce but, il écrivit à son parent M. Rossi, maréchal de camp à Bastia, pour solliciter une place d’adjudant-major dans les bataillons de gardes nationales en formation. Sa nomination avait lieu en février 1792 ; mais sa joie fut de courte durée : M. Rossi lui notifia, dans les premiers jours de mars, qu’il ne pouvait plus occuper l’emploi d’adjudant-major auquel il l’avait destiné, parce qu’il était dans l’obligation, ainsi que tous les officiers en activité dans les troupes de lignes qui étaient maintenant employées dans les bataillons de gardes nationales, « de rejoindre son corps le 1er avril au plus tard ». Or, les lieutenants-colonels des bataillons de garde nationales étaient, par exception, dispensés de rentrer dans les régiments. En homme de décision rapide, il résolut, dans l’intérêt de sa famille, de se faire élire, coûte que coûte, un des lieutenants-colonels du bataillon qui avait pris garnison à Ajaccio le 1er mars.
Après le retrait des candidatures Pietrino Cunéo et Ludovic Ornano, les candidats en présence étaient Mathieu Pozzo-di-Borgo et Jean Peraldi, frères des députés à la Législative ; le lieutenant Bonaparte et Quenza, frère d’un membre de l’administration départementale.
Bonaparte s’allia à Quenza ; il lui laissait, en cas de succès, le commandement du bataillon et se reservait l’emploi de lieutenant-colonel en second.
Les trois délégués du département chargés de procéder aux élections, arrivèrent à Ajaccio dans la soirée du 30 mars. Il n’y avait en ville que de mauvaises auberges. Un des commissaires, Grimaldi, descendit chez son parent Fesch ; le second, Quenza, le frère du candidat avait été reçu par Ramolino, un parent de Letizia ; le troisième, Murati, avait été accaparé par Jean Peraldi, à son entrée en ville.
Grimaldi et Quenza étaient favorables au parti Bonaparte ; Murati devenait suspect, par suite de son séjour chez les adversaires. Or, de l’attitude des commissaires, de leurs préférences envers un candidat, dépendait l’issue de l’élection, car l’effet moral aurait été décisif sur les douteux qui attendaient la dernière heure pour se prononcer.
Dans la journée du 31, Bonaparte fut nerveux et inquiet. Pour sûr, confiait-il à quelques-uns de ses dévoués partisans, Murati, un de ses bons amis, avait été séquestré par les Peraldi ! Ne devait-on pas le délivrer ?
A la nuit tombante, trois montagnards, armés de pied en cape, se rendirent chez Peraldi, demandèrent à parler à Murati, et le contraignirent à les suivre, malgré les protestations de Peraldi, chez Bonaparte.
Le lendemain, les gardes nationaux s’assemblèrent à l’église Saint-François. Les commissaires avait pris un arrêté, dans la matinée, disant que les électeurs en armes n’auraient pas été admis dans la salle du vote. Dans les deux partis, on observa, en apparence, l’arrêté, mais chaque électeur avait dissimulé des armes sous ses vêtements.
Mathieu Pozzo-di-Borgo monta à la tribune. Il flétrit en termes violents, l’acte de brigandage commis la veille, qui entachait de nullité les opérations électorales. Lorsqu’il voulut passer aux instigateurs de cette manoeuvre, les partisans de Bonaparte, après avoir essayé vainement d’étouffer sa voix, le saisirent par les jambes, l’arrachèrent de la tribune, l’expulsèrent de la la salle.
Désormais la lutte n’était plus douteuse. Le calme se rétablit et on procéda aux élections. Quenza fut élu lieutenant-colonel en premier du deuxième bataillon de volontaires nationaux, Bonaparte Lieutenant-colonel en second.
Leurs amis se partagèrent les emplois de capitaines, lieutenants et sous-officiers.
Le 2 avril 1792, le 2e bataillon de gardes nationales, autrement dit le bataillon Quenza-Bonaparte était passé en revue par M. le colonel Maillard, du 42e de ligne.
En prenant le commandement effectif du bataillon, puisque Quenza était dépourvu de connaissances militaires, Bonaparte rédigea aussitôt, en quelques articles concis, « un règlement pour la police et le service » de ses hommes.
La lutte de ces derniers jours avait accentué la division intestine qui existait entre les ajacciens les habitants de l’intérieur. Les ajacciens traitaient dédaigneusement les gardes nationaux de paysans, c’est-à-dire de rustres.
D’autre part, la question religieuse passionnait l’opinion publique ; le bas peuple et les bonnes femmes étaient pour les pères capucins d’Ajaccio qui venaient d’être expulsés ; les patriotes, et en particulier les gardes nationaux, étaient pour les prêtres constitutionnels.
Le dimanche de Pâques, 8 avril, à la suite d’une dispute entre deux jeunes gens qui jouaient aux quilles, un conflit sanglant se produisit entre la population et les gardes nationaux ; le 8 avril, un garde national était blessé grièvement, et le lieutenant Rocca della Serra tué ; le lendemain, les gardes nationaux tuaient une veuve, une fillette de treize ans, blessaient mortellement l’abbé Peraldi, neveu du député à la Législative, blessaient à la cuisse le commissaire du roi Grandin, et, à la main Mlle Apostoline Comnène. Les troubles se prolongèrent jusqu’au 12 avril.
Au cours de ces événements tragiques, Bonaparte avait gardé l’esprit alerte, lucide. Il réussit à imposer à la municipalité d’Ajaccio une convention qui sauvegardait la dignité de ses hommes.
La présence des garde nationaux étant devenue impossible à Ajaccio, le bataillon Quenza-Bonaparte reçut l’ordre de se rendre à Corté. Paoli, qu’il était allé voir à Monticello, en vue d’un commandement dans les compagnies de volontaires qu’on allait lever, s’était montré très réservé ; du moment qu’il n’y avait plus rien à faire en Corse, il résolut de se rendre à Paris pour obtenir sa réintégration dan son régiment.
Bonaparte arriva à Paris le 28 mai. Il descendit à l’Hôtel des Patriotes hollandais, rue Royale, où logeaient les députés corses Pozzo-di-Borgo, Leonetti, et Peraldi, avec le dessein arrêté de circonvenir Pozzo et Peraldi, de regagner leur amitié, ou, tout au moins, d’atténuer leur hostilité.
Il avait quitté Valence, en 1791, le cerveau saturé de lectures, réfractaire déjà aux influences d’autrui, et ayant un esprit clair, organisé à ne recevoir de leçons que des faits, des observations directes sur la vie ; depuis il s’était mêlé à la foule ; il avait assisté à des élections, toisé les grands meneurs de la politique corse ; il avait vu les manoeuvres employées, la ruse, la force pour triompher, apprécié le rôle de l’argent dans le maniement des hommes, mesuré l’intensité des passions qui les mènent ; il avait observé Paoli, un héros, en qui s’alliaient la subtilité, la prudence, la fermeté, sous le déguisement d’une bienveillance inaltérable, d’un patriotisme éclairé ; et on n’était jamais sûr de pénétrer le fin fond de sa pensée ; il avait alors compris, ainsi qu’il l’écrivait à Pozzo en 1790, que les théories des philosophes doivent fléchir et s’adapter aux nécessités de la vie ; les élections de lieutenant-colonel et les troubles de Pâques avaient hâté son apprentissage des hommes ; on ne se dirigeait pas dans la vie comme une force abstraite mais, si on voulait réussir, on avait des intérêts à ménager, des passions à flatter, des ruses d’adversaires à déjouer ; en un mot, on devait rester maître de soi, réprimer la fougue de son tempérament, comprimer les élans de la franchise, tout subordonner à la froide raison. Maintenant, à vingt-trois ans, tout enthousiasme irréfléchi était éteint en lui ; il calculait ses actes avec prudence, saisissait d’un esprit délié, l’écheveau embrouillé d’une combinazione, se pliait au gré des circonstances ; mais il avait gardé de la fougue initiale de son tempérament, la décision prompte, le coup d’oeil rapide et d’ensemble. La forme de ses lettres elle-même se modifiait ; sa phrase acquérait de la concision, se débarrassait de toutes les superfluités du style.
Bonaparte comprit, à l’accueil poli, mais froid, de Pozzo qu’il n’avait pas à compter sur son concours ; il apprit d’autre part, que Peraldi avait manifesté l’intention de se rendre expressément au bureau de l’artillerie pour déposer une plainte sur le rôle qu’il avait joué à Ajaccio. Pour paralyser l’action de Peraldi, il rendit visite à Barthélemy Arena, gagna sa confiance ; Arena était le seul député corse affilié aux Jacobins ; il pouvait donc disposer d’un grand crédit auprès du Ministère.
Il n’était bruit à Paris que d’une contre-révolution militaire. Bonaparte, l’esprit perpétuellement en éveil, lisait les feuilles publiques, suivait les événements d’un oeil clairvoyant, mais restait réfractaire à l’ambiance des passions déchaînées, dominé surtout par le besoin d’éclaircir, de comprendre le comment et le pourquoi des choses.
Il assista, en observateur lucide, à la Journée du 20 juin et à celle du 10 août.
Le 10 juillet, le Minsitre de la Guerre lui annonçait qu’il était réintégré dans on régiment avec le grade de capitaine, et il exprima le désir « qu’il abandonnât la garde nationale pour se rendre à son régiment ». Or, le 10 août, M. d’Ablancourt, ministre de la guerre, avait été renversé sans avoir signé le brevet de capitaine de Bonaparte ; celui-ci renouvela avec insistance les démarches dans les bureaux, et enfin, le 30 août, Servan, le nouveau ministre de la guerre, lui délivrait, à la date du 6 février (jour légal de sa nommination à l’ancienneté), son brevet de capitaine au 4e d’artillerie, avec rappel de solde ainsi que l’ordre en avait été donné, le 10 juillet.
Par décret du 7 août, suivi d’un article additionnel du 16, la Législative avait voté la suppression de la maison Saint-Louis ; il était donc de toute urgence pour Bonaparte qu’il rentrât en Corse pour y conduire sa soeur Marianna. Dans le courant de septembre, il arrivait à Marseille, ; comme il n’y avait aucun bateau en partance pour Ajaccio, il se rendait à Toulon, y apprenait l’abolition de la Royauté et la proclamation dela République, par décret du 21 septembre ; dans les premiers jours d’octobre, il débarquait à Ajaccio.
Son arrivée causa un événement en ville ; ses adversaires avaient escomptés sa comparution devant une cour martiale, et il rentrait à Ajaccio, à l’âge de vingt-trois ans, avec le grade capitaine. Ses partisans lui écrivaient pour lui exprimer « le vif désir qu’ils avaient de l’embrasser » ; les officiers de son bataillon lui faisaient part que tout allait à l’abandon ; il répondait que « dorénavant il serait là et que tout marcherait comme il faudrait ».
La situation de la Corse était critique. Le Directoire du département, composé en majeure partie, de jeunes gens inexpérimentés, avait accumulé les fautes, désorganisé les services administratifs.
Paoli, qui, il y a un an, était l’idole des Corse, avait fait de nombreux mécontents. Les frères Arena sapaient vigoureusement son autorité ; les Bonaparte, irrités de l’échec subi par Joseph aux élections des députés à la Convention qui avaient eu lieu du 17 au 22 septembre, plus irrités encore de la désignation, fin décembre 1792, de Pozzo-di-Borgo comme procureur général syndic du Département, avaient noué des intelligences avec Saliceti, qui visait à supplanter Paoli.
Sur les ordres du Conseil exécutif, Paoli, nommé le 11 septembre, commandant en chef de la 23e division militaire, faisait pousser activement, depuis le mois d’octobre, l’organisation d’une expédition contre la Sardaigne ; le bataillon Quenza-Bonaparte devait opérer une diversion à la Maddalena tandis qu’une attaquz serait dirigée contre Cagliari ; l’attaque de Cagliari, commandée par l’amiral Truguet (15-26 février 1793) et la contre-attaque de la Maddalena, commandée par Colonna-Césari (22-26 février 1793) échouèrent piteusement ; les troupes de débarquement étaient composées de volontaires marseillais, pour la plupart des gamins de quinze à seize ans, qui n’avaient jamais vu le feu ; ils furent pris d’une terreur panique dès les premiers engagements. Le capitaine Bonaparte qui commandait en chef l’artillerie à la Maddalena dut abandoner un mortier au pouvoir de l’ennemi.
Le 2 mars, Bonaparte envoyait au Ministre de la Guerre une protestation au sujet de « l’abandon » de la Madeleine. Après quatre jours de lutte, disait-il, où l’artillerie avait incendié un chantier de bois, écrasé quatre-vingt maisons, démonté l’artillerie ennemie, alors que les volontaires occupaient un « poste avantageux », ils recevaient l’ordre de Colonna-Césari de se « retirer promptement », ce qu’ils firent le coeur rempli de « confusion et de douleur ».
Il terminait en ces termes : « Voilà le récit fidèle, citoyen ministre, de cette honteuse expédition. Nous avons fait notre devoir et les intérêts comme la gloire de la République exigent que l’on recherche et l’on punisse les lâches et traîtres qui nous ont fait échouer ».
Quelques jours après, il était rentré à Ajaccio.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 11, 2007
LE LIEUTENANT BONAPARTE A AUXONNE ET A VALENCE
Je crois l’amour nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes. Enfin, je crois que l’amour fait plus de mal que de bien.
En arrivant à Auxonne, le premier soin de Bonaparte fut de publier sa Lettre à Buttafoco. Il traita avec M. Joly, imprimeur à Dôle ; le tirage de sa brochure qui avait été fixé à cent exemplaires était terminée le 15 mars. Le lendemain, il l’expédiait au Club patriotique d’Ajaccio et il en adressait quelques exemplaires à Paoli. Le 2 avril, Paoli accusait réception de son envoi au lieutenant Bonaparte. Il se méfiait du zèle intempestif de son fougueux apologiste et lui conseillait la mesure, la modération : « Ne vous donnez pas la peine, lui écrivait-il, de démentir les impostures de Buttafoco ; cet homme ne peut avoir de crédit auprès d’un peuple qui a toujours estimé l’honneur et qui maintenant a recouvré sa liberté ». Il écrivait au surplus, à Joseph, que la brochure de son frère « aurait fait plus grande impression si elle avait dit moins et elle avait montré moins de partialité ».
Le lieutenant avait amené avec lui à Auxonne son frère Louis dont il dirigeait l’éducation en vue de le faire entrer dans l’artillerie. Il avait repris ses études de garçon studieux ; il lisait de nombreux ouvrages d’histoire, en tirait d’abondantes notes ; il était recherché dans les salons libéraux d’Auxonne pour la crânerie et la véhémence de ses idées révolutionnaires.
Le 1er juin 1791, il était nommé lieutenant en premier au 4e régiment de Valence. Sa solde était augmentée d’environ deux cents livres. Le 14 juin, il partait pour sa nouvelle garnison.
A valence, Bonaparte fut heureux de retrouver son logement chez Mlle Bou, et il pris pension, comme autrefois, à l’hôtel des Trois pigeons où se réunissaient messieurs les officiers.
A peine arrivé, il se fit admettre, avec d’autres camarades, à la société des Amis de la Constitution. Le soir même, il prononça un discours vibrant qui lui valut d’unanimes applaudissements. On le nomma secrétaire.
Les événements le tenaient surexcité. On parlait, en termes vagues, d’un vaste complot organisé à l’étranger par les émigrés pour étouffer, de concert avec les grandes puissances européennes, la Révolution. Des désertions en masse se produisaient dans l’armée.
Le lieutenant Bonaparte se montrait assidu à la Société des Amis de la Constitution, se mêlait aux agitations de la rue, sans cesser d’être avide de savoir. Il prolongeait souvent la veillée, une fois rentrée dans sa chambre, à lire avec voracité ou à écrire pour atténuer son violent désir d’action.
A la suite de l’évasion du roi, le 3 juillet 1791, après avoir signé, par écrit, le 6 juillet, le Serment civique, il le réitéra, le 14 juillet, au Champs de Mars de Valence, tandis que beaucoup d’officiers préféraient émigrer plutôt que de violer la foi en leur roi.
L’inaction l’énervait ; son esprit était enfiévré par des bouillonnements de pensées. Depuis des mois, il avait concentré ses méditations sur le sujet de concours proposé, en 1790, par l’Académie de Lyon, sur les vérités et les sentiments à inculquer aux hommes pour les rendre heureux. Précisément, les limites fixées par ce concours allaient expirer fin août ; il se mit à relire le discours de Rousseau sur l’inégalité, afin de rafraîchir les idées sur sa conception du bonheur ; mais il n’était plus le petit jeune homme candide, enthousiaste, du premier séjour à Valence ; il avait démonté le mécanisme, comparé les civilisations des peuples anciens et modernes ; il avait promené son regard sur la vie, pénétré au fond de l’âme des hommes, scruté les passions qui les font agir ; son esprit avait mûri, il s’était enrichi de faits, d’observations directes ; il relisait donc Rousseau, mais il le relisait avec un esprit indépendant ; en reproduisant sur son cahier de notes les idées de Rousseau qui l’avaient frappé, il griffonnait en marge : Je ne crois pas cela, je ne crois rien de tout ceci, et, à la fin , exaspéré par les sophismes du philosophe genevois, il écrivait d’un trait une dissertation intitulée : Mes réflexions sur l’état de la nature ».
Puis, tout plein de son sujet, il commençait la rédaction de son mémoire, remplissait, d’abondance, plus de soixante feuillets in-folio. Il y mettait sa sensibilité frémissante, ses rêveries tumultueuses, ses idées sur l »homme et la Société, montrait son âme à nu, débordante de passion. Sa pensée commençait à s’affranchir de l’influence de ses maîtres ; sa forme restait encore hésitante, n’était qu’une pâle imitation de Rousseau et de l’abbé Raynal qui l’avaient saturé de leur jargon littéraire ; cependant sous les oripeaux, la phraséologie creuse de l’abbé Raynal, la mémoire de Bonaparte laissait entrevoir un esprit logique, vigoureux, ayant des idées nettes sur les grands problèmes de l’humanité, un fervent admirateur de Paoli, convaincu, comme les Corses d’autrefois, que la liberté et le patriotisme devaient être le fondement des sociétés.
Dans le feu du travail, il avait eu connaissance du décret du 12 août qui ordonnait la levée, en Corse, de quatre bataillons de gardes nationales. Son mémoire achevé, expédié, il éprouva le désir de se trouver au milieu de ses compatriotes où il pourrait obtenir, à l’exemple de quelques-uns de ses camarades, un grade élevé dans les nouveaux bataillons.
Grâce au bienveillant appui de M. le baron du Teil, maréchal de camp et inspecteur d’artillerie, il put obtenir une permission de trois mois avec solde. Dans les premiers jours de septembre, il se mit en route pour la Corse avec son frère Louis.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 10, 2007
BONAPARTE MELE AU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN CORSE
Il est plus facile d’arrêter de parler politique de que de modérer.
Dès les premiers mouvements révolutionnaires, MM. le comte de Buttafoco et l’abbé Peretti, députés corses pour la noblesse et le clergé aux Etats-Généraux, écrivaient à leurs partisans pour leur recommander le calme et la modération ; ils affirmaient que l’ordre n’allait pas tarder à renaître ; les deux députés du tiers, MM. Saliceti et Colonna-Cesari, au contraire, pressaient leurs amis de s’emparer du pouvoir, de donner autorité pleine et entière aux municipalités, de former des milices nationales, comme cela se faisait partout en France.
Le lieutenant Bonaparte, à peine arrivé à Ajaccio, prit l’initiative de la formation d’un Comité Patriote de trente-six membres ; il se montrait enthousiaste de « l’heureuse révolution qui avait rendu l’homme à ses droits » et dénonçait les fonctionnaires français qui avaient maintenu pendant « vingt ans les Corses dans l’esclavage ».
La formation des milices nationales, à laquelle s’étaient montrés hostiles Buttafoco et l’abbé Peretti, occasionna un grand tumulte, le 30 octobre, à Ajaccio, des troubles sanglants, le 5 novembre, à Bastia ; une délégation du Comité Patriotique de Bastia se rendait à Paris, faisait connaître qu’aucun décret de l’Assemblée nationale n’avait été publié jusqu’à ce jour en Corse ; dans sa séance du 30 novembre 1789, l’Assemblée déclarait que la Corse faisait partie de l’Empire français », et votait ensuite un décret d’amnistie en faveur des « Corses qui, après avoir combattu pour la Liberté, s’étaient expatriés par l’effet et la suite de la conquête de leur île ».
Le grand proscrit corse, Pascal Paoli, arrivait à Paris le 3 avil 1790 ; il était reçu par Mirabeau et Lafayette comme un « héros et un martyr de la Liberté », il était présenté au Ministre de la guerre, au Roi, à la Cour, et il était l’objet d’une réception enthousiaste à la société les Amis de la Constitution, présidée par Robespierre.
Des conflits violents se produisaient en Corse entre les royalistes et les révolutionnaires ; le 18 avril 1790, le comte de Rully, colonel du Maine, était assassiné à Bastia ; le 25 juin, MM. de Cadenol, ingénieur des ponts et chaussées, et Raquine, juge royal, Lajaille, directeur de l’artillerie, Descamps, directeur de l’hôpital militaire « fauteurs de l’aristocratie », qui « parlaient et agissaient contre la Constitution », étaient mis en état d’arrestation par la municipalité d’Ajaccio ; ce coup de force avait été exécuté par le lieutenant Bonaparte ; son âme débordait d’enthousiasme pour la liberté, pour Paoli, sa plus haute personnification en Corse, et il se sentait disposé à tout oser pour assurer le triomphe des idées nouvelles.
Pascal Paoli débarquait à bastia le 17 juillet 1790 ; le lieutenant Bonaparte alla lui présenter ses hommages ; dans la nouvelle organisation administrative, son frère Joseph était élu, le 12 octobre, président du directoire du district d’Ajaccio.
Le congé du lieutenant Bonaparte, qui avait été prorogé de quatre mois et demi en avril 1790, venait à expiration à la fin de novembre, et il n’attendait « qu’un vent favorable pour s’embarquer » ; sur ces entrefaites, on apprenait, par le Moniteur que, dans la séance du 6 novembre, Buttafoco avait prononcé une violente diatribe contre Paoli et ses sectateurs « des hommes audacieux qui se couvraient du masque du bien public » pour répandre les « impostures », « emprisonner les citoyens », « mettre leur volonté à la place des décrets de l’Assemblée ».
Le « Club Patriotique » d’Ajaccio, qui était affilié aux Jacobins de Paris, donnait mission au lieutenant Bonaparte, dans sa séance du 6 janvier 1791, de stigmatiser dan un écrit « les infâmes calomnies » de Buttafoco.
Le lieutenant Bonaparte terminait son travail le 23 janvier. Il en donnait lecture dans la séance du soir ; c’était intitulé : Lettre de M. Bonaparte à M. Buttafoco, député de la Corse à l’Assemblée nationale.
Bien qu’il se fut promis de raisonner avec « flegme », il rééditait toutes les basses calomnies des Paolistes contre Buttafoco ; il le traitait de « vendu », de « lâche », de « traître », d' »égoïste ».
Ces violences sans mesure charmèrent les membres du Comité patriotique qui votaient l’impression de l’ouvrage parce que l’auteur, suivant les termes du président Masseria « avait dévoilé avec autant de finesse que de force et de vérité « les infâmes calomnies de Buttafoco ».
Le lendemain, Bonaparte partait pour son régiment.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 9, 2007
BONAPARTE, LIEUTENANT D’ARTILLERIE
Quand j’avais l’honneur d’être lieutenant en second, je déjeunais avec du pain sec, mais je vérouillais ma porte sur ma pauvreté.
Séjours à Valence, en Corse, à Auxonne
Bonaparte était rendu à Valence dans les premier jours de novembre 1785. Il avait un billet de logement pour Mlle Bou qui demeurait à l’angle de la Grand’Rue et de la rue du Croissant. Il prit pension à l’Hôtel des Trois Pigeons où se réunissaient MM. les lieutenants.
Durant les premiers mois de son séjour à Valence, Bonaparte fut absorbé par l’apprentissage de son métier d’artilleur. Sur la recommandation de Monseigneur de Marbeuf, il avait été reçu chez Monseigneur de Tardivon, abbé de Saint-Ruff, où se réunissait la haute société valentinoise ; il fut ainsi admis dans l’intimité de Mlle du Colombier, de Mlle de Laurencin et de Mlle de Saint-Germain.
Mais le jeune Bonaparte était tourmenté par un besoin d’activité. M. Aurel, libraire, tenait un cabinet de lecture au rez-de-chaussée de son logement. Il se mit à lire fièvreusement ; Joseph lui avait envoyé des ouvrages sur la Corse ; il prit connaissance de de Boswell et de nombreux mémoires écrits par les Français au moment de la conquête de l’île. Sa sympathie allait d’un élan vers les écrivains qui parlaient de la Corse avec admiration : l’abbée Raynal et Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau l’enivrait de sa corrosive éloquence, Rousseau marquait sur son esprit l’empreinte de son âme inquiète. D’ailleurs, n’y avait-il pas d’affinités entre eux ? Les majestueuses montagnes suisses de Rousseau n’avaient-elles pas une étroite parenté avec ses montagnes corses ? Comme Rousseau, n’avait-il pas palpité, son âme ne s’était-elle pas éclose à la lecture de Plutarque ? N’avait-il pas, aussi, comme lui, « cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de joug et de servitude », que Rousseau indique dans ses Confessions ?
Ainsi le lieutenant Bonaparte passait les loisirs que lui laissait son service militaire dans la méditation et le rêve. Ses méditations et ses rêves, étaient circonscrits, par inclination d’âme, à la patrie, aux institutions des peuples et des gouvernements.
Le 1er septembre 1786, il partait en congés de semestre pour Ajaccio.
Il arriva dans sa ville natale le 15 septembre, « après une absence de sa patrie de sept ans, neuf mois, et âgé de dix-sept ans un mois », ainsi qu’il l’a consigné lui-même dans une note intime de jeunesse.
Sa grande joie était de faire des excursions dans les environs d’Ajaccio. Son passé d’enfant revivait à son esprit. A l’exemple de Rousseau, il goûtait le charme, le « sentiment » de la nature. Ses habitudes étaient restées celle d’un « jeune homme appliqué et studieux » ; il avait apporté à Ajaccio une caisse de livres qui était de bien plus grandes dimensions que celles contenant ses effets.
Les intérêts de la famille faisait l’objet de sa constante sollicitude. Sa mère était créancière de 3.050 livres envers l’Etat pour la pépinière de mûriers et, en mai 1786, l’Administration avait résilié son contrat avec la veuve Bonaparte et cessé toute avance. Il adressa une requête à l’intendant M. de la Guillaumye, qui fit preuve de mauvais vouloir. La solution de l’affaire de la pépinière réclamait sa présence en Corse. Le 21 avril 1787 il demandait et obtenait un congé de cinq mois et demi, pour raison de santé, avec appointements, puis, en septembre, une prolongation de six mois sans appointements, à compter du 1er septembre 1787. Le 12 septembre il s’embarquait pour Paris avec l’idée arrêtée d’exposer l’affaire de la pépinière à M. le Contrôleur général lui-même et tâcher d’en obtenir la liquidation, une bonne fois pour toutes.
Mais au contrôle il n’existait aucune pièce relative à la pépinière d’Ajaccio. Le 1er janvier 1788 il était retour à Ajaccio ; il se rendit à Bastia, demanda une audience à M de barrin, commandant en chef de la Corse, puis à M. de la Guillaumye, mais il ne put obtenir que de vagues promesses tant pour l’affaire de la pépinière que pour celle du dessèchement des Salines.
Le 1er juin 1788, à l’expiration de son congé, il se mettait en route pour Auxonne, la nouvelle garnison de son régiment.
Pendant son séjour à Auxonne, d’une durée de plus d’un an, le lieutenant Bonaparte fait preuve d’une très grande activité cérébrale ; il suit avec une assiduité exemplaire les cours de l’école d’artillerie d’Auxonne, placé sous la direction de M. le baron du Teil, maréchal de camp, attire sur lui l’attention de ses professeurs, et, à la clôture du Cours de pratique, en septembre 1788, il se remet avec ardeur à ses études favorites. Il lit, la plume à la main, de nombreux livres d’histoire, ancienne, anglaise, histoire de France, histoire des arabes, histoire de Prusse, etc… , se préoccupe d’en dégager des faits précis, significatifs, s’exprimant par des chiffres ; il écrit deux nouvelles historiques, le Comte d’Essex, tirée de l’histoire d’Angleterre, le Masque Prophète, tirée de l’histoire des Arabes, et trace, sous forme de lettres, une esquisse de l’histoire de la Corse.
Le 5 mai 1789, les Etats-Généraux se réunissaient à Versailles. Une grande agitation se produisait dans le pays. Le moment propice lui semblait venu de faire paraître ses Lettres sur la Corse, d’éclairer M. Necker, le ministre philosophe, sur l’état lamentable de l’île, de « noircir du pinceau de l’infamie » la « cohorte d’employés français » qui administrait l’île.
Mais les événements se précipitaient ; le 17 juin, le tiers état s’était séparé des deux autres ordres et s’était constitué en Assemblé nationale ; le 20 juin avait lieu la séance du Jeu de Paume ; le 14 juillet la prise de la Bastille ; le 16, le départ de Paris des princes et seigneurs de la Cour ; le 17, l’acceptation par le roi de la cocarde tricolore.
Les contre-coups de la Révolution se répercutaient, en juillet, à Auxonne. Le lieutenant Bonaparte se demandait si la Corse n’allait pas bénéficier de ce mouvement révolutionnaire, récouvrer même son indépendance !
Le 8 août, il demandait à jouir de son semestre d’hiver, ainsi qu’il y avait droit d’après les règlements ; le 21 août, le Ministre de la guerre lui accordait le congé sollicité ; le lieutenant Bonaparte arrivait à Ajaccio dans les derniers jours de septembre 1789.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
BONAPARTE ELEVE AU COLLEGE D’AUTUN, A L’ECOLE DE BRIENNE, A L’ECOLE MILITAIRE DE PARIS
De toutes les institutions, la plus importante est l’institution publique. Tout en dépend, le présent et l’avenir.
Napoléon et Joseph entrèrent au collège d’Autun le 1er janvier 1779. Ils furent aussitôt l’objet des taquineries de leurs jeunes camarades. Joseph ne paraissait guère s’en émouvoir, mais le petit Napoléon, les nerfs frémissants, les déconcertait par son impétuosité ; on ne tarda guère à le laisser tranquille.
Le collège d’Autun était dirigé par des séculiers depuis la suppression des Jésuites. Les petits Corses furent confiés à l’Abbé Chardon qui leur donna des leçons de français ; au bout de trois mois, le petit Napoléon avait appris le français de manière à faire librement la conversation et même de petits thèmes et de petites versions.
Le 28 mars 1779, le prince de Montbarey, ministre de la guerre, donnait avis à Charles Bonaparte que son fils était admis à l’école militaire de Brienne. Le petit Napoléon quitta le collège d’Autun le 21 avril. Après un séjour de trois semaines au château de Thoisy-le-Désert qui appartenait au père de son camarade J.-B. de Champeaux, il faisait son entrée au collège de Brienne le 15 mai 1779.
Le personnel enseignant du collège royal de Brienne était composé de religieux Minimes, auxquels étaient adjoints des professeurs laïques pour l’étude des mathématiques, de l’allemand et des arts d’agrément.
Après avoir passé avec satisfaction son examen d’entrée, le jeune Bonaparte fut placé en septième. Il fut un objet de curiosité pour les jeunes nobles qui se trouvaient dans la classe. Son accent corse, sa façon d’estropier les mots français, mettait la classe en gaîté. A l’appel de son nom, ayant prononcé à l’ajaccienne, Nabulioné de Bonaparte, on l’affubla du sobriquet de Paille-au-nez. Comme à Autun, on le plaisanta sur Paoli, sur la conquête de la Corse. Ces innocentes espiègleries l’exaspéraient ; son amour de la Corse s’enfiévrait au choc des persécutions dont il était l’objet. Il se promenait constamment seul, à l’heure des récréations, demeurait étranger à tous les jeux, et sa pensée se reportait avec force vers son pays natal ; le climat froid, humide, de la Champagne, lui causait des malaises. Il éprouvait l’âpre nostalgie du chaud soleil d’Ajaccio, de son ciel pur, de sa mer bleue. Ce n’était qu’un pauvre exilé !
Cependant ce petit garçon taciturne, ombrageux, faisait des progrès rapides.
Aux exercices publics de 1781, il brillait par ses réponses en arithmétique et en géométrie ; l’histoire et la géographie le passionnaient, attiraient sur lui l’attention de ses maîtres ; c’est qu’avec les héros de l’antiquité s’ouvrait au rêve sa pauvre âme comprimée ; dans ces mâles Spartiates, surtout, il reconnaissait des êtres d’énergie et de courage comme il y en avait dans son île. En 1782 il tenait la tête de sa classe en mathématiques ; sur les conseils de M. de Marbeuf, il avait tourné ses études vers la marine ; M. de Keralio, sous-inspecteur des écoles royales, lui avait donné l’assurance qu’à la prochaine inspection il serait désigné soit pour l’école militaire de Paris, soit pour le département de Toulon. L’inspectiond e 1783 fut passée par M. Raynaud des Monts, qui avait remplacé M. de Kéralio ; il ne désigna que deux élèves de Brienne pour passer à l’école de Paris et ils étaient tous deux d’un an plus âgés que Bonaparte qui n’avait que quatre ans de séjour à l’école, au lieu de six exigés par les règlements.
Charles Bonaparte éprouva une vive déception en apprenant que son fils n’avait pas été compris dans la promotion pour l’école de Paris. Il y comptait si fermement qu’il avait mis en pension à Autun, à ses frais, le jeune Lucien, pour être prêt à remplacer Napoléon à Brienne cette année là. Ils e trouvait aux prises avec de graves difficultés d’argent ; il avait obtenu, en 1782, la direction de la pépinière de mûriers créée à Ajaccio ; l’entreprise de desséchement des Salines où devait être établie la pépinière, ne lui avait occasionné que des déboires ; l’affaire Odone traînait en longueur ; sur les conseils de l’intendant, il se bornait à demander « la préférence d’un bail emphythéotiques de la campagne dite des Milelli et de la maison Badine moyennant une légère redevance ». Il menait un train de maison important, surtout aprè avoir recueilli, en 1780, la succession d’un parent de San Miniato, avait cuisinière, nourrice, femme de chambre ; la naissance de Paola-Maria, en 1780, et de Marie-Nunziata (Caroline) en 1782, avaient encore augmenté ses charges. Sa santé au surplus, s’altérait visiblement. Il souffrait de maux d’estomac très violents, suivis, après le repas, de vomissements rebelles.
Charles Bonaparte prit la résolution de se rendre à Paris ; il se mit en route avec sa fille Marie-Anne qui avait été admise, en novembre 1782, à Saint-Cyr, il se rendit directement à Autun, retira Lucien du Collège, et l’emmena avec lui à Brienne où il arriva le 21 juin 1784. Il entretint longuement le petit Napoléon de la Corse, des parents, des amis, des inquiétudes que lui causait Joseph qui, après avoir dirigé son éducation vers l’état ecclésiastique, manifestait le désir de suivre la carrière militaire.
Charles Bonaparte quitta Brienne le 22 juin, se rendit à Versailles, plaça Marie-Anne à Saint-Cyr, consulta sur sa santé, M. de la Sonde, médecin de la Reine, gagna ensuite Paris pour faire agréer Lucien comme élève du roi, à la place de Napoléon, puis, comme l’état de sa santé s’aggravait, il rentra en Corse précipitamment sans avoir eu le temps de repasser par Brienne.
Le jeune Bonaparte qui avait été déçu dans ses espérances pour la marine à l’inspection de 1783, avait maintenant tourné ses études ves l’artillerie. Le sous-inspecteur des écoles, M. Raynaud des Monts arriva à Brienne le 16 septembre 1784. Bonaparte fut interrogé le 22 septembre et il fut jugé digne de passer à l’école de Paris. M. le marquis de Timbrune lui donnait avis, le 22 septembre, que le roi le nommait à une place de cadet-gentilhomme dans la compagnie de cadets-gentilhommes établi à son école ».
Il faisait son entrée à l’école militaire de Paris le 30 octobre 1784. Bonaparte apportait dans ce milieu de jeunes adolescents enthousiastes, qui rêvaient de leurs prochains galons d’officiers, son esprit grave, net, réfléchi, sa susceptibilité de Corse farouche.
Dans le feu du travail, il apprenait que son père venait de mourir à Montpellier, où il était allé consulté des sommités médicales, le 14 février 1785, à peine âgé de trente neuf ans. Sa douleur fut vive et profonde.
Les examens d’artillerie eurent lieu à l’école de Paris du 6 au 12 septembre 1785 ; la liste du concours paraissait à la fin septembre ; la promotion comptait cinquante-huit élèves : Bonaparte fut reçu avec le numéro 42 ; le 28 septembre parurent les promotions qui portaient la date du 1er septembre ; Bonaparte était nommé lieutenant en second au régiment de la Fère-artillerie à Valence, et affecté à la compagnie de bombardiers d’Autume.
Le 3 octobre, il se mettait en route pour Valence.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
septembre 7, 2007
L’ENFANCE DE NAPOLEON
Je naquis quand la patrie périssait.
Les Corses qui avaient résisté aux invasions des peuples étrangers, Romains, Goths, Vandales, Sarasins, et lutté contre Gênes pendant des siècles pour défendre leur indépendance, qui avaient même réussi, en 1755, à constituer un gouvernement national avec Pascal Paoli, durent subir la loi du plus fort avec les Français qui leur infligèrent une sanglante défaite à Pontenuovo, le 8 mai 1769.
Pendant que les colonnes mobiles parcouraient la Corse pour obtenir le désarmement général des « rebelles », le 15 août 1769, à onze heures du matin, naissait à Ajaccio, dans une modeste maison de la rue Malerba, un enfant qui reçut le prénom de Napoléon, en souvenir d »un oncle de son père, mort à Corté, deux années auparavant. Son père s’appelait Charles Bonaparte, et sa mère Letizia Ramolino. Charles avait vingt-trois ans, Letizia dix-neuf. Ils étaient mariés depuis cinq ans ; le nouveau né était leur quatrième enfant ; d’eux d’entre eux étaient morts en bas-âge.
Charles Bonaparte était un ancien secrétaire du gouvernement de Paoli qui avait pris une part active à la guerre de l’indépendance, et il n’avait consenti à mettre bas les armes qu’à la suite du départ du chef corse. C’était un beau et grand garçon, aimable, spirituel, aimant le luxe et tournant avec facilité le vers italien en des poésies légères. Il appartenait à une des plus notables familles ajacciennes. Un de ses ancêtres, originaire de Sarzane, et issu, prétendait-il, d’une famille patricienne de Florence, avait émigré à Ajaccio au début du XVIème siècle, au moment de la fondation de cette ville par les Génois. Ses descendants y menèrent uniformément, pendant près des deux siècles de leur enracinement en Corse, une existence de petits propriétaires terriens, à peine relevé par une charge de notaire, qu’on se transmettait de père en fils ; ils se montrèrent remuants, actifs, ambitieux, se firent élire, sans interruption, de père en fils, membres du conseil des anciens d’Ajaccio (1) souvent même orateurs (2) auprès du Sénat de Gênes, s’allièrent aux familles marquantes de l’île et se firent reconnaître, par acte authentique le 28 juin 1759, par les Bonaparte de Florence. Aussi voyait-on au XVIIIe siècle leurs armes à l’entrée de leur maison familiale de la rue Malerba, un écusson fendu par deux barres et deux étoiles avec la lettre B. P. , lesquelles armes, surmontées de la couronne de comte, étaient les même que celles des Bonaparte de Florence, qui jouissait du patriciat, et comptait parmi la haute noblesse de Toscane ; aussi bien, enfin, depuis cette époque, orthographiaient-ils leur nom Buonaparte, comme la branche de Toscane.
Letizia Ramolino était la fille unique de Jean-Jérôme Ramolino, chargé des routes et pont de l’île au nom de la République Sérénissime, et d’Angèle-Marie Pietra-Santa, d’une vieille famille corse, qui s’était remariée en secondes noces, en 1757, avec un officier suisse le lieutenant François Fesch, originaire de Bâle, du régiment de Bouard, en garnison à Ajaccio.
Elle s’était montrée ardente patriote, comme toute les femmes corses de l’époque, et malgré sa jeunesse, elle laissait percer dans tous ses actes un esprit viril. A la cessation des hostilités, elle avait refusé un sauf-conduit pour Bastia que lui avait fait parvenir son grand-père, J.-M. Pietrasanta, un des membres du conseil supérieur, s’était réfugiée avec son mari sur les hauteurs du Monte-Rotondo, puis avait entrepris, quoique dans un état de grossesse avancée, le long et rude voyage d’Ajaccio en passant par la province de Vico pour éviter les postes français.
Dans la maison Bonaparte, on était nombreux autour de la table familiale : outre Charles et Letizia, il y avait leur fils Joseph, âgé d’un an, né à Corté l’année précédente, la mère de Charles, Maria-Saveria, l’oncle Lucien, archidiacre à la cathédrale, la nourrice du nouveau né, Camille Carbone, femme d’un marin, Augustin Ilari, et une femme de charge.
Les ressources de la famille Bonaparte, très modestes, se trouvaient considérablement réduites par les dégâts des dernières guerres ; il est vrai qu’elle fondait de grandes espérances sur un procès en litige, la succession Odone qui comprenait le domaine des Milelli avec moulin à huile et bâtiment d’exploitation. Cet Odone était un parent éloigné de Charles ; il était mort sans héritiers et la succession qui lui revenait, prétendait-il de droit, avait été captée par les Jésuites, puis, à l’expulsion de ceux-ci de la Corse, en 1763, confisquée par le Roi.
Charles Bonaparte, avide de parvenir, se plia avec docilité à la conquête française. Pour être en mesure de bénéficier des faveurs du nouveau régime, il s’empressa de se rendre à Pise, se fit recevoir docteur en droit le 3 novembre 1769, et obtint le même jour confirmation de sa noblesse par lettres patentes de l’archevêque de Pise lui accordant l’exercice du titre de noble et de patrice. Admis, par la suite, à faire ses preuves de noblesse devant le Conseil Supérieur de la Corse, celui-ci, par arrêt du 13 septembre 1771, déclara la famille Bonaparte noble de noblesse prouvée au delà de deux cents ans.
La Corse fut érigée en pays d’Etat. Au moment de l’organisation des juridictions de l’île, en mai 1771, Charles Bonaparte fut nommé assesseur civil et criminel à la juridiction d’Ajaccio au traitement de 900 livres.
Letizia accoucha, le 2 juillet 1771, d’une fille qui reçut les prénoms de Marie-Anne. Le petit Napoléon n’avait pas été qu’ondoyé ; on en profita pour baptiser, le 21 juillet, les deux enfants à la fois.
En 1773, les Bonaparte placèrent le petit Napoléon dans une école mixte tenue par des soeurs qui occupaient l’ancien établissement des Jésuites.
A la maison, on était en proie à des embarras d’argent. Charles se liait avec de hauts fonctionnaires français, était toujours en mouvement, tenait à paraître, dépensait au delà de ses revenus. La naissance d’un garçon, Lucien, le 21 mars 1775, puis d’une fillette, le 3 janvier 1777, Marie-Anne, en mémoire d’une autre fillette du même nom, décédée quleques mois auparavant, à l’âge de cinq ans, ne firent qu’aggraver les charges de la famille.
Des factions avaient agité la Corse de 1772 à 1777, suscitées par le Comte de Narbonne, commandant en second à Ajaccio, qui voulait supplanter le Comte de Marbeuf, commandant en chef de l’île.
Charles Bonaparte s’était montré un partisan dévoué de Marbeuf. Celui-ci pour le récompenser de ses bons services, le fit élire, le 2 juin 1777, député à la cour pour la noblesse : Charles sut mettre à profit ses relations avec Marbeuf pour l’intéresser à l’admission d’un de ses fils, de préférence Napoléon, comme boursier dans une école militaire.
Le petit Napoléon, en effet, paraissait mieux destiné à l carrière militaire ; il était d’un tempérament vif, batailleur : on l’appelait Ribulione, le Perturbateur. Malgré les coups, les réprimandes, il persistait à vagabonder au bord de la mer, avec son frère de lait, Ignazio, le fils de sa nourrice, et à prendre part aux querelles des enfants de la vieille ville avec ceux des faubourgs. Il était élevé durement, à la Corse, et il se tenait en relations constantes avec les enfants du peuple, les gamins de son âge. On l’avait placé à l’automne 1777, au collège d’Ajaccio, dans une classe de l’abbé Recco.
L’amitié de Charles et du Comte de Marbeuf s’était ressérée. Marbeuf était reçu chez les Bonaparte, où il était l’objet d’attentions délicates lorsqu’il passait par Ajaccio pour se rendre à son marquisat de Cargèse. Quand, le 2 septembre 1778, Letizia accoucha d’un garçon qui reçut le prénom de Louis, le comte de Marbeuf et Mme de Boucheporn, la femme de l’intendant, acceptèrent de tenir le nouveau-né sur les fonds baptismaux.
Le petit Napoléon, n’avait fait jusqu’ici que des études en italien. D’après les nouvelles reçues du ministère de la guerre, sa nomination dans une école militaire était escomptée à bref délai.
Comme Charles devait se rendre à la Cour pour remplir son mandat de député de la noblesse, il décida d’emmener avec lui Napoléon et Joseph pour les placer, à ses frais, au Collège d’Autun, où ils se familiariseraient très vite avec la langue française. L’évêque d’Autun, Monseigneur de Marbeuf, était le neveu du commandant en chef de l’Ile, et il pourrait s’intéresser aux petits Corses.
Charles Bonaparte s’embarqua pour Marseille, le 15 décembre 1778, avec Joseph, Napoléon, Joseph Fesch qui venait d’obtenir une bourse au Séminaire d »Aix et l’abbé Varèse, un cousin de Letizia, nommé sous-diacre à la cathédrale d’Autun.
1. Les conseil des Anciens était chargé de l’administration de la ville.
2. Tous les ans, le Conseil des Anciens désignait une délégation d’un ou plusieurs membres qui, sous le nom d’orateurs se rendaient à Gênes pour exposer, devant le Sénat, les voeux de la cité.
(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)
août 22, 2007
LES REFUGIES DE LA GORGONA – NAPOLEON BONAPARTE
Je m’étais embarqué à Livourne pour me rendre en Espagne lorsque les vents contraires nous obligèrent de relâcher à la Gorgona. La Gorgona est un rocher escarpé qui peut avoir une demi-lieue de circuit. Il n’y avait aucun bon refuge mais, dans la nécessité où nous étions, nous fîmes comme nous pûmes, vu que notre navire faisait eau de plusieurs côtés.
Il est peu de situations aussi pittoresques que la position de cette île, éloignée de toute terre par des bras de mer immenses, environnée de rochers contre lesquels les vagues se brisent avec fureur. Elle est quelquefois le refuge du pâle matelot contre les tempêtes, mais plus souvent la Gorgona n’est pour eux q’un écueil où bien des navires ont souvent fait naufrage.
Fatigué des tempêtes que nous avions essuyées, je débarquai aussitôt avec des matelots. Ils n’avaient jamais vu cette île et ne savaient pas si elle était habitée. Arrivés à terre, j’emploie le peu de force qui me restait à la parcourir et ne tardai pas à me convaincre que jamais créature humaine n’avait habité un si stérile séjour. Je me trompais toutefois et je revins de mon erreur lorsque j’entrevis des pans de murailles demi-ruinées par le temps. Ils paraissaient avoir été bâtis depuis plusieurs siècles. Le lierre et d’autres arbrisseaux de cette espèce avaient tellement crû à leur abri qu’il était difficile d’apercevoir les pierres.
Je fis dresser une tente dans cette enceinte où avaient été jadis des maisons, pour pouvoir y passer la nuit. Les matelots couchèrent à bord et je me trouvai seul dans cette région. Cette idée m’occupa assez agréablement pendant une partie de la soirée. Je me trouvais, je puis le dire, dans un petit monde où bien certainement il y avait de quoi pourvoir à mon entretien, à l’abri des séductions des hommes, de leurs jeux ambitieux, de leurs passions éphémères. A quoi ne tenait-il que je n’y vécusse sinon heureux, du moins sage et tranquille ?…
Je m’endormis dans ces idées et l’on peut croire que je m’égalai plusieurs fois à Robinson Crusoé. Comme lui j’étais roi de mon île. Je n’avais pas encore achevé on premier somme quand la clarté d’un flambeau et des cris de surprise me réveillèrent. Mon étonnement se changea en crainte quand j’entendis que l’on criait en langue italienne : «Malheureux ! tu périras…»
Je n’avais pour toute arme que ma canne. Je l’empoigne en me jetant en bas de mon matelas. Je cherchais la porte que je trouvais embarrassée. Je réfléchissais au parti que je devais prendre lorsqu’on mit le feu à la tente en s’écriant : «Ainsi périssent tous les hommes !» L’accent avec lequel était prononcée cette horrible imprécation me glaça d’épouvante. Je me fis courage cependant et, demi étouffé par les tourbillons de fumée, je parvins à me débarrasser et à me mettre hors d’atteinte du feu. Je cherchai alors le lâche ennemi qui m’avait voulu sacrifier aussi inhumainement, mais je ne vis personne et n’entendis aucun bruit. Que l’on se figure ma situation !
Le coeur encore saisi du danger auquel je venais d’échapper…, alarmé de ceux que je pouvais encore courir et que je ne pouvais prévoir…, nu, exposé à un vent des plus violents, les maux de ma situation étaient encore augmentés par le mugissement des vagues et l’obscurité de la nuit. Je voyais, à la lueur de la flamme qui consumait mon habitation, les ruines où j’avais assis ma demeure. Elles semblaient me dire que tout périt dans la nature et qu’il fallait que je périsse.
… Je ne restai pas un quart d’heure dans cette situation que j’entendis du bruit et, un moment après, je vis arriver deux hommes. Je l’avoue, sans armes, je me cachai derrière la demeure en attendant que je pusse comprendre pourquoi ils étaient si cruels, car je ne pouvais m’imaginer qu’ils fussent si animés contre les hommes sans quelque forte raison.
Quel fut mon étonnement quand les paroles suivantes frappèrent mes oreilles :
«Ma fille, sur le bord de sa tombe, tu as livré ton père aux cuisants remords. O Dieu ! entends les gémissements de cette déplorable victime. Il invoque l’Eternel qui, depuis tant d’années, soutient notre vie. Ma fille, qu’as-tu fait ? Peut-être as-tu immolé aux mânes de nos compatriotes un compatriote même. Peut-être est-ce un de ces Anglais vertueux qui protègent encore nos fugitifs citoyens… Non ! non ! mon âme ne peut y survivre. J’ai supporté les malheurs de ma patrie, ceux de ma famille, les miens, tant que l’innocence a régné dans mon coeur, mais ces cheveux blancs souillés par le crime… Adieu, ma fille… J’expie ton crime. Oui, flammes ardentes, purifiez… Ma fille, je te pardonne. Vis pour me venger et ne pardonne jamais aux tyrans de la patrie… Impute-leur jusqu’à ce nouveau crime. Impute-leur la mort de ton père».
Ce discours me fit renaître… De pareilles situations sont difficiles à peindre… Je me précipite aux pieds du vertueux vieillard. «Oui, mon père, lui dis-je, je suis Anglais et Anglais de vos amis. Ce que je viens d’entendre me console de l’accident malheureux qui a failli me coûter la vie». Après l’expression d’allégresse, le vieillard me conduisit dans la caverne qu’il habitait : «Sois bienvenu, Anglais. Vous régnez ici. La vertu a le droit d’être vénérée en tous lieux». Je ne finirais jamais si je voulais rapporter tous les récits que nous tînmes. Je lui demandai le récit des événements qui l’avaient porté à fuir la société de l’homme et il commença en ces termes :
«J’ai puisé la vie en Corse et avec elle un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance. Nous languissions alors dans les chaînes des Génois. Agé encore que de vingt ans, je déployai le premier l’étendard de la liberté et mon bras jeune et désespéré remporta sur les tyrans des avantages que mes compatriotes chantaient encore il y a dix ans… Quelques années après, nos tyrans appelèrent à leur secours les Allemands. Qu’avions-nous fait aux Allemands pour qu’ils vinssent nous faire la guerre ? Ils en furent la dupe toutefois et nous vîmes plusieurs fois l’aigle impériale fuir devant nos agiles montagnards… Les méchants dans ce monde ont des amis et les Français vinrent à leur secours. Les Français après avoir été battus nous battirent. Les plaines et les villes se soumirent. Pour moi, je me réfugiais avec ceux de mes compagnons qui avaient juré de ne pas survivre à la liberté de la patrie.
«Après diverses vicissitudes, Paoli di Rostino fut fait premier magistrat et général. Nous chassâmes nos tyrans. Nous étions libres, nous étions heureux, losque les Français, que l’on dit être ennemis des hommes libres, vinrent armés du fer et du flambeau et, en deux ans, contraignirent Paoli de s’en aller et la nation à se soumettre. Quant à moi, avec mes amis et parents nous soutînmes la guerre pendant huit ans. Je vis, pendant cet intervalle, quarante de mes compagnons terminer leur vie par le supplice du criminel. Un jour que nous résolûmes de nous venger, nous descendîmes près de soixante – c’était le triste reste des défenseurs de la liberté ! Dans les plaines nous prîmes plus de cent Français. Nous les conduisions à notre demeure lorsque nous fûmes avertis que les tyrans s’en étaient emparés. Je quittai mes gens pour voler au secours de mon infortuné père que je trouvai nageant dans son sang. Il n’eut que la force de me dire : «Mon fils, venge-moi. C’est la première loi de la nature. Meurs comme moi, n’importe, mais ne reconnais jamais les Français pour maîtres». Je continuais mon chemin pour aller savoir des nouvelles de ma mère lorsque je trouvai son corps nu, chargé de blessures et dans la posture la plus révoltante. Ma femme, trois de mes frères avaient été pendus sur les lieux mêmes. Sept de mes fils, dont trois ne passaient pas cinq ans, avaient eu le même sort. Nos cabanes étaient brûlées, le sang de nos brebis était confondu avec celui de mes parents. Je cherchais ma fille et ne la trouvai pas ; furieux, égaré, transporté par la rage, je voulais voler mourir par les coups de ces brigands qui avaient fait périr tous les miens. Retenu cependant par mes compagnons, nous enterrâmes tous les corps de nos infortunés parents et nous résolûmes… O Dieu ! que ne résolûmes-nous pas !… Mais enfin nous prîmes le parti de quitter une île proscrite où des tigres régnaient. Notre bâtiment débarque à la Gorgona. Je trouvai le paysage conforme à mon humeur et j’y restai. Je ne gardai que trois fusils et quatre barils de poudre. Mes compagnons continuèrent leur cours vers l’Italie. Je vis partir le navire sans chagrin. J’avais des nourritures pour trois jours. Je sais qu’il est peu d’endroits sur la terre où il n’y ait de quoi nourrir l’homme. Les bâtiments où vous étiez sont les ruines d’un ancien monastère et la citerne existe encore. Les poissons et les insectes de la mer, les glands des chênes verts que vous voyez me servent de nourriture. Je me regarde ici comme le dictateur d’une république. Les oiseaux sont nombreux sur ces rochers, mais je n’en tue jamais. Ce sont mes sujets. Mais comment pourrais-je en tuer puisque je n’en vois jamais ?… Les malheurs qui ont empoisonné mes jours m’ont rendu la clarté du soleil importune. Il ne luit jamais pour moi. Je ne respire l’air que la nuit et mes regrets ne sont pas renouvelés par l’aspect des montagnes où vécurent mes ancêtres. La petite forêt de pins que vous voyez ici à côté nous donne du bois plus que nous n’en avons besoin et ce bois nous éclaire.
«C’est à la lueur de ces flambeaux que nous vivons. Nos courses, nos pêches sont éclairées par cet astre, qui, s’il n’est pas aussi brillant que le vôtre, n’éclaire du moins que des actions justes.
«Je passai une année sans aucun événement, lorsque environ à cette heure-ci, un jour, dans le mois de décembre, j’aperçus du côté de la citerne des feux qui m’annonçaient l’arrivée de quelques hommes. Je me glissai avec le moins de bruit qu’il me fut possible et je vis sept Turcs qui tenaient trois hommes enchaînés. Je les vis les délier, en tuer un, et donner la liberté aux autres en ne leur donnant aucune nourriture. Après cet événement, ils se rembarquèrent. Quand je me fus assuré que les deux nouveaux débarquants n’étaient pas Français, je résolus de leur donner refuge. Pour cela faire, je retournai à ma demeure et allumai un grand feu. Attirés par la lueur, ils y vinrent. Quelle fut ma surprise, je reconnus ma fille. L’autre était un jeune Français. En considération de ma fille je lui accordai la vie. «Monsieur, lui dis-je, vous saurez que je suis un ennemi de votre nation, et j’ai juré sur mes autels, par le Dieu qu’ils ont outragé, de venger, de massacrer tous ceux qui tomberaient en ma puissance. je vous exempte toutefois en considération de ma fille. Cherchez une demeure dans cette île qui soit éloignée de celle-ci. Ne sortez jamais que lorsque le soleil est sur l’horizon. Je vous laisse vivre. A défaut de quoi votre mort s’ensuivrait». Trois ans se passèrent ainsi sans que j’eusse eu la curiosité de voir s’il vivait toujours. J’y allai au bout de ce terme et ne trouvai aucun vestige de son corps. J’ignore ce qu’il peut être devenu. Je bénis toutefois le ciel qui m’a délivré de ce méchant homme.
«Il y a six ans que je fus réveillé par le bruit de plusieurs coups de canon et de mousqueterie. Le soleil s’était levé. Je ne voulus pas, quoique j’en eusse bien envie, trahir mon serment et j’attendis la nuit. Elle n’avait pas plutôt répandu ses voiles que j’allumai un grand feu et me mis à faire la tournée de mon royaume. Je vis sept hommes couchés à terre, étendus sur des couvertures, et quatre autres qui les soignaient. Les quatre vinrent à moi. Insensé ! je n’eus pas l’esprit de me défendre. Ils me tirèrent ma barbe, me battirent, me bafouèrent, m’appelèrent sauvage. Ils voulurent m’obliger à dire où il y avait de l’eau. Je ne voulus jamais pour les punir de leurs mauvais traitements. C’étaient d’ailleurs des Français. Ma fille qui me suit presque toujours vint bientôt. Elle ne me vit pas plutôt dans l’état où j’étais tiré qu’elle tua d’un coup de fusil deux de ces brigands. Les deux autres se sauvèrent. La frégate était à une certaine distance. Elle ne pouvait pas approcher à cause des rochers. Je leur criai de venir prendre leurs malades. Ils envoyèrent trois hommes qui vinrent à la nage. Je leur permis à tous de s’embarquer. O ingratitude affreuse ! Ils ne furent pas plutôt arrivés à leur frégate qu’ils tirèrent quelques coups de canon contre les restes des ruines qu’ils prirent pour mon habitation.
«Depuis ce temps-là, j’ai juré de nouveau sur mon autel de ne plus pardonner à aucun Français. Il y a quelques années que j’ai vu périr deux bâtiments de cette nation. Quelques bons nageurs se sauvèrent dans l’île, mais nous leur donnâmes la mort. Après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français.
«L’année passée, un des bateaux qui font la correspondance de l’île de Corse avec la France vint échouer ici. Les cris épouvantables de ces malheureux m’attendrirent. Je me suis souvent reproché cette faiblesse depuis, mais que voulez-vous, monsieur, je suis homme et avant d’avoir le coeur d’un roi ou d’un ministre, il faut bien avoir étouffé ces sentiments qui nous lient à la nature et je n’étais roi que depuis onze ans. J’allumai donc un grand feu vers l’endroit où ils pouvaient aborder et, par ce moyen, je les sauvai. Vous vous attendez peut-être que leur reconnaissance… Eh ! non ! Ces monstres, à peine arrivés ici, tranchèrent des maîtres. Deux cavaliers escortaient un criminel qu’ils laissèrent à bord. Je demandai ce qu’il avait fait. Ils me répondirent que c’était une canaille de Corse, que ces gens méritaient tous d’être pendus. Ma colère fut grande. Mais que devais-je faire ? Ils me reconnurent comme Corse et prétendirent me conduire avec eux. J’étais un coquin qu’il fallait rouer. Ils firent plus : ils m’enchaînèrent. Ils prétendaient que l’on avait promis une récompense pour ceux qui me livreraient. J’étais perdu. J’allais expier par les supplices ma fâcheuse mollesse. Mes ancêtres irrités se vengeaient de ce que j’avais trahi la vengeance due à leurs mânes… Cependant le ciel, qui connaissait mon repentir, me sauva. Le bâtiment fut retenu sept jours. Au bout de ce terme, ils manquèrent d’eau. Il fallait savoir où l’on pourrait en puiser. Il fallut me promettre la liberté. L’on me délia. Je profitai de ce moment et j’enfonçai le stylet de la vengeance dans le coeur de deux de ces perfides. Je vis alors pour la première fois l’astre de la nature. Que sa splendeur me parut brillante mais, ô Dieu ! comment pouvait-il contempler de pareilles trahisons !
«Cependant ma fille était à bord, garrottée ainsi que je l’avais été. Heureusement que ces hommes brutaux ne s’étaient pas aperçus de son sexe. Il fallait aviser au moyen de la délivrer. Après y avoir longtemps rêvé, je me revêtis de l’habit d’un des soldats que j’avais tués. Armé de deux pistolets que je trouvai sur lui, de son sabre, de mes quatre stylets, j’arrivai au bâtiment. Le patron et un mousse furent les premiers qui sentirent le glaive de mon indignation. Les autres tombèrent également sous les coups de ma fureur. Je recueillis tous les meubles qui pouvaient appartenir à l’équipage. Nous traînâmes leurs corps aux pieds de notre autel et là, nous les consumâmes. Ce nouvel encens parut être favorable à la divinité…»
LE MASQUE PROPHETE – NAPOLEON BONAPARTE
L’An 160 de l’hégire, Mikadi régnait à Bagdad ; ce prince, grand, généreux, éclairé, magnanime, voyait prospérer l’empire arabe dans le sein de la paix. Craint et respecté de ses voisins, il s’occupait à faire fleurir les sciences et en accélérait les progrès, lorsque la tranquillité fut troublée par Hakem, qui, du fond du Korassan, commençait à se faire des sectateurs dans toutes les parties de l’empire. Hakem, d’une haute stature, d’une éloquence mâle et emportée, se disait l’envoyé de Dieu ; il prêchait une morale pure qui plaisait à la multitude ; l’égalité des rangs, des fortunes, était le texte ordinaire de ses sermons. Le peuple se rangeait sous ses enseignes. Hakem eut une armée.
Le calife et les grands sentirent la nécessité d’étouffer dans sa naissance une insurrection si dangereuse ; mais leurs troupes furent plusieurs fois battues, et Hakem acquérait tous les jours une nouvelle prépondérance.
Cependant une maladie cruelle, suite des fatigues de la guerre, vint défigurer le visage du prophète. Ce n’était plus le plus beau des Arabes. Ses traits nobles et sévères, ses yeux grands et pleins de feu étaient défigurés ; Hakem devint aveugle. Ce changement eût pu ralentir l’enthousiasme de ses partisans. Il imagina de porter un masque d’argent.
Il parut au milieu de ses sectateurs ; Hakem n’avait rien perdu de son éloquence. Son discours avait la même force ; il leur parla, et les convainquit qu’il ne portait le masque que pour empêcher les hommes d’être éblouis par la lumière qui sortait de sa figure.
Il espérait plus que jamais dans le délire des peuples qu’il avait exaltés, lorsque la perte d’une bataille vint ruiner ses affaires, diminuer ses partisans et affaiblir leur croyance : il est assiégé, sa garnison est peu nombreuse. Hakem, il faut périr, ou tes ennemis vont s’emparer de ta personne ! Il assemble tous les sectateurs et leur dit : «Fidèles, nous que Dieu et Mahomet ont choisis pour restaurer l’empire et regrader notre nature, pourquoi le nombre de vos ennemis vous décourage-t-il ? Ecoutez ; la nuit dernière, comme vous étiez plongés dans le sommeil, je me suis prosterné et ai dit à Dieu : Mon père, tu m’as protégé pendant tant d’années ; moi ou les miens t’aurions-nous offensé, puisque tu nous abandonnes ? Un moment après, j’ai entendu une voix qui me disait : Hakem, ceux seuls qui ne t’ont pas abandonné sont tes vrais amis et seuls sont élus. Ils partageront avec toi les richesses de tes superbes ennemis. Attends la nouvelle lune, fais creuser de larges fossés, et tes ennemis viendront s’y précipiter comme des mouches étourdies par la fumée». Les fossés sont bientôt creusés, l’on en remplit un de chaux, l’on pose des cuves pleines de liqueurs spiritueuses sur le bord.
Tout cela fait, l’on sert un repas en commun, l’on boit du même vin, et tous meurent avec les mêmes symptômes. Hakem traîne leurs corps dans la chaux qui les consume, met le feu aux liqueurs et s’y précipite. Le lendemain, les troupes du calife veulent avancer, mais s’arrêtent en voyant les portes ouvertes ; l’on entre avec précaution et l’on ne trouve qu’une femme, maîtresse d’Hakem, qui lui a survécu. Telle fut la fin de Hakem, surnommé Durhaï, que ses sectateurs croient avoir été enlevé au ciel avec les siens.
Cet exemple est incroyable. Jusqu’où peut pousser la fureur de l’illustration !
août 21, 2007
LES FRERES BONELLI – BOCOGNANO
François Bonelli
François Bonelli né à Bocognano le 17 janvier 1760, était déjà capitaine depuis le 1er octobre 1790 d’une compagnie détachée dans le district d’Ajaccio lorqu’il fut élu capitaine au deuxième bataillon de volontaires corses. Il était au siège de Bastia où Lacombe Saint-Michel le fit chef du 16ème bataillon d’infanterie légère (22 avril 1794). Envoyé en Corse par Bonaparte (21 mai 1796) et chargé du commandement d’une colonne mobile du Liamone (17 octobre 1796), réformé (1er janvier 1799), envoyé à Milan au dépôt de la 22ème demi-brigade (15 avril 1799), nommé commandant auxiliaire du bataillon du Liamone (15 octobre 1799), derechef réformé (18 décembre 1799), derechef employé comme chef du premier bataillon des chasseurs du Liamone (2 septembre 1803) puis comme chef de bataillon des 2ème chasseurs du Golo (23 septembre 1805), il obtint sa pension par un décret du 28 mai 1809 et cessa d’être en activité le 30 septembre de la même année. Il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur le 2 juin 1815 par le duc de Padoue et reçut de Murat « à titre de souvenir », le 23 septembre 1815, le décrèt daté de Bocognano, de sa propre maison, qui le nommait chevalier des Deux-Siciles. Il avait le 2 juin 1793 épousé Anne-Françoise Tartaroli. Sa mort survint le 13 août 1843.
Ange-Toussaint Bonelli
Angelo-Santo Bonelli, fils de Zampaglino (Ange-Mathieu Bonelli) et de Marie-Antonie Muffragi, né à Bocognano le 5 septembre 1771, soldat au régiment Royal Corse (4 février 1788), sergent-major au 2ème bataillon de volontaires corses (15 janvier 1792), sous-lieutenant au 17ème bataillon d’infanterie légère où était entrée la compagnie d’infanterie commandée par son frère François (4 mai 1793), capitaine à ce même bataillon par ordre de Lacombe Saint-Michel en remplacement de son frère François devenu lieutenant-colonel du 16ème bataillon (22 février 1794), continuant par arrêté de Saliceti et e Ritter à jouir des appointements attachés à son grade de capitaine après la suppression de la compagnie (9 février 1795), capitaine à la suite de la 16ème demi-brigade d’infanterie légère (10 juin 1795), capitaine titulaire (4 août 1795), capitaine dans la gendarmerie nationale en Corse (26 novembre 1797), adjoint à l’état-major général de l’armée d’Italie (5 décembre 1799), reçoit l’ordre de se rendre à Luxembourg pour être attaché provisoirement à la 65ème demi-brigade, mais, grace à la protection de Lucien Bonaparte, est envoyé en Corse à la suite de la 23ème demi-brigade légère (19 août 1802), devient chef du 3ème bataillon léger corse (22 novembre 1804), et passe au service de Naples dans la gendarmerie (10 mars 1806). Colonel (13 février 1813), licencié (20 mars 1815), réadmis au service de la France comme lieutenant-colonel de cavalerie en non-actyivité (18 décembre 1816), mis en retraite provisoire (1er juillet 1818) et en retraite définitive (20 septembre 1820), il commandait en 1831 les dix-sept compagnies de garde nationale qui formaient la légion de Bocognano, une des trois légions que comptait le département de la Corse.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 17, 2007
NAPOLEON BONAPARTE A AUXONNE PAR MARTINE SPERANZA* (2)
Vie Militaire
Les premiers travaux de Bonaparte sur l’artillerie datent de 1788, c’est qu’à cette époque il voulait devenir un bon artilleur. La personnalité du commandant de l’Ecole et celle du professeur de mathématiques, tous deux passionnés pour leur arme, ont sans doute fortement encouragé Bonaparte dans cette voie.
Dans ses Cahiers sur l’histoire de l’artillerie dont le premier est conservé à la Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze), il prend des notes sur les systèmes en usage au XVIIIème siècle, Vallière et Gribeauval, et sur le cours du professeur Lombard concernant l’emploi des différentes charges de poudre.
En août 1788 le baron du Teil fait des expériences sur le jet des bombes avec le canon : comment employer des bombes de différents calibres lorsqu’on n’a pas de mortiers ou des mortiers sans affûts ? Bonaparte, le plus jeune lieutenant de la commission est chargé, selon l’usage, de rédiger le procès verbal des épreuves. Pour complèter ces expériences et les pousser plus avant, il écrit lui-même en mars 1789, un mémoire sur le jet des bombes qui fit autorité quelques années plus tard et, servit à tout le corps de l’artillerie.
Le Régiment de la Fère possède à cette époque un traité de fabrication de l’artifice de guerre qui passe pour un des meilleurs traités du corps royal.
Comme le professeur Lombard dont les ouvrages sont reconnus par tous, plusieurs officiers du régiment publient sur l’artillerie. Le Chevalier du Teil, frère du baron et major du Régiment a pris une part active dans la controverse opposant les partisans de l’ancien système de Vallière et les promoteurs du nouveau système de Gribeauval, en donnant « De l’usage de l’artillerie nouvelle dans la guerre de campagne » Metz – 1778. Gassendi, capitaine détaché, fait paraître en 1789 un Aide-mémoire destiné aux officiers d’artillerie du Corps-Royal. Le chevalier d’Uturbie, chef de brigade au Régiment, rédige un Manuel de l’Artilleur, dont les nombreuses éditions ont prouvé la valeur.
Bonaparte rédige même en septembre 1788, sur la demande de ses camarades, un projet de règlement de la Constitution de la Calotte du Régiment, société formée par les lieutenants pour juger les officiers qui manquent à l’honneur. Mais il le fait avec tant de sérieux et d’un ton si grave que tous se moquent de lui.
Les Lectures – Les Ecrits
Pendant les loisirs que lui laissent ses études d’artilleur, Bonaparte s’éfforce de compléter son instruction. Enfermé dans sa chambre, il lit et ses nombreuses notes de lecture sont la preuve de son infatigable curiosité.
C’est l’histoire surtout qui l’attire : Rollin, l’abbé Marigny, Mably, Raynal, Barrow, mais aussi la géographie de Lacroix, l’Histoire Naturelle de Buffon, les tragédiens de Corneille et Racine, et des auteurs aussi variés que Bernardin de Saint-Pierre, Stevenson, Montesquieu ou Rousseau.
Il emprunte des livres et il en achète. En 1791, il demande à M. Joly libraire imprimeur à Dole de lui faire parvenir l’ouvrage de Guishardt « Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains » Lyon – 1760. Mais les deux volumes sont livrés après le départ de Bonaparte pour Valence ; ils figurent à la Bibliothèque Municipale de Dole qui les acheta sans doute au libraire.
Ces lectures inspirent à Bonaparte plusieurs nouvelles en prose : « Le Comte d’Essex » nouvelle anglaise écrite en 1789, « Le Masque Prophète » » (avril 1789) et une « Nouvelle Corse ». D’autres écrits plus politiques datent de cette période : la Dissertation sur l’autorité royale (1788) et les Lettres sur la Corse.
Il n’y a pas d’imprimeur à Auxonne. En avril 1791, Bonaparte demande à M. Joly à Dole d’imprimer cent exemplaires de sa « Lettre à Buttafoco », écrite en Corse quelques mois plus tôt. C’est un pamphlet plein d’insolence et d’ironie contre Matteo de Buttafoco, chef de file des royalistes et adversaire de Paoli, le célèbre patriote corse.
Il se rend plusieurs fois à pied à Dole pour corriger les épreuves, en compagnie de son frère Louis (récit de Joly dans sa lettre à Amanton du 14 août 1821. Bibliothèque Municipale de Dole).
Les Fréquentations
Parmi les artilleurs du Régiment de la Fère Bonaparte a de bons amis, surtout le lieutenant des Mazis qui était déjà avec lui à l’Ecole Militaire de Paris, puis à Valence. Il s’entretient volontiers avec le capitaine Gassendi, qui aime la Corse, lit Dante, Le Tasse et Rouseau et écrit des vers.
Ses liens avec le professeur Lombard qui l’a pris en amitié, lui permettent d’être reçu dans les salons d’Auxonne, chez Madame de Berbis, chez le Directeur de l’Arsenal, et chez le baron du Teil.
D’autres liens se créent avec Jean-Marin Naudin, le Commissaire de Guerres, qui a passé treize années en Corse avant de venir à Auxonne. Naudin vit séparé de sa femme dont il divorcera en 1793. Bonaparte rencontre chez lui Madame Renaud et semble avoir éprouvé de l’amitié pour elle. Jeanne Lucant avait épousé en 1775 Dominique Renaud, trésorier du Régiment de Grenoble, mais son mari l’avait abandonnée lorsque le Régiment avait quitté Auxonne. Elle divorcera en 1793 et deviendra Madame Naudin en 1798.
Chez Naudin, il rencontre André Degoy, quartier-maître du Régiment, qui avait fait campagne en Amérique, et Norbert Bersonnet agent comptable des vivres qui lui prête des livres. Souvent, il rend visite à Jean-Baptiste Lardillon, directeur de la Poste aux Lettres, pour y lire les journaux.
De Manesca Pillet, que Bonaparte aurait voulu épouser, nous n’avons trouver aucune trace.
Les Promenades
« Bonaparte vint un jour chez moi à Dole, d’Auxonne à 8 h du matin, (il était vêtu d’une carmagnole et d’un pantalon de toile blanche rayée de bleu, chapeau rond) me proposer de lui imprimer la lettre à Buttafoco… Il me demanda le jour où il devait revenir pour vérifier l’épreuve de la 1ère feuille d’impression : il dit qu’il y arriverait à 8 h du matin. Deux jours après précisément à cette heure, Bonaparte était dans ma chambre. Il lut l’épreuve sans s’asseoir et ne voulut prendre qu’un doigt de vin, malgré mes instances… Il me demanda encore le jour fixe où il devait revenir à la même heure, pour voir le reste des épreuves ; il ajouta qu’il amènerait son jeune frère qui était curieux de voir comment on imprimait… Il repartit tout de suite parce qu’il devait être présent à Auxonne à 11 h précise… » (Extrait de la lettre de Joly à Amanton – Bibliothèque municipale de Dole).
A Auxonne Bonaparte est un marcheur infatigable, l’aller et le retour à Dole dans la matinée ne l’effraye pas, même si parfois des ampoules aux pieds (lors du voyage du Creusot) l’obligent à prendre un cheval. Il devient familier de la campagne à l’entour de sa ville de garnison. Il préfère les lieux ombragés : Villers-Rotin où le Tilleul planté en 1601 à la naissance de Louis XIII a déjà presque deux cents ans ; le hameau de la Cour, à la lisière de la forêt de Crochères, où se trouve une clairière de vieux chênes ; la Levée, ce lieu de promenade favori des Auxonnais. La Chapelle de la Levée, plus tard appelée Chapelle Napoléon, est située tout près de la nouvelle route surélevée qui conduit à Auxonne, en franchissant huit ponts de pierre construits en 1739. Le bois de Boutrans la touche ; à côté coule une source d’eau très pure. En 1867 Maître Garnier notaire honoraire, fit ériger là, selon le voeu de sa fille Amélie morte en 1863, un obélisque gravé en souvenir des promenades de Bonaparte (aujourd’hui terrain privé).
Les Décors
Comme ses camarades officiers, Bonaparte prend pension chez la veuve du traiteur Dumont et mange dans la grande pièce du rez-de-chaussée qui donne sur la rue de Saône. L’inventaire après décès de Jeanne Chevalier, veuve Dumont (2 avril 1806 – Maître Caire- Archives de Maître Lagé) nous restitue le décor : la cheminée avec crémaillère et tournebroche, une grande armoire en noyer avec commode et tiroirs pour le linge de table, un placard et bureau formant une seule pièce, entre la fenêtre et la cheminée, pour la vaisselle, au mur deux miroirs à cadre doré et un Saint Suaire, au milieu de la pièce une grande table avec allonges et tréteaux, et des chaises paillées.
A partir de 1787 quatre salles de billard seulement sont autorisées à Auxonne. Les officiers y sont assidus. Celle du Sieur Bourotte est située à l’angle de la rue Chesnois et de la rue des Pelletiers. Son décor sur toile peint par Picard en 1773, était encore en place il y a peu de temps (collection particulière).
Bonaparte accompagne fréquemment M. et Mme Lombard chez M. Pillon d’Arquebouville, directeur de l’Arsenal (rue Chesnois). Le soir on joue au loto dans le grand salon au rez-de-chaussée : des tables à jouer, des fauteuils garnis de coussins, un secrétaire en noyer, une glace sur la cheminée, des rideaux de toile de coton composent l’ameublement ; à l’office six paires de flambeaux d’argent, à la cave six pièces de vin de Comté et deux cents bouteilles de vin d’extraordinaire. A l’étage se trouve l’appartement où réside l’inspecteur d’artillerie, M. de la Mortière lorsqu’il vient visiter l’Ecole d’Auxonne, et le petit salon décoré (O) (Apposition de scellés au domicile de François Laurent Pillon d’Arquebouville – 5 mars 1790).
(Extrait du catalogue réalisé par Martine Speranza à l’occasion du bicentenaire de Bonaparte à Auxonne)
* Martine Speranza est présidente de l’Association Auxonne-Patrimoine.
août 15, 2007
NAPOLEON BONAPARTE A AUXONNE PAR MARTINE SPERANZA* (1)
Auxonne, est une ancienne place forte dont le passé militaire, les fortifications, l’Arsenal et les Casernes seraient vite tombés dans l’oubli, s’ils n’avaient eu pour hôte, un jour de juin 1788, le lieutenant Napoléon Bonaparte.
Tous disent que déjà à cette époque on le remarque : c’est un jeune officier d’artillerie, fort maigre, très brun, aux yeux perçants, au visage sérieux, à l’accent légèrement italien : il est Corse, intelligent, et ambitieux. « Ce jeune homme ira loin » dit Lombard, son professeur de mathématiques, mais Bonaparte n’est encore qu’un simple lieutenant en second.
Lorsque le 18 Floréal an VIII, le Premier Consul en route pour l’Italie, s’arrête à Auxonne, il est fêté comme un héros. Le 2 décembre 1804, il devient Napoléon 1er, mais aujourd’hui à Auxonne il reste Bonaparte.
Son séjour ici comme à Valence, a fait l’objet de maints ouvrages, des plus grandes biographies aux plus mauvaises compilations ; il a fallut tous les lire et revenir aux sources, c’est à dire aux archives militaires et civiles qui permettent de redresser les erreurs des uns et vérifier le sérieux des autres ; mais rien n’est jamais terminé.
AUXONNE EN BOURGOGNE
« Auxonne, petite ville du Duché de Bourgogne, située sur la Saône qui passe à sa partie occidentale, est à 74 lieues de Paris, long. 23 d 3 ‘ 35″, lat. 47 d 11 ‘ 24″. Son territoire est plat, marécageux et argileux ; à l’occident sont de superbes prairies qui vont du nord au midi ; elles sont terrminées par de petites collines couvertes de forêts en divers endroits. La Saône coule dans la même direction et baigne les murs de la ville. A son orient sont d’excellentes terres, on y récolte des grains de toutes espèces, elles sont aussi bornées à environ une lieue et plus par des collines et des montagnes qui sont pareillement couvertes de forêts et sur lesquelles les nuées orageuses ont coutume de se diriger ». (Description topographique et médicale de la ville d’Auxonne – Par Roussel méd. adj. de l’Hôpital. 1786 ms F 502 – Archives départementales de la Saône et Loire).
La popualtion de la ville est de 3599 habitants en 1786, à cela s’ajoute le régiment d’artillerie, soit environ 1200 hommes et officiers.
Le voyageur qui passe par Auxonne, tel Arthur Young le 30 juillet 1789, voit une belle rivière et de grasses prairies, mais la réalité est un peu différente. Le climat est mauvais, la fin de l’automne et le printemps sont humides et froids, le peuple des campagnes est misérables, il ne se nourrit que de céréales et de légumes, « surtout d’une espèce de bouillie faite avec la farine de blé de Turquie appelée gaude ». La ville enfermée dans ses murs semble jouir d’une situation plus privilégiée ; la présence du régiment et de ses officiers lui procure une activité quotidienne, il n’y a pas moins de 35 cabaretiers, aubergistes, cafetiers ou traiteurs en ville en 1788. Mais de graves problème inquiètent le commandant de l’Ecole et le médecin de l’Hôpital : les casernes sont construites dans un lieu malsain, le long du fossé des fortifications, là où les eaux stagnent. Les latrines s’y diversent et c’est « le militaire si précieux à l’état, qui est la première victime de cette insalubrité » (ms Roussel -op. cit). Le canal de la petite Saône qui traverse la ville n’a pas assez de courant d’eau, les égoûts s’y déversent et répandent une odeur intolérable. Cette situation engendre des fièvres intermittentes dont Bonaparte a souffert en arrivant à Auxonne ; on compte 40 morts au Régiment entre 1788 et 1791.
La municipalité essaye, dans la mesure de ses modestes ressources, d’améliorer la vie quotidienne : le nom des rues est peint systématiquement aux angles des maisons, permettant aux soldats porteurs de billets de logement de s’orienter plus facilement ; le soir la ville est éclairée par 30 réverbères ; en 1786 le Roi donne enfin l’autorisation de démolir la tour de la Porte de France, vestige des anciennes fortifications, qui donnait à l’entrée d’Auxonne « une teinte sombre et lugubre » et causait par son étroitesse des encombrements perpétuels. Les propriétaires de maisons contribuent à l’embellissement de la ville par la construction de façades à la mode surtout dans la rue principale : on se préoccupe d’urbanisme.
Les relations entre la municipalité et le commandant de l’Ecole n’ont pas toujours été bonne et l’absence continuelle de M. de Bissy, gouverneur d’Auxonne, en est en partie responsable. Le Roi dut envoyer au baron du Teil, en 1783, un brevet l’établissant lieutenant-général, sous l’autorité du gouverneur, pour commander tant aux habitants qu’aux gens de guerre ; la situation devient meilleure avec le nouveau maire, de La Ramisse, puis son successeur Petit en 1788.
Et pourquoi ne pas rapporter pour mieux évoquer les hommes, les petits évènements qui rompent la vie monotone et réglée de la ville ? Parfois la Saône rejette le cadavre d’un soldat noyé, ainsi Jean-Baptiste Larcher dit l’Espérance trouvé mort au bas du grand pont, « vêtu d’un habit de culotte bleu uniforme d’artillerie, un gilet de coton blanc… portant cheveux noirs en queue et attachés d’un ruban noir vulgairement nommé floret… » Parfois on voit en ville une scène semblable à celle décrite par le Mercure Dijonnais en 1788 : « MM les officiers d’artillerie s’étaient mis à danser en rond l’un d’entre eux entra dans le milieu de la danse, monta sur les épaules d’un tambour et reçut sur son derrière un coup de main de chaque officier. Il remercia le tambour et lui donna douze sous ».
Ce jeu s’appelle fondre la cloche, l’officier avait manqué à une dame.
Comme partout la Révolution va tout bouleverser ; c’est l’heure des doléances, le désordre des esprits va gagner la rue. En janvier 1789 commence déjà la Révolution dont Bonaparte ne connaîtra que les prémisses à Auxonne, du 14 juillet au serment du 23 août.
LA REVOLUTION
11 et 12 juin 1788 : deux émeutes éclatent à Dijon après la « mise en vacances » du Parlement.
13 juin 1788 : 400 hommes du Régiment de la Fère arrivent à Dijon sur la demande du commandant de la province. Ils rentreront à Auxonne le 25 octobre après le retour des parlementaires.
11 juin 1789 : le Tiers-Etat auxonnais se prononce pour le vote par tête dans une assemblée de toute la nation formée des trois ordres réunis.
15 juillet 1789 : une émeute éclate à Dijon. A Auxonne, on reçoit des nouvelles alarmantes de Paris.
19 juillet et 20 juillet : à Auxonne la populace brise les barrières des octrois et pille la maison du receveur des gabelles. La bourgeoisie prend les armes pour veiller à la sureté publique. Le Régiment de la Fère intervient et le calme revient.
Fin juillet : Un régiment de garde nationale s’organise.
23 août 1789 : le Régiment de la Fère prête serment conformément aux décrets des Etats Généraux ; environ 150 artilleurs ont été répartis en détachements dans la province, à Macon, Cluny, Tournus ; chaque ville soucieuse de sa tranquillité réclame des troupes royales. Des canonniers sont envoyés à Dijon avec 4 pièces pour exercer les volontaires artilleurs.
10 décembre 1789 : le maire d’Auxonne Petit démissionne. Il est remplacé le 28 janvier 1790 par F.A. de Suremain.
27 et 28 février 1790 : la garde nationale proclame son adhésion aux décrets de l’Assemblée Nationale et invite la garnison qui avait su maintenir l’ordre « dans les temps de trouble et d’anarchie » à s’unir à elle pour défendre la tranquillité publique.
14 juin 1790 : le maire de Suremain, nommé administrateur au district, est remplacé par C. Bertrand.
14 juillet 1790 : nouvelle prestation de serment par les gardes nationaux et par le régiment, chaque officier et soldat « reçoit à la boutonnière un ruban aux couleurs de la nation ».
16 août 1790 : les cannoniers du régiment se révoltent et exigent de leur colonel la distribution de la masse noire. Un détachement de 50 hommes ne peut s’opposer à cette action. Le maire Bertrand dénonce la collusion entre les soldats insurgés et une certaine classe de citoyens.
23 janvier 1791 : l’aumonier du Régiment prête serment à la constitution civile avec 7 prêtres familiers.
20 juin 1791 : la fuite du Roi est présentée comme un enlèvement. La peur réapparaît : on fait l’inventaire des armes de l’Arsenal, on ramène en ville les armes du Polygone, on double la garde du Pont.
4 juillet 1791 : le Régiment de la Fère, devenu le 1er Régiment d’Artillerie, prête le serment conformément au décret de la Constitutante du 21 juin.
21 juillet 1791 : constitution à Auxonne d’une société populaire.
Fin 1791 : de nombreux officiers du Régiment émigrent pour constituer à l’étranger une armée destinée à délivrer le Roi : 14 capitaines et presqu’autant de lieutenants.
(Extrait du catalogue réalisé par Martine Speranza à l’occasion du bicentenaire de Bonaparte à Auxonne)
* Martine Speranza est présidente de l’Association Auxonne-Patrimoine.
août 13, 2007
LES CAHIERS D’ALEXANDRE DES MAZIS – VALENCE ET AUXONNE (2)
Le 8 septembre 1785… Buonaparte put subir au bout de la première année les examens d’élèves et d’officiers, faculté qu’avaient les élèves des écoles militaires sans passer par l’école de Metz. Il fut nommé lieutenant d’artillerie au régiment de La Fère, je me présentais en même temps que lui, mais à ma seconde année.
Nous partîmes de l’Ecole militaire à 11 heures du soir pour rejoindre notre régiment à Valence, un sous-officier nous conduisit à la diligence. Le lendemain matin, lorsque nous pûmes marcher, nous mîmes pied à terre pour monter une côte rapide, sa première exclamation fût : « Enfin, je suis libre ». Et il se mit à courir comme un fou, sautant, gesticulant, et respirant ce premier air de liberté.
A Lyon, ayant manqué la diligence, nous fûmes obligés d’y rester un jour et, oubliant toute prévoyance, nous dépensâmes en achat de livres le peu d’argent que nous avions. Nous aurions été fort embarrassés pour rejoindre notre garnison si un officier d’artillerie, avec lequel nous avions voyagé, voyant notre embarras, ne nous eût pas offert sa bourse.
Buonaparte fut placé dans la compagnie de Bombarbiers de Monsieur de Coquebert. Mon frère aîné, qui était déjà capitaine au régiment de la Fère, nous reçut à notre arrivée et accueillit Buonaparte d’autant mieux que son frère, Joseph, sachant qu’il était placé dans le même régiment que moi, avait écrit à mon frère pour le prier d »être son mentor. Mais loin de là. Buonaparte fut fort choqué de la recommandation… disant qu’il n’avait pas besoin d’être mis sous tutelle.
Bien que mon frère déclinât au plus vite la mission qui lui étai donné, le jeune officier lui conserva toujours rancune d’avoir accepté, il s’éloigna de lui et jamais il ne me témoigna le désir de le voir, même après qu’il l’êut nommé administrateur de la loterie.
Peu de jours après notre arrivée à Valence, Buonaparte me proposa de faire une course à cheval à Chabeuil. Nous avions encore nos uniformes d’élèves de l’Ecole militaire, nous prîmes des chevaux de louage et ne fîmes qu’un temps de galop. Mon frère qui nous vit partir était fort effrayé de « voir d’aussi mauvais cavaliers monter d’aussi mauvais chevaux ». Une fois lancé, nous ne pûmes nous retenir, nous traversâmes un village à toute bride, nos chevaux épars, la poudre qu’ils renfermaient répandue sur nos habits, ce qui nous fit prendre pour des contrebandiers ; nous revînmes à Valence le même train et fûmes plusieurs jours à nous remettre de cette équipée, qui fut toujours pour Buonaparte un souvenir plein de charme parce qu’il lui rappelait ce premier élan de sa jeunesse libre.
Notre séjour à Valence fut consacré par Buonaparte à ses études favorites, il s’occupait peu de son métier. Quoi qu’on en ait dit, il n’a jamais lu l’histoire de nos capitaines ni des livres de tactiques. Il était d’une pureté de moeurs tout à fait rare chez un jeune homme, il ne pouvait concevoir qu’on pût se laisser dominer par une femme et il n’a jamais lu d’autre roman que Paul et Virginie qui lui plaisait beaucoup. Peu après notre arrivée au régiment, un officier qui vivait avec une actrice l’amena un jour pour souper avec nous, habillée en homme et nous la présenta comme un jeune officier nouvellement arrivé. Napoléon s’aperçut de la plaisanterie et jamais on ne put le déterminer à l’embrasser. A Lyon, comme à Paris ; je l’ai toujours vu fuir ce qui était contraire aux bonnes moeurs.
De Valence, Buonaparte partit pour la Corse où il passa son semestre et son congé d’été. Pendant son séjour, il parcourut toute cette île, habillé comme les gens du pays et errant avec les paysans dans le « makis ». De ce moment, il commença à être désabusé sur l’amour de la liberté qu’il croyait trouver dans les coeurs corses. Plus tard, il me dit qu’il s’était convaincu que plus les peuples s’éloignent de la civilisation, plus ils sont barbares. Ce fut lors de ce premier voyage que Buonaparte, n’ayant plus d’argent pour l’exécuter, mon frère et moi lui prétâmes vingt-cinq louis. A la fin de 1788, il rejoignit le régiment à Auxonne. Je revins l’y trouver. Il était alors très occupé d’écrire une histoire de la Corse. Lorsqu’il travaillait, il fermait les volets de sa chambre afin d’être plus recueilli (il envoya son ouvrage à un Père minime à Brienne). Nous mangions ensemble, nous voulions essayer une cure de laitage, mais ce régime n’allait pas à son tempérament et nous fûmes obligés d’y renoncer. A cette époque, nous visitâmes le Creusot établissement qui renfermait trois usines également intéressantes, l’exploitation des mines de charbon de terre, la fonderie et la maufacture de cristaux.
Nous partîmes à pied, le sac sur le dos, nous pûmes coucher à Cîteaux, mais mon camarade ne pouvant plus marcher parce qu’il avait des ampoules aux pieds, nous nous résolûmes de prendre un cheval. A Chagny, nous passèrent une soirée fort agréable dans la famille d’un ancien camarade de Buonaparte, comme lui élève à Brienne, qui nous reçut à merveille, Buonaparte aimait à se rappeler son voyage sentimental ; il fut au moment de l’écrire à la façon de Sterne. Devenu Empereur et se promenant un jour avec moi dans les jardins de Saint Cloud, il me dit : « Nous avons une dette Des Mazis. » Je cherchais inutilement à me rappeler.
« Vous souvenez-vous, dit-il, que nous nous fîmes faire la barbe avant d’arriver au Creusot ? Ayant remis à payer à notre retour, ayant pris un autre chemin, nous ne nous sommes pas acquittés. » Après cette conversation, Buonaparte fit jouer le télégraphe pour savoir ce qu’était devenu le barbier. Il étai mort et sa famille avait quitté le pays. Deux jours nous suffirent pour visiter Le Creusot, nous retournâmes à Auxonne par Chalon en remontant la Saône.
Pendant l’hiver de 1790, Buonaparte resta au régiment. Le général du Teil le chargea de plusieurs expérience relatives au tir de bombes, il s’acquita de cette mission avec zèle, c’était la première fois qu’il en mettait à s’occuper de son service. Les plans… et autres travaux que le général donnait à faire aux officiers ne furent jamais exécutés par lui, il n’y entendait rien. Un sergent les exécutait, il les signait. Il protestait qu’il ne pouvait pas plus s’astreindre à tracer des lignes qu’à bien écrire.
Au mois d’avril 1791, Buonaparte passa dans le régiment de Grenoble, il retourna alors à Valence, quant à moi je suivis le régiment de La Fère à Douai. Ce fut dans ce second séjour qu’il se fit présenter dans le monde, parce que, disait-il, il ne suffit pas de connaître les hommes par les livres, il faut, pour les étudier, vivre avec eux. Avant de nous séparer, il me remit les vingt-cinq louis qu’il m’avait empruntés. Les idées républicaines commençaient à germer dans les esprits, elles avaient surgi spontanément dans la tête de Buonaparte dès son enfance, mai son théâtre ne s’étendait pas au-delà de la Corse ; aussi, lorsque après la Fédération, on voulut obliger les officiers à assister aux assemblées populaires, il s’y refusa. Les mouvements politiques qui s’opéraient en France lui faisaient espérer qu’un jour Paoli, qui était son héros, reviendrait dans sa patrie et qu’il pourrait se jondre à lui pour fonder en Corse la république des Spartiates qu’il avait toujours rêvée. Le retour de Paoli, sa trahison lorsqu’il livra son pays à l’Angleterre, détrompèrent cruellement les illusions de sa jeunesse.
Mes opinions n’étant pas les siennes, malgré ses efforts pour m’y ramener, je restai fidèle à mon drapeau. Nous nous retrouvâmes en semestre à Paris dans cette même année. Je me rappelle qu’il me conta qu’étant au café de Foi un orateur impromptu, comme on en voyait tant alors, se mit à haranguer l’assistance d’une manière peu convenable ; lui, impatienté, monta sur une table et parvint à persuader les auditeurs que ce parleur était un espion de la police. On le jeta à la porte. C’était la première fois quue Buonaparte parlait en public.
A cette époque, nous nous séparâmes, je ne m’attendais guère à trouver sur le trône celui que je quittais, mon camarade, mon ami !
Revenu à Paris en 1792, Buonaparte vint chez mon oncle, M. des Mazis, ancien capitaine du régiment d’Eu, espérant m’y trouver et redoubler sur ses instances pour m’engager à ne point émigrer ; il m’écrvit une lettre que je n’aurais jamais reçue. Déjà j’avais quitté la France. Quel prodigieux contraste que celui des premières années de Buonaparte et son existence d’homme. Dans sa jeunesse rien d’extraordinaire en fait de science ni de dispositions naturelles, rien de saillant que de petites bizarreries de caractère ; il n’était ni catholique ni protestant sans être athée, la lecture des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau l’avait dirigé dans les principes qu’ils s’était faits. En butte à l’adversité, il est heurté par cette république, dont son imagination caressait le côté poétique.
Explusé de l’artillerie comme noble et forcé de quitter la Corse, il vit obscurément à Marseille. Puis le général Carteaux, aveugle, promoteur de sa grande fortune, le tire de sa retraite, où il vivait avec sa famille et lui ouvre la carrière qu’il doit remplir de son nom.
Telles sont les seules notes que mon père ait laissées. Pour les complèter, j’ajouterai quelques détails puisés dans mes souvenirs. ils m’ont été confirmés par des amis et camarades de mon père auxquels je les ai communiqués. Lorsqu’il émigra en 1792, mon père était capitaine au régiment de La Fère. Son frère Aîné, Gabriel Des Mazis, capitaine en premier dans le même régiment, commandait un détachement envoyé dans une ville éloignée de la garnison. Mon père et mon oncle n’étaient donc pas ensemble lorsqu’ils quittèrent la France pour rejoindre en Allemagne l’armée des Princes. Séparés au moment de leur départ, ils n’avaient pu se communiquer leurs projets ni leurs intentions, mais le Ciel qui protégeait l’amitié qui les unissait permit que mon père retrouvât son frère dans un petit village où il venait d’arriver, bien inquiets l’un pour l’autre et ne voyant pas de terme à leur séparation, ils regardèrent -et leurs camarades aussi- cette rencontre comme tout à fait providentielle. Dès lors, ils se promirent, quelque chose qu’il arrivât, de ne plus se séparer et nous savons si cette promesse a été religieusement gardée. Pendant les 10 ans que dura leur exil, ils allèrent d’Allemagne en Hollande, où s’était réunie l’armée des Princes, puis en Angleterre où ils durent faire partie de l’expédition de Quiberon. Puis, après qu’elle eut échoué, le Portugal ayant demandé à l’Angleterre des officiers d’artillerie, un certain nombre d’émigrés de ce corps passèrent au service de Sa Majesté très fidèle, mon père et mon oncle y restèrent jusqu’en 1802. A cette époque, le désir de rentrer dans leur patrie les décida à profiter du calme qui commençait à s’y rétablir pour solliciter des lettres d’amnistie. Elles furent délivrées le 26 février, an II (1803).
Plus heureux que bien d’autres, ils rentrèrent en France, ayant dans leur ceinture la même somme (100 louis) qu’ils s’étaient partagée, lorsqu’ils se retrouvèrent en Allemagne. Souvent, elle avait été réduite à bien peu de chose, malgré les leçons de mathématiques et dessin qu’ils donnaient. Ils aimaient à nous raconter ce trait qui excitait toujours leur reconnaissance envers la Providence qui avait veillé sur eux pendant ces dix longues années.
Les premiers temps de leur retour furent employés à visiter leur famille et leurs amis. Mais bientôt ils durent songer à l’avenir. Ils vinrent à Paris. Mon père et mon oncle se trouvant sans fortune par suite de la confiscation de leurs biens, mon père se décida à demander une audience au Premier Consul. Elle leur fut accordée de suite. Malgré les événements qui s’étaient passés depuis leur séparation, il reçut de Bonaparte un accueil tel que pouvait le désirer un ancien camarade. Le Premier Consul demanda avec intérêt des nouvelles de mon oncle et apprit qu’il venait d’être gravement malade.
« Eh bien, dit-il à mon père, soyez tranquille, je lui trouverai une place qui conviendrait mieux à un convalescent que la carrière qu’il a toujours suivie. » En effet, peu de temps après, il le nomma admistrateur de la loterie… et mon père travailla au Cadastre en attendant de pouvoir rentrer dans l’artillerie. En 1806, le 2 mars, l’Empereur le nomma admistrateur du mobilier des palais impériaux ; il lui annonça lui-même sa nominaton. Mon père, passionné pour l’artilerie, et tout entier au souvenir de sa vie militaire qu’il avait commencé à l’âge de cinq ans à l’école militaire de Rebais, ne put dissimuler sa surprise et exprima à l’Empereur combien il était incapable de remplir une place si peu en rapport avec ses goûts et ses études.
« Sire, dit-il, je ne suis point administrateur, renvoyez-moi plutôt à mes canons. » Mais Napoléon lui déclara qu’il avait besoin de lui, il accepta donc, et ce même jour, l’Empereur disait au ministre de l’Intérieur, : « aujourd »hui, j’ai gagné un million en choisissant des Mazis pour administrateur du mobilier. » Toutes les fois qu’il le voyait, il le traitait avec la même bienveillance et témoignage d’amitié, il aimait alors à revenir sur le passé et à causer intimement des années de leur jeunesse.
A cette époque, mon père fit par de son mariage à l’Empereur, qui, de son côté, voulait lui donner une femme : apprenant qu’il épousait Mademoiselle Henriette des Mazis, dont les parents habitaient le Maine : « Ah ! Ah ! une chouane ! -Oui, Sire, » répondit mon père.
Cela ne l’empècha de vouloir signer sur le contrat de mariage. Vers la fin de 1812, il le nomma chambellan pour l’attacher de plus près à sa personne. En 1815, mon père rentra dans la vie privée où il donna constamment l’exemple de la piété la plus solide et des vertus les plus aimables.
(notes de Cécile des Mazis, l’aînée des cinq enfants d’Alexandre)
août 11, 2007
LES CAHIERS D’ALEXANDRE DES MAZIS – ECOLE MILITAIRE (1)
Alexandre des Mazis (1768-1841), fut sans nul doute le plus intime des amis de jeunesse de Napoléon Bonaparte. Leur amitié née à l’Ecole Militaire de Paris fin 1784 se prolongea ensuite en garnison à Valence et Auxonne, au sein du régiment de la Fère, qu’ils intègrèrent ensemble en 1785. Et si la Révolution les sépara un temps, l’affection mutuelle que se portaient les deux compères ne s’était pas pour autant distendue. Ainsi, en 1802, de retour d’émigration, Alexandre des Mazis fut reçu par le Premier Consul au Palais des Tuileries. En charge du garde meuble impérial sous l’Empire, il semble qu »il continua de fréquenter assidument le Maître de l’Europe dans le cadre domestique, en plus de ses fonctions publiques peu exposées elles-aussi. Les courts mémoires de ce vieil homme droit, honnête, et moral, écrits sans doute trop tardivement (à l’été 1835), et qui étaient a priori destinés à ses petits-enfants, sont toutefois assez décevants. Outre un certain nombre d’erreurs (relevées assez durement par Robert Laulan), ils nous laissent un sentiment de frustration. Dans ses Cahiers, des Mazis ne fait état que des ses rapports de jeunesse avec Bonaparte, mais ne dévoile rien de son intimité avec lui et l’impératrice Joséphine à La Malmaison. Cependant, Alexandre des Mazis demeure le principal témoin et acteur de la vie de Bonaparte entre 1784 et 1791. Son témoignage ne peut donc être être totalement négligé. Ce court récit sur une véritable amitié de plus de trente ans nous livre malgré tout quelques anecdotes et faits intéressants sur le quotidien des deux jeunes hommes à Paris, en Bourgogne et dans la Drôme. Il nous confirme aussi que Napoléon avait un sens aigu de l’amitié.
Au 1er septembre 1783, je suis rentré à l’école militaire de Paris en sortant de Rebais où j’étais resté quatre ans environ, placé dans la classe de mathématiques pour suivre les instructions nécessaires pour entrer dans l’artillerie ; je me trouve placé dans la salle d’étude auprès de Le Lieur de Ville-sur-Arce, entré la même année à l’école, venant de Brienne et se destinant aussi à l’artillerie. Nous nous liâmes bientôt et notre amitié a duré jusqu’à la fin des jours de cet ami que je regrette encore et qui, comme moi, avait été lié étroitement à Buonaparte qu’il avait laissé à l’école de Brienne parce qu’il était trop jeune pour venir à l’école de Paris. Je vous dirai quelle a été la destinée de ce bon camarade. Ses aventures font aussi partie des réminiscences de notre jeune âge et vous feront connaître un honnête homme, jouet de la fortune, que Buonaparte estimait, qu’il voulait rendre heureux, mais qui détruisait par sa mauvaise étoile le bien qu’on lui faisait. Ville-sur-Arce me parlait souvent de son camarade et du regret de ne pas se trouver ensemble à Paris, il m’en faisait beaucoup d’éloges, tant sous le rapport du caractère que sous celui de l’instruction, il me donnait envie de me lier aussi avec lui. A la fin de 1784, vers le mois de septembre, Ville-sur-Arce fut reçu élève d’artillerie, il quitta l’école et fut reçu à celle de Metz. Nous eûmes le regret de nous quitter et il ne vit pas Buonaparte qu n’arriva qu’un mois après son départ. Il avait été choisi par Monsieur Reynaud des Monts, inspecteur des écoles militaires, pour faire partie de élèves de Brienne qui devaient en sortir pour aller à Paris. Ville-sur-Arce en partant me dit qu’il désirait que j’accueillisse son ami, que je pourrais lui être utile, soit auprès de ses camarades, soit auprès des chefs, que l’originalité de son caractère, ses manières un peu étrangères pourraient lui attirer des ennuis que je pourrais lui éviter. Je lui promis de rechercher l’amitié de Buonaparte et nous nous dîmes adieu en conservant l’espoir que nous nous retrouverions ensemble dans l’artillerie et que notre première liaison se cimenterait encore dans le monde où nous allions entrer. Cet espoir n’a pas été trompé : après avoir parcouru les diverses vicissitudes des événements politiques, nous nous sommes toujours retrouvés amis et dans la même union de pensées, quoiqu’ayant, l’un et l’autre, été le jouet des tempêtes des révolutions et longtemps séparés par d’immenses distances. Lorsque Buonaparte arriva, je fus à lui en lui parlant de Ville-surArce. Il m’accueillit assez froidement, mais sans refuser mes avances ; nous fumes placés dans la même division et le hasard fit qu’on le plaçât à côté de moi dans la classe de mathématiques, se destinant à entrer dans la marine.
Nous passâmes plusieurs mois sans rapprochement particulier, mais une circonstance que son caractère inflexible fit naître, me mit en rapport avec Buonaparte ; on lui avait donné un instructeur dans le maniement des armes un élève nommé Champeaux assez sévère dans son commandement. Un jour le jeune élève, qui souvent avait ses idées ailleurs qu’à l’exercice, n’obéit pas aux leçons qu’on lui donnait, ou les exécutait mal.
Son instructeur lui donna un coup de baguette de fusil sur les doigts. Buonaparte, enflammé de colère, lui jetta son fusil à la tête en promettant que jamais il ne recevrait de leçon de lui. Les chefs, voyant qu’il fallait agir avec douceur avec cet indocile élève, me chargèrent de son éducation militaire. Je m’acquittai fort mal de cette commission. Si mon élève put gagner quelque chose du côté des formes, il perdit beaucoup du côté de l’instruction. Car, pendant les heures qu’on faisait marcher au pas ordinnaire et faire la charge en douze temps, nous laissions de côté nos fusils pour causer de tout autre chose ; j’appris alors à connaître ce que valait mon nouveau camarade, soit par l’originalité de son caractère, soit par son instruction. Nous désirâmes réciproquement de nous lier ensemble, ce que j’avais d’opposé à lui pouvait aussi lui convenir, il trouvait quelqu’un qui le concevait, l’appréciait, et à qui il pouvait sans contrainte, manifester ses pensées.
Au bout de quelques mois il fut admis au Bataillon sans, cependant être très instruit des manoeuvres, mais les distractions continuelles qu’il avait en faisant l’exercice du bataillon lui attiraient souvent de fortes réprimandes de ses chefs, surtout de M. de Lanoy qui voulait que les élèves fissent l’exercice comme de vieux soldats ; il arrivait quelquefois que lorsqu’on faisait le comandement de reposer sur les armes, on voyait au second rang un fusil resté en l’air, on était sûr que c’était celui de M. Buonaparte, j’avais soin de le pousser du coude, étant son voisin de droite, mais son arme n’en arrivait pas moins trop tard à « libre » et le bruit qu’elle faisait troublait l’unité exigée si strictement par M. de Lanoy qui s’emportait en criant : « Monsieur Buonaparte, réveillez-vous donc, vous faites toujours manquer les temps d’exercices. »
Buonaparte était arrivé à l’école militaire avec plusieurs élèves de Brienne, il y en avait un qui avait attiré son amitié. C’était Laugier, il avait beaucoup d’esprit naturel et plaisait sous tous les rapports, mais il était dissipé et avait un caractère tout à fai opposé à celui de Buonaparte, il aimait le plaisir, les jeux et se liait avec les élèves les plus gais. Voyant que Buonaparte vivait retiré, peu communicatif, il s’éloigna de lui, il s’associa à ceux qui le raillaient, soit sur sa réserve, soit sur sa taciturnité. Buonaparte s’aperçut de ce changement, il s’en plaignit, lui fit des reproches de sa dissipation, Laugier n’écouta pas les conseils d’un ami, il excitait même les camarades à lui faire des niches, mais il en fut puni, car un jour qu’il se promenait seul dans la salle de récréation, Laugier vint doucement par-derrière lui, au moment où il traversait d’une salle à dans l’autre et, le poussant fortement, s’enfuit dans la foule des élèves pour se soustraire à sa colère, mais il l’eut bientôt distingué et atteint, malgré les efforts de ceux qui l’entouraient et qui riaient de cette malice. Buonaparte le prit au collet et le poussa à terre avec tant de force que Laugier fut tomber violemment contre la grille en fer d’un poêle, il s’y fit une blessure assez profonde au front. Le capitaine commandant de service, en entendant ce bruit, vint à Buonaparte pour le punir, mais avec le plus grand sang froid, il répondit au chef : « J’ai été insulté, je me suis vengé. Tout est dit. » Et il continua sa promenade sans émotion. Depuis ce moment, Laugier fut plus réservé. Buonaparte regrettait d’avoir perdu cet ami qui avait de si heureuses dispositions, hors de l’école militaire, il en parlait encore avec un sentiment sincère d’affection. Laugier a émigré, il s’est distingué dans son régiment, il est mort en 1796, tué en duel à l’armée de Condé par des Roches, officier d’artillerie qui, au régiment de la Fère à Auxonne, avait manqué de se battre avec Buonaparte. Un ouvrage sur Buonaparte a été fait par lui ou par quelqu’un qui a pris son nom.
Buonaparte était dans la classe de mathématiques… MM. Dagelet et Monge, deux hommes distingués étaient nos professeurs, M. Dagelet avait fait le tour du monde de M. de Bougainville, il avait de l’esprit, de l’instruction et aimait beeaucoup à raconter ses voyages, il nous intéressait infiniment lorsqu’il nous parlait. Souvent toute une étude se passait à l’écouter, il racontait très bien et ses récits excitaient l’enthousiasme parmi ses jeunes auditeurs pour les voyages d’outre-mer, beaucoup se destinaient pour la marine, Dabaud, Peccaduc, Phelippeaux, Le Lieur et Buonaparte étaient du nombre. Dans le courant de 1784, il fut question du voyage de M. de la Perouse. MM. Dagelet et Monge sollicitèrent et obtinrent la faveur d’en faire partie, comme astronomes, les aspirants à la marine étaient trop enflammés du désir d’aller parcourir les mers, comme leur professeur, pour ne pas désirer ardemment de le suivre dans cette expédition. Buonaparte aurait bien voulu avoir occasion de déployer son énergie dans une si belle entreprise, mais Darbaud eut seul la préférence, on ne put pas admettre un plus grand nombre d’élèves, il partit avec MM. Dagelet et Monge en 1784. M. Monge ne pouvant supporter la mer, fut obligé de relacher à Madère et de revenir en France. MM Dagelet et Darbaud suivirent le sort funeste de M de la Perouse. Si Buonaparte eut réussi dans ses désirs, comme lui il aurait péri dans une isle éloignée, il lui était réservé de mourir au-delà des mers, mais après avoir tenté bien d’autres voyages.
Cette année, on prévint qu’il n’y aurait pas d’examen de marine, les élèves qui se destinaient à cette partie, pour ne pas perdre une année, dirigèrent leurs études pour entrer dans l’artillerie. Buonaparte fut du nombre ainsi que Peccaduc et Phelippeaux ; me destinant aussi au corps d’artillerie, comme avaient fait mes pères, nous eûmes de plus ce motif de rapprochement. On avait dans cette classe de mathématiques beaucoup de zèle pour cette science, nos professeurs se plaisaient à nous instruire et tous nous efforcions de leur complaire. M. Dagelet venait souvent s’approcher de Buonaparte pour causer avec lui. Il se plaisait à apprécier l’opiniâtreté qu’il mettait à soutenir ses opinions, déjà très avancées. Ces conversations roulaient quelquefois sur les littérateurs, sur la Corse et sur la politique. Les connaissances de Buonaparte n’étaient pas très avancées, il avait plus de facilité à concevoir les propositions qu’à les exprimer. On nous proposait des problèmes à résoudre qui n’étaient pas dans nos cours. Buonaparte venait toujours à bout de les résoudre. Il ne quittait le travail qu’après avoir vaincu les difficultés.
Buonaparte ne réussissait pas aussi bien dans ses autres classes, le maître d’allemand, ne pouvant rien lui faire apprendre, avait fini, après bien des menaces, à lui laisser faire tout autre chose que de l’allemand. Il avait pour cette langue une répugnance invincible et il ne comprenait pas qu’on pût s’en mettre un mot dans la tête. Il profita de cette liberté pour lire pendant toute la classe des livres d’histoire et de politique qu’on lui prêtait de la bibliothèque qui était à disposition des élèves. Il lisait surtout Montesquieu et des histoire de la Corse. Le maître d’écriture avait fait comme celui de l’allemand, il l’avait renvoyé de sa classe, non parce qu’il n’écrivait pas bien, mais parce qu’il voyait qu’il ne pourrait jamais s’assujettir aux plus simples principes de l’écriture. M. Daniel était pourtant un académicien dans cette partie et n’estimait les élèves qu’autant qu’ils écrivaient parfaitement. Buonaparte s’appliquait aux cours d’histoire et de géographie, faits par M. de l’Aiguille, ancien jésuite. Il professait d’une manière admirable, il avait un art admirable pour se faire écouter, il ne lisait jamais ses cahiers, il parlait d’abondance en un très bon style, s’animant lorsque le sujet le demandait. Il conversait avec ses élèves et disputait avec ceux qui n’en avaient pas une conforme à la sienne, je parlerai plus tard d’une discussion au sujet de la Corse avec Buonaparte, et M. de l’Aiguille. Il a été placé par l’Empereur. Je l’ai revu sous l’Empire, il se rappelait encore de la chaleur de son élève dans cette recherche, s’il avait été avantageux pour la Corse d’avoir été soumise à la France. Le professeur en soutenant sa patrie attaquait l’écolier dans ce qu’il avait de plus sensible.
Ses compositions en littérature avaient de l’originalité, mais ne lui attiraient pas d’éloges de M. Domairon, son professeur qui pouvait à peine lire tant elles étaient mal écrites. Lui-même ne pouvait parfois en venir à bout. M. Domairon est l’auteur de plusieurs ouvrages de littératures estimés, il était placé à l’Université. Quant aux étude de dessin de fortification, de dessin d’agrément et de danse, il ne s’en occupait nullement, les trouvant trop futiles et ayant peu de dispositions.
L’exercice qui lui plaisait le plus était celui des armes. Nous avions un excellent maître, Monsieur… Toutes les heures consacrées à la salle d’armes étaient employée à faire assaut. Napoléon s’y mettait en nage, il était dangereux de férailler avec lui, il se mettait en colère lorsqu’il était touché et fondait sur son adversaire sans règle ni mesure ; c’était avec moi qu’il faisait assaut le plus souvent et, lorsque je lui portais une botte, j’avais soin de me retirer en arrière pour lui donner le temps de se calmer.
« Par Saint Pierre, s’écriait-il, je vais me venger », et il allait d’estoc et de taille sans songer à se garantir des coups qu’il se mettait hors d’état de parer et qu’alors il était facile de lui porter. Le maître d’armes venait s’interposer pour faire cesser le combat qu’il poussait à outrance. Il a cassé un grand nombre de fleurets. Je porte encore la marque d’une de ces bottes qui m’a mis plusieurs jours hors de combat avec lui.
Ses récréations se passaient souvent à se promener à grands pas dans les salles de récréation, les bras croisés, à peu près comme il a été représenté depuis dans ses portraits, ayant la tête baissée, défaut pour lequel on le reprenait souvent à l’exercice, il ne faisait aucune attention aux jeux de ses camarades, auxquels il ne prenait aucune part. Il paraisait très occupé de ses reflexions et avait l’air de se réveiller lorsque parfois on le heurtait en courant. Ces méditations lui donnaient un air distrait. On le voyait ainsi s’animer, marcher à plus grands pas et rire ou gesticuler. Cette manière d’agir l’avait fait passer pour singulier, nous nous promenions parfois ensemble et sa conversation était toujours intéressante, elle roulait sur des choses sérieuses, il gémissait sur la frivolité des élèves, les désordres qui régnaient entre eux et le peu de soin qu’on apportait à nous surveiller et nous préserver de la la corruption. Il ne jouait jamais avec ses camarades. Cette réserve a été mal interprétée par les chefs de l’Ecole, qui attribuaient l’isolement qu’il recherchait à de l’éloignement pour la France qui avait subjugué sa patrie. C’était la Corse qui le plus souvent occupait ses pensées et faisait le sujet de nos conversations. Il espérait qu’un jour la Corse deviendrait un état libre et indépendant. Dans son imagination il s’en voyait législateur. Cette idée qui se formulait dans la tête de Buonaparte a été à l’origine de toutes les grandes qualités qui se sont plus tard développées chez lui. Le commencement de la Révolution française lui a fait entrevoir que son rêve pourrait se réaliser.
A la mort de son père en 1785, son confesseur fut chargé de le conduire à l’infirmerie comme c’était l’usage dans ses premiers moments de douleur ; il refusa d’y aller, disant qu’il avait assez de force d’âme pour supporter cette peine sans qu’on prit soin de le consoler. Il n’était pas complètement irreligieux et encore moins athée et cependant il n’était ni catholique ni protestant, les seules circonstances qui tirassent Buonaparte de sa rêverie habituelle était l’attaque ou la défense des redoutes que nous nous amusions à faire avec la neige. Alors, il se mettait à la tête d’un de ces partis et le commandait avec une intelligence remarquable. Un jour de fête publique, un ballon devait être lancé au Champ de Mars, les élèves de l’école étaient sous les armes depuis fort longtemps et le ballon ne partait pas. Buonaparte s’impatienta et, sans me communiquer son projet, il me donna son fusil à tenir, il sort des rangs sans être aperçu et va couper les cordes qui retiennent le ballon. Il fut crevé et Buonaparte puni sévèrement.
août 9, 2007
LA MAISON BONAPARTE – AJACCIO
La Maison historique
La première demeure des Bonaparte s’élevait au bord de la Grande-Rue ; elle a été démolie par les Français lorsqu’ils bâtirent la citadelle vers 1755, et fut certainement celle du premier Bonaparte établi en Corse vers 1490, Francesco, surnommé le Maure de Sarzanne, du nom de la petite ville italienne d’où sa famille était originaire. On ignore où vécurent les Bonaparte de 1555 à 1623, date du mariage de Sebastiano Bonaparte avec Angela-Felice Lubera qui apporte en dot la demeure de son père, le capitaine Troilo Lubera. La « casa Lubera », qui portait sur l’entablement de son portail l’inscription latine « spe mea est in Deo », a été démolie il y a quelques années pour faire place à un petit jardin rue du Conventionnel Chiappe. C’est seulement à la fin du XVIIème siècle que les Bonaparte s’installent dans une partie de la maison qui depuis porte leur nom. Le 20 décembre 1682, Giuseppe Bonaparte épouse Maria Bozzi dont la dot s’élève à 4901 livres et comprend quelques pièces de la casa Bozzi à Ajaccio. A partir de ce moment, les Bonaparte essaieront de s’attribuer cette maison tout entière, étage par étage, demi-étage par demi-étage, voire chambre par chambre : la coutume corse divisait et subdivisait en effet la propriété à un point tel qu’il existait parfois autant de propriétaire que de chambres.
A la mort de Maria Bozzi en 1704 ses trois enfants survivants héritent de sa part : Sebastiano reçoit un appartement, Antonio une pièce et deux chambres au premier étage, et Virginia l’étage supérieur. qu’elle transmettra à ses descendants. Sebastiano meurt dès1720 laissant des enfants en bas âge. Son frère Antonio, resté célibataire, prend en charge les intérêts de ses neveux. En 1734 il achète une chambre supplémentaire à Giovanni-Battista Bozzi qu’il donne avec sa propre part à son neveu Napoleone en 1737. Pour éviter que les dernières pièces échappent à la famille, il lui fait épouser en 1743 Maria Bozzi, fille de Giovanni-Battista, qui apporte en dot la moitié de la maison de la rue Malerba. Lorsqu’Antonio meurt en 1762, la totalité de la maison est entre les mains de ses trois neveux à l’exception de l’étage supérieur qui appartient à la fille de Virginia. Le cadet des neveux, Luciano Bonaparte, est entré dans les ordres et devenu archidiacre à Ajaccio. Tout comme son oncle Antonio, Luciano tente d’empècher la division de la maison dans la descendance de ses deux frères. En 1766 après de longues tractations, sa belle-soeur, née Maria-Rosa Bozzi accepte d’échanger sa part de la maison familiale contre une vigne aux Salines. La « casa » se trouve alors dans un complet état de vétusté ; on accède à l’étage supérieur par une simple échelle mobile, les murs sont décrépis, le toit est à reprendre entièrement. L’archidiacre fait refaire les planchers et les fenêtres, construire un escalier fixe et reprendre le toit et les murs intérieurs, ce qui lui permet de gagner deux chambres ; les travaux lui coûtent 1500 livres en monnaie de Gênes, mais la maison est devenue la importante de le rue Malerba qui prend désormais le nom de rue Bonaparte.
Le seul héritier mâle des Bonaparte, Carlo-Maria, épouse en 1764 Letizia Ramolino ; sur douze enfants, huit survivent, dont sept naissent dans la maison familiale d’Ajaccio, l’aîné Joseph, ayant vu le jour à Corte. Charles de Buonaparte, comme il se nomme à présent lui-même, adhère au rattachement de l’île à la France ; c’est un personnage important, avocat au Conseil Supérieur de la Corse et assesseur de la juridiction royale d’Ajaccio ; en 1771 il est reconnu noble par le roi de France et en 1777 se rend à Versailles comme député de la noblesse de l’île. Pour soutenir ce train de vie il agrandit et embellit la demeure familiale en faisant construire en 1774 sur un emplacement acheté à la famille Ponte une terrasse qui lui coûte 600 F ; il y fait installer une petite cabane de bois pour permettre au jeune Napoléon d’y travailler ; en 1780 Charles dépense 896 F en travaux d’aménagements intérieurs ; il fait tendre sa chambre à coucher d’étoffe cramoisie et y installe une cheminée de marbre de 260 livres ; enfin une grande table de vingt couverts forme le centre de la salle à manger. Charles meurt en 1785 ; l’aîné de ses enfants Joseph n’a que 17 ans et l’archidiacre Luciano reprend les rênes de la famille. Le jeune Napoléon parti pour le collège d’Autun en décembre 1778 ne rentre à Ajaccio qu’après la mort de son père ; de 1786 à 1793 il effectue cinq séjour plus ou moins long sur son île : du 15 septembre 1786 au 12 septembre 1787, du 1er janvier à fin mai 1788, de septembre 1789 à janvier 1791, de fin septembre 1791 à mai 1792 et du 15 octobre 1792 au 11 juin 1793.
En 1790 l’archidiacre agrandit la maison en achetant à Carlo Sapia pour 1660 livres un bâtiment voisin de la casa ; relativement important, il comprend une cuisine, deux chambres, un magasin et deux greniers. Il est possible qu’une partie de ces deux pièces corresponde aux trois salles situées dans le prolongement de la galerie.
Mais la Révolution a éclaté, et les Bonaparte fervents partisans des idées républicaines, doivent céder devant le parti anglais auquel Paoli et Pozzo di Borgo se sont ralliés. En mai 1793 Letizia doit quitter Ajaccio précipitamment avec ses enfants ; le 24 mai les propriétés de la famille sont saccagées et la maison est pillée ; tout disparait y compris les portes et fenêtres. Elle est réquisitionnée par les anglais et le rez-de-chaussée est utilisé comme magasin à fourrage et dépôt d’armes tandis que l’étage sert de logement à des officiers anglais, parmi lesquels a peut-être figuré Hudson Lowe, le futur géôlier de Napoléon à Sainte-Hélène.
A la fin d’octobre 1796 les français chassent les anglais de Corse, et Joseph Bonaparte peut rentrer à Ajaccio en décembre 1796 ; le 10 décembre Napoléon lui écrit : « Mets en ordre nos affaires domestiques surtout notre maison d’habitation que je désire à tout événement voir dans une situation propre et digne d’être habitée. Il faut la remettre comme elle était en y joignant l’appartement d’Ignazio. Fais les petits arrangements pour que la rue soit plus habitable. » L’achat devait être prévu depuis longtemps, car dès le 11 décembre Joseph achète pour 8500 livres l’appartement à Ignazio Pianelli et à son épouse, Artillia-Maria Pozzo di Borgo, petite-fille de Virginia Bonaparte, celle-là même qui avait reçu l’étage supérieur de la maison.
Dès son arrivée, Joseph se préoccupe de trouver un architecte afin de remettre la maison en état. Il choisit un Suisse établi en Corse, Samuel-Etienne Meuron entrepreneur en fortifications de la place d’Ajaccio. Le 16 février 1797 Joseph remet 17457 livres 15 sols à son fondé de pouvoir Francesco Braccini afin de payer les travaux ; lorsque les comptes seront arrêtés le 11 mai 1799, ils s’élèveront à 19776 livres 14 sols. Joseph quitte la Corse le 28 mars 1797 et sa mère le remplace dès la seconde quinzaine de juin. Les moyens de restaurer la maison lui sont fournis par la loi du 31 janvier 1797 qui indemnise les Corses victimes de l’occupation anglaise ; Letizia reçoit 124800 francs dont 16000 francs pour la seule maison d’Ajaccio ; il semble bien qu’elle ait surestimé les dommages subis par le mobilier et le linge puisqu’elle les évaluait à 25000 F. Letizia signe les factures des maçons, des menuisiers, des forgerons et des séruriers entre juin 1797 et juin 17998 ; à cette date, le gros oeuvre et le premier étage sont sur le point d’être achevés, car le serrurier livre les gonds des portes et les mouvements de sonnettes. Le modèle de la rampe d’escalier est envoyé en novembre 1797 à Marseille chez Mme Clary, belle-mère de Joseph, qui la fait exécuter, puis expédier à Ajaccio. La maison semble avoir été reprise entièrement, car Letizia fait venir de Gênes et de Marseille 20000 briques, 5000 tomettes et 3000 tuiles. Enfin il faut tendre les murs de papier peint et complèter le maigre mobilier échappé au pillage. Les achats sont également faits à Marseille ; dès janvier 1797 Elisa fait parvenir à Joseph cinq tentures en papier et une en damas, la chambre étant tapissée en rouge velouté. Elisa fournit également de nombreux sièges, des trumeaux et une table de marbre. En septembre de la même année le marchand Laplane expédie de Marseille 8 fauteuils, 18 chaises et un « bois de lit avec son palanquin ». Enfin en avril 1798, Letizia réclame à Mme Clary des papiers peints de différentes couleurs : rouge et blanc, jonquille, rouge, ponceau avec des roses. Fesch rejoint sa soeur à Ajaccio en octobre 1798 ; il écrit aussitôt à Joseph : « Costa loge dans votre maison ; selon votre ordre, le premier est réparé, mais le second et le toit exigeraient une forte réparation. » En novembre la situation est identique : « Je n’ai pu achever la maison, faute de matériaux qu’on attend de Marseille. » Elle dut être achevée au début de 1799, car en juillet, Letizia, Fesch et le jeune Louis quittent Ajaccio pour toujours, confiant leur maison à Camilla Illari, la nourrice de Napoléon.
Au retour d’Egypte Bonaparte fait escale quelques jours à Ajaccio du 29 septembre au 5 octobre 1799 ; il s’installe dans la maison rénovée, au second étage dans la chambre dite de l’alcôve. Son séjour est marqué par un bal organisé par Murat dans la galerie récemment aménagée et par une promenade aux Milelli, propriété ajaccienne des Bonaparte. Enfin le 4 au soir, il quitte secrètement la maison pour s’embarquer sur la « Muiron » qui le conduira à Fréjus. Il ne devait plus revoir sa maison natale mais se préoccupera de son sort sous l’Empire.
L’Empereur avait conçu le projet de donner la maison Bonaparte à sa vieille nourrice Camilla Illari, qui était venue à Paris après le couronnement. Il chargea le cardinal Fesch de connaître l’avis de Madame Mère. Celle-ci répond que si une demeure ou presque tous ses enfants ont vu le jour cesse d’appartenir à sa famille, elle ne la cédera qu’à son cousin germain André Ramolino.
L’Empereur y consent mais sous la condition expresse que sa nourrice aurait en échange la maison de ce dernier. L’acte est passé devant Maître Raguideau au château de Malmaison le 23 mars 1805.
Le contrat stipule que Ramolino doit créer dans les deux ans une place à ses frais en faisant démolir la maison Pietra-Santa et une partie de la maison Gentile ; c’est l’origine du jardin situé devant la maison. Ramolino meurt dans la maison en 1831 ; quelques semaines auparavant, il reçoit la visite du jeune prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe, à qui il fait don d’un fauteuil « Louis XV ». Après sa mort, sa veuve Madeleine Baciocchi, soeur du Prince de Lucques et Piombino, y habite jusqu’à son décès en 1847.
En 1831, la propriété passe au filleul et parent d’André Ramolino, Napoléon Lévie ; celui-ci reçoit plusieurs propositions d’achat : 500000 F en 1833 par l’ambassadeur Pozzo di Borgo, puis 200000 F un peu plus tard par le duc d’Orléans, fils de Louis-Philippe. Madame Mère qui vit toujours, conteste cet héritage et attaque en nullation la donation de 1805 prétextant la naissance du Roi de Rome, survenue en 1811 ; lorsque ce dernier meurt en 1832, elle assigne Lévie devant le tribunal d’Ajaccio en tant qu’héritière de son petit-fils. Madame Mère meurt en 1836, et suivant ses dernières volontés, le cardinal Fesch reprend l’instance ; il disparaît à son tour en 1839. Son héritier est l’ancien roi d’Espagne Joseph, qui parvient à rentrer en possession de la maison par une transaction du 2 juin 1843. Lévie, autorisé par Louis-Philippe à ajouter à son nom celui de Ramolino, quitte les lieux en juin 1844, emmenant avec lui tout le mobilier. C’est donc d’une demeure vide qu’hérite la fille de Joseph, Zenaïde princesse de Canino, à la mort de son père en juillet 1844.
Elle s’en déssaissit en 1852 en faveur de son cousin Napoléon III, qui ouvre en 1857 un crédit de 20000 F pour la restauration du bâtiment. Les travaux sont menés par l’architecte du palais de Fontainebleau Alexis Paccard ; c’est à cette époque que les plafonds sont peints par Jérôme Maglioli, peintre et architecte de la maison. Il restaure et aménage les caves situées sous la galerie, achetées en 1860 à Mme génie, née Marie-Benoîte Ponte. Dès 1858 le garde-meuble tente de racheter, sans succès, l’ancien mobilier à Lévie-Ramolino ; un devis d’ameublement du premier étage est alors demandé. L’Empereur et l’impératrice visitent la maison en septembre 1860 et sont déçus de la trouver vide. La négociation avec Lévie-Ramolino est relancée, et ce dernier accepte enfin de céder le mobilier pour 15000 F ; il est installé lors de la visite que l’impératrice Eugénie effectue avec son fils en 1869 à l’occasion du centenaire de la naissance de Napoléon. Elle place alors sur la cheminée de la chambre natale de Napoléon 1er un buste du Prince Impérial d’après Carpeaux.
A la chute de l’Empire la maison est confisquée par un décret du 6 septembre 1870 ; elle n’est restituée au Prince Impérial qu’en 1874 ; à sa mort elle passe à sa mère l’impératrice Eugénie, puis au décès de cette dernière, à son héritier le Prince Victor. En 1923, ce dernier offre la maison à l’Etat qui accepte le don l’année suivante ; elle est classée par le Service des Monuments Historiques qui en assure l’entretien jusqu’en 1967. Depuis cette date, la maison Bonaparte est un musée national dépendant du musée de Malmaison.
Elle se dresse à l’angle des rues Saint-Charles (anciennement Malerba) et Letizia (anciennement del Pevero), devant une petite place créée au début du XIXème siècle, puis transformée en jardin. En 1936 à l’occasion du centenaire de la mort de Madamè Mère, on y a érigé un buste en bronze du Roi de Rome, par le sculpteur marseillais Elie-Jean Vezien.
La façade à trois étages est décorée des armes des Bonaparte ; elles avaient été démontées lorsque la plaque de marbre rappelant la naissance de Napoléon avait été posée, puis rescellées en 1899 pour le centenaire du Consulat.
(Bernard Chevallier – Extrait du guide de la Maison Bonaparte – 1986)
août 7, 2007
GENERAL JEAN-PIERRE DU TEIL – AUXONNE
Jean-Pierre du Teil de Beaumont, né le 14 juillet 1722 à Châbons (Isère), volontaire au corps de l’artillerie en mars 1731, cadet (18 décembre 1733), sous-lieutenant de cannooniers (24 août 1735), lieutenant en second (9 novembre 1743) et en premier de cannoniers (24 août 1735), lieutenant en second (9 novembre 1743) et en premier cannoniers (29 mars 1746), capitaine en second de sapeurs (14 avril 1748), capitaine en premier de cannoniers (1er janvier 1757), employé à Schlestadt (1er janvier 1759), avait déjà pour raisons de santé obtenu sa pension de retraite le 21 mai 1760. Mais il rejoignit volontairement l’armée et prit par à la bataille de Warbourg. Il fut réadmis (20 juin 1761), devint capitaine de bombardiers (25 novembre 1761), et après avoir été détaché à La Rochelle (13 août 1765), chef de brigade au régiment de Toul (25 août 1765), avec rang de lieutenant-colonel (29 février 1768), lieutenant-colonel sous-directeur à Collioures (11 avril 1770), lieutenant-colonel du régiment de Toul (27 novembre 1773), colonel du régiment de La Fère (1er janvier 1777), comandant de l’école d’artillerie d’Auxonne (3 juin 1779), brigadier d’infanterie (1er mars 1780), maréchal de camp (1er janvier 1784). Il n’aimait pas la Révolution mais la servit. Inspecteur général d’artillerie (1er avril 1791), commandant en chef l’équpage de l’artillerie à l’armée du Rhin (avril 1792), poste qu’il ne rejoignit pas pour cause de maladie, il était inspecteur général d’artillerie à l’armée des Alpes au mois de septembre 1793. Arrêté par trois membres du comité révolutionnaire de cette ville, il fut envoyé à Lyon aux repésentants du peuple Collot d’Herbois et Fouché, traduit devant le commissaire militaire et fusillé le 27 février 1794.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 6, 2007
LOUIS CHARLES RENE, COMTE DE MARBEUF
Louis-Charles-René, Comte de Marbeuf, fils d’un lieutenant général, était né à Rennes, le 4 novembre 1712. Successivement enseigne au régiment de Bourbonnais (13 octobre 1728), lieutenant (7 juillet 1729), capitaine (23 avril 1732), aide-major général de l’infanterie (1er mai 1747), colonel (15 février 1748), birgadier d’infanterie (3 septembre 1759), maréchal de camp (25 juillet 1762), lieutenant général (23 octobre 1768), il fut nommé le 4 août 1772 commandant en chef des troupes françaises en Corse. Il touchait un traitement de 71 2008 livres, 45 208 livres comme commandant en chef, 15 000 comme lieutenant général, 4 00 comme grand’croix de Saint-Louis, 4 000 sur le département des finances comme gentilhomme de la chambre du roi de Pologne et duc de Bar, 3 000 à titre de pension sur le trésor de guerre. En 178, à l’âge de soixante-douze ans, il se maria : « Mes parents et amis, disait-il, me voyant seul de mon nom, ont exigé que je me marie, pour pouvoir le péerpétuer ». Il mourut le 20 septembre 786 à Bastia et y fut enseveli dans l’église de Saint-Jean-Baptiste.
Sa veuve, fille d’un maréchal de camp, Catherine-Salinguerra-Antoinette de Gayardon de Fenoyl, née le 6 juin 1765, avait reçu par décision du 28 septembre 1783, une pension de 8 000 livres assurée à titre de douaire sur le trésor royal. Napoléon 1er lui donnal, le 22 juillet 1809, une dotation de 15 000 livres et la nomma, le 19 juin 1813, baronne d’Empire. Elle mourut à Paris le 18 mars 1839.
Son fils Laurent-François-Marie né à Bastia le 26 mai 1786, élève pensionnaire de Fontainebleau (22 septembre 1803), caporal (21 avril 1804), sous-lieutenant au 25ème régiment de dragons (16 janvier 1805), lieutenant (21 novmebre 1806) et adjudant-major au même régiement (10 novembre 1807), officier d’ordonnance de l’Empereur (29 octobre 1808), baron de l’Empire (9 décembre 1809), chef d’escadron aux chasseurs à cheval de la garde impériale (6 avril 1810), colonel du 6ème régiment de chevau-légers (14 octobre 1811), mourut de ses ses blessures le 25 novembre 1812, à Marienpol, grand-duché de Varsovie.
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon – Arthur Chuquet)
août 5, 2007
LE PERE BERTON – COLLEGE DE BRIENNE LE CHATEAU
Louis-Sébastien Berton, né à Reims le 6 mars 1746, fit d’assez bonnes études à l’Université de sa ville natale, s’engagea, dit-on, au régiment dur Roi, puis quitta le service pour entrer chez les Minimes. Il fit sa profession le 27 août 1765 au couvent de Reims. Principal du collège de Brienne jusqu’à la Révolution, grand vicaire de l’évêque constitutionnel de Sens, passant la Terreur dans cette dernière ville où il instruisait un jeune homme et cultivait un jardin, il fut nommé par Bonaparte économe du collège de Saint-Cyr : le décret, daté du 20 juillet 1800 et signé par Lucien Bonaparte, ministre de l’intérieur, porte que « Le Breton s’occupera sans délai de l’établissement du régime économique ». Le 28 mars 1801, Berton succédait, comme directeur du collège de Compiègne, à Crouzet, qui venait au collège de Saint-Cyr remplacer Sallior. Proviseur du lycée de Reims en 1803, mis à la retraite en 1808, il mourut le 20 juillet 1811. « Si cet homme, a écrit Lacatte-Joltrois dans sa Biographie rémoise manuscrite, n’eût pas revenu dans son pays, on l’aurait toujours regardé comme un personnage important. Qu’avait-il ou que lui restait-il ? Un ton plus dur que sévère, sans cependant savoir se faire obéir. Les mémoires qu’il fit dans lesquels on remarquait la dureté de son caractère, ne lui donnèrent aucune confiance. Il faut avouer que les discours qu’il prononçait aux distributions des prix étaient toujours bien faits et faisaient admirer son éloquence. Voilà tout. Il négligea sa place, se livra aux plaisirs de la table, et se perdit, et, s’il est vrai qu’il se laissa mourir, comme on dit, en se privant de manger, et ne buvant que de l’eau pendant quarante-deux jours, qu’il allait chercher lui-même dans une cruche à la rivière (il demeurait alors dans la rue du Cerf), que penser de cet homme ? »
(Notes et notices – La jeunesse de Napoléon par Arthur Chuquet)
août 4, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LES GALERIES ET JARDINS DU PALAIS ROYAL
Une rencontre au Palais Royal
Je sortais des Italiens et me promenais à grands pas sur les allées du Palais Royal. Mon âme, agitée par les sentiments vigoureux qui la caractérisent, me faisait supporter le froid avec indifférence ; mais, l’imagination refroidie, je sentis les rigueurs de la saison et gagnai les galeries. J’étais sur le seuil de ces portes de fer quand mes regards errèrent sur une personne du sexe. L’heure, la taille, sa grande jeunesse ne me firent pas douter qu’elle ne fût une fille. Je la regardais : elle s’arrêta non pas avec cet air grenadier des autres, mais un air convenant parfaitement à l’allure de sa personne. Ce rapport me frappa. Sa timidité m’encouragea et je lui parlai… Je lui parlai, moi qui, pénétré plus que personne de l’odieux de son état, me suis toujours cru souillé par un seul regard… Mais son teint pâle, son physique faible, son organe doux, ne me firent pas un moment en suspens. Ou c’est, me dis-je, une personnne qui me sera utile à l’observation que je veux faire, ou elle n’est qu’une bûche.
– Vous aurez bien froid, lui dis-je, comment pouvez-vous vous résoudre à passer dans les allées ?
– Ah ! monsieur, l’espoir m’anime. Il faut terminer ma soirée.
L’indifférence avec laquelle elle prononça ces mots, le flegmatique de cette réponse me gagna et je passai avec elle.
– Vous avez l’air d’une constitution bien faible. Je suis étonné que vous ne soyez pas fatiguée du métier.
– Ah ! dame, monsieur, il faut bien faire quelque chose.
– Cela peut-être, mais n’y a-t-il pas de métier plus propre à votre santé ?
– Non, monsieur, il faut vivre.
Je fus enchanté, je vis qu’elle me répondait au moins, succès qui n’avait pas couronné toutes les tentatives que j’avais faites.
– Il faut que vous soyez de quelques pays septentrionaux, car vous bravez le froid.
– Je suis de Nantes en Bretagne.
– Je connais ce pays-là… Il faut, mademoiselle, que vous me fassiez le plaisir de me raconter la perte de votre p…
– C’est un officier qui me l’a pris.
– En êtes-vous fâchée ?
– Oh ! oui, je vous en réponds. (Sa voix prenait une saveur, une onction que je n’avais pas encore remarquée). Je vous en réponds. Ma soeur est bien établie actuellement. Pourquoi ne l’eus-je pas été ?
– Comment êtes-vous venue à Paris ?
– L’officier qui m’avilit, que je déteste, m’abandonna. Il fallut fuir l’indignation d’une mère. Un second se présenta, me conduisit à Paris, m’abandonna, et un troisième avec lequel je viens de vivre trois ans, lui a succédé. Quoique Français, ses affaires l’ont appelé à Londres et il y est. Allons chez vous.
– Mais qu’y ferons-nous ?
– Allons, nous nous chaufferons et vous assouvirez votre plaisir.
J’étais bien loin de devenir scrupuleux, je l’avais agacée pour qu’elle ne se sauvât point quand elle serait pressée par le raisonnement que je lui préparais en contrefaisant une honnêteté que je voulais lui prouver ne pas avoir…
(Paris le 22 novembre 1787)
août 3, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DES FEMMES
Dialogue sur l’amour
Dans cet écrit, Napoléon Bonaparte se met en scène face à son meilleur ami de jeunesse, son camarade Alexandre des Mazis. Ils y exposent des avis divergents sur la grande question métaphysique qu’est l’amour.
Des Mazis. – Comment, monsieur, qu’est-ce que l’amour ? Eh ! quoi, n’êtes-vous donc pas composé comme les autres hommes ?
Bonaparte. – Je ne vous demande pas la définition de l’amour. Je fus jadis amoureux et il m’en est resté assez de souvenir pour que je n’aie pas besoin de ces définitions métaphysiques qui ne font jamais qu’embrouiller les choses : je vous dis plus que de nier son existence. Je le crois nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes, enfin je crois que l’amour fait plus de mal… et que ce serait un bienfait d’une divinité protectrice que de nous en défaire et d’en délivrer le monde.
Des Mazis. – Quoi ! L’amour nuisible à la société, lui qui vivifie la nature entière, source de toute production, de tout bonheur. Point d’amour, monsieur, autant vaudrait-il anéantir notre existence !
Bonaparte. – Vous vous échauffez. La passion vous transporte. Reconnaissez, je vous en prie, votre ami. Ne me regardez pas avec indignation et répondez. Pourquoi depuis que cette passion vous domine, ne vous vois-je plus dans vos sociétés ordinaires ? Que sont devenues vos occupations ? Pourquoi négligez-vous vos parents, vos amis ? Vos journées entières sont sacrifiées à une promenade monotone et solitaire jusqu’à ce que l’heure vous permette de voir Adélaïde.
Des Mazis. – Eh ! que m’importe à moi, monsieur, vos occupations, vos sociétés ? A quoi aboutit une science indigeste ? Qu’ai-je à faire de ce qui s’est passé il y a mille ans ? Quelle influence puis-je avoir sur le cours des astres ? Que m’importe le minutieux détail des discussions puériles des hommes ?… Je me suis occupé de cela sans doute. Qu’avais-je de mieux à faire ? Il fallait bien par quelque moyen se soustraire à l’ennui qui me menaçait ; mais, croyez-moi, je sentais, au milieu de mon cabinet, le vide de mon coeur. Parfois mon esprit était satisfait, mais mes sentiments !… Oh ! Dieu, je n’ai fait que végéter tant que je n’eus pas aimé. Actuellement au contraire, quand l’aurore m’arrache au sommeil, je ne me dis plus : Pourquoi le soleil luit-il aujourd’hui pour moi ? Non ! le premier rayon de lumière me présente ma chère Adélaïde en habit du matin. Je la vois penser à moi, me sourire. Hier au soir, elle me serrait la main ; elle soupirait, nos regards se rencontraient. Comme ils exprimaient nos sentiments ! Je contemple un portrait qui me ravit l’âme. Cent fois je le remets pour le reprendre aussitôt. Cette promenade, monsieur, que vous appelez monotone, eh ! non, la vaste étendue du globe ne contient pas plus de variété. D’abord, mon esprit repasse les choses qu’elle m’a dites ; je relis le billet qu’elle m’a écrit ; je pense à celui qui doit peindre toute l’étendue de mon amour. Je le refais cent fois. Mon imagination s’élève ; je vois bientôt mes feux couronnés, je regrette tantôt de ne pas avoir une fortune immense à lui sacrifier. Ici même, je voudrais avoir une couronne. Concevez-vous le charme de la proposer à ses parents, la joie que cela lui causerait. Tout ce qui approche d’elle est sacré à mes yeux. Une autre fois, je penserai aux préparatifs des noces qui doivent bientôt nous unir, jusqu’aux présents que je dois lui faire… Mon coeur se dilate à imaginer quelque chose qui puisse l’obliger, lui prouver mon amour. Voyez-vous le château où nous devons passer nos jours, les sombres bosquets, les riantes prairies, les délicieux parterres. Rien ne m’affecte que le plaisir d’être tous les jours à côté d’elle. Mais bientôt elle doit me donner des gages de notre amour… Mais vous riez ! En vérité je vous déteste.
Bonaparte. – Je ris des grandes occupations qui captivent votre âme et plus encore du feu avec lequel vous me les communiquez. Quelle maladie étrange s’est emparée de vous ? Je sens que la raison que je vais appeler à votre secours ne fera aucun effet et, dans le délire où vous êtes, vous ferez plus que de fermer l’oreille à sa voix ; vous la mépriserez. Souvenez-vous que vous n’êtes pas de sang-froid et que mon amitié fut toujours le juge qui vous rappela à vos devoirs. Souvenez-vous que je m’en suis toujours rendu digne. J’aurais besoin de répéter ici les obligations que vous me devez et les marques qui vous sont connues de mes sentiments, car, moi-même, je ne serais pas à l’abri de vos invectives dans les accès de votre délire. Car votre état est pareil à celui d’un malade qui ne voit que la chimère qu’il poursuit et sans connaître la maladie qui la produit, ni la santé qu’il a perdue. Je n’agiterai donc pas si vos plaisirs sont dignes de l’homme, ou même si c’en sont. Je veux croire que ce sexe, roi du monde par sa force, son industrie, son esprit et toutes ses autres facultés naturelles, trouve sa suprême félicité à la languir dans les chaînes d’une molle passion et sous les lois d’un être plus fragile d’entendement comme de corps. Je veux croire, comme vous le dites, que le souvenir de votre Adélaïde, son image, sa conversation, puissent vous dédommager des agréments de vos occupations, de vos sociétés ; mais n’est-il pas vrai que vous désirez toujours la fin de cet état et que votre insatiable imagination voudrait obtenir ce que la vertu d’Adélaïde ne peut accorder. Ma froide tranquillité, je le vois, n’est pas propre à peindre le pesant fardeau qui tourmente l’existence d’un amant dans le moindre échec qui lui survient. Qu’Adélaïde s’absente pour quinze jours seulement, que deviendrez-vous ? Si un autre s’efforce de plaire à cet objet que vous croyez vous appartenir, que d’inquiétudes ! Si une mère alarmée trouve mauvaises de trop fréquentes visites qui font parler un public méchant, enfin, monsieur, que sais-je, cent petites autres choses qui frappent fortement un amant vous agitent. Souvent les nuits se passent sans sommeil, les repas sans manger, la Terre n’a point d’endroit pour contenir votre inquiétude extrême. Votre sang bouillonne, vous marchez à grands pas le regard égaré. Pauvre chevalier, est-ce là le bonheur ?… Je ne doute pas que si, aujourd’hui, dans l’extase que vous a occasionnée un serrement de main, vous ne trouviez cet état la suprême félicité ; je ne doute pas, dis-je, que demain, dans une humeur contraire, vous ne trouviez votre faiblesse insupportable.
Mais, chevalier, voilà votre position. S’il fallait défendre la patrie attaquée, que feriez-vous ? S’il fallait !… Mais à quoi êtes-vous bon ? Confiera-t-on le bonheur de vos semblables à un enfant qui pleure sans cesse, qui s’alarme ou se réjouit au seul mouvement d’une autre personne ? Confiera-t-on le secret de l’Etat à celui qui n’a point de volonté ?
Des Mazis. – Toujours des grands mots vides de sens ! Que fait à moi votre Etat, ses secrets ? En vérité, vous êtes inconcevable aujourd’hui. Vous n’avez jamais raisonné si pitoyablement.
Bonaparte. – Ah ! chevalier, que vous importent l’Etat, vos concitoyens, la société ! Voilà les suites d’un coeur relâché, abandonné à la volupté. Point de force, point de vertus dans votre sentier. Vous n’ambitionniez que de faire le bien et, aujourd’hui, ce bien même vous est indifférent. Quel est donc ce sentiment dépravé qui a pris la place de votre amour pour la vertu ? Vous ne désirez que de vivre ignoré à l’ombre de vos peupliers. Profonde philosophie ? Ah ! chevalier, que je déteste cette passion qui a produit une si grande métamorphose ? Vous ne songez pas que vous tirez vers l’égoïsme et tout vous est indifférent, opinions des hommes, estime de vos amis, amour de vos parents. Tout est captivé au tyran fort de votre faiblesse. Un coup d’oeil, un serrement de main, un baiser, chevalier, et que vous importe alors la peine de la patrie, la mauvaise opinion de vos amis ; un attouchement corporel… mais je ne veux pas vous irriter. Je le veux croire : l’amour a des plaisirs incomparables, des peines encore plus grandes peut-être, mais n’importe, considérons seulement l’influence qu’il a dans l’état de la société. Il est vrai, chevalier, que dans l’état des choses, notre âme, née indépendante, a besoin d’être formée, dégradée si vous voulez par des institutions, que, dès la naissance, l’attention que tous les législateurs ont donnée à l’éducation…, que nous sommes nés pour être heureux, que c’est la loi suprême que la nature a gravée au fond de nous-mêmes. Il est vrai que c’est la base qui nous a été donnée pour servir de règle à notre conduite. Chacun, né juge de ce qui peut lui convenir, a donc le droit de disposer de son corps comme de ses affections, mais cet état d’indépendance est vraiment opposé à l’état de servitude où la société nous a mis.
En changeant d’état, il a donc fallu changer d’humeur. Il a donc fallu substituer au cri de notre sentiment, celui des préjugés. Voilà la base de toutes les institutions sociales. Il a fallu prendre l’homme dès son origine pour en faire s’il se peut une autre créature. Croyez-vous, sans ce changement, que tant d’hommes souffriraient d’être avilis par un petit nombre de grands seigneurs et que des palais somptueux seraient respectés par des hommes qui manquent de pain ? La force est la loi des animaux ; la conviction celle des hommes. On convint, soit pour repousser les attaques des bêtes plus fortes, soit pour ne pas être exposé à se battre à chaque instant, l’on convint, dis-je, des lois des propriétés et chacun fut assuré au nom de tous de la propriété de son champ.
Cette conviction n’existait qu’entre un petit nombre d’hommes. Il fallait donc des magistrats, soit pour repousser les attaques des peuplades voisines, soit pour faire exécuter la convention reçue.
Ces magistrats sentirent le charme du commandement, mais les plus alertes du peuple s’y opposèrent. Ils furent gagnés et ainsi associés aux projets des ambitieux. Le peuple fut subjugué. Vous voyez l’inégalité s’introduire à grands pas ; vous voyez se former la classe régnante de la classe gouvernée. La religion vint consoler les malheureux qui se trouvaient dépouillés de toute propriété. Elle vint les enchaîner pour toujours. Ce ne fut plus par les cris de la conscience que l’homme devait se conduire. Non ! L’on craignit qu’un sentiment que l’on faisait tout au monde pour étouffer reprît le dessus.
Il y eut donc un Dieu. Ce Dieu conduisait le monde. Tout se faisait par acte de sa volonté. Il avait donné des lois écrites… et l’empire des prêtres commença, empire qui probablement ne finira jamais.
Que l’homme donc soit dégradé, triste vérité ! mais que l’état de société ne soit légitime, c’est ce dont l’on ne peut disconvenir. Le silence des hommes là-dessus est une approbation tacite que rien ne peut démentir. Vous avez vingt ans, monsieur, choisissez : ou renoncer à votre rang, à votre fortune et quitter un monde que vous détestez, ou, vous inscrivant dans le nombre des citoyens, soumettez-vous à ses lois. Vous jouissez des avantages du contrat, serez-vous infidèle aux autres clauses ? Ce ne serait pas vous croire honnête homme que d’en douter. Vous devez donc être attaché à un Etat qui vous procure tant de bien-être et, promettant à la fois de faire un digne usage des avantages qu’il vous a accordés, vous devez rendre heureux le peuple au-dessus duquel vous êtes et faire prospérer la société qui vous a distingué. Pour cela faire, mon cher chevalier, il faut que vous soyez toujours maître de votre âme et de vos occupations et il ne faut pas que l’aspect des affaires vous empêche. Pour cela faire, il faut que, guidé toujours par le flambeau de la raison, vous puissiez balancer avec équité les droits des hommes à qui vous devez. Pour cela faire, il faut que, prêt à tout entreprendre pour le service de l’Etat, vous soyez soldat, homme d’affaires, courtisan même si l’intérêt du peuple et de votre nation le demande. Ah ! que votre récompense sera douce ! Défiez alors les malignes vapeurs de la calomnie, de la jalousie ! Défiez hardiment le temps même ! Vos membres décrépits ne seront plus qu’une image imparfaite de ce qu’ils furent jadis et ils attireront cependant le respect de tous ceux qui vous approcheront. L’un racontera, dans sa cabane, le soulagement que vous lui avez apporté. L’autre, en faisant le récit des complots méchants, dira : S’il ne fût pas venu à mon secours, j’eusse péri du supplice des criminels. Chevalier, cesse de restreindre cette âme altière et ce coeur jadis si fier à une sphère aussi étroite ! Toi aux genoux d’une femme ! fais plutôt tomber aux tiens les méchants confondus ! Toi mépriser les peines des hommes ! Sentiment d’honneur, subjugue-le plutôt ! Estimé par tes semblables, respecté, aimé par tes vassaux la mort viendra t’enlever au milieu des pleurs de ceux qui t’entoureront, après avoir coulé une vie douce, oracle de tes proches et père de tes vassaux.
Des Mazis. – Je ne vous entends pas. Comment, monsieur, mon amour pourrait-il m’empêcher de suivre le plan que vous venez de tracer ? Quelle idée vous êtes-vous faite d’Adélaïde ?
Adélaïde, s’il faut pour remplir ses devoirs, soulager les malheureux ; s’il faut pour être vertueux, aimer sa patrie, les hommes, la société, qui plus qu’elle vertueuse ? Croyez-vous que je faisais le bien avec la froideur de la philosophie ? Quand la volonté d’Adélaïde sera le mobile qui me conduira, lui faire plaisir, la récompense… Non, monsieur, vous n’avez jamais été amoureux.
Bonaparte. – Je plains votre erreur. Quoi, chevalier, vous croyez que l’amour est le chemin de la vertu ? Il vous immétrigue à chaque pas. Soyez sincère. Depuis que cette passion fatale a troublé votre repos, avez-vous envisagé d’autre jouissance que celle de l’amour ? Vous ferez donc le bien ou le mal suivant les symptômes de votre passion. Mais, que dis-je, vous et la passion ne font qu’un même être. Tant qu’elle durera, vous n’agirez que pour elle et, puisque vous êtes convenu que les devoirs d’un homme riche consistaient à faire du bien, à arracher de l’indigence les malheureux qui y gémissent, que les devoirs d’un homme de naissance l’obligeaient à se servir du crédit de son nom pour détruire les brigues des méchants, que les devoirs du citoyen consistaient à défendre la patrie et à concourir à sa prospérité, n’avouerez-vous pas que les devoirs d’un bon fils consistent à reconnaître en son père les obligations d’une éducation soignée, à sa mère… Non ! chevalier, je me tairais si j’étais obligé de vous prouver de pareilles évidences…
NAPOLEON BONAPARTE – SUR L’AMOUR DE LA PATRIE
Parallèle entre l’amour de la patrie et l’amour de la gloire
J’ai à peine atteint l’âge de l’aurore des passions ; mon coeur est encore agité de la révolution que cette première connaissance des hommes produit dans nos idées et cependant vous exigez, mademoiselle, que je discute une question qui exigerait une connaissance profonde du coeur humain. Mais vous obéir n’est-il pas le seul titre qui puisse me maintenir digne de cette société intime ? Considérez donc ce discours moins comme un production de l’esprit et des connaissances que comme le tableau fidèle des sentiments qui agitent ce coeur où toute la perversité des hommes n’a peut-être pas encore pénétré.
Si j’avais à comparer les siècles de Sparte et de Rome avec nos temps modernes, je dirais : Régna ici l’amour et l’amour de la patrie. Par les effets opposés que produisent ces passions, on sera autorisé sans doute à les croire incompatibles. Ce qu’il y a de sûr du moins, c’est qu’un peuple livré à la galanterie a même perdu le degré d’energie nécessaire pour concevoir qu’un patriote puisse exister. C’est le point où nous sommes parvenus aujourd’hui. Peu de personnes croient à l’amour de la patrie. Quelle foule d’ouvrages n’a-t-il pas paru en montrer le chimérique ? Sentiments que produit l’action sublime du grand Brutus, n’êtes vous donc qu’une chimère ? Romains, premier peuple de la terre par la simplicité de vos vertus, la force de vos âmes et l’étendue de vos connaissances naturelles, vous vous êtes tous trompés. Vous avez élevé des autels à Brutus comme à un héros. Eh bien ! aprrenez de moi que ce grand homme n’est qu’un fou qu’égara l’amour-propre, lorsque, au milieu de votre place publique, il enfonça dans le sein de ses fils le glaive vengeur des lois. Vous crûtes qu’il était animé de cette passion qui vous transportait tous. Eh bien ! cette passion sublime que vous nous vantez tant n’est que de l’amour-propre, et vous avez été assez peu habiles pour vous laisser séduire ainsi par une férocité sans exemple. L’on vit la vanité de l’emporter sur l’amour paternel. Voilà messieurs, la sensation que j’éprouve à la vue de la question que je dois approfondir. L’amour de la gloire, dit-on, a produit cette foule d’actions que la postérité a célébrées à juste titre, mais auxquelles nos histoires opposent les produits de l’amour de la patrie…
L’amour de l’estime des hommes ou de la gloire peut-il avoir produit cette foule d’actions que la postérité à célébrer sous le nom d’amour de la patrie, ainsi le prétendent nos sophistes modernes. Si cependant nous venons à en démontrer l’insuffisance, que sera-ce donc ? Quel aura donc été le mobile des célèbres patriotes qui tiennent une place si distinguée dans les annales de l’Univers, quelles seront les passions primitives constituant le patriotisme ?
Tel, mademoiselle, serait l’objet des idées que je vais développer sous vos auspices. Puissent-elles en être dignes, heureux toutefois de m’avoir procuré le plaisir de captiver l’attention de la société intime.
Ouvrons les annales des Monarchies. Notre âme s’enflamme sans doute au récit des actions de Philippe, Alexandre, Charlemagne, Turenne, Condé, Machiavelli et tant d’autres hommes illustres qui, dans leur héroïque carrière, eurent pour guide l’estime des hommes ; mais quel sentiment maîtrise notre âme à l’aspect de Leonidas et de ses trois cents Spartiates. Ils ne vont pas un combat, ils courent à la mort pour le sort qui menace leur patrie ; ils affrontent les forces réunies de l’Orient pour obéir, premiers soutiens de la liberté ; mais toi, qui aujourd’hui enchaînes à ton char le coeur des hommes, sexe dont tout le mérite consiste dans un extérieur brillant, considère ici ton triomphe et rougis de ce que tu n’es plus. C’est dans tes annales que je vais trouver la plus grande preuve de l’insuffisance de la gloire. Quelles sont les héroïnes qui triomphent au milieu de Sparte. Je les vois, à la tête des autres citoyens, célébrer par des cris d’allègresse le bonheur de la patrie. « O Thermopyles, vous renfermez le tombeau de mon époux, puissiez-vous rendre le même office à mon fils si des tyrans menaçaient jamais ma patrie. » Quoi ! vous que je vois couronnés de myrthe, vous êtes les efforts sublimes du plus grand héroïsme. Quoi ! ce ne serait donc autre que le vil amour de la gloire ? Mais l’amour de la gloire n’est il pas l’envie d’avoir son nom chanté par la renommée ! Avaient-elles rien de pareil à espérer les femmes spartiates ? N’étaient-ce pas les effets ordinaires que produisait la nouvelle d’une bataille que l’envie de leurs proches d’y être ? Ceux-là, dit Plutarque, se montraient triomphant dans les temples et les places publiques, tandis que les mères et les femmes de ceux qui étaient échappés n’osaient se montrer. Oui, voilà des choses dignes de la patrie. Vous voyez donc bien que l’amour de la gloire ne peut pas avoir été le moteur des Spartiates.
Mais, si l’amour de la gloire a été le principe des actions des républicains et des monarchistes, d’où vient la différence étonnante des sentiments qui nous animent au seul récit, d’où vient la différence même des actions ? Aristide, le plus sage des Athéniens, Thémistocle, le plus ambitieux, encore la terreur du Grand roi, et tous deux sauveurs et restaurateurs de leur patrie, sont récompensés par un exil ignomineux. « O Dieux, puissiez-vous oublier l’injustice de mes compatriotes autant que moi-même je leur pardonne, dit Aristide en jétant un dernier regard sur son ingrate et chère patrie. » -« Dis à mon fils, disait Cimon en subissant son arrêt ignomineux, que, n’étant plus citoyen, je ne lui suis plus rien et que Athènes est toujours sa mère patrie.
Thémistocle préfère avaler la coupe fatale à se voir à la tête de troupes de l’Orient et à se trouver à portée de venger son outrage particulier. Il pouvait espérer sans doute subjuguer la Grèce. Quelle gloire dans la postérité et quelle satisfaction pour son ambition ! Mais non, il vivait au milieu des fastes de la Perse en regrettant toujours son pays. « O mon fils, nous périssions si nous n’avions péri ! » Phrase énergique qui doit être à jamais écrite dans le coeur d’un vrai patriote.
A ces traits d’héroïsme comparerons-nous les actions de Robert d’Artois, de Gaston d’Orléans, du grand Condé et de cette foule de Français qui ne rougirent pas de dévaster les campagnes qui les avaient vu naître. Les uns avaient été nourris dans les préceptes du patriotisme et les autres de l’amour de la gloire. Osez prononcer que le patriotisme n’est rien. Rien ne produisit-il jamais quelque chose ?
Dion possède une grande fortune, une race distinguée, une considération acquise. Que manque-t-il à son bonheur ? Ames énervées, vous pouvez deviner et vous osez parler ! Sa patrie est esclave d’un tyran qui est son allié, d’un tyran qui l’aime et le considère, mais enfin d’un tyran. Les feux brûlants du patriotisme embrasent sa grande âme. Enflammé par le feu brûlant du patriotisme, le disciple du grand Platon, le sévère Dion quitte les lieux fortunés de l’Attique. Adieu, plaisirs qui charmiez sa philosophie. Il sacrifie sa tranquillité. Un tyran règne dans sa patrie. Fuis, Denys, fuis donc ces rives, ci-devant le théâtre de tes cruautés. Dion a déjà arboré dans Syracuse l’étendard de la Liberté, mais l’effet surprenant de la jalousie, ce monstre effroyable que vomirent les enfers dans leurs fureurs se glisse dans le coeur des Syracusains. Les insensés ! Ils osent prendre les armes contre leur sauveur ; ils attaquent de toutes parts la légion qui vient de les délivrer et qui reste fidèle à ce héros qui la conduit. Quels sont cependant les sentiments qui l’animent ? « Etrangers, qui prenez ici la défense de mes jours, s’écrie Dion, ne versez pas, je vous en conjure, le sang de mes compatriotes ! » Est-ce l’amour de la gloire qui lui a dicté cette harangue sublime ? Qu’eût fait le grand Condé ?… Dites, messieurs, que croyez-vous qu’eût fait le grand Condé dans cette circonstance ? Syracuse ! Syracuse, tu aurais porté longtemps la peine de ton ingratitude. Liée à son char, tu eusses servi à jamais de monument à sa gloire et la postérité n’aurait sans doute qu’applaudi sa bravoure. Mais ce ne sont pas là les sentiments qui agitent un coeur où n’est que l’amour de la patrie. Tandis que ses barbares concitoyens font usage, pour lui ravir la vie, de ces armes que lui même leur a fournies : « Etrangers, s’écriait Dion, qui défendez ici mes jours, je vous en conjure ne versez pas le sang de mes concitoyens. » Le protecteur de la liberté n’est plus dans la cité.
Déjà les sattelites des tyrans font couler des flots de sang. La liberté chancelle dans sa dernière forteresse. Dion jouit de son triomphe, voit à ses genoux ces ingrats qui, parjures, en voulaient à sa vie. Mais quoi ! tu pleures ; des larmes ont coulé de tes stoïques yeux ! Quoi ! ces tigres qui, pour prix de ta première défaite, sont altérés de ton sang, ces tigres arrachent tes larmes ! Sentiment de la patrie, que tu es puissant sur les coeurs ! Ainsi que le soleil dissipe le plus épais brouillard, ainsi ô grand Dion, ton aspect dissipa la nombreuse cohorte du tyran. Qu’avec plaisir tu vis couler ton sang ! Il scella pour longtemps la liberté de Syracuse. Vous voulez que l’amour de la goire ait produit ces sublimes larmes ! Vous voulez qu’il ait produit cette courte harangue où règne un sentiment que Jesus-Christ a seul depuis renouvelé ! Mais non ! non ! L’amour de l’immortalité est un sentiment personnel qui céda toujours à l’amour-propre blessé. Turenne, le héros de la France, cède à un intérêt personnel et se rue contre la patrie, -mais que dis-je, cède ? donne une nouvelle force aux effets de la vengeance de l’amour-propre. C’est un sentiment liable avec les passions les plus opposées ! Condé aux Dunes était animé par l’amour de la gloire comme à Rocroy et à Nordlingue.
Faut-il encore chercher des preuves de l’insuffisance de l’amour de la gloire ? Ouvrons les annales de cette petite île trop peu connue sans doute pour l’honneur des temps modernes : un Corse est condamné à périr sur l’échafaud. Ainsi l’ont voulu les lois de la République. Outre les liens du sang, ceux de la reconnaissance et de la plus tendre amitié liait étroitement son neveu à son sort. Dans le transport qui l’anime, il se jette au genoux du premier magistrat, du grand Paoli. « M’est-il permis de plaider pour mon oncle ? Les lois son-elles faites pour faire notre malheur ? Il n’est que trop coupable sans doute, mais nous offrons 2.000 sequins pour le racheter. Jamais il ne rentrera dans l’île. Nous en fournirons 400 tant que durera le siège de Furiani. -Jeune homme, lui répond Paoli, vous êtes Corse. Si vous croyez que cela puisse faire honneur à la patrie, ce jugement va se prononcer et je vous accorde sa grâce. » Ce bon jeune homme se lève. Les convulsions de son visage exprime assez le désordre de son âme. « Non ! non ! Je ne veux pas acheter l’honneur de la patrie pour 2.000 sequins. O mon oncle, je périrais plutôt dans tes bras. Sous quelle face que j’envisage cette héroïque réponse, je ne puis y apercevoir aucune trace de gloire.
Si je continuais, Mademoiselle, à parcourir les annales de cette illustre nation, quels traits de patriotisme n’y trouverai-je pas ? Gaffori, qui joignit à l’âme de Brutus l’éloquence de Cicéron, tu fais au patriotisme le sacrifice de ton amour paternel. Ni l’ambition, ni l’attachement à ses propriétés, ni même ses fils prisonniers des tyrans ne purent tenter Rivorella. « Quand à mes fils, il faudra bien sans doute qu’on me les rende. Je considère le reste comme indigne, m’étant personnel et incomparablement au-dessous des engagements que j’ai contractés avec mes compatriotes ; je meurs content puisque je meurs pour mon pays. Paoli, dans mes bras ! Je serai à côté de Gaffori, et des autres illustres patriotes. » Quelques Amphipolitains firent part à Argileonis de la mort de son fils Brasidas qu’ils avaient vu périr : « sans doute, non, Sparte, n’en a point encore un pareil. -Ne dites point cela, mes amis ; mon fils était un digne citoyen, je veux le croire, mais Sparte en compte dans ses murs encore plus de soixante-dix encore plus dignes d’elle. »
Ce sont les réponses privées où se peint le sentiment. Chaque trait, chaque mot d’un Spartiate peint un coeur embrasé du plus sublime patriotisme. Vous qui prétendez au titre de bons patriotes, qui aspirez à en avoir le sentiment, voici votre baptème. Il n’appartint sans doute qu’à ces âmes privilégiées de la vertu, à ces hommes qui, par la force de leurs organes, peuvent maîtriser toutes leurs passions et par l’étendue de leur vue gouverner les Etats, de marcher sur les traces de Cincinnatus, des Fabricius, des Caton, des Thrasybule ; mais vous, qui prétendez simplement au titre de bons citoyens, méditez Pedaratus. Un vain titre est refusé aux Bouillon et Turenne, le héros de la France, Turenne, le rempart invincible de la patrie, Turenne, qu’elle a comblée de ses faveurs, eh bien ! Turenne réduit en cendres les chaumières qu’il avait si longtemps défendues. Des honneurs refusés à Condé blessent sa gloire, et Condé déploie l’étendard de la révolution. Voilà ce que produisit, dans les deux plus grands hommes de la France, la soif de l’ambition. Que Pedaratus, simple citoyen d’une république célèbre, est dans ce moment au-dessus de ces illustres monarchistes ! Il demande avec instance au tribunal du peuple d’être élu un des Trois Cents, première magistrature de la République. Il est refusé. « Sparte, chère patrie, tu renfermes donc trois cents citoyens plus honnêtes hommes que moi. Dieux soyez témoins de mon allègresse ! Ah ! Puissé-je être le dernier en amour que je consentirai volontiers à ce prix à n’être que citoyen. Demeurez enfin confondus, prôniste de la gloire. Rendez hommage à la vérité. Car les Spartiates affectaient-ils tous ces sentiments sublimes pour s’acquérir de la gloire ? C’était donc un sentiment joué et joué par toute une ville ? Mais pour peu que vous en connaissiez le génie des hommes, vous verrez que cette imposture n’aurait pas duré longtemps. Le ridicule de l’ennui même d’affecter un sentiment que l’on n’a pas aurait bientôt fait que le peuple au moins aurait secoué le joug inutile…
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (5)
VII
Le Comité supérieur céda bientôt la place à l’administration régulière qui fut organisée selon les décrets de l’Assemblée nationale. Mais le maître de la Corse, c’était Paoli. Rappelé de l’exil par la Constitutante, avec tous les Corses qui s’étaient expatriés après la conquête française, imposant encore, malgré ses soixante-six ans, par sa haute taille, par son air résolu et par le regard pénétrant de ses yeux bleus, Paoli avait abordé, le 17 juillet 1790, à Bastia au milieu de l’enthousiasme délirant des insulaires, et dès lors, bien qu’il ne voulût être qu’un simple citoyen, il fut pour les Corses, comme auparavant, le « général, » le « père » ou le Babbo. Napoléon Bonaparte, dans son exaltation juvénile, le nommait le « père de la liberté, » l’ « homme créé pour la consolation commune. » Giubega l’appelait « notre héros », nostro eroe : « Le généreux accueil, écrivait-il, et tous les témoignages d’estime que Paoli reçus à Paris justifient les sentiments de respect et d’attachement que la Corse a toujours eu pour lui. »
Néanmoins Giubega comprenait que Paoli serait le véritable roi de Corse. A vrai dire, c’était la meilleure solution du problème. Pourquoi ne pas se servir de Paoli puisque les Corses voyaient en lui, suivant l’expression d’un de nos fonctionnaires, leur dieu et leur unique ressource ? Mieux valait Paoli que l’anarchie, et Paoli avait mis sincèrement à la disposition de la France son influence et son nom. « Il faut, s’écriait Barère, que Paoli lui-même apprenne à devenir Français. » Et Paoli, ainsi que Napoléon Bonaparte et tous les Corses, était devenu Français. Il ne parlait des Français que comme des compatriotes et des frères ; il vantait le « titre glorieux » de Français que les Corses avaient désormais ; il assurait qu’ils regardaient maintenant le soldat français non comme l’instrument d’une administration arbitraire et le suppôt de la tyrannie, mais comme le défenseur de leur île ; qu’ils seraient dignes de la nouvelle Constitution ; que les lois rendues par l’Assemblée nationale leur retraçaient l’image de leur précédent gouvernement embelli et perfectionné. En toute circonstance, il affirmait sa loyale affection pour le grand pays dont dépendait son petit pays.
Mais la réaction ne pouvait s’éviter. Paoli fut entraîné par les paolistes. Tout pour Paoli et ses amis, tel était le mot d’ordre. Gaffori, mandé à Bastia par le Comité supérieur, se vit arrêté et envoyé en France. D’autres personnages qui passaient pour aristocrates furent embarqués de force ou obligés de s’éloigner. On évinça les français de tous les emplois, et que de maledictions furibondes lancèrent les meneurs du congrès d’Orezza contre le système d’antan ! Giubega était venu, comme électeur du district de l’île Rousse, à cette assemblée qui dura dix-huit jours, du 9 au 27 septembre. Elle n’avait d’autre mission que de nommer les membres du Département et de désigner le chef-lieu. Elle ne nomma que des paolistes avérés, elle ne désigna pas de chef-lieu, et combien de motions illégales elle prit et qui sans nul doute blessèrent Giubega jusqu’au fond du coeur puisqu’elles condamnaient impitoyablement son passé ! Elle ne se borna pas à choisir les administrateurs des districts et parmi eux des bannis qui n’étaient ni propriétaires, ni domicilés dans l’île depuis un an ; à donner au Babbo le commandement de toutes les milices corses ; à décider que les deux députés du tiers, Saliceti et Cesari, seraient, l’un, procureur général syndic, et l’autre, général en second des gardes nationales ; à désapprouver avec éclat la conduite des deux députés de la noblesse et du clérgé, Buttafoco et Peretti. Elle vota la suppression du régime provincial qu n’avait rendu que de « funestes services à la tyrannie. » Elle exprima hautement sa haine contre l’ancien gouvernement royal -ce gouvernement dont Giubega avait été l’un des plus fermes appuis- en déclarant qu’il avait exercé « le plus cruel despotisme. » Elle cassa toutes les délibérations -ces délibérations que Giubega avait souvent inspirées- prises par les Etats en faveur des généraux Marbeuf, Narbonne et Sionville, ces « principaux ennemis de la nation corse qui avaient poursuivi arbitrairement les meilleurs citoyens ! » Elle demanda que la mémoire de tous ceux qui avaient été » les victimes du pouvoir judiciaire et militaire parce qu’il avaient désiré la liberté de la patrie » fût réhabilitée. Elle proposa de révoquer les concessions d’étangs et de terres communales prononcées par la royauté -comme la concession de l’étang de Stagone que Giubega avait désséché pour planter sa pépinière. C’était, a dit Napoléon l’esprit du temps. Joseph Bonaparte ne fit-il pas dans ce congrès d’Orezza la motion d’élever une pyramide qui porterait les noms des héros de 1769 et des martyrs de l’indépendance ainsi que la date de la régénération du peuple corse et le témoignage de l’indignation publique contre les traîtres ? Lui aussi, de même que Napoléon, oubliait l’attitude de son père ; lui aussi oubliait que les résolutions des Etats dénoncées à l’assemblée d’Orezza comme « écrites avec l’encre de la flatterie et de la peur » avaient été approuvées par son père ; lui aussi oubliat que l’inscription latine de Bastia qui rappelait l’amour des Corses pour Marbeuf, avait été votée par son père et qu’elle venait d’être effacée et remplacée ainsi : « Le voilà détruit, ce monument que le vil mensonge et la vénale adualtion ont dédié au tyran de la Corse gémissante ! »
Giubega avait gardé le silence. Il sentait qu’il ne jouerait plus aucun rôle. Les électeurs le nommèrent juge à La Porta ; il refusa la place ; l’ancier greffier en chef des Etats ne pouvait déchoir, et peut être, dans sa maison de Calvi où il se retira, se prenait-il à regretter l’époque où il était l’un des fonctionnaires les plus considérés et les plus influents de son pays natal. Ce qui semble sûr, c’est qu’il crut désormais et à tort- que Paoli n’avait d’autre visée que celle de son intérêt personnel ; d’autre but que la puissance suprême, d’autre désir que de rendre à la Corse son indépendance et de restaurer le gouvernement national. Giubega aurait dit volontiers, comme Buttafoco, que Paoli était un renard qui perdait son poil, mais qui ne perdait pas sa malice. Et Paoli, de son côté, n’aimait pas Giubega. Il lui reprochait ses attaches génoises. Même durant la guerre de l’indépendance, il suspectait son zèle et il ne l’avait employé qu’à son corps défendant et sur les instances du chanoine Salvini. Il lui fit bonne mine en 1790 ; mais aux yeux de Paoli, Giubega était un « rallié », un de ces Corses qui, de même que Charles Bonaparte, de même que Buttafoco et Gaffori, avaient courtisé Marbeuf ou sollicité les faveurs des bureaux et dans le secret des coeurs, il lui en voulait d’avoir servi le despotisme royal. Les Corses que Paoli affectionnait, fort naturellement, et qu’il préférait aux autres, c’étaient ceux qui, selon ses propres termes, avaient sucé les maximes de la liberté avec le lait. Quant aux Giubega, aux Arena, aux Bonaparte, il les nommait, en 1793, des patriotes de quatre jours, des esclaves qui ne s’étaient émancipés que depuis quatre années, des gens dont l’opinion était soumise à l’influence des circonstances et des événements extérieurs.
Quoi qu’il en soit, Giubega combattit les desseins de Paoli sur les forteresses de l’île. Lorsque, dans les premiers mois de 1792, ils formèrent quatre bataillons de volontaires corses, Paoli, ainsi que le Directoire du département, voulu les mettre en garnison dans les quatre présides, à Bastia, à Ajaccio, à Calvi, à Bonifacio, et au château de Corte où il n’y avait que des troupes de lignes. Non que Paoli et le Directoire eussent des projets de révolte contre la France : un des membres du Directoire était Joseph Bonaparte qui professait des sentiments tout français. Mais ils désiraient exercer leur droit. Les volontaires n’était-ils pas destinés à la défense du pays ? Pourquoi la Corse ne serait-elle pas protégée par des milices corses ? Pourquoi les nouveaux bataillons ne prendraient-ils pas contact avec les anciens régiments ? Et Paoli, tout bas, remarquait avec assez de justesse que la fidélité des troupes de ligne pouvait être en défaut et que certains de leurs officiers étaient soupçonnés d’aistocratie, disposés soit à émigrer, soit à trahir. Mais les commandants des forteresses, ne connaissaient que leur consigne, refusèrent d’ouvrir leurs portes. Le Directoire du département demandait que les volontaires du 3e bataillon, commandé par Achille Murati -ce Murati à qui, selon le jeune et exubérant Napoléon de 1791, il ne manquait pour être un Turenne que des circonstances et un théâtre plus vaste- eussent accès à la citadelle de Calvi. Le vieux commandant Maudet répondit rudement qu’il n’obéirait pas aux réquisitions du Directoire, et, lorsque les députés de la Corse joignirent leurs plaintes à celle du département, il répliqua que les vieux renards valaient bien les jeunes et que, grâce à lui, dans le trouble et le désarroi des choses, Calvi était la seule place de l’île où le sang n’avait pas coulé. Giubega encourageait Maudet ; il commandait la garde nationale de la ville, et il avait un grand ascendant sur la municipalité ; sous l’influence de Giubega, tout Calvi vantait la prudence de Maudet et son dévouement à la loi. Vainement Paoli envoyait un Calvais, un de ses meilleurs amis confidents, l’actif et remuant Panattieri, qu’il chargeait de résister aux mesures de Giubega et de gagner la population. Il dut reconnaître qu’il ne pouvait rien contre la « conjuration » et que « l’esprit de Giubega regnait toujours à Calvi » : lo spirito di Giubega regna ancora in Calvi !
C’est que Giubega opposait de solides arguments à Paoli. Il remontrait ques les volontaires corses commettaient de graves désordres et volaient l’argent de la nation, qu’ils étaient indiscipilnés, très mal organisés, le rebut des villes et de la montagne, la garde prétorienne du Directoire, et Paoli, malgré lui, donnait raison à Giubega : « L’assertion de Giubega avait quelque fondement, l’asserzione di Giubega aveva qualche fondamento. » Puisque Paoli, ajoutait à Giubega, voulait mettre des gardes nationales dans les citadelles, pourquoi recourait-il aux volontaires de Corse et non aux volontaires du continent ? Pourquoi les prenait-il dans l’île et non en France ? Si la guerre éclatait, « quelqu’un ne pouvait-il penser à séparer la Corse de la France ? »
Ce quelqu’un, c’était Paoli. Aussi, dans sa correspondance de 1792, Paoli se plaint-il très vivement de Giubega. Il lui reproche d’être un misérable aristocrate, de pactiser avec les gens de Bastia -qui n’étaient nullement paoliste- de renouer avec ses ennemis de jadis, Buttafoco et Gaffori. « Giubega, écrit Paoli, m’accuse de tahison ; si je le rencontre, je veux le rendre plus petit qu’un grain de mil ; c’est encore un de ceux qui, lorsqu’on les montre au doigt, deviennent zéro ! » Et, à son tour, il accuse Giubega d’être un royaliste de la vieille roche : Giubega, prétend Paoli, avait dit dans ses discours que, si la contre-révolution se produisait, la Corse devrait se détacher de ceux qui tenaient ferme pour la liberté et la Constitution ; selon Giubega, le gouvernement précédent, le gouvernement de Marbeuf et des Boucheporn, convenait mieux à l’île que le gouvernement actuel.
Paoli l’emporta ; il fit entrer les volontaires dans les forteresses. Sous la Constituante, sous la Législative et dans les commencement de la Convention, il eut toujours la confiance des ministres et de l’Assemblé, et, comme disait Saliceti, une confiance sans limites. Il n’était pas du tout, à cette époque, le « machiavéliste » qu’ont représenté ses adversaires, et, nous le répétons, il ne pensait aucunement à séparer la Corse de la France. S’il avait l’ambition de faire seul le bien de la nation Corse, cette ambition n’était-elle pas satisfaite ? Il fut, le 11 septembre 1792, nommé par le Conseil exécutif lieutenant-général et commandant de la 23e division militaire, et il présidait en même temps l’administration départementale ; il avait donc tous les pouvoirs, et, au nom de la France, il gouvernait la Corse comme avant la conquête. Jusqu’à sa rébellion, il eut pour la France l’attachement, qu’il lui avait promis ; jusqu’au dernier jour, il sentit et déclara que la force de la Corse venait de son intime union avec la France.
Mais il s’appuya sur Pozzo di Borgo, sur Cesari ; sur Panattieri, sur Leonetti, et un grand parti se forma contre lui. A la tête de ce parti était Saliceti qui voulait dominer l’île : après avoir été l’admirateur de Paoli, Saliceti devint, selon le mot de Volney, son rival, et il trouva des alliés : Gentili, les Arena, les Bonaparte, tous ceux que Paoli avait écartés. Cosas di Corsica ! Paoli, Pozzo et autres souhaitaient de rester fidèles à la France, et ils n’avaient aucune arrière-pensée d’indépendance et de soumission à l’Angleterre. S’ils se révoltèrent, ce fut, comme disait Pozzo, contre Saliceti et compagnie ; ce fut comme disait le Conseil supérieur du département, contre les intrigants qui désiraient « despotiser en Corse » et « accaparer le crédit ; » ce fut, comme disait Paoli, contre la cabale, contre l’arbitraire et les abus de l’autorité. « Mes ennemis, s’écriait Paoli, me qualifient de tyran parce qu’ils voient en moi un obstacle à leurs projets ambitieux ; ma tyrannie n’existe pas, ou, si elle existe, il faudrait qu’il y eût dans chaque département des gens qui l’exercent dans mon style ! »
Le parrain de Napoléon appartenait au parti qui s’était formé contre Paoli. Il n’intervint pas dans la lutte qui s’engagea sourdement d’abord, puis ouvertement, entre Saliceti et Paoli dans les premiers mois de 1793. Pourtant, il eut, dit-on, en septembre ou en octobre 1792, une entreveu avec le Babbo. Pozzo di Borgo avait obtenu du ministre Servan le brevet de lieutenant-général pour Paoli : ce grade, avait dit Pozzo, était nécessaire au babbo qui, fort de son influence et du commandement des troupes, verrait toutes les intrigues se taire en sa présence. Mais Paoli, lieutenant-général, dépendait du ministre de la guerre et du général en chef de l’armée du Midi. Ses ennemis accueillirent donc sa nomination sans déplaisir : ils le « tenaient » ; » Paoli n’était plus au dessus des lois ; il se soumettait du moins aux lois militaires. Telle fut la pensée de Giubega. Lorsqu’il apprit que Paoli avait envie de refuser les fonctions que lui offrait le Conseil exécutif, il courut à Rostino et pria Paoli d’accepter le fardeau et de sacrifier une fois encore son repos personnel à la sécurité publique. N’était-il pas le seul homme qui inspirait la confiance, le seul qui pût dans le danger suprême rallier les Corses et les mener au combat, le seul qui connût les vrais patriotes et sût les employer au salut du pays ? Ne devait-il pas conséquemment avoir en main toutes les forces de l’île ? Giubega, écrit un contemporain, se doutait que Paoli deviendrait bon gré mal gré coupable envers la loi.
On n’a du reste que peu de détails sur les derniers jours de Giubega. Il fit à la fin de 1792 le voyage de Paris, et, le 18 mars 1793, devant des gens qui parlaient de la mission des trois députés, Saliceti, Delcher et Lacombe Saint-Michel, envoyés en Corse par la Convention, il disait tout haut que le conflit ne pouvait s’éviter, que Paoli n’était pas homme à se soumettre ni à se démettre, et n’obéirait pas aux ordres des commissaires. Mais lorsque Giubega revint à Calvi, il déraissonait, tant l’exécution de Louis XVI avait troublé, bouleversé son esprit !
L’événement produisit, en effet, sur tous les Corses une profonde impression d’horreur. Des six députés de l’île, un seul Saliceti, vota la mort du monarque ; les cinq autres demandèrent sa détention, et Chiappe assurait que la fatale sentence annonçait la perte de la République et un nouveau roi après de nouveaux carnages. Paoli ne disait-il pas dans ses conversations intimes que les Corses devaient être les ennemis, et non les bourreaux des rois ? Napoléon Bonaparte ne déplorait-il pas devant Sémonville le grand crime que la Convention avait commis ? Muselli, faisant l’oraison funèbre du frère de Paoli, n’affirmait-il pas que l’acte du 21 janvier avait excité l’indignation de ses compatriotes ? Leonetti, le neveu de Paoli, attaquant les murs de Calvi, ne criait-il pas aux défenseurs de la ville qu’il paieraient cher le sang de leur roi ?
VIII
Ce fut à Calvi, chez les Giubega, au mois de juin 1793, que les Bonaparte vinrent chercher un asile, lorsqu’ils furent chassés d’Ajaccio par les paolistes, lorsque la Consulta de Corte, composée de mille délégués des communes, déclara qu’ils étaient nés de la fange du despotisme, qu’ils avaient été nourris et élevés sous les yeux et aux frais du pacha luxurieux qui commandait dans l’île, qu’ils avaient secondé les efforts et appuyé les impostures des Arena, qu’ils seraient, par suite, ainsi que les Arena, abandonnés à leurs remords et à l’opinion publique, qui, d’ores et déjà , les avait condamnés à une perpétuelle exécration et infamie.
On sait que Napoléon courut quelque danger. Il avait pris la voie de terre, et il s’égara dans le maquis. Selon la tradition, un faiseur de fagots le remit dans le bon chemin et le conduisit à Calvi, chez Laurent Giubega. Depuis, et jusqu’à sa mort, cet homme ne parla que de sa rencontre avec Napoléon et on ne l’appelait plus que Napolino ou le petit Napoléon.
Le frère de Laurent, Damien, reçut Bonaparte avec amitié. Les filles de Mme Letizia étonnèrent, dit-on, la domestique par leurs habitutdes de propreté et leurs petits talents : sur l’ordre de leur mère, elles allaient l’une après l’autre à la cuisine faire le plat doux du dîner.
Laurent mourut au mois de septembre suivant. Il avait épousé durant son séjour à Gênes une demoiselle noble de la ville, Marie Rogliano, à qui Napoléon Bonaparte faisait ses compliments en ces termes à la fin d’une lettre de 1789 : « Permettez que Madame reçoive ici le serment de mon hommage. » Plusieurs enfants étaient nés de ce mariage et morts en bas âge. Une fille avait survécu, Annette, qui devait dit-on épouser le beau Joseph Bonaparte. Pendant le siège de Calvi, en 1794, elle fut blessée à la cuisse par un éclat de bombe. Elle en resta boiteuse : ce qui ne l’empêcha pas de se marier deux fois, la première avec un veuf, le docteur Massoni, la seconde avec un officier de l’administration, nommé Durante. Elle n’avait eu qu’une fille, morte très jeune. Lorsqu’elle décéda, en 1851, à Calvi, elle était dans sa soixante-douzième année, et cette reine manquée aurait connu la misère si ses parents ne l’avaient secourue.
Le frère de Laurent, Damien, député par l’ordre de la noblesse à la cour, en 1779, et, comme nous l’avons vu, assesseur du juge royal Schouller avant la Révolution, exérçait la profession de médecin, et, en 1793, le représentant Lacombe Saint-Michel louait le zèle de sa femme et de sa fille qui servaient d’infirmières et donnaient l’exemple du zèle le plus charitable. Damien était devenu médecin adjoint à l’hopital de Calvi aux appointements de 2.000 livres, et Lacombe assurait qu’il se rendait très utile, qu’il avait sans Calvi la plus grande influence, qu’en Corse un chef de parti est tout et que la masse du peuple ne voit que par ses yeux. Après la capitulation de Calvi, il se rendit à l’armée d’Italie, et Desgenettes qui le vit alors, le compare à un vieux lion. Desgenettes ajoute qu’il avait avec lui une douzaine d’enfants et de petits-enfants, qu’il était était estimé pour son savoir et qu’il se vantait de l’antiquité de sa maison, casa antichissima, et du rôle qu’il avait joué dans la guerre de l’indépendance en défendant Calvi contre les Génois. Damine Giubega fut plus tard sous-prefet de Calvi et président du tribunal civil.
Deux de ses fils, Vincent et Xavier ont laissé quelque réputation. Vincent, docteur en droit civil canonique, attaché à l’envoyé de France près la république de Gênes, puis prêtre et vicaire général de l’évêché de Sagone, fut, lorsque l’île redevint française, juge au tribunal de cassation. Il mourut en 1800 à l’âge de 39 ans, trois mois après que Bonaparte l’eût envoyé siéger au tribunal d’appel d’Ajaccio. Ses poésies italiennes, gracieuses, pleines de naturel et de goût, l’ont fait surnommé l’Anacréon et le Parny de la Corse. Il en détruisit un grand nombre par scrupule religieux. On admire surtout ses sonnets et le poème qui célèbre le retour de Paoli et son débarquement à Bastia en 1790.
Xavier ou François-Xavier, capitaine d’une compagnie franche qui s’appelait la compagnie de Giubega, employé à l’armée d’Italie en 1795 comme adjoint aux adjudants généraux, entré en 1796 dans l’administration des vivres et, de 1798 à 1799, agent général des contributions et finances à la suite de l’armée française à Rome, fut sous-préfet de Calvi et, à la fin de l’Empire, préfet de Corse. Lorsque Napoléon quitta l‘île d’Elbe il nomma Xavier Giubega l’un des douze membres de la junte et, le 6 avril 1815, lui confia de nouveau la préfecture du département. Aussi Xavier Giubega fut-il, après les Cent-Jours, comme « homme dangeureux et intelligent » envoyé en surveillance à Toulon, puis à Montpellier.
Le fils de Xavier, Pascal-Hiacynthe, boursier à Paris au Lycée impérial, secrétaire de son père et délégué par la junte en 1815 pour arborer dans l’arrondissement de Calvi le drapeau tricolore et « dissiper la faction anglo-corse, » secrétaire -général du département de la Corse en 1830, sous-préfet de Sartène, de Corte et de Sisteron sous le règne de Louis-Philippe, révoqué par le commissaire du gouvernement en février 1848, réintégré bientôt sur la recommandation du préfet Aubert, fut, durant, dix ans, du mois d’août 18488 au mois d’août 1858, sous-préfet de Bastia. Il aimait à rappeler q’un lien de parenté religieuse et spirituelle unissait les Giubega aux Bonaparte. Il eut plusieurs enfants : Laurent qui combattit aux journées de février 1848 et « sortit de la lutte avec une main blessée et des vêtements en lambeaux, » Pierre, naguère conseiller à la Cour d’appel d’Aix, et une fille mariée à un Calvais, Pierre-Marie Rossi, cousin germain du prefet Aubert.
août 1, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LA CORSE
C’est aujourd’hui que Paoli entre dans sa soixante-et-unième année. Son père Hiacinto Paoli aurait-il jamais cru, lorsqu’il vint au monde, qu’il serait compté un jour au nombre des plus braves hommes de l’Italie moderne. Les Corses étaient dans ces temps malheureux (1725) écrasés plus que jamais par la tyrannie génoise. Avilis plus que des bêtes, ils traînaient dans un trouble continuel une vie malheureuse et avilissante pour l’humanité. Dès 1715, cependant, quelques pièves avaient pris les armes contre les tyrans, mais ce ne fut qu’en 1729 que commença proprement cette révolution où se sont passés tant d’actes d’une intrépidité signalée et d’un patriotisme comparable à celui des Romains. Eh bien ! Voyons, discutons un peu. Les Corses ont-ils eu droit de secouer le joug Génois ? Ecoutons le cri des préjugés : les peuples ont toujours tort de se révolter contre leurs souverains. Les lois divines le défendent. Qu’ont de commun les lois divines dans une chose purement humaine ? Mais, concevez-vous l’absurdité de cette défense générale que font les lois divines de jamais secouer le joug même d’un usurpateur ? Ainsi, un assassin assez habile pour s’emparer du trône après l’assassinat du prince légitime est aussitôt protégé pas les lois divines et tandis que, s’il n’eût pas réussi, il aurait été condamné à perdre, sur l’échafaud, sa tête criminelle. Ne me dites pas qu’il sera puni dans un autre monde, parce que j’en dirai autant de tous les criminels civils. S’en suivrait de là qu’ils ne doivent pas être punis dans celui-ci. Il est d’ailleurs simple qu’une loi est toujours indépendante du succès du crime qu’elle condamne.
Quant aux lois humaines, il ne peut pas y en avoir dès que le prince la viole.
Ou c’est le peuple qui a établi ces lois en se soumettant au prince, ou c’est le prince qui les a établies. Dans le premier cas, le prince est inviolablement obligé d’exécuter les conventions par la nature même de sa principauté. Dans le second, ces lois doivent tendre au but du gouvernement qui est la tranquillité et le bonheur des peuples. S’il ne le fait pas, il est clair que le peuple rentre dans sa nature primitive et que le gouvernement, ne pourvoyant pas au but du pacte social, se dissout par lui-même ; mais disons plus : le pacte par lequel un peuple établit l’autorité souveraine dans les mains d’un corps quelconque, n’est pas un contrat, c’est à dire que le peuple peut reprendre à volonté la souveraineté qu’il avait communiquée. Les hommes dans l’état de nature ne forment pas de gouvernement. Pour en établir un, il a fallu que chaque individu consentît au changement. L’acte constitutant cette convention est nécessairement un contrat réciproque. Tous les hommes ainsi engagés ont fait des lois. Ils étaient donc souverains. Soit par la difficulté de s’assembler souvent, soit pour toute autre cause, le peuple aura remis son autorité à un corps ou homme particulier. Or, nul n’est tenu aux engagements qu’il contracte contre son gré. Il n’y pas de lois antérieures que le peuple qui, dans quelques gouvernements que ce soit doit être foncièrement regardé comme le souverain, ne puisse abroger. Il n’en est pas de même quant aux liens qu’il peut avoir les peuples voisins.
Ouvrez les Annales de Corse, lisez les Mémoires de ses braves insulaires, ceux de Michele Merello, etc. ; mais, bien plus, lisez les projets de paix proposés par la République même, et, par les remèdes qu’ils y apportent, vous jugerez des abus qui devaient y régner. Vous y verrez ques les accroissements de la République dans l’île furent commencés par la trahison et la violation du droit de l’hospitalité surprise de Bonifacio et des gens les législateurs de Capo Corso. Vous y verrez qu’ils soutinrent par la force de leur marine plusieurs mécontes des habitants des pièves d’stria contre la République de Pise qui en possédait quelque partie. Enfin, si à force de ruse, de perfidie et de bonheur, ils vinrent à faire consentir les ordres de l’Etat à déclarer Prince la République de Gênes, vous y verrez le pacte tant réclamé par les Corses, quelles étaient les conditions qui devaient constituer leur souveraine principauté.
Mais, de quelque nation que vous soyez, seriez-vous même un ex-eunuque du sérail, retenez votre indignation au détail des cruautés qu’ils employèrent pour se soutenir. Paolo, Colombano, Sampietro, Pompiliani, Gafforio, illustres vengeurs de l’humanité, héros qui délivrâtes vos compatriotes des fureurs du despotisme, quelles furent les récompenses de vos vertus, Des poignards, oui, des poignards !
Efféminés, modernes qui languissez presque tous dans un doux esclavage, ces héros sont trop au-dessus de vos lâches âmes ; mais considérez le tableau du jeune Leonardo, jeune martyr de la patrie et de l’amour paternel. Quel genre de mort termina ton héroïque carrière au printemps de tes ans ? Une corde.
Montagnards, qui a troublé votre bonheur ? Hommes paisibles et vertueux qui couliez des jours heureux au sein de votre patrie, quel tyran barbare a détruit vos habitations ? Quatre mille familles furent obligées de sortir en peu de temps. Vous qui n’aviez que votre patrie, par quel événement imprévenant vous-vois je transportés dans des climats étrangers ? Le feu consume vos demeures rustiques et vous n’avez plus l’espoir de vivre avec vos Dieux domestiques. Puissent les furies vengeresses te faire expier dans les plus affreux tourments le meurtre des Zucci, des Rafaelli, et des autres illustres patriotes que tu fis massacrer malgré les lois de l’hospitalité qui les avaient appelés dans ton palais, misèrable Spinola ! Par quel genre de mort la République tarderait-elle de faire périr les soutiens de la liberté corse ?
Si par la nature du contrat social, il est prouvé que, sans même aucune raison, un corps de nation peu déposer le prince, que serait-ce d’un privé qui, en violant toutes les lois naturelles, en commettant des crimes, des atrocités, va contre l’institution du gouvernement ? Cette raison ne vient-elle pas au secours des Corses en particulier, puisque la souveraineté ou plutôt la principauté des Génois n’était que conventionnelle. Ainsi, les Corses ont pu, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des Français. Amen.
(Valence le 26 avril 1786)
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (4)
VI
Pendant que Giubega plaidait subtilement sa cause à Versailles et à Paris, la Corse s’agitait et, selon le mot du commandant en chef, le vicomte de Barrin -qui avait succédé à Marbeuf- l’explosion était à peu près générale et aussi forte qu’on pouvait l’imaginer. Quelques Corses pensaient à restaurer l’ancien gouvernement national. La plupart demandaient que les indigènes eussent toutes les places sans exception et ils rappelaient avec indignation que le traitement des Corses employés dans l’île par l’administration était inférieur d’un tiers à celui des Français. Le vicomte de Barrin qui n’avait pas d’instructions et presque pas de troupes, ne savait que gémir. De toutes parts des comités, des municipalités nouvelles se formaient. Les paysans brûlaient les registres des communes.
Giubega fut consulté par le ministre de la guerre, La Tour du Pin. Le vicomte de Barrin l’avait recommandé comme un homme attaché au service du roi et très instruit des affaires de son pays, fort utile par ses connaissances et son zèle aux principaux administrateurs de l’île, et, de son côté, Giubega assurait que ses sentiments étaient purs, et qu’il se dévouait entièrement à la France et au monarque? Il fit un Mémoire sur l’état actuel de la Corse. La possession de cette contrée, disait-il était onéreuse ; même en temps de paix, les dépenses excédaient les recettes de six cents mille livres pour le moins. Pourtant, il fallait conserver la Corse, ne fût-ce que pour empêcher l’Angleterre d’y prendre pied ? Mais, ajoutait Giubega, les garnisons étaient faibles et, si le peuple courait aux armes, « il ne dépendait que de lui de s’emparer des places ; » la perte d’une forteresse entraînait la perte de toutes les autres ; il fallait donc dépêcher en Corse quelques régiments de plus.
Ce mémoire ne convainquit pas le ministre. Il avait décidé de ne plus envoyer de troupes dans l’île. Pouvait-il dégarnir le midi de la France, Dauphiné, Languedoc, Provence ? La Corse se révoltait-elle contre Sa Majesté ? Renforcer les garnisons, n’était-ce pas aigrir les insulaires, leur inspirer de la défiance, leur faire croire qu’ils paraîssait redoutables ? Ne serait-ce pas provoquer la sédition au lieu de la prévenir ? Mieux valait employer la douceur, et, si des excès se produisaient, puisqu’il était impossible de les punir, pratiquer l’indulgence commandée hélas ! par les circonstances.
Mais Giubega avait vu les députés de l’île, Buttafoco, l’abbé Peretti, l’avocat Saliceti et le capitaine Colonna de Cesari Rocca, ainsi que les principaux Corses qui se trouvaient à versailles et à Paris, et ces hommes, oubliant pendant quelques jours leurs dissentiments personnels, se réunirent pour délibérer sur la situation de leur pays. Buttafoco et Peretti, liés à la cause de l’aristocratie, se retirèrent bientôt en accusant les autres de n’envisager que leur intérêt propre, l’intérêt du parti populaire. Sans se soucier de cette désertion, Saliceti, Cesari et leurs amis cherchèrent, comme disait Giubega, à mettre quelque ordre dans le désordre. Ils adoptèrent le plan de Giubega. Il y aurait un Comité permanent ou Comité national qui comprendrait vingt deux membres, sujets sages et zélés, attachés au roi et à la patrie, » nommés dans l’assemblée de chacune des onze juridictions royales par des députés de chaque commune. Les juridictions de Bastia, d’Ajaccio, de Calvi, de La Porta, d’Ampugnani, auraient trois représentants ; le Cap Corse et Corte, deux ; le Nebbio, Aleria, Vico, Sartène, Bonifacio et Porto-Vecchio, un. Le Comité installerait un inspecteur dans chaque juridiction et un commissaire dans chaque piève ou canton. Chaque inspecteur rendrait compte au Comité qui, après avoir délibéré, enverrait à Paris tous les renseignements nécessaires pour recevoir et exécuter les décrets de l’assemblée. Les commandants des troupes et des milices prêteraient main-forte au Comité sitôt qu’il leur adresserait une réquisition ; une milice bourgeoise serait établie « suivant l’ancien régime de la Corse, » et le Comité seul fixerait le nombre et le mode de levées de ces gardes nationales.
Le projet fut accueilli avec enthousiasme par la plupart des communes, et Napoléon Bonaparte, alors en Corse, jugeait qu’il était inspiré par l’amour de l’ordre, par le patriotisme, par le zèle plus noble. Mais le vicomte de Barrin, l’intendant La Guillaumye, la commission des Douze, le désapprouvaient, et les Douze publièrent un manifeste qui déclarait ce plan de comité et de milices dangereux et impraticable. Napoléon Bonaparte répondit à ce manifeste par une adresse véhémente, et, le 5 novmebre éclatait l’insurrection de Bastia. Le vicomte de Barrin dut accorder aux bastiais la formation d’une milice bourgeoise, et huit semaines plus tard, le 30 novembre, lorsque trois capitaines de cette garde nationale bastiaise demandèrent à l’Assemblée nationale que leur pays ne fût plus soumis au régime militaire, la Constituante décida que tous ses décrets seraient exécutés dans l’île, que la Corse faisait partie intégrante de l’empire, que les insulaires étaient gouvernés par la même constitution que les autres Français. C’était un véritable décret d’incorporation. La Corse devenait réellement française et acquérait les mêmes droits que le reste du territoire. Dès ce moment, les Corses s’attachent sincèrement à la France. Ils ne sont plus Corses ; ils sont Corses-Français, et on peut dire, pour employer une expression de Napoléon Bonaparte, que la Corse est leur pays, et la France leur mère-patrie. « La nation française, s’écriait le jeune lieutenant d’artillerie, nous a ouvert son sein ; désormais nous avons les mêmes intérêts, les mêmes sollicitudes ; il n’est plus de mer qui nous sépare ! » Il fit tendre sur la maison familiale d’Ajaccio, dans la rue Saint-Charles, une banderole qui portait les mots : Vive Paoli et aussi ces mots : Vive Mirabeau, Vive la nation.
Son parrain partage ses idées. Il n’y a plus d’Etat en Corse ; il n’a plus de greffier en chef ; mais bien qu’il perde à la Révolution, Giubega, en bon Corse, l’acclame et l’installe.
A la vérité, le décret de la Constituante n’apaisait pas les esprits. La Corse fut enivrée de sa liberté nouvelle, et Barrin déplorait plus que jamais « l’état de combustion épouvantable » où se trouvait la contrée. Des milices s’organisent partout, sans règles ni principes. Les paysans avaient tous des fusils et ils ne cessaient de tirer au blanc. Barthélemy Arena, qui régnait en maître à l’île Rousse, refusait de recevoir une garnison de troupes de ligne en disant que les milices suffiraient à garder la place, et Napoléon Bonaparte applaudissait cet Arena qu’il condamna plus tard à l’éternel exil : « Arena, disait-il, est venu les armes à la main, les décrets de l’Assemblée nationale de l’autre, et il a fait pâlir les ennemis publics ! »
Par bonheur, le comité que Giubega avait projeté de créer, parvint à s’imposer. Une commission municipale, formée de notables, s’était constituée à Bastia après l’insurrection du 5 novembre 1789. Elle invita au mois de février 1790, toutes les pièves à déléguer chacune un de leurs membres à un Congrès. Ce Congrès se tint à Orezza dans l’église de la Conception, durant huit jours, du 22 février au 1er mars. Il eut pour président un gentilhomme, Petriconi, colonel de la garde nationale bastiaise, ancien député de la noblesse, exilé jadis parce qu’il avait blâmé l’administration de Marbeuf. Ses deux secrétaires furent Louis Benedetti, assesseur du juge royal de Bastia, et Laurent Giubega. Il décréta l’établissement d’un Comité supérieur qui veillait au maintien de l’ordre public et qui siégea successivement à Bastia, à Orezza, à Corte, et enfin à Bastia.
Le Comité supérieur vécut du 2 mars au 1er septembre 1790. Il comptait soisante-six membres, six par juridiction, qui résidaient à Bastia par tiers. Chaque tiers était remplacé tous les quinze jours. Il y avait un président permanent, le frère de Pascal Paoli, ce Clément Paoli que Napoléon Bonaparte nommait un bon guerrier et un vrai philosophe ; mais Clément se faisait vieux et à chaque quinzaine, le tiers qui entrait en fonctions élisait un second et réel président. Les membres hors de tour allaient, en qualité de commissaires, dans les endroits de l’île où une insurrection était sur le point d’éclater.
Bien qu’illégal, le Comité supérieur rendit de grands services et par d’habiles mesures, soit par des sommations réitérées, soit par de envois ou « marches » de la milice, soit par des moyens de douceur, mezzi blandi, il pacifia la Corse, la fit passer sans effusion de sang, et comme insensiblement, du despotisme à la liberté. Il avait raison de dire qu’il était « le seul lien qui pût réprimer et réfréner le peuple; » Dans l’effacement ou l’écroulement de toutes les autorités il tint lieu d’une administration départementale, il fixa les idées des Corses, il donna une interprétation conforme des décrets de la Constituante sur l’organisation des municipalités, il trancha les questions qui provoquaient des troubles, il apaisa des querelles particulières et notamment celle qui divisait les Giubega et les Arena.
Giubega siégea dans le Comité supérieur qui le nommait « un très digne confrère et sage compatriote. » Durant près d’un mois, du 20 avril au 3 mai comme doyen et du 3 au 15 mai comme président, il dirigea les débats, et un jour, l’ancien greffier en chef des Etats écrivit sur un ton impérieux au vicomte de Barrin -ce Barrin dont il exécutait docilement les volontés un an auparavant -qu’il fallait respecter les intentions de l’Assemblée nationale, que le Comité supérieur n’avait d’autre but que l’intérêt de la nation française » à laquelle la Corse avait l’avantage d’être incorporée. »
Il fut un des membres les plus influents du Comité et celui peut-être qu’on écoutait avec le plus de déférence. Ses collègues le prient, dans la séance du 8 mars, de leur rendre compte des décisions de la Constituante sur les élections des officiers municipaux. Ils favorisent les intérêts personnels en statuant que la subvention allouée à sa pépinière de Calvi restera provisoirement la même que par le passé. Ils lui font place dans une commission de quinze « signori » élue le 19 avril et chargée d’examiner et de proposer les moyens qui sont les plus propres au calme et à l’union.
Lui-même déploie autant de fermeté que d’habileté. Dans la séance du 13 avril, il déclare que le Comité supérieur ne fera qu’une besogne inutile tant qu’il ne disposera pas de « moyens coercitifs, » mezzi coattivi. A quoi servent, par exemple, les délibérations tenues jusqu’ici pour obliger les adjudicataires de la subvention à payer l’arriéré de leur dû qui monte à près d’un demi-million ? Il faut, conclut Giubega, former un corps de troupes soldées, Un corpo di truppa pagata, qui contraigne les adjudicataires au paiement de leur dette, qui exécute les résolution du Comité et les décrets de l’Assemblée nationale, arrête les délinquants, maintienne le bon ordre, imprime dans l’île entière le respect des autorités légitimes. Sans doute, il sera malaisé de solder ce corps ; mais « les difficultés ne sont que passagères et tant que le Comité manquera de forces, tout son zèle sera infructeux, les embarras iront se multipliant, les délits seront impunis, et les lois inobservées. » La motion de Giubega fut adoptée.
Mais, si énergique qu’il fût, Giubega ne cessait de recommander la modération. La cour avait, au mois d’août 1789, envoyé en Corse le maréchal de camp Gaffori seconder le vicomte de Barrin, et Gaffori, que Napoléon Bonaparte nommait le sattelite de la tyrannie et le restaurateur du despotisme, n’avait trouvé dans l’île que défaveur et défiance : il avait combattu la formation de la milice nationale et la constitution du Comité supérieur ; il avait couru le pays avec les détachements du régiment provincial dont il était naguère colonel ; il s’était fait à Corte un parti considérable et le régiment de Salis, qui tenait garnison dans cette ville, avait tiré les habitants sans réquisition de la municipalité. Lorsque le Comité supérieur se réunit à Orezza, du 12 au 20 avril 1790, Giubega se joignit à Barbaggi et à plusieurs autres pour demander l’ « union des esprits discordants. » Il proposa d’apaiser toute les « contestations » et d’écrire à Gaffori une lettre conciliante. Son discours que les assistants jugèrent très sensés, sensatissimo, et applaudirent unanimement, fut imprimé aux frais de la nation et la lettre, rédigée par une commission dont Giubega était membre, envoyée à Gaffori : le Comité assurait le général de son respectueux attachement et le chargeait d’exprimer au régiment de Salis ses sentiments d’estime ; Gaffori devait, ainsi que les soldats, « oublier les choses passées et ce qui pouvait avoir provoqué l’irritation; » il devait prendre part aux travaux du Comité. Gaffori vint à Orezza et promit obéissance au Comité, jura de l’aider à former les milices et à rétablir la tranquilité. Sur les instances de Gaffori, le Comité décida même de se fixer à Corte, point central et le plus commode pour toute les provinces.
juillet 31, 2007
NAPOLEON BONAPARTE – SUR LE SUICIDE
Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd’hui ? Du côté de la mort. Dans l’aurore de mes jours je puis espérer encore vivre longtemps. Je suis absent depuis six à sept ans de ma patrie. Quels plaisirs ne goûterai-je pas à revoir dans quatre mois et mes compatriotes et mes parents ! Des tendres sensations que me fait éprouver le souvenir des plaisirs de mon enfance, ne puis-je pas conclure que mon bonheur sera complet ? Quelle fureur me porte donc à vouloir ma destruction ? Sans doute, que faire dans ce monde ? Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? Si j »avais déjà passé soixante ans, je respecterais le préjugé de mes contemporains et j’attendrais patiemment que la nature eut achevé son cours ; mais puisque je commence à éprouver des malheurs, que rien n’est plaisir pour moi, pourquoi supporterais-je des jours que rien ne prospère ? Que les hommes sont éloignés de la nature ! Qu’ils sont lâches, vils, rampants ! Quel spectacle verrai-je dans mon pays ? Mes compatriotes chargés de chaînes et qui baisent en tremblant la main qui les opprime ! Ce ne sont plus ces braves Corses qu’un héros animait de ses vertus, ennemi des tyrans, du luxe des vils courtisans. Fier, plein d’un noble sentiment de son importance particulière, un Corse vivait heureux s’il avait employé le jour aux affaires publiques. La nuit s’écoulait dans les tendres bras d’une épouse chérie ? La raison et son enthousiasme effaçaient toutes les peines du jour. La trendresse, la nature rendaient ses nuits comparables à celle des Dieux. Mais, avec la liberté, ils se sont évanouis comme des songes, ces jours heureux ! Français, non contents de nous avoir ravis tout ce que nous cherissions, vous avez encore corrompu nos moeurs. Le tableau actuel de ma patrie et l’impuissance de le changer est donc une nouvelle raison de fuir une terre où je suis obligé par devoir de louer des hommes que je dos haïr par vertu. Quand j’arriverai dans ma patrie, quelle figure faire, quel langage tenir ! Quand la patrie n’est plus, un bon patriote doit mourir. Si je n’avais qu’un homme à détruire pour délivrer mes compatriotes, pe partirais au moment même et j’enfoncerais dans le sein des tyrans le glaive vengeur de la patrie et des lois violées. La vie m’est à charge parce que je ne goûte aucun plaisir et que tout est peine pour moi. Elle m’est à charge parce que les hommes avec qui je vis et vivrai probablement toujours ont des moeurs aussi éloignées des miennes que la clarté de la lune diffère de celle du soleil. Je ne peux donc pas suivre la seule manière de vivre qui pourrait me faire supporter la vie, d’où s’ensuit un dégoût pour tout.
(Valence le 3 mai 1786)
juillet 30, 2007
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (3)
IV
En 1789, à la veille de la convocation des Etats généraux, Napoléon eut l’idée de prendre Giubega pour confident de ses secrètes pensées. On sait qu’il était, à cette époque, Corse de coeur et d’âme, qu’il aimait la Corse par dessus tout, qu’il ne respirait que l’amour de sa petite île. Ma nation, écrivait-il en parlant de la Corse, et comme s’il n’eût pas porté l’uniforme d’officier français. Mais ne pouvait-il dire, ainsi que le personnage d’une de ses nouvelles : « J’ai puisé la vie en Corse et avec elle un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance ? » Il louait le peuple corse, ce peuple, fort de sobriété et de sa constance, qui s’était si longuement, si bravement battu contre les armées étrangères. Il exaltait Paoli qui, à Brienne et à l’Ecole militaire de Paris, était déjà son idole ; il vantait l’éloquence, la fermeté, les ressouces d’esprit du grand Pasquale, le montrait faisant face à tout, effrayant les Génois même, ouvrant des ports et créant une marine, fondant une Université. Il maudissait les Français qui, « vomis sur les côtes de la Corse, étaient venus renverser et noyer dans des flots de sang le trône de la liberté, » qui, non contents de ravir à l’insulaire tout ce qu’il possédait, avaient encore corrompu ses moeurs. Il vouait à l’éxécration les généraux français, -non Marbeuf, son bienfaiteur et le bienfaiteur des siens, dont il ne prononçait pas le nom -mais Narbonne-Fritzlar et Sionville qui, selon lui, avaient commis des horreurs et déshonoré leur caractère par leurs cruautés, Narbonne-Fritzlar qui faisait entasser dans la tour de Toulon et mourir les prisonniers corses, Sionville qui brûlait les maisons, coupait les oliviers, arrachait les vignes des insurgés, arrêtait leurs parents et leurs amis. Il jugeait que les Corses pouvaient secouer le joug des Français comme ils avaient secoué le joug des Génois, et de 1785 à 1789, la pensée de son pays réduit à l’esclavage ne cessait de le poursuivre. « Nos maux, mandait-il à Giubega, sont toujours présents à mon esprit et ont si profondément frappé mon âme qu’il n’y a rien au monde que je ne sacrifie pour les voir finir. »
Lorsqu’il composait vers ces temps les Lettres sur la Corse, il voulait non seulement faire oeuvre d’historien, mais faire oeuvre de patriote. Révéler la véritable situation de sa terre natale, flétrir les abus de l’administration française, appeler au tribunal de l’opinion les hommes qui gouvernaient la Corse, découvrir leurs menées, détailler leurs tyranniques mesures et « noircir du pinceau de l’infamie » ceux de ses concitoyens qui trahissaient la cause commune, tel était son but.
Il sentait toutefois qu’il était bien jeune pour « empoigner le burin de l’histoire. » -Paoli ne lui disait-il pas que « l’histoire ne s’écrit pas dans les tendres années, » la storia non si scrive negli anni teneri ?– Il sentait que cette entrerprise convenait plutôt à un homme mûr, expérimenté, connu dans l’île et même en France, revêtu d’une de ces fonctions qui inspirent la confiance. Pourquoi son parrain ne serait-il pas l’organe des Corses persécutés ? Pourquoi Giubega ne dirait-il pas la vérité qui, venant de sa bouche, serait mieux écoutée ?
Napoléon écrivit donc à Giubega. Dans une suite d’interrogations rapides, fièvreuses, il s’indigne que la Corse ne « renaisse » pas comme la France où le mot liberté semble enflammer les coeurs, et qu’elle continue à subir le despotisme. Il demande à Giubega si ses compatriotes doivent toujours courber la tête sous le triple joug du militaire, du robin, du financier qui s’unissent pour les opprimer. Le militaire, dit Bonaparte avec une emphase qui rappelle Raynal, « ne trouve aucune digue et inonde de ses débordements jusqu’au sommet le plus élevé de ces montagnes. » Le robin, étranger à la langue et aux moeurs de la Corse, étranger même aux lois de son propre pays, ne juge que pour avoir du pain et amasser une fortune. Le financier, le « publicain », dépourvu comme le magistrat, de moralité et de probité, lève à son gré les impositions. Et ces Français, dont la naissance est aussi abjecte que la conduite, ces Français qui sont l’écume du royaume, viennent dénigrer, humilier et mépriser l’insulaire ! « N’est-ce pas la plus horrible des tortures que puisse subir le sentiment ? N’est-ce pas là tyrannie la plus affreuse ? De tous les degrés du despotisme, n’est-ce pas le dernier ? Le Péruvien, qui égorgeait le féroce espagnol, éprouvait-il une vexation plus ulcérante ? ». Eh bien ! que Giubega qui sait tout cela, et le sait mieux que Bonaparte, ose prendre la parole. Il est prudent et rompu aux affaires ; il se fera sûrement entendre ; il aura l’oreille des ministres d’aujourd’hui ; car ces ministres sont sages, et ils veulent le bien, et ils ne restent pas sourds aux doléances des peuples. Oui, que Giubega porte au pied du trône ou devant les Etats du royaume les gémissements de la Corse : peut-être suffit-il qu’un homme comme lui élève la voix pour que le sort de l’ïle soit changé. Sans doute, les commissaires du roi, le commandant en chef et l’intendant apporteront des liasses de certificats qui les justifieront ; ils jugeront que tout est pour le mieux. Mais le Français n’a t-il pas appris par son propre exemple que dans une nation les trois quarts « voient mal » et que l’autre quart n’encense que la fortune qui le favorise ! Que Giubega s’acquitte donc de ce grand devoir envers la patrie ; qu’il saisisse l’occasion de mettre en pleine évidence la mauvaise administration de la Corse ; qu’il ait pitié de ses compatriotes qui seront esclaves à jamais, si personne ne crie combien ils sont misérables. « La scène a changé, il faut changer la conduite. »
Cette lettre fut-elle envoyée ? Giubega la reçut-il ? Répondit-il à son filleul ? Ce qu’on sait, c’est qu’il accueilli plus tard avec bienveillance un opuscule que l’aîné des Bonaparte avait composé dans le même goût et sur le même sujet. C’était des Lettres de Paoli à ses compatriotes. Joseph y retraçait la situation malheureuse de la Corse et traitait des moyens de regénérer l’île par les réformes qui se préparaient sur le continent.
Mais Napoléon, aveuglé par sa passion corse, ignorait ou oubliait le rôle et les vrais sentiments de Giubega, comme il ignorait ou oubliait le rôle et les vrais sentiments de son père Charles Bonaparte. Il assurait à Paoli que ses parents s’étaient toujours attachés au bon parti : il oubliait que son père avait accepté, recherché les faveurs de Marbeuf. Il rappelait que Letizia avait à Corte joué au reversis avec Paoli et que Charles avait été l’un des secretaires du général, avait rédigé dans les termes les plus chauds et les plus énergiques une proclamation à la jeunesse corse : il oubliait que son père avait été, selon l’expression française, tout à fait dans la main du roi, avait été , comme disait le commandant d’Ajaccio, comblé des bienfaits du gouvernement. Il écrivait qu’avant la Révolution des « brigands » commandaient en Corse et jonchaient la terre de leurs victimes : il oubliait que son père avait servi ces brigands. Il flétrissait les Corse « à l’âme basse, » ceux que « l’amour d’un gain sordide avait corrompus, » ceux qui s’étaient jetés les premiers dans les bras de la France et qui « avaient prospéré dans l’avilissement universel » : il oubliait que son père était de ceux là. Il critiquait âprement la commission permanente des Etats ou commisison des Douze, cette commission de douze gentilhommes qui prétendait représenter la nation et qui laissait toujours l’intendant usurper leurs droits : il oubliait que son père -tout comme Giubega- avait été Douze, avait été Dodici. Il reprochait à Buttafoco d’avoir obtenu par son assiduité dans les bureaux de Versailles honneurs, domaines, pensions : son père Charles Bonaparte n’était-il pas sun Buttafoco au petit pied ?
Pareillement, lorsqu’il priait Giubega de protester contre les méfaits et forfaits de l’administration française, Napoléon oubliait que Giubega avait été le principal soutien de cette administration, que Giubega avait été, comme s’exprime un contemporain, le très fidèle serviteur de Marbeuf, fedelissimo servitore di Marbeuf.
Si Giubega lut la lettre de Napoléon, il dut hausser railleusement les épaules et dire, de même que Paoli trois ans plus tard, que l’officier d’artillerie n’était qu’un jouvenceau irréfléchi, qu’un jeune garçon inexpérimenté, un giovinetto, un ragazone inesperto.
V
Giubega joignait à son habileté, à sa massima cautela une très grande ambition, et des contemporains assurent qu’il désirait être intendant de la Corse, qu’il essaya de remplacer La Guillaumye, successeur de Boucheporn. On ne s’étonnera donc pas qu’il ait voulu jouer un rôle durant la Révolution.
La noblesse de l’ïle devait élire un député aux Etats généraux. Giubega résolut de briguer ses suffrages et, pour préparer l’opinion, il annonça hautement son dessein. Il sut bientôt que le maréchal de camp comte Mathieu de Buttafoco serait son concurrent, et déjà ses ennemis objectaient que la charge de greffier des Etats, était incompatible avec la députation, qu’il ne convenait pas d’envoyer à Versailles un simple gentilhomme qui serait mal reçu s’il n’avait ni titre ni grade militaire. Giubega écrivit à Paris qu’il tenterait les chances du scrutin : il n’était sans doute ni titré, ni officier général, mais il était bon gentilhomme, comme six cents autres en Corse, et si la noblesse de l’île le choisissait pour son représentant, le premier commis ferait pendant son absence les fonctions de greffier en chef.
La lutte électorale fut vive. Buttafoco, que Jean-Jacques tenait pour un très galant homme, instruit et doué d’esprit, avait toujours été d’avis que l’île ne pouvait être une république, que ses ports seraient constamment aux mains des étrangers, que les Corses, entourés et resserrés de toutes parts, n’avaient dans l’intérieur qu’une liberté de nom, qu’il valait mieux, comme il disait à Paoli, « renoncer à l’idée flatteuse, mais inconsistante d’une malheureuse indépendance. » Aussi, s’était-il en 1768, battu contre ses compatriotes, et, d’ailleurs il servait depuis l’âge de dix ans sous les drapeaux du roi. Les partisans de Giubega lui reprochèrent d’avoir trahi la patrie et de vouloir le maintien de l’ancien régime. Mais, de leur côté, les amis de Buttafoco répétaient que Giubega avait été l’organe et l’instrument de toutes les avanies et vexations exercées par Marbeuf.
Il fallait d’abord que Giubega fût un des trois députés que la noblesse de la juridiction de Calvi déléguait à l’assemblée générale de Bastia, et il réussit à enlever le vote. Il avait huit électeurs contre lui : Cattaneo, membre du Conseil supérieur, deux Questa et cinq Fabbiani. Mais ses adhérents étaient onze : lui-même qui n’hésita pas à se donner sa voix ; son frère Damien et son neveu Xavier ; les trois officiers de l’état-major de Calvi, le commandant Maudet, le major Gombault, et l’aide-major Saillant ; les deux Anfriani, père et fils ; deux Castelli et Dominique Fabiani. Il y eut de très chaudes contestations. Cattaneo soutenait, non sans raison, que les trois officiers de l’état-major et les deux Anfriani n’avaient pas droit de suffrage : les trois officiers étaient Français du continent, et non Corses, et leurs lettres de noblesse n’avaient pas été enregistrées ni au Conseil supérieur, ni au greffe des Etats, et les deux Anfriani avaient déjà voté dans l’assemblée du tiers. Il se plaignait, en outre, que les officiers de l’état-major fussent venus l’épée au côté, que des grenadiers fussent entrés dans la salle la baïonnette au bout du fusil et que leur lieutenant l’épée nue à la main, se fût placé près du juge royal : les électeurs disait Cattaneo, avaient l’air d’une bande de prisonniers gardés à vue et ils avaient dû quitter à la porte leurs armes et même leur canne. Mais le juge royal Schouller, feignant d’être malade, produisit un certificat de « faiblesse de santé, » et Damien Giubega, son assesseur, qui le remplaça, admit hardiment dans l’assemblée de la noblesse calvaise les trois officiers français et les deux Anfriani : avec le plus grand sang-froid, il rendit les deux sentences l’une après l’autre, la première, de concert avec un des Anfriani, en faveur des messieurs de l’état-major, la seconde, de concert avec les deux officiers, en faveur d’Anfriani : les offciers admettaient celui qui, l’instant d’auparavant, avait prononcé leur admission. Le 29 avril, les onze partisans de Giubega envoyaient à Bastia comme députés de la noblesse calvaise Laurent Giubega, Charles-Antoine Anfriani, et Dominque Fabiani. Toutefois, les huit opposants, ou, ainsi qu’on les appelait, les huit protestants ne se tinrent pas pour battus : ils firent, eux aussi leur élection et ils nommèrent trois députés : Cattaneo, Octave Questa et Simon Fabbiani. « Voilà, s’écriait un de nos fonctionnaires, voilà les hauts faits de Giubega : il bouleverse tout ! »
A Corse, Corse et demi. Giubega vainqueur à Calvi, fut vaincu à Bastia. Dès la première séance de l’assemblée générale des trois ordres, le 18 mai, il déclara qu’il s’opposait formellement à l’admission de Cattaneo, de Questa, et de Simon Fabbiani : lui, Laurent Giubega, ainsi qu’Anfriani et Dominique Fabiani, étaient les vrais représentants de la noblesse calvaise, comme en témoignait le procès-verbal dûment rédigé à Calvi et revêtu de l’approbation du juge Schouller. Mais Cattaneo avait la langue bien affilé ; il répondit que l’élection de Giubega était nulle et une discussion s’engagea qui dura deux heures.
Le lendemain, 19 mai, nouveaux débats dans l’assemblée générale. Cattaneo assura que l’élection de Giubega était due à la violence, aux baïonnettes des grenadiers et à l’intrusion de cinq membres qui n’appartenaient aucunement à la noblesse calvaise. Giubega répliqua qu’il n’y avait pas eu la moindre contrainte, le moindre « appareil de coaction, » que les grenadiers veillaient au bon ordre et que leur intervention avait été nécessaire à cause de l’effervescence des esprits. Mais le procureur du roi, Serval, et le président de l’assemblée générale, le juge royal de Bastia, Franceschi, étaient amis de Buttafoco ; Serval donna ses conclusions et Franceschi les adopta : l’ordre de la noblesse devait, dans sa sagesse et sa compétence, statuer sur l’exclusion ou l’admission des députais calvais. C’était d’avance condamner Giubega. Aussi, disait-il tout haut qu’il regardait l’assemblée de la noblesse comme incompétente et que nul, sinon le roi et son Conseil, n’avait le droit de prononcer sur la validité des élections : « Vous refusez donc, s’exclama Cattaneo, de vous soumettre au jugement de vos pairs et vous insultez la noblesse ! » -« Oui, répondit Giubega, je refuse de me soumettre à la décision de la noblesse, non que je manque d’estime et de respect pour elle, mais je récuse quelques-uns de ses membres à cause de leurs parentés et alliance. » Le jour suivant, 20 mai, dans la séance de l’après-midi, l’opiniâtre Giubega voulut présenter un mémoire à l’assemblée générale. Mais la plupart des gentilshommes crièrent que les intérêts particuliers retardaient l’intérêt commun et que Giubega n’avait qu’à lire ses observations dans la chambre de la noblesse. Le président Franceschi partagea cet avis ; il décida que Giubega lirait son mémoire, non en assemblée générale, mais séparément à chacun des trois ordres.
L’affaire était jugée. Faut-il raconter que Giubega, Anfriani et Dominique Fabiani furent exclus par la chambre de la noblesse qui, par onze voix contre sept, ne reconnut comme députés de Calvi que Cattaneo, Questa, et Simon Fabbiani ? Faut-il dire que Buttafoco fut élu député de la noblesse de Corse ? Le 6 juin, à trois heures de l’après-midi, les électeurs se réunirent. Ils devaient être vingt-deux, selon le règlement, et ils n’étaient que dix-sept. Cinq manquaient : Cinq partisans de Giubega, Frédéric et Jean-Baptiste de Susini, Pierre-Paul Cuneo d’Ornano, Benedetti de Vico et Hyacinthe Arrighi de Corte. L’assemblée les attendit jusqu’à cinq heures, puis les fit appeler ; ils refusèrent de venir. Elle les somma de se présenter ; ils refusèrent de nouveau. Après les avoir attendus jusqu’à sept heures et demie, les dix-sept gentilshommes procédèrent à l’élection. Buttafoco fut nommé député ; Gaffori, suppléant de Buttafoco ; Cattaneo, suppléant adjoint, pour remplacer Buttafoco ou Gaffori en cas de mort ou de légitime empêchement.
Le parti populaire était indigné. L’évèque de Sagone s’élevait contre les « tracasseries » dont Giubega avait été l’objet ; il assurait que le juge royal Franceschi, mû par une rancune personnelle, avait voulu se venger d’un homme qui méritait l’estime de la nation et la confiance du gouvernement ; selon lui, Giubega, Anfriani, et Dominique Fabiani, nommés suivant les règles députés légitimes de la noblesse calvaise, ne devaient pas être exclus, et la chambre de leur ordre, en décidant de la validité de l’élection, avait empiété sur les attributions du Conseil d’Etat par un « coup d’autorité. »
Les deux représentants du tiers, l’avocat Saliceti et le capitaine Colonna de Cesari-Rocca, protestaient, eux aussi, contre l’admission de Cattaneo, de Questa et de Simon Fabbiani ; ils déclaraient que le tiers état et le public impartial blâmait l’assemblée de la noblesse ; ils affirmaient que l’assemblée de la noblesse était illégale et que Buttafoco, élu par des gens qui n’avaient ni titre ni caractère pour être électeurs, ne pouvait être regardé comme député.
Napoléon Bonaparte était du même sentiment, et il prit avec chaleur le parti de son parrain ; dans sa fameuse Lettre à Buttafoco, il soutient que Buttafoco a gagné le Conseil supérieur -il y avait trois membres de ce Conseil, Morelli, Belgodere, et Cattaneo, dans l’assemblée de la noblesse- a mis tout en jeu, menaces, promesses, caresses, argent.
Giubega avait couru à Paris. Il quitta Bastia, le 7 juin, sur un bateau de poste, douze heures après l’élection de Buttafoco. Mais il eut mauvais temps ; il fut obligé de relâcher dans la rivière de Gênes ; il tomba malade, et lorsqu’il arriva, le 1er juillet, à Paris, Buttafoco était déjà validé. Il ne perdit pas courage. Il fit un mémoire habile, plein de finasseries, d’arguements spécieux et de raisons plausibles, un mémoire où se déployaient toutes les ressources de son esprit adroit et retors. Selon lui, l’assemblée de la noblesse était incompétente pour statuer sur l’admission des députés de Calvi. Onze membres, sur dix-huit, avaient voté son exclusion. Mais Buttafoco qui n’aurait eu d’autre compétiteur que Giubega, pouvait-il être juge dans sa propre cause ? Boccheciampe n’était-il pas allié à Simon de Fabbiani ? Pruni n’avait-il pas un procès pendant au Conseil supérieur et la prudence ne lui défendait-elle pas d’indisposer Cattaneo contre lui ? Et Buttafoco pouvait-il être élu par une assemblée où il ne comptait que des parents et des alliés ? Gaffori n’était-il pas son beau-père ; André Antoni, son oncle ; Casalta, ainsi que Jean Antoni, ses cousins ? L’élection de Buttafoco, concluait Giubaga, était donc illégale, était « un acte de nullité, d’injustice et d’aritocratie ; » l’assemblée dont il avait eu les voix, offrait « tous les caractères de l’irrégularité, du désordre, » et il fallait ordonner une prompte onvocation de la noblesse corse, composée de ses membres légitimes et chargée d’élire un député légitime.
Le temps s’écoulait. D’André devait faire « le rapport des difficultés élevées sur la députation de la noblesse de l’ïle de Corse. » Il laissa la tâche à Grellet de Beauregard, député du tiers état de la sénéchaussée de la Haute-Marche. Le 30 octobre, Beauregard était prêt, et Giubega priait le président de la Constituante d’ « accélerer la décision ; » il était, disait-il, épuisé par les dépenses d’un séjour de quatre mois et il comptait que l’assemblée nationale reconnaîtrait la solidité de ses réclamations et le tort qu’il avait subi.
Le rapport fut déposé le 4 novembre. Mais comment donner raison à Giubega ? Le marquis de Monteynard écrivait que le grefier en chef était un homme très dangereux, qu’il avait longtemps abusé de la place qu’il occupait, que la prochaine assemblée des Etats de Corse le casserait aux gages.
Le président de l’ordre de la nobesse corse, Bocchepiampe, dans ses lettres au roi et aux ministes, demandait justice contre les « sujets turbulents » qui méconnaissaient la faveur royale, contre le juge et l’assesseur de Calvi qui venait de mésuser si scandaleusement de leurs fonctions contre cet « intrigant redoutable » cet auteur d’une « cabale séditieuse, » ce Laurent Giubega qui, pour satisfaire sa passion et son intérêt personnel, avait entraîné le tribunal de Calvi et jeté le trouble dans les élections.
Le juge royal de Bastia, Franceschi, condamnait pareillement la conduite de Giubega et de ses partisans. Selon lui, dans la réunion des trois ordres, Giubega s’était servi d’expression peu mesurées et très propres à échauffer les membres de la noblesse ; Cattaneo, au contraire, avait soutenu ses droits avec modération et prudence. Mais Franceschi protestait surtout contre l’élection de Calvi : l’assesseur, Damien Giubega, frère de Laurent Giubega, ne pouvait, disait-il, rendre un jugement dans cette affaire, et son devoir, ou celui du juge royal, Schouller, était de récuser les cinq personnages qu’il avait admis comme gentilshommes, les deux Anfriani, membres du tiers état, et les trois officiers de l’état-major qui ne présentaient pas leurs titres de noblesse.
Le comité de vérification des pouvoirs ne put donner gain de cause à Giubega. Il décida qu’ « il n’ya avait pas lieu de réformer l’élection de Buttafoco. » Mais pour consoler Giubega -et la consolation était mince- il demanda que le gentilhomme corse eût le droit d’assister aux séances de l’assemblée dans la tribune des supléants, et la Constituante approuva les propositions de son Comité.
juillet 29, 2007
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (2)
II
La France confia le gouvernement de l’ïle à deux hauts fonctionnaires ou commissaires du roi, à un commandant en chef et à un intendant. Elle créa onze juridictions royales et un Conseil supérieur revêtu des attributions d’un parlement. Elle établit trois ordres, noblesse, clergé, tiers état, et fit de la Corse un pays d’Etats ; car les pays d’Etat, disait le comte de Vaux, « croyant avoir quelque part à la distribution des subsides, les paient avec moins de murmure. » Les Etats se tenaient à Bastia à des époques indéterminées, et, à chaque tenue, ils nommaient trois députés qui représentaient les trois ordres et portaient à Versailles un cahier de demandes. La première assemblée eut lieu en 1770 ; elle élut député Stefanini, évêque de Sagone, pour le clergé, Antonio Massesi pour la noblesse, ete Laurent Giubega, quoique noble, pour le tiers etat.
Pendant son séjour en france, Giubega attira l’attention par la fierté de son attitude et la franchise de ses propos. A un déjeuner qu’il donnait aux députés, le ministre de la guerre -qui dépendait de l’île- s’efforçait de leur démontrer que la Corse serait heureuse sous la dominaition française. Giubega le regardait fixement sans faire aucun signe d’approbation. Le ministre, étonné, demanda si le député du tiers état ne partageait pas son opinion. « Excellence, répondit Giubega, je ne puis pas oublier que nous avons perdu le plus grand des biens qui est l’indépendance. »
Le mot est-il authentique ? En tout cas, après son voyage, Giubega compris plus que jamais que la Corse ne pouvait être une république, qu’elle ne trouverait le repos et la prospérité que dans l’union avec la France, qu’isolée, indépendante, elle serait fatalement à la merci des factions, des discordes intérieures, des interventions de l’étranger. Il servit donc le nouveau gouvernement. Procureur du roi à La Porta, puis à Ajaccio, il fut nommé le 16 février 1771, greffier en chef des Etats. Cette charge, qui lui rapportait 2.000 livres par an, fit de Giubega un des premiers personnages de l’île ; c’était comme on disait, une charge d’importance et de confiance « qui ne pouvait être exercée que par un noble de noblesse prouvée. » Il fut installé dans ses fonctions le 1er mai 1772 et désormais, dans les séances de l’assemblée, il eut sa place au bureau, au-dessous et « aux pieds » des deux commissaires du roi. Il écrivait et signait tous les actes, et il avait seul le pouvoir d’en délivrer des copies. C’était même lui, et non le président qui proposait les matières sur lesquelles l’assemblée délibérait.
Son zèle fut apprécié. Les mémoires que l’administration le chargea de rédiger sur la législation du pays, furent goûtés ; ils parurent aussi clairs que complets. Le département des finances lui donna, outre une pension de 700 livres, la direction du bureau des impositions. En 1781, il obtint le privilège de déssécher à Calvi le marais du Stagnone et de planter sur l’emplacement une pépinière de muriers. mais ce fut surtout en 1785 qu’il rendit d’éclatants services. Cette année là, les Etats lui exprimèrent solennellement leur satisfaction et leur reconnaissance en déclarant, qu’il avait, par ses lumières et ses talents, par ses réflexions et ses éclaircissements de toutes sortes, aidé l’assemblée à résoudre avec autant de précision que de promptitude les questions les plus essentielles et les plus épineuses. Aussi, après la session, Giubega n’hésita pas à solliciter du ministre de la guerre une gratification. Les commissaires du roi, le commandant en chef Marbeuf et l’intendant Boucheporn, appuyèrent chaudement sa demande. Ils écrivaient que Giubega avait fourni de nouvelles preuves de son intelligence et de son activité dans l’assemblée des Etats où « des objets vraiment importants avaient exigé de sa part un travail plus considérable que les matières traitées dans les Etats précédents. » Marbeuf et Boucheporn ajoutaient que Giubega était sans contredit celui de tous les Corses qui avait le mieux mérité du gouvernement royal, qu’on le trouvait « à la tête de toutes les affaires difficiles et délicates, » que ses entreprises privées « réuissaient bien, » que les commissaires du roi avaient toujours fait le plus grand cas et rendu dans tous les témoignages les plus avantageux de Laurent Giubega. Le 13 juillet 1786, le ministre de la guerre, maréchal de Ségur, accordait à Giubega une gratification de 1.200 livres.
Nombre de ses compatriotes le jalousaient. Ils prétendirent qu’il avait pesé sur les motions des Etats et, dans l’année 1777, on le qualifia de despote en pleine séance de l’assemblée. Ce fut lui, dit-on, qui proposa d’élever une statue au roi et un monument au marquis de Monteynard, ministre de la guerre et gouverneur honoraire de la Corse, lui qui proposa de graver sur la façade du palais des Etats l’inscription suivante : « A Marbeuf, cet homme éminent qui a si bien mérité de leur pays, tous les ordres ont fait graver sur le marbre les sentiments d’amour depuis longtemps gravés dans les coeur. » Les Corses irréconciliables le traitèrent de renégat, l’appelèrent un instrument d’oppression, lui reprochèrent de flatter, de seconder Marbeuf, le tyran de la Corse, et d’avilir la nation.
Pourtant, en plusieurs circonstances, Giubega montra qu’il n’était pas le flagorneur et le plat valet de Marbeuf. Le commandant en chef voulait perdre le lieutenant-colonel Abbatucci dont il redoutait l’ascendant sur le peuple. Abbatucci avait dit imprudemment à Marbeuf qu’il se chargeait pendant son absence de maintenir les Corses dans la bonne voie. Marbeuf remarqua devant Giubega qu’Abbatucci avait encore la même influence qu’avant la conquête et pourrait la tourner contre le roi. Giubega se hâta d’avertir son compatriote qui était aussi son ami. Mais Marbeuf sut impliquer le lieutenant-colonel dans une méchante affaire, et Abbatucci, injustement accusé d’avoir suborné de faux témoins, fut condamné par le Conseil supérieur à neuf ans de galère et à la marque. Giubega se joignit à la députaiton des Etats qui vint supplier le commandant en chef d’adoucir la sentence, et il se jeta tout pleurant aux genoux de Marbeuf. « Excellence, s’écria-t-il, je ne me relèverai que si vous m’accordez la grâce que nous vous demandons. » Il réussit à gagner le bourreau qui ne fit qu’érafler Abbatucci au lieu de le marquer, et quand le maheureux s’embarqua pour se rendre au bagne de Toulon, Giubega l’accompagna jusqu’au dernier instant et lui remit une bourse de cent louis.
On sait enfin que Giubega ne voyait pas sans déplaisir le nombre de cohorte de commis français que l’administration avait investis des emplois. Chacun des ses mots était répandu et il ne prononçait pas au hasard « Les pauvres insulaires, dit-il un jour, ne peuvent-ils pas manger le peu de pain que produit leur île puisqu’on ne leur donne rien nulle part ? »
III
Pendant qu’il était procureur du roi à Ajaccio en 1770 et 1771, Giubega s’était lié très intimement avec Charles Bonaparte qui venait, à son exemple, d’entrer dans les juridictions royales. A la prière de Charles, Giubega fut le parrain de Napoléon, né le 15 août 1769, et de Marie-Anne, née le 14 juillet 1771 et morte en bas âge. Les deux enfants furent baptisés le même jour, le 21 juillet 1771, et ils eurent le même Padrino, « l’illustrissimo Lorenzo Giubega de Calvi, procuratore del Re. »
Ce fut par l’entremise de Giubega que Charles Bonaparte obtint la protection du tout-puissant Marbeuf. Malgré le courage qu’il avait montré dans la guerre de l’indépendance, Charles était de ces Corses, qui selon le mot de Paoli, avaient les cheveux frisés et sentaient les parfums du continent. Ses fils ont prétendu qu’il voulait, après le désastre de Ponte-Novo, tenter une résistance impossible, qu’il désirait rejoindre Paoli sur la terre d’exil, qu’il ne se rallia qu’à contre-coeur aux Français, qu’il déplorait la mollesse de ses compatriotes et les accusait de s’accomoder trop aisément à la domination étrangère, qu’il écrivit même une chanson satirique, Pastorella infida sei, où Paoli, représenté par un berger, se plaint de la Corse, sa maîtresse infidèle. Non. Charles embrassa sur le champ le parti Français. La Corse disait-il, -tout comme Giubega- est le plus petit pays du monde, et le roi de France, le plus grand monarque de la terre. « J’ai été, ajoutait-il, bon patriote et paoliste dans l’âme, tant qu’a duré le gouvernement national; mais ce gouvernement n’est plus ; nous voilà Français, vive le roi et son gouvernement, Evviva el re é suo goberno ! » Et Charles, ce Charles que les siens nous ont dépeint faible, frivole et fastueux, eut assez de souplesse et de persévérance pour faire son chemin sous le nouveau régime, briguant, intriguant, quémandant -comme plus tard Napoléon dans les comités- pratiquant le métier de solliciteur avec une intrépidité toute corse, multipliant les démarches, obsédant les bureaux sans redouter ni fatigue ni humiliation, inquièt d’humeur, subtil d’esprit, ardent d’imagination, forgeant des projets, revendiquant des sucessions, engageant des procès, déployant pour défendre ses prétentions, une audacieuse argutie, assurant d’un air imperturbable qu’il avait le droit de son côté.
Il ne faut pas oublier que la famille de Letizia était dévouée aux Génois. Le père de Letizia, Ramolino, avait été inspecteur des ponts et chaussées au service de Gênes, et son beau-père, Fesch, capitaine dans la marine génoise. Son grand-père, Pietra-Santa, fut un des quatre Corses qui siégèrent dès 1768 au Conseil supérieur, et l’intendant vantait non seulement la décence et son application, mais son attachement à la France. Sur le conseil de Pietra-Santa, Charles Bonaparte, à peine remis des émotions de la défaite, résolut d’obtenir un emploi de judicature. Cinq mois après la fuite de Paoli, le 30 novembre 1769, il présentait à l’Université de Pise une thèse qui lui valait son diplôme de docteur en droit, et, l’année suivante, il était nommé assesseur de la juridiction royale d’Ajaccio aux appointements mensuels de 900 livres. Ce serait peu aujourd’hui ; c’était beaucoup pour cette époque, et en Corse, puisque les habitants, selon le mot du comte de Vaux, étaient accoutumés à une médiocre fortune, et avec le temps, Charles espérait arriver, comme le grand-père de Letizia, au parlement de Corse : ses fonctions d’assesseur, étaient, disait-on, « le séminaire et le premier port » qui devait le conduire à la place de membre du Conseil supérieur, et l’intendant Chardon avait jugé qu’il était doué de talent et capable de bien faire.
Mais, cinq à six ans après l’annexion, Charles n’était pas content. Il lui importait de plaire à Marbeuf qui ne semblait pas répondre à ses avances. Le 18 mai 1775, dans une lettre intime à Giubega, il se plaint que le commandant en chef ne le paie pas de retour, et pourtant, dit-il, « je lui suis vivement attaché et le diable m’entraîne de ce côté. » Marbeuf allait partir pour le continent. Charles demande à Giubega s’il peut quitter Ajaccio pour courir à Bastia et souhaiter bon voyage au général. Il n’ose, de lui-même, faire cette démarche ; il a peur que sa venue ne soit pas opportune, qu’on ne lui sache aucun gré de sa visite, qu’on ne l’accueille sans remerciement ni reconnaissance, senza grato nè grazia.
Giubega que Charles traite de « très cher compère, » recommanda vivement le gentilhomme ajaccien à Marbeuf, et l’année suivante, en 1777, à la tenue de Etats où, comme d’ordinaire, s’exerça l’influence de Marbeuf et Giubega, Charles avait mission d’ « aller en cour » : il était élu, par trente voix sur soixante-neuf, député de la noblesse et chargé avec Santini, évêque de Nebbio, et Paul Casabianca qui représentaient le clergé et le tiers état, de se rendre à Versailles pour y porter, comme de coutume, les voeux du pays et « implorer » la continuation de toutes les grâces multipliées que le roi daignait répandre sur le peuple. » Les trois délégués ne furent appelés en France qu’à la fin de 1778, et c’est alors que Charles mena au collège d’Autun où ils entrèrent le 1er janvier 1779, ses deux fils, Joseph et Napoléon. Il toucha 3.000 livres pour ses frais de route et de séjour, et quand il regagna la Corse, après avoir affirmé dans une pétition qu’il était dans la détresse, il obtint encore 2.000 livres en récompense de sa « bonne conduite ». Il avait d’ailleurs prôné Marbeuf et assuré que tout allait bien dans l’ïle, que le commandant en chef « ne cessait d’employer ses soins et ses fonds à la régénération du pays. » Ne fut-il pas, à son retour, un de ceux qui, le 4 juin 1779, votèrent l’inscription latine en l’honneur de Marbeuf ?
En revanche, il eut, par le crédit de Marbeuf, tout ce qu’il souhaitait : une bourse pour Joseph au collège d’Autun, une bourse pour Napoléon à l’école militaire de Brienne, une bourse pour Elisa à la maison royale de Saint-Cyr. Le commandant en chef consentit à être le parrain de Louis. Il concéda à Charles Bonaparte, comme à Giubega et aux mêmes conditions avantageuses, une pépinière de mûriers. Il lui donna 6.000 livres pour achever le défrichement du marais des Salines. Il lui fit attribuer sur la succession Odone le bail emphytéotique de la maison Boldrini et de la campagne des Milelli.
Aussi, Charles Bonaparte temoignait-il en toute occasion le plus grand attachement à Marbeuf. Lorsqu’en 1784 le commandant en chef, à l’âge de 72 ans, épousa, sur le désir de ses parents et amis, pour perpétuer son nom, Mlle Antoinette de Fenoyl, Charles lui prédit dans un sonnet un fils qui serait le vrai portrait de son père et suivrait avec éclat la carrière des siens.
On comprend dès lors que les relations entre les familles Giubega et Bonaparte étaient constantes. Le 14 juin 1779, Laurent Giubega tint sur les fonds baptismaux avec Mme Letizia dans l’église Sainte-Marie de Bastia la fille de Muselli, premier commis des Etats. A chaque voyage qu’il fait en Corse, le lieutenant d’artillerie Napoléon Bonaparte ne manque pas de rendre visite au greffier en chef et de l’assurer de « son plus profond respect. »
NAPOLEON BONAPARTE EN BD – ETUDE DE MARCHE
Nous souhaitons prouver qu’il existe bien un marché pré-existant fort conséquent pour une bande dessinée sur le sujet napoléonien se voulant artistiquement et scientifiquement de qualité. Notre démarche s’inscrit dans la perspective de démontrer à de futurs partenaires (mécènes et/ou investisseurs) qu’un tel projet peut trouver un équilibre financier à très court terme. Le soutien de tous les internautes sensibles à notre dessein est donc crucial. Merci de nous apporter votre concours en prenant quelques instants pour répondre au questionnaire.

juillet 28, 2007
LAURENT GIUBEGA – LE PARRAIN DE NAPOLEON PAR ARTHUR CHUQUET (1)
Napoléon n’a jamais, croyons-nous, parlé de son parrain Laurent Giubega. Mais Joseph Bonaparte le nomme dans ses Mémoires et il assure que Giubega avait acquis l’affection et le respect d’un grand nombre de ses compatriotes par son rôle dans la guerre de l’indépendance, par son savoir juridique et par sa facilité de parole. Bien que les documents n’abondent pas à notre gré, une étude sur ce personnage ne sera peut-être pas dépourvue d’intérêt.
I
La famile de Laurent Giubega était originaire de Gênes. Agnolo Giubega combattit dans les rangs de l’armée combinée des Génois et des Pisans qui chassa les sarrazins de la Sardaigne en l’an 1015. Don-Pierre-François Giubega, établi à Madrid, est dans son testament qui date du 24 juillet 1516, qualifié de « grand avocat fiscal royal et intendant général de la chambre du roi. » Son frère Jean-Antoine était secrétaire d’Etat de François Sforza, duc de Milan, et un autre frère, Dom Claude, abbé du Mont-Cassin.
Jean-Antoine se maria. Son fils, Jean-César, hérita de « l’Espagnol » Don-Pierre-François, qui l’avait institué légataire universel. Le petit-fils de Jean-César, Pasqualino, capitaine au service de Gênes, vint se fixer à Calvi, en Corse en l’année 1570.
L’arrière-petit-fils de Pasqualino, François-Xavier-Giubega, eut huit enfants, dont l’avant dernier fut Lorenzo ou Laurent Giubega, auquel ce travail est consacré.
Laurent Giubega fit de fortes études à gênes sous la direction de son frère aîné, l’archidiacre Pascal, et durant quelques années il exerça dans cette ville avec distinction la profession d’avocat. Lorsqu’il regagna son île natale, il prit avec son frère Damien une part active à la lutte des Corses contre les Français en 1768 et 1769.
Paoli semblait le tenir en grande estime. A plusieurs reprises il loue le zèle, la diligence, l’éloquence de Laurent Giubega. Il lui communique les nouvelles du dehors. Tantôt il lui mande que la favorite a fait disgracier Choiseul, que le peuple corse a résolu de vaincre ou de périr, que les Français quitteront la partie parce que l’Angleterre a déclaré qu’elle ne souffrirait pas que l’île appartint à Louis XV. « Ne dissimulons pas dit Paoli, les secours que nous recevons de l’étranger, et les Français se croiront perdus, » et il annonça à Giubega qu’un seigneur anglais et un marquis milanais viennent d’arriver à l’Île Rousse, qu’une felouque a débarqué à l’embouchure du Golo un capitaine de vaisseau anglais avec du plomb et huit petits canons de campagne. Tantôt il exprime à Giubega l’indignation que lui inspire la « perfidie » des Français et leur « dessein, arrêté avec les Génois, de réduire le pays sous le plus intolérable despotisme. » Mais il ne cesse d’espérer le succès. Il voit, écrit-il à Giubega, la confusion régner chez les ennemis et il lui rapporte leurs propos : les officiers français pensent ou bien qu’ils vont prochainement se retirer au cap Corse ou bien, s’ils se renforcent, que leurs bataillons seront incomplets et ne compteront même pas 4.000 hommes ; ils ajoutent que leur roi redoute la dépense et que, si l’île n’est pas soumise dans les deux mois, la cour renoncera décidément à la Corse ; bref, les Français semblent « désorientés » parce qu’il reconnaissent les difficultés insurmontables de leur entreprise. « Courage donc, cria Paoli à Giubega, courage et résolution de défendre la patrie, et nous aurons la victoire ; notre résistance rendra notre nom célèbre et notre liberté eternelle! »
Au mois de mars 1759, Paoli charge Giubega d’envoyer une escorte à Vivario au devant des prisonniers français et de les loger dans l’église et le couvent de Ghisoni. Le général, comme les Corses l’appelaient, entre à ce sujet dans de minutieux détails. Les soldats seront mis dans l’église. les officiers habiteront le couvent, et les cinq ou six Corses qui veilleront sur eux les traiteront bien et empêcheront le peuple de les insulter. Paoli sait que, parmi ces Français, un lieutenant-colonel aime passionnément la chasse ; on peut le laisser parcourir la campagne avec quelques hommes sûrs. Les moines se fâcheront peut-être et il leur faudra se serrer un peu ; mais qu’ils voient avec quel zèle les Capucins et les Observantins de Corte ont obéi à la loi, et ils montreront le même attachement aux intérêts de la nation corse, le même souci de son salut et de son honneur. Et lorsque les moines regimbent, le général ne les blament pas : « Ils ont tort ; mais il est des occasions où l’on doit pallier le tort des moines ; ils peuvent faire du bien et du mal ; tachez de les gagner, surtout le père Don Diego. » La sollicitude de Paoli s’étend même auu corps de garde du couvent : il craint qu’un détachement français ne vienne le surprendre, l’attaquer à l’improviste, et il engage Giubega à se mettre en mesure. On lui a dit qu’il y a parmi les hommes du poste un mauvais sujet ; que Guibega se renseigne sur le compte de ce vaurien : « Il ne sied pas que les officiers français voient de quelle espèce de gens nous nous servons. »
Vers la même époque, Paoli prie Giubega de pacifier le Fiumorbo – le canton actuel de Prunelli dans l’arrondissement de Corte. Il faut, lui écrit-il enlever à tout prix Astolfi et quelques « infâmes », quelques « machinateurs » qui égarent les esprits ; il faut « faire un exemple » et effrayer le pays ; Giubega a dû ceindre l’épée, exercer le métier de soldat ; qu’il éclaire les bons, les timides, les indifférents et qu’il frappe les méchants. Qu’il sache user de ruse, qu’il s’abouche secrètement avec certains personnages qui connaissent les desseins des séditieux ; qu’il les « manie avec adresse et discrétion ; » qu’il n’hésite pas à leur donner de l’argent ; qu’il s’assure de ceux qui sont généreux de leur naturel et qui se laisseront aisément ramener dans le droit chemin par de bonnes paroles. Qu’il réconcilie les deux Murati, qui sont patriotes et pleins des meilleurs intentions ; quel dommage « si quelqu’un soufflait la discorde parmi eux ! » Qu’il se concerte avec les magistrats et la junte pour apaiser les querelles domestiques et terminer « les malentendus et chicanes qui existent entre les chefs de famille. » Les rancunes privées, les dissentions instestines ont déjà fait tant de mal à la nation corse, et le moment n’est-il pas venu pour les insulaires d’oublier les ressentiments particuliers et de concourir à la défense commune ?
La victoire de Ponte-Novo, remportée le 8 mai 1769 par le comte de Vaux, mit fin à l’indépendance corse. Paoli s’enfuit en Toscane, et lîle devint française. Laurent Giubega fut un des premiers à se soumettre. A la nouvelle de la défaite, nombre de familles, les Giubega, les Arrighi, les Bonaparte, avaient quitté Corte pour se réfugier sur le Monte-Rotondo. Le comte de Vaux leur envoya des officiers qui les invitèrent à regagner Corte. Les fugitifs, dit-on députèrent au vainqueur quelques-uns d’entre eux, Laurent Giubega et son frère Damien, Charles Bonaparte, Nicolas et Louis Paravicini d’Ajaccio, Dominique arrighi, de Speloncato, Jean-Thomas Arrighi et Jean-Thomas Boerio de Corte, Thomas Cervoni, de Soveria. Monsieur de Vaux reçut courtoisement ces délégués. Il les assura de la clémence royale et leur vanta les avantages que la Corse recueillerait de son union avec la France. Laurent Giubega était le chef de la députation. Il répondit que la Corse se montrerait digne de la bonté du roi : « Puisque l’indépendance nationale est perdue, nous nous honorerons d’appartenir au peuple le plus puissant du monde, et, de même que nous avons été bons et fidèles Corse, nous serons bons et fidèles Français. »
juillet 27, 2007
SOUVENIRS DICTES PAR MADAME MERE – LAETITIA BONAPARTE
Madame Mère, à la fin de sa longue existence dicta son autobiographie abrégée à sa dame de compagnie, mademoiselle Rosa Mellini. La dictée de ces souvenirs n’est d’ailleurs, que le récit sommaire de certains événements de la vie de la mère de l’empereur Napoléon Bonaparte, rappelés par elle avec une naïve et touchante simplicité. Ses courts Souvenirs comportent aussi de petites erreurs surprenantes (comme l’âge du décès de Charles Bonaparte).
A trente-deux ans, je restai veuve et Charles mourut à l’âge de trente-cinq ans, à Montpellier, victime de douleurs d’estomac, dont il se plaignait toujours, surtout après qu’il avait dîné.
Il avait été trois fois député en France, car ses rares qualités lui avaient attiré l’affection et l’estime de ses concitoyens.
En dix-neuf ans de mariage, je fus mère de treize enfants dont trois moururent en bas âge (et deux en naissant).
Charles était fils unique comme moi, lorsque nous nous mariâmes ; il avait sa mère et trois oncles, savoir l’archidiacre Lucien, Joseph, et Napoléon.
Devenue mère de famille, je me consacrai entièrement à la bonne direction de celle-ci et je ne sortais de chez moi que pour aller à la messe. J’entends qu’une des obligations du vrai chrétien soit d’aller à l’église, tous les jours et indispensablement des jours de fêtes ; mais je crois pourtant que l’église n’exige pas, dans les jours de travail, que les personnes qui se trouvent à la tête des affaires et surtout les mères de famille doivent perdre la plus grande partie du jour, hors de chez elle. Ce serait interrompre le cours régulier des affaires et se rendre coupable envers Dieu des graves inconvénients qui surviennent, bien souvent dans les familles, en l’absence du chef.
D’ailleurs ma présence était nécessaire pour mettre un frein à mes enfants tant qu’ils furent petits.
Ma belle-mère et mon mari étaient si indulgents à leur égard, qu’au moindre cri, la moindre réprimande, ils accouraient à leur aide, faisant mille caresses. Pour moi, j’étais sévère et indulgente, en temps voulu. Aussi étais-je obéie et aimée de mes enfants, qui, même après avoir grandi, m’ont toujours témoigné, dans tous les temps, le même amour et le même respect.
Ma belle-mère était si bonne que, toutes les fois que je relevais de couches, elle se faisait l’obligation d’entendre une messe de plus, de sorte qu’elle en arriva au point d’entendre neuf messes par jour !
De tous mes enfants, Napoléon, dès ses premières années, était le plus intrépide. Je me souviens que, pour donner un foyer à leur ardeur extraordinnaire, j’avais dû démeubler une grande chambre, où, dans les heures de récréation et de mauvais temps, il leur était permis de s’amuser, à leur gré.
Jérôme et les trois autres s’occupaient à sauter ou à dessiner des pantins sur le mur. Napoléon, à qui j’avais acheté un tambour et un sabre de bois, ne peignait que des soldats toujours rangés en ordre de bataille.
Dès ses premières années, il montra un goût particulier pour l’étude des nombres, au point que certaines soeurs ou béguines lui donnèrent le nom de mathématicien et le régalaient toujours de confitures. Un jour qu’il les rencontra sur la place Saint-François, il se mit à courir vers elles, en s’écriant Celui qui veut savoir où est mon coeur, le trouvera au milieu des seins des soeurs. La soeur Orto, femme grasse, avec de mauvaises jambes, la réprimanda, mais, à la fin, elle dut céder et lui adoucir la bouche, pour le faire taire.
Devenu un peu plus grand, je le faisais accompagner à l’école des jésuites et je lui donnais un morceau de pain blanc pour son déjeuner. Un jour on vint me rapporter que M. Napoléon avait été rencontré, plus d’une fois, dans la rue, en mangeant du pain de munition, chose qui ne convenait pas à un enfant de sa condition. Je le réprimandai fortement et il me répondit que, tous les matins, il échangeait son morceau de pain contre celui d’un soldat, puisque devant, lui aussi, être soldat, il était convenable qu’il s’accoutumât à manger de ce pain, que d’ailleurs il préférait au pain blanc.
A huit ans, il prit tellement goût à l’étude et particulièrement à l’arithmétique, qu’il fallut lui construire une espèce de petite chambre, en planches, sur la terrasse de la maison, où il se retirait tout le jour, afin de ne pas être troublé par ses frères. Le soir, seulement, il sortait, un moment et marchait en distrait, dans les rues, sans avoir fait sa toilette et oubliant toujours de remonter ses bas tombants. D’où vient le dicton répété aujourd’hui même, quelquefois, à Ajaccio : Napoléon à la michaussette, fait l’amour à Jacquelinette.
A ce même âge de huit ans (c’était un jour de fête, le 5 mai), notre fermier d’affaires étant venu en ville, avec deux jeunes et vigoureux chevaux, Napoléon attendit le moment du départ, monta lui-même sur l’un de ces deux chevaux et, nouvel Alexandre, galopait toujours en avant du fermier, qui tremblant de frayeur, l’exhortait à s’arrêter. Il arriva ainsi à destination et descendit de cheval, en riant beaucoup de la peur du fermier.
Avant de partir, il observa attentivement le mécanisme d’un moulin, alors en mouvement ; il alla reconnaître le volume d’eau qui le mettait en mouvement, demanda au fermier quelle était la quantité de blé moulue, pendant une heure, et prenant des notes sur tout, il ajouta, peu de temps après, que son moulin devait moudre, en un jour, une telle quantité de blé et, en une semaine, une telle autre quantité. Le fermier fut étonné par l’exactitude du calcul et, revenu en ville avec Napoléon, il me dit que si Dieu accordait longue vie au petit monsieur, il ne manquerait pas de devenir le premier homme du monde.
Je ne me suis jamais laissé faire illusion sur les grandeurs et les flatteries de la cour, et si mes fils avaient donné plus d’attention à mes paroles, ils se trouveraient mieux qu’ils ne le sont actuellement.
Tout le monde m’appelait la mère la plus heureuse de l’univers, tandis que ma vie a été une continuité de chagrins et de martyres. A chaque courrier qui arrivait, je craignais toujours qu’il m’apportât la funeste nouvelle de la mort de l’empereur, sur le champ de bataille.
Lorsque nous étions à Porto-Ferrajo, l’empereur me parut un soir, plus gai que de coutume ; il m’invita, ainsi que Pauline, à faire une partie d’écarté. Un moment après, il nous quitta et alla se renfermer dans son cabinet. Voyant qu’il ne revenait plus, j’allai chez lui, pour l’appeler et le chambellan me dit qu’il était descendu dans le jardin. je me souviens que nous étions dans une des plus douces soirées du printemps ; la lune brillait au dessus des arbres, et l’empereur se promenait seul, à pas précipités, le long des allées du jardin. Tout à coup il s’arrêta et, appuyant sa tête contre un figuier : Et pourtant il faudra bien que je le dise à ma mère !… s’écria-t-il. A ces mots, je m’avance et avec l’accent de la plus vive impatience : Et bien, lui dis-je, Qu’avez-vous donc, ce soir, car je vous vois beaucoup plus pensif qu’à l’ordinaire ?
L’empereur la main sur le front et, après un moment d’hésitation, me répond : Oui, il faut que je vous le dise, mais je vous défends de le répéter à qui que ce soit, ce que je vais vous confier, pas même à Pauline. Il sourit, m’embrasse et reprend : Et bien, je vous préviens que je pars, cette nuit. -Pour aller où ?- A Paris, mais, avant tout, je vous demande votre avis ? -Ah ! permettez que je m’éfforce d’oublier, pour un instant, que je suis votre mère. Je réfléchis et j’ajoutai : Le ciel ne permettra pas que vous mouriez, ni par le poison, ni dans un repos indigne de vous, mais l’épée à la main.
Marie-Louise était insipide à voir de près, ou à entendre, lorsqu’elle parlait ; mais elle écrivait très bien. Il est inexact que l’empereur ait fait préparé pour elle, à Paris, un appartement identique à celui qu’elle occupait à Vienne. Ce fut Caroline qui alla au devant d’elle et l’accompagna en France. L’empereur alla à a rencontre et ce fut moi qui l’a reçu, pour la conduire à son appartement. Le cardinal, mon frère, les unit par mariage.
Au baptème du petit Napoléon, l’empereur d’Autriche fut le parrain et je fus la marraine.
A notre dernier départ de Paris, Marie-Louise me dit : Je désire que vous veniez avec moi en Autriche. Je la remerciai et lui répondis que je ne me séparais jamais de mes enfants. A la mort du petit Napoléon, elle m’écrivit une lettre de condoléance, mais je ne lui ai pas répondu.
Ma vie finit avec la chute de l’empereur. A dater de ce moment, je renonçai à tout, pour toujours. plus de visites dans aucune société ; plus de théâtre, qui avait été mon unique distraction, dans les moments de mélancolie. Mes enfants et mes neveux m’ont toujours prié d’aller au théâtre, je m’y suis toujours refusée, en regardant leur invitation comme une injure. Ils n’ont jamais pu comprendre, comme moi, la profondeur de l’humiliation dans laquelle ils sont tombés par la mort de l’empereur.
Lien : Biographie de Madame Mère
juillet 25, 2007
CHARLES BONAPARTE PAR NASICA (2)
Charles Bonaparte depuis la conquête de l’île de Corse jusqu’à sa mort (1785)
Fiers et impétueux sur le champ de bataille, les français sont magnanimes et indulgents après la victoire. Satisfaits d’avoir vaincu des ennemis dignes sous tant de rapports de se mesurer à eux, ils accordèrent une amnistie ample et loyale à tous ceux qui ne refusèrent pas de se soumettre à la nouvelle domination.
La politique ombrageuse et cuelle de Gênes avait soigneusement exclu les Corses de tous les emplois de leur pays ; la politique sage et généreuse de la France voulut obtenir le concours des plus notables de l’île en les y appelant. Charles Bonaparte entre autres fut nommé assesseur à la justice royale d’Ajaccio. Il hésita d’abord à accepter cette place par suite d’une répugnance patriotique, mais les sollicitations de ses amis et de ses parents prévalurent.
Cependant la frayeur de la domination française se dissipait de jour en jour. Les illusions de l’indépendance nationale s’évanouirent avec le temps ; le sentiment de la liberté se refroidissait dans les coeurs ; le joug de l’étranger paraissait s’adoucir insensiblement par l’habitude de le porter, par l’impuissance de le sécouer et par la grandeur du nom de la France. Charles pourtant en gémissait au fond de son âme ; il voyait avec peine la résignation trop facile de ses concitoyens. Dans un moment de dégoût et de noble indignation, il composa la chanson satirique Pastorella infida sei, ou Paoli, sous l’allégorie d’un berger, se plaint amèrement de la Corse, comme d’une maîtresse infidèle. La jeunesse de l’ïle apprit la chanson et resta française.
En dépit de ses regrets cachés et de son amitié constante pour Paoli, Charles se concilia l’estime des Français. Le comte de Marbeuf surtout le traita toujours avec une bienveillance toute particulière. Ses talents, ses manières, sa position sociale et la haute réputation dont il jouissait lui valurent cette flatteuse distinction. Charles ne pouvait pas être insensible à tant d’égards ; il paya de retour le gouverneur français. On a pris texte de cette cette liaison pour répandre les calomnies les plus absurdes : un simple rapprochement des dates suffit pour en faire justice.
Charles Bonaparte, qui aimait le luxe et la représentation, dépensait parfois au delà de ses revenus. Cependant sa famille devenait chaque jour plus nombreuse, et, comme s’il en pressentait déjà la grandeur future, il se proposait de donner une éducation soignée à tous ses enfants. Prêt à s’imposer tous les sacrifices possibles pour atteindre un but si légitime, et si sage, il songeait sérieusement à envoyer dans des établissements d’instruction publique l’aîné et le cadet de ses fils, qui étaient assez avancés en âge pour commencer régulièrement leurs classes. Ce fut alors que Marbeuf voulut lui donner une preuve certaine de l’attachement qu’il lui avait voué. Il lui suggéra l’idée de faire des démarches afin d’obtenir les bourses du gouvernement pour Joseph et pour Napoléon. Il appuya lui-même fortement sa demande, et les bourses furent accordées.
Charles avait toujours espéré pouvoir améliorer sa fortune par la revendication de la succession Odone, qui lui était dévolue et dont on avait injustement disposé en faveur des Jésuites. Il avait fait plusieurs réclamations, du temps de Paoli, mais toujours sans succès. Après la conquête de l’ïle, qui entraîna l’explusion des jésuites, ces biens furent affectés à l’instruction publique. Charles renouvela ses réclamations qui ne furent pas plus heureuses. Comme il l’a dit lui-même, il continua de s’épuiser en démarches inutiles.
En 1777, Charles fut nommé député de la noblesse pour aller à Paris. Il passa par Florence, où il obtint une lettre du Grand-duc Léopold pour la reine de France, sa soeur. Cette recommandation lui valut l’honneur d’être admis à la cour et un libre accès au ministère. Monseigneur Santini, qui, par son rang aurait dû conduire la députation corse, se trouva en seconde ligne. Il eut le bon esprit de ne pas s’en fâcher.
Charles profita de la faveur dont il jouissait pour faire de nouvelles démarches au sujet de la succession Odone. Il présenta au ministère de la guerre un mémoire détaillé sur les droits qu’il avait à cette succession. Des ordres précis furent donnés ; il aurait obtenu enfin la justice qu’il réclamait depuis longtemps, sans les difficultés que lui suscitèrent en Corse quelques fonctionnaires intéressés personnellement à faire éliminer sa demande.
Dans cette intervalle, les premiers symptômes de la maladie qui devait conduire au tombeau Charles Bonaparte se déclarèrent. Il se rendit à Montpellier pour consulter la faculté de médecine et revint à Paris mieux portant, ce qui lui fit croire qu’il était sauvé. Vaine espérance qui devait bientôt être détruite !
Ce fut pareillement à cette époque que Charles acquis de nouveaux titres à la bienveilance du Comte de Marbeuf. Des mésintelligences existaient entre ce dernier et le comte de Narbonne. Les Corses, dont la destinée se ressentira toujours des caprices, des haines et des vengeances mutuelles de leurs chefs, étaient partagés entre deux factions ; car ils ignoraient alors, comme ils semblent ignorer encore aujourd’hui, que ce qu’ils ont de mieux à faire, c’est de demeurer étrangers aux démélés de leurs gouvernants, d’avoir autant de respects pour les lois que de mépris pour ceux qui les foulent aux pieds et les font servir à leurs mauvaises passions.
Les choses en étaient au point que la cour jugea à propos de rappeler l’un des deux ; mais elle aurait voulu rappeler celui qui avait le plus de torts à se reprocher, et qui, dans tous les cas, était le moins agréable aux Corses. Charles fut consulté, et le rappel de Narbonne arrêté. En cela Charles ne fut que l’interprète des sentiments bien prononcés de ses commettants, qui, tous, ou presque tous, préféraient les manières affables, insinuantes et populaire de Marbeuf, aux manières franches, loyales si l’on veut, mais rudes et hautaines de Narbonne.
Cependant, si celui-ci avait un faible parti en Corse, il en avait en revanche un bien puissant à la cour : Marbeuf, qui le savait, s’attendait à lui être sacrifié. Victorieux, il sentit toute l’étendue de l’obligation qu’il avait envers celui qui le faisait triompher d’un rival redoutable. La famille de Marbeuf lui fut dès ce moment très attachée, et trouva plus d’une fois l’occasion de lui être agréable.
L’archevèque de Lyon lui écrivit pour le remercier de ce qu’il avait fait en faveur de son oncle et lui envoya en même temps une lettre de recommandation pour M. de Brienne, sachant qu’il avait un de ses enfans à l’Ecole militaire de Brienne. Cette recommandation fut très utile à Napoléon, puisque la famille Brienne eut pour lui un attachement tout particulier : elle ne contribua pas peu à le faire remarquer de bonne heure aux inspecteurs, qui tous les ans visitaient l’école.
Les relations de la famille Bonaparte avec la famille Marbeuf furent dès lors plus intimes, plus amicales. Ceux qui ne voient les choses que de loin, ou se soucient fort peu de les voir de près, font remonter cette intimité à une époque à laquelle ces deux familles ne se connaissaient nullement, et se trouvaient d’ailleurs, par leurs positions respectives, placées dans des rangs opposés. Napoléon disait lui-même dans son exil, sur le rocher de Sainte-Hélène, que c’était de cette époque que daitait la bienveillance des familles Marbeuf et Brienne envers les enfants Bonaparte.
Charles fut obligé de rentrer en Corse plus tôt qu’il n’aurait désiré, la maladie dont il était atteint faisaint des progrès effrayants sous le ciel de Paris. Les médecins qu’il consulta pour la seconde fois, lui conseillèrent de rentrer au plus vite chez lui ; l’air natal pouvait seul lui apporter quelque soulagement. Il ramena avec lui Joseph, qui était placé dans le séminaire d’Autun, et pour lequel il venait d’obtenir une place à l’école militaire de Metz. Napoléon qui l’attendait à Brienne, en fut d’abord désolé ; mais il ne s’en plaignit point et fut au contraire satisfait du prompt retour de son père à Ajaccio, dès qu’il sut que l’état de sa santé l’avait empêché de venir le voir à Brienne, comme il le lui avait promis.
Quoique Charles fût après son retour lié plus que jamais au comte de Marbeuf, aussi puissant en Corse qu’il l’était à la cour, il ne cessa d’éprouver des désagréments de la part des créatures du comte de Narbonne, qui ne pouvaient lui pardonner la préférence qu’il avait accordé au premier. Ils lui suscitaient toute sorte de difficultés pour le faire échouer dans la revendication des biens de la succession Odone. Ils étaient d’autant plus à craindre, qu’étant du continent, ils avaient tous des patrons à Paris, qui les soutenaient en dépit des réclamations les plus vives et les plus fondées.
Voyant enfin qu’il ne pouvait pas venir à bout de surmonter les obstacles qu’une chicane déloyale élevait sans cesse contre lui, il se détermina, pour en finir, à demander à bail emphytéotique une portion des biens de la succession Odone. Cette demande parut d’abord déjouer les intrigues et les cabales de ses ennemis ; mais elle fut bientôt paralysée par les retards que la mauvaise volonté mit à en règler la redevance.
Toutes ces tracasseries incitèrent Charles à partir pour Paris, et à porter lui-même ses réclamations au ministère, au pied du trône s’il le fallait. La traversée fut pénible, sa maladie s’éveilla tout à coup, s’annonçant avec des symptômes alarmants. Il fut obligé de s’arrèter à Montpellier, mais il se hâta, quoique dangereusement malade, d’adresser au ministère un Mémoire contenant ses griefs.
Ce Mémoire, fait pour ainsi dire au lit de mort, ne sera pas tout à fait indifférent pour ceux qui attachent un certain intérêt à connaître le père de Napoléon.
MEMOIRE : Pour régler la redevance du bail elmphytéotique de la campagne dite Les Milelli, et la maison La Badine, appartenant autrefois aux Jésuites d’Ajaccio en Corse.
Monseigneur, Charles de Bonaparte, d’Ajaccio en Corse, a l’honneur de vous représenter qu’ayant été prévenu par une lettre de l’Intendance du 12 novembre dernier qu’il vous avait plu d’ordonner une expertise des biens ci-dessus demandés par le suppliant en bail emphytéotique, il attendait d’en être instruit par le sieur Souiris, économe sequestre et subdélégué de monsieur l’Intendant ; mais voyant que, malgré les ordres reçus, le sieur Souiris observait le plus profond silence pour conserver le plus longtemps possible la possession et jouissance des biens dont il se regarde comme propriétaire depuis tant d’années, il prit le parti de lui présenter une requête de la teneur suivante :A monsieur Souiris, économe des bien de l’Instruction publique et subdélégué de la juridiction d’Ajaccio.
Monsieur, Charles de Buonaparte a l’honneur de vous représenter que, depuis l’année 1779, il présenta un Mémoire au ministère de la guerre, en lui exposant qu’il était le seul héritier de Virginie Odone ; que ladite Virginie, ses enfants et héritiers, étaient appelés à la succession de Pierre Odone, son père, qui par son testament avait substitué tous ses biens à ladite Virginie, sa fille, et à ses enfants, au cas que Paul-Emile, son fils, vint à mourir sans enfants, ou que les enfants nés du dit Paul-Emile mourussent eux-même sans laisser de postérité ; que le cas prévu par le testament était arrivé ; que Paul-François Odone, méconnaissant le droit de la nature; enivré d’un faux principe de religion, avait donné aux Jésuites d’Ajaccio les biens grévés de la dite substitution fidéi-commissaire, dévolus de toute justice à la famille Bonaparte ;
Que la prise de possession faite par les Jésuites dénotait assez les biens considérables dont la dite famille avait été privée ; que l’Instruction publique était à la vérité censée propriétaire des dits biens, mais que l’utilité d’une pareille destination ne pouvait pas couvrir le vice de son titre ;
Que pour éviter les suites toujours funestes d’un procès en justice réglées vis-à-vis des économes qui plaideraient aux frais de l’Instruction, il s’était borné à demander une indemnité proportionnée à sa privation, justifiée par les titres qu’il avait produits ;
Que Monseigneur le prince de Montbarey avait renvoyé la requête et les titres aux commissaires du roi en Corse, et qu’après trois années de débats avec l’économe général, le suppliant, pour voir la fin de ses démarches, s’était restreint, du consentement de monsieur l’Intendant, à demander la préférence d’un bail emphytéotique de la campagne dite de Milelli, et de la maison La Badine, moyennant une légère redevance ;
Que monsieur l’Intendant, en 1782, avait formé son rapport, et que finalement il vous avait plu, Monseigneur, d’accorder au suppliant, par préférence, le bail emphytéotiquedes biens dont il s’agit, vous réservant d’en fixer la redevance après en avoir reconnu la valeur ; que le remontrant vous avait réitéré ses instances pour obtenir la jouissance provisoire, afin de procéder aux réparations urgentes, mais que monsieur le Changeur subdélégué général venait de lui faire part qu’il vous avait plu de décider qu’il était plus expédient de le mettre en possession des dits biens, que d’en accorder la jouissance provisoire ; que vous aviez autorisé à cet effet monsieur l’Intendant à faire procéder à l’estimation, le chargeant de faire terminer cette opération le plus promptement possible ;
Qu’il paraîssait nécessaire de faire procéder par des experts publics à l’estimation des biens fonds, en faisant détailler leur état, soit par rapport aux deux maisons délabrées et menaçant ruine, soit par rapport à la campagne, qui était exposée aux incursions des bestiaux et remplie de makis de toutes parts ; comme aussi de faire procéder à la liquidation des fruits et revenus, année commune, déduction faite des frais de culture et entretien, qui absorbent la meilleure partie du revenu ;
D’avoir égard au défaut du moulin à huile de la dite campagne, qui a été aliéné et qui occasionnera une dépense de deux mille livres pour en faire venir un de Marseille, comme aussi que les maisons sont presque sans portes, sans fenètres, san planchers, et sans crépissage ;
Qu’il est nécessaire, eu égard à la situation des biens, d’achever cette opération le plus promptement possible, pour mettre le suppliant à portée de recueillir le fruit de la justice que vous aviez eu la bonté, Monseigneur, de lui rendre et qu’il espérait obtenir complète au moyen d’une redevance légère et proportionnée aux privations dont sa famille avait été la victime ;
Finalement, il le priait de joindre la requête au procès-verbal d’expertise, pour qu’il pût en prendre une copie légale et en faire part au ministère ;
Que cette requête, Monseigneur, au lieu de produire l’effet qu’on devait en attendre, décida le sieur Souiris à s’acharner plus fortement contre le suppliant, qui s’est épuisé en démarches inutiles pour parvenir à faire exécuter votre volonté ;
Qu’enfin les experts nommés, le sieur Souiris, jouant le rôle de juge et partie, ne voulut point des experts publics, mais il nomma le médecin Grecque, son intime ami, auquel il délivra une instruction secrète sur la manière dont on devait rédiger l’expertise, afin de n’être jamais d’accord ;
Que les experts n’ayant pas été d’accord, le suppliant laissa au sieur Souiris le choix du troisième, pourvu qu’il fût pris parmi les gens du métier ; mais il répondit qu’il fallait en écrire à Bastia au subdélégué général. Cette réponse de Bastia ne venait jamais, et à force de réclamations, le sieur Changeur nomma pour troisième le sieur Frère, géomètre du terier, absent d’Ajaccio.
Le suppliant, voyant alors qu’il était joué de toute part, se décidé à s’embarquer pour venir à Paris se jeter à vos pieds, et il a eu le malheur de tomber malade dans la traversée de la mer, et d’être obligé de s’arrêter à Montpellier pour le rétablissement de sa santé.
Il s’est efforcé de vous adresser le présent Mémoire, parce qu’il est persuadé qu’aussitôt qu’on aura su qu’il est tombé malade, on fera achever l’opération au gré du sieur Souiris, qui espère que les biens finiront pas lui être adjugés, si on règle une redevance au delà du produit.
Ce Mémoire produisit son effet. Le ministère ordonna que l’exposant fût mis en possession des biens réclamés ; mais Charles n’existait plus lorsque cet ordre fut mis à exécution par ses ennemis : il était mort à Montpellier d’un squirre à l’estomac, cause de ses souffrances depuis plusieurs années.
Joseph, que Charles avait amené avec lui pour le conduire à Metz, fut le seul qui l’assista dans ses derniers moments. Son beau-frère, l’abbé Fesch, accouru à son secours du séminaire d’Aix, n’arriva que pour pleurer avec Joseph sur son cerceuil. Pendant son agonie, Charles appelait souvent napoléon, son fils, le conjurant d’aller à son secours avec sa grande épée.
Après lui avoir rendu les derniers devoirs, Fesch revint à Aix, Joseph rentra en Corse. Napoléon reçut la fatale nouvelle à Paris, où il avait été transféré par les inspecteurs, qui avait apprécié de bonne heure ses talents et son génie. Lorsque sa douleur fut un peu calmée, il écrivit à son oncle l’archidiacre Lucien, et à sa mère les deux lettres suivantes.
Paris, le 28 mars 1785
Mon cher oncle,
Il serait inutile de vous exprimer combien j’ai été sensible au malheur qui vient de nous arriver. Nous avons perdu en lui un père, et Dieu sait quel était ce père, sa tendresse, son attachement ; hélas ! tout nous désignait en lui le soutien de notre jeunesse. Vous avez perdu en lui un neveu obéissant, reconnaissant… ah ! mieux que moi vous sentez combien il vous aimait. La patrie même, j’ose le dire, a perdu par sa mort un citoyen zélé, éclairé et désintéressé. Cette dignité dont il a été plusieurs fois honoré marque assez la confiance qu’avaient en lui ses concitoyens. Et cependant le ciel l’a fait mourir ; en quel endroit ? à cent lieues de son pays, dans une contrée étrangère, indifférente à son existence, éloigné de ce qu’il avait de plus précieux. Un fils, il est vrai, l’a assisté dans ce moment terrible ; ce dut petre pour lui une consolation bien grande, mais certainement pas comparable à la triste joie qu’il aurait éprouvée s’il avait terminé sa carrière dans sa maison, près de son épouse et au sein de sa famille. Mais l’Être Suprême ne l’a pas ainsi permis : sa volonté est immuable, lui seul peut nous consoler. Hélas ! du moins, s’il nous a privé de ce que nous avions de plus cher, il nous a encore laissé les personnes qui seules peuvent le remplacer.
Daignez donc nous tenir lieu du père que nous avons perdu. Notre attachement, notre reconnaissance seront proportionnés à un service si grand. je finis en vous souhaitant une santé semblable à la mienne.
Votre très humble et très-obéissant serviteur et neveu.
NAPOLEONE DE BUONAPARTE
Paris, le 29 mars 1785
Ma chère mère,
C’est aujourd’hui, que le temps a un peu calmé les premiers transports de ma douleur, que je m’empresse de vous témoigner la reconnaissance que m’inspirent les bontés que vous avez toujours eues pour nous. Consolez-vous, ma chère mère ; les circonstances l’exigent. Nous redoublerons nos soins et notre reconnaissance, et heureux si nous pouvons, par notre obéissance, vous dédommager un peu de l’instimable perte d’un époux chéri. Je termine, ma chère mère ; ma douleur me l’ordonne, en vous priant de calmer la vôtre. Ma santé est parfaite et je prie tous les jours que le ciel vous en gratifie d’une semblable. Présentez mes respects à Zia Geltrude, Minana Saveria, Minana Fesch, etc.
PS : La reine de France est accouchée d’un prince, nommé le duc de Normandie, le 27 mars, à 7 heures du soir.
Votre très humble et affectionné fils,
NAPOLEONE DE BUONAPARTE
Charles méritait bien les regrets de son fils; il emportait ceux de ses concitoyens et de tous ceux qui l’avaient connu. Il était bon patriote, bon époux, excellent père, loyal, franc et sincère ami. Il ne laissa pas à ses enfants une grande fortune, mais il leur léguait en revanche une réputaiton pure et intacte. Sa passion pour la dépense avait sans doute un peu dérangé ses affaires, mais elle ne l’avait pas ruiné comme on a osé le dire.
Madame Bonaparte sentit plus que personne la perte qu’elle avait faite. Sa douleur fut extrême ; cependant elle n’oublia pas qu’elle était la mère d’une nombreuse famille, qu’elle se devait tout entière à ses enfants. Ses larmes coulèrent longtemps, mais son parti fut bientôt pris. Quoique à la fleur de l’âge, elle avait donné donné le jour à treize enfants, dont cinq garçons et trois filles avaient survécu. Jérôme était encore au berceau.
Le monde n’eut plus de charmes pour elle ; le souvenir de son époux et l’éducation de ses enfants remplirent toute son existence. Elle vécut dans la retraite et n’eut d’autres soins que le retablissement de ses affaires domestiques. Son guide, son appui, son soutien, c’était l’archidiacre Bonaparte, son oncle. Ce respectable vieillard s’était dessaisi depuis plusieurs années de l’administration des affaires de la famille pour se livrer entièrement à son ministère ; mais, dans une telle conjoncture, il n’hésita pas à en reprendre le fardeau. La maison Bonaparte ne tarda pas à se ressentir de l’habilité de la main qui la dirigeait.
Une bonne partie de la fortune de la famille Bonaparte se composait de gros et menu bétail ; l’autre de vignes, enclos et maisons. Les colons, bergers, les locataires, furent mandés ; l’archidiacre prit connaissance de tout et rétablit le plus grand ordre dans ces affaires.
Madame Bonaparte trouva dans les soins affectueux de son oncle un adoucissement à ses chagrins. La mort, qui avait empoisonné sa vie en moissonnant trop tôt celle de son mari, respecta aussi longtemps qu’il fallait les jours de son mentor. Lorsqu’il descendit dans la tombe, ses larmes coulèrent à nouveau, son coeur saigna encore, sa situation de fortune singulièrement améliorée : elle se résigna et attendit.
juillet 24, 2007
CHARLES BONAPARTE PAR NASICA (1)
Ecrite entre 1821 et 1829 (mais publiée qu’en 1852), cette Notice sur la vie de Charles Bonaparte père de Napoléon 1er est la première ébauche de « biographie » réalisée sur le géniteur du plus célèbre personnage de l’Histoire. Elle est proposée dans l’ouvrage de Tomaso Nasica : Mémoire sur l’enfance et la jeunesse de Napoléon 1er. Ce petit livre est désormais quasi introuvable et présente un certain intérêt de par la proximité temporelle de son auteur avec les contemporains de Charles Bonaparte. Cependant il ne peut être considéré comme une source totalement fiable. La légende hagiographique teintée de naiveté l’emporte sur les aspects scientifiques par trop absents de l’ouvrage. Malgré ses défauts, ce récit bien écrit, fort agréable à lire, est assez instructif si l’on sait le manier avec précautions.
Charles Bonaparte et sa famille avant la conquête de la Corse par la France (1769).
Les Bonaparte étaient considérés comme une des familles les plus distinguées d‘Ajaccio à l’époque où Charles Bonaparte, père de Napoléon, attira sur lui l’attention de ses concitoyens par ses qualités morales et par ses talents. Né en 1746, il commencça ses études à Corte et se fit remarquer par son intelligence, sa modestie, et son amour du travail. Privée de tout établissement scientifique par les Génois, dont l’esprit ombrageux redoutait les effets de l’éducation sur un peuple qui supportait déjà si impatiemment leur joug, la Corse envoyait les plus nobles de ses enfants faire leurs études en Italie. La proximité de la ville de Pise, et peut être aussi la sympathie douloureuse que font naître entre les peuples des infortunes qui se ressemblent, attiraient les Corses vers l’Université célèbre qui avait fondée Côsme de Medicis. Pise était alors l’Athènes de la péninsule italienne. Comme la célèbre ville grecque, elle gisait à demi morte sous ses marbres, au milieu des restes magnifiques d’une grandeur qui n’était plus. La fameuse république de Pise, qui avait subjugué la Sardaigne, pris Carthage et enlevé Palerme aux Sarrasins, qui avait défait des armées royales en bataille rangée, et envoyé une flotte de quarante vaisseaux au secours d’Amaury, roi de Jérusalem ; Pise enfin, qui avait fait longtemps avec succès la guerre aux Génois, ces ennemis mortels et détestés des Corses, avait fini par être vendue et livrée. Les Pisans avaient tellement pris à coeur la perte de leur liberté qu’ils s’étaient expatriés de colère ; aussi cette pauvre cité se trouvait-elle si dépeuplée à l’époque dont nous parlons, que l’herbe croissait dans ses larges rues. Tel était à peu près le sort que la Corse avait eu elle-même à subir.
C’est donc à Pise que Charles Bonaparte fut envoyé pour terminer ses études. Il trouva sur les bords de l’Arno l’élite de la jeunesse corse, jeunesse impétueuse et fière qui sympathisait avec celle de Pise et qui avait acquis, au contact des douces moeurs italiennes, ce poli d’urbanité qu’on ne trouve aisément dans les montagnes.
Ces pauvres insulaires, forcément économes, vivaient de peu dans une ville où tout était bon marché, et quelquefois éprouvaient, malgré cela, des moments de gêne. Mais lorsque les galions de quelques étudiants arrivaient, comme disait plaisamment l’Empereur en parlant de quelques cent francs que Junot recevait de sa famille, l’heureux possesseur du petit trésor se hâtait d’en faire part à ceux qui attendaient encore cette pluie d’or qui devait venir des rives de la Corse, et Charles Bonaparte n’était pas de caractère à poser en exception à la règle. Au contraire, il ouvrait si largement sa bourse à ses condisciples dans l’embarras, qu’il s’acquit bientôt l’estime et l’amitié de cette jeunesse studieuse et désintéressée qui serrait ses rangs sur la terre de l’étranger. A leur retour du continent, les amis de Charles, disséminés sur tous les points de l’île, le vantaient comme un savant distingué, un ami généreux, un étudiant modèle, et jetaient ainsi les premières bases de sa réputation naissante.
Sa famille, heureuse du bien qu’elle entendait dire, ne regardait pas aux sacrifices qu’elle faisait pour l’entretenir sur le continent, quoique ces sacrifices fussent onéreux dans une île qui a toujours été fort pauvre en numéraire.
Lorsque Charles Bonaparte eut terminé son droit, il fit ses dispositions pour retourner dans sa patrie. De l’embouchure de l’Arno, et tandis que les molles brises de la Toscane l’embaumaient encore du parfum de leurs orangers, il découvrit au loin sous la forme d’un rocher nu, dont la cime blanchie de neige se dessinait sur l’azur profond de la Méditérranée. Le jeune Corse, qui avait quelquefois sacrifié aux muses, dut alors éprouver ce sentiment louable et si naturel qui faisait dire au fils d’Ulysse : « Dans mon Ithaque, il n’y a que des rochers, des buyères, des terres arides, et pourtant mon coeur la préfère aux plus riches plaines de Grèce. »
Précédé de sa bonne renommée, regardé comme l’honneur de sa famille et l’espoir de sa patrie, Charles reçut de ses concitoyens un accueil empressé. Son éloquence, son patriotisme, ses manières nobles et simples achevèrent de lui concilier tous les coeurs . Enfin, l’estime dont on l’entourait devint si générale qu’elle fixa les regards de Paoli, qui voulut que le jeune Bonaparte lui fût présenté.
Paoli, dont la mémoire est encore adorée des Corses, était alors à l’apogée de sa puissance et règnait de fait sur ce peuple qu’on disait si difficile à gouverner. Fils de Giacinto Paoli qui avait commandé les Corses dans les dernières guerres contre les Génois ; frère de Clément paoli, l’homme le plus brave de son temps et l’un des premiers magistrats de l’île, Pascal Paoli avait été proclamé général de la Corse et rappelé de Naples, où il servait avec distinction. Courageux, éclairé, politique habile, mettant toute sa gloire à sauver sa patrie et à la rendre heureuse, il marchait noblement vers ce grand but. Après avoir battu les génois, il avait profité du calme qui suivit sa victoire pour réorganiser sa justice et faire fleurir l’agriculture. Investi par la nation d’un pouvoir absolu, il l’avait balancé lui-même en créant un conseil suprème composé d’hommes très capables, et, au dessus- de ce conseil, il avait établi un syndicat chargé de surveiller tous les magistrats de l’ïle, sans faire d’exception pour lui. Afin d’occuper Gênes de ses propres affaires, il avait armé en course des bâtiments légers qui poursuivaient le long des côtes de la Ligurie des navires marchands de la république. Ces corsaires, par des prises heureuses qu’ils ramenaient en Corse, faisaient reparaître l’argent dans ce pays que des siècles de guerre avaient épuisé. Paoli battait monnaie, fondait une Université, créait des imprimeries, et, chose qui ne s’était jamais vue, ont eut alors un journal en Corse. Paoli, quoique partisan rigide des moeurs austères et simples de sa nation, voulut la distraire un instant des graves préoccupations de la guerre, en donnant des fêtes auxquelles il conviait les personnes les plus éminentes de l’île ; il se faisait ainsi une sorte de cour, et ce luxe inusité enchantait les Corses.
C’est à cette époque que Charles Bonaparte, encore fort jeune, lui fut présenté. Le général, qui se connaissait en hommes et qui cherchait à s’entourer de gens de coeur, le traita avec tant d’égards que Charles conçut pour lui un vif attachement, une admiration sincère qu’il conserva jusqu’au tombeau. Si l’état de sa fortune le lui eût permis, il fût resté auprès du général ; mais sa famile exigea qu’il utilisât dans sa ville natale les connaissances qu’il avait acquises en Italie, et il devint bientôt un des premiers avocats d’Ajaccio.
Les talents et les qualités de Charles Bonaparte lui permettaient d’aspirer aux plus hauts partis, et sa famille, dont il était l’unique espoir, eût vivement désiré qu’il fit un mariage opulent. Charles n’entra pas dans ces vues et ne consulta que son coeur, en enlevant à l’admiration passionnée de toute la jeunesse de la ville, mademoiselle Letizia Ramolino, qui était d’une rare beauté, et qui à peine âgée de quatorze ans, possédait tous les charmes de son sexe.
La première année de se son mariage ne fut marquée que par un événement bien triste : il perdit son premier enfant. L’année suivante, il voulut mettre à exécution un projet qu’il avait conçu pendant son séjour à Pise ; il partit pour Rome afin de visiter la patrie des Scipions, des Césars, et de se perfectionner dans la science si difficile des lois anciennes.
Il y passa une année scolaire et revint en Corse, peu satisfait de Rome et des Romains.
Il débarqua à bastia, et, en traversant l’ïle pour se rendre à Ajaccio, il voulut voir Paoli qui était alors à l’abbaye de Rostino, dont le général aimait le séjour parce qu’il était né pour ainsi dire à l’ombre de son clocher. Le jeune voyageur traversa Pontenovo qui devait être le dernier champ de bataille de l’indépendance, gravit la montagne du village de Pastoreccia où était née la mère du général et dont quelques bois d’oliviers faisaient partie de son patrimoine. Sur le versant opposé, il découvrit bientôt, dans le petit hameau de la Stretta dépendant de la commune de Morosaglia, la maison paternelle de Paoli, qu’entouraient des châtaigniers gigantesques et qu’accompagnait une petite chapelle dédiée à a Madone. Non loin de cette modeste maison du chef de la Corse, s’élevait le superbe monastère des Franciscains où se rendait Charles. Lorsqu’il demanda Paoli, on l’introduisit dans son salon en le priant d’attendre, le général étant enfermé dans on cabinet où il s’occupait de quelques dépêches importantes qu’il allait faire partir pour l’Italie. « Je reviendrai quand il sera visible » dit le jeune Corse qui se mit en devoir de se retirer. Mais à ce moment la porte du cabinet s’ouvre, et Paoli paraissant sur le seuil, s’écrie : « c’est toi Charles ? Je t’ai bien reconnu , viens donc que je t’embrasse. » Et, sans écouter les excuses du voyageur qui craignait de le déranger : « Tu n’es pas de trop ici, dit-il en le faisant entrer dans son cabinet ; au contraire, tu arrives de l’Italie et j’ai besoin de savoir ce qui s’y passe ; viens donc. » Il le garda toute la journée, le fit souper avec lui et ne lui laissa reprendre sa route que le lendemain, après lui avoir fait promettre de quitter Ajaccio pour s’établir à Corte, ville centrale, où le général avait fixé le siège de son gouvernement.
Cette promesse, que Charles Bonaparte voulut tenir, souleva une petite tempête au sein de sa famille. Madame Bonaparte, dont les parents habitaient la ville maritime qu’il fallait quitter, refusa d’abord d’échanger les brumes de la côte, et surtout le doux parfum des orangers d’Ajaccio, pour l’air vif et pur des montagnes, alléguant pour gagner sa cause toutes les raisons que put lui suggérer sa logique de dix-sept ans. Mais quelques touchantes que fussent les prières d’une femme aimée et d’un oncle vénéré à l’égal d’un père, elles ne pouvaient balancer dans le coeur d’un Corse l’influence irresistible de Paoli ; Charles se rendit suel à Corte, conformément à sa promesse, et sa jeune femme ne tarda pas à l’y rejoindre.
A Corte, Charles se révéla sous un nouveau jour : à son économie primitive succéda l’amour du faste et de la dépense ; ses relations s’étendirent sur toute l’ïle, où il s’acquit bientôt une grande popularité, et il se posa en homme politique. Son caractère ardent, son éloquence passionnée, son instruction et sa connaissance des lois le firent rechercher par les principaux personnages de l’Etat. Il était admis dans la confidence de tous les secrets de la nation ; ses avis étaient écoutés, et, sans avoir de place ostensible dans le gouvernement, il exerçait une véritable influence sur la conduite des affaires.
Cerpendant la situation de la Corse devint bientôt très alarmante. Dès l’an 1764, les français, appelés par la république de Gênes, étaient débarqués en Corse sous les ordres du Comte de Marbeuf et s’étaient mis en possession des lieux que les Génois possédaient encore sur le littoral. Cette occupation française avait inquiété Paoli ; mais déguisant habilement ses alarmes, il était demeuré en bons termes avec les nouvelles garnisons, tout en continuant de faire la guerre aux Génois. Pendant près de quatre ans, les Français se bornèrent au simple rôle de spectateurs. Mais ensuite la république de Gênes, à bout d’efforts, céda au roi de France ses prétendus droits sur cette île, à condition qu’elle pourrait la reprendre, après la conquête, en payant les frais de l’expédition.
Lorsque cette effrayante nouvelle arriva aux oreilles des Corses, un cri de fureur s’éleva d’un bout de l’île à l’autre. Paoli, qui n’osait assumer la responsabilité d’une guerre si périlleuse, convoqua les députés des communes à Corte afin de connaître, disait-il, le voeu de la nation.
Charles Bonaparte assista à cette consulte extraordinaire, et, après le discours de Paoli qui en était le président, il prit la parole et s’exprima en ces termes :
« Vaillante jeunesse corse !
Toutes les nations qui ont aspiré à la conquête de la liberté ont été exposées aux grandes vicissitudes qui déterminent le triomphe des peuples. Il y en a eu de moins vaillantes, de moins puissantes que nous ; cependant à force de constance elles ont atteint le grand but qu’elles se proposaient.
Si le désir suffisait pour obtenir la liberté, tout le monde serait libre : mais il faut pour cela une vertu persévérante, supérieure à tous les obstacles, qui ne se nourrit point d’apparence, mais de réalité. Cette vertu, il n’est que trop vrai, se trouve rarement parmi les hommes ; aussi ceux qui la possèdent sont-ils considérés comme des demi-dieux.
Les droits et la condition d’un peuple libre sont trop inappréciables pour qu’on puisse en parler d’une manière digne de leur importance. Je me borne donc à vous rappeler qu’ils excitent l’envie et l’admiration des plus grands hommes de l’univers.
Je voudrais me tromper, mais je crois que la plupart de ceux qui se préparent à nous attaquer ne veulent qu’effacer de la carte une nation qui, ayant le coeur plus grand que sa fortune, semble reprocher à l’Europe son insouciance, et lui rendre plus sensible la honte de s’endormir au bruit de ses chaînes.
Vaillante jeunesse, voici le moment décisif. Si nous ne triomphons de la tempête qui nous menace, c’en est fait tout à la fois de notre nom et de notre gloire. En vain aurions-nous montré jusqu’ici des sentiments d’héroïsme ; en vain nos pères auraient combattu pour la liberté et nous l’auraient transmise au prix de leur sang : tout serait perdu… Mais non ! ombres honorées de tant de braves, qui siégez au temple immortel de la gloire, ne craigniez pas d’avoir à rougir : vos enfants ont hérité de votre courage et de vos vertus. ils sont inébranlables dans la résolution de suivre votre exemple ; ils seront libres, ou ils sauront mourir !
Si nous en croyons nos ennemis, nous aurons à combattre les troupes françaises. Nous ne pouvons nous persuader que le roi Très-Chrétien, qui a été médiateur entre nous et les Génois, qui connaît la justice et nos griefs, veuille maintenant épouser la querelle de la république pour exterminer un peuple qui a toujours espéré en sa puissante protection. Mais enfin, s’il est arrêté dans le livre des destins que le plus grand monarque du monde doive se mesurer avec le plus petit peuple de la terre, nous ne pouvons être que fiers. Nous sommes, dans ce cas, certains de vivre avec honneur ou de mourir avec gloire.
Quand à ceux qui manquent de courage pour affronter le trépas, qu’ils ne s’inquiètent point ; ce n’est pas eux que l’on parle : c’est aux hommes de coeur, c’est aux vrais braves. Oui, jeunes Corses, c’est à vous que la patrie s’adresse ; c’est à vous de vous montrer dignes de vous-mêmes, digne du nom que vous portez.
On prétend que des armées étrangères viennent courir les chances de la guerre, pour protéger les intérêts et soutenir les injustes prétentions de la République ; et nous, qui combattons pour nos propres intérêts, pour nos personnes, pour nos enfants; nous, qui avons le nom et la gloire de nos pères à défendre, pourrions-nous balancer un moment à exposer notre vie ?
Chacun est persuadé, valeureuse jeunesse, que votre courage ne vous permettrait pas de survivre à la perte de la liberté. Surpassez donc par votre promptitude l’attente générale, et apprenez à nos enenmis qu’il n’est pas si aisé d’accomplir leurs criminels desseins.
Vivez heureux pour la patrie et pour vous-mêmes. »
Ce discours électrisa l’assemblée, et l’entraîna, par un mouvement unanime et spontané, à accepter la guerre contre la France.
Il arriva ce qui était facile à prévoir : accablés par le nombre, n’ayant pas même d’artillerie pour pouvoir défendre avec des chances de succès leurs gros villages ainsi que les défilés de leurs montagnes, les corses furent vaincus ; mais ils ne le furent pas sans gloire. Ils disputèrent leur île hameau à hameau, rocher à rocher, tuant aux français le plus de monde qu’il était possible avec leurs misérables munitions ; enlevant quelquefois des régiments entiers et forçant, à l’affaire de Borgo, une grosse garnison française à capituler ; ils firent enfin, sous les ordres de Clément Paoli, l’Achille de cette courte et sanglante Iliade, de vrais prodiges de valeur. Les français ne revenaient pas de leur étonnement en se voyant aux prises avec ces hommes qui, éprouvés par des siècles de lutte et quoiqu’étrangers aux leçons de la stratégie, connaissaient parfaitement toutes les ruses de la guerre. Ces patriotes intrépides, après avoir invoqué à genoux Dieu et la Sainte Vierge, s’élançaient contre eux au bruit de leurs conques marines, en poussant des cris aigus, et visaient avec une si terrible justesse qu’une foule d’officiers de marque tombaient sous les balles de leurs carabines. C’était quelque chose de touchant que l’abnégation héroïque de ce pauvre peuple qui, manquant de tout, hors de courage, pour se défendre, n’avait pas même d’ambulances pour recueillir ses blessés.
Charles Bonaparte avait payé de sa personne dans cette guerre de l’indépendance. Après la défaite de Pontenovo, qui frappa au coeur la nationalité insulaire, il fut d’avis de tenter encore la fortune des combats. On pouvait en effet continuer à opposer une vive resistance aux troupes d’invasion. Il n’était pas difficile de rallier à Corte les débris des patriotes. Dans cette ville et dans les pièves des alentours, on brûlait de reprendre l’offensive, et le comte Vaux se trouvait constamment harcelé par d’infatigable tirailleurs. Dans la Balagne, on luttait avec énergie contre de Lucker et le marquis d’Arcambal, qui avait plus de quatre mille hommes sous leurs ordres. Jacques-Pierre Abbatucci, Jules Foata, le curé de Guagno, et d’autres chefs aussi intelligents que braves, tenaient vigoureusement en échec, dans le pays d’outre-monts, les nombreux soldats que commandait Narbonne. Tout n’était donc pas perdu pour la Corse : tant de ressources habilement employées, devait au moins en retarder la conquête. Telle était l’opinion de Charles ; mais Paoli appréciait autrement l’état des choses. Dans sa sagesse, il crut devoir épargner de nouveaux malheurs à ses concitoyens : il prit la douloureuse résolution de cesser la lutte et de s’éloigner.
Dès lors, le projet de défendre Corte fut abandonné ; et quand on apprit que les Français avançaient pour s’en emparer, une foule de familles de distinction, qui s’étaient réunies dans ce dernier sanctuaire de la liberté, se réfugièrent sur le Monte Rotondo, dont la cime atteint la région des neiges éternelles.
Charles Bonaparte et sa jeune femme, alors enceinte de Napoléon, étaient parmi ces fugitifs. Après avoir franchi les montagnes boisées de pins qui sont posées en contreforts aux flancs du Rotondo, il fallut gravir encore des sentiers étroits et rocailleux pour arriver au terme du voyage.
Lorqu’on eut atteint les plateaux élevés de cette montagne haute et nue, d’où l’on découvre la mer Méditérranée, les côtes de Sardaigne, et, dans un éloignement vaporeux, les rivages de l’Italie et même de la France, les femmes s’abritèrent sous quelques roches avancées ; les soldats de l’indépendance se groupèrent un peu plus loin, et agitèrent les questions douloureuses que soulevait la situation du moment : Fallait-il mourir les armes à la main, ou quitter leur île natale ? Mourir, oui ; mais les femmes, mais les enfants !… Oh ! Si l’ange tutélaire de la Corse leur eût dit en désignant tour à tour la France et l’Italie : Voilà l’empire, volà le royaume d’un de ces enfants qui causent vos alarmes ; le vainqueur futur de l’Europe est sur cette montagne, où vous pleurez l’asservissement de votre patrie ; la défaite qui vous désole entrait dans les vues de la Providence : sans elle vous ne pourriez pas vous vanter d’avoir mis au monde Napoléon.
Et ils accusaient Dieu de les avoir abandonnés. L’impatience humaine ne laissera-t-elle donc jamais à la Providence le temps de mûrir ses dessins ? Il est vrai que les folles colères de l’homme ne l’émeuvent pas !
Ces fiers patriotes étaient tous décidés à ne pas sortir de la triste alternative qui faisait depuis vingt-quatre heures le sujet de leur délibération. Mais le comte de vaux fut assez habile pour les porter à changer d’avis. Le lendemain de son entrée dans Corte, ayant à coeur de hater la complète pacification de la Corse, il détacha, en parlementaires, ses aides de camp auprès d’eux, et les fit prier de lui envoyer une députation pour s’entendre avec lui.
La députation fut aussitôt formée. Charles Bonaparte en faisait partie. Le général reçut avec beaucoup d’égards ceux qui la composaient, et leur dit que l’ïle entière était soumise et que Paoli et son frère venait de la quitter. Il leur tint, du reste, un langage si conciliant, si rassurant sur les intentions de la France, « qui allait être avec la Corse une seule nation, » qu’ils acceptèrent, pour eux et pour leurs compagnons, les sauf-conduits offerts par le comte, et chacun rentra dans ses foyers.
Cependant Charles Bonaparte, en retournant à Ajaccio avec sa famille, voulut éviter autant que possible la rencontre des troupes françaises qui occupaient la route de Vizzavona, et suivit celle de Niolo, Vico, et Cinarca. Il fallut à madame Bonaparte son tempérament robuste et toute la trempe de son caractère pour ne pas succomber aux fatigues d’un voyage si long et pénible. Elle dut marcher plus d’une demi-journée à pied, par des chemins détournés, tenant presque toujours sur ses bras son enfant Joseph qui était né à Corte l’année précédente et ne voulait pas la quitter. Au passage du Liamone, elle faillit se noyer : son cheval perdit pied et fut entrainé par le courant. Son mari et les pâtres que l’abbé Acquaviva leur avait donnés pour guides, épouvantés du péril qu’elle courait, se jetèrent à la nage pour la sauver, en lui criant de se laisser tomber dans la rivière. Mais la courageuse jeune femme s’affermit au contraire sur sa selle et dirigea si habilement son cheval qu’elle parvint à gagner la rive opposée. La Providence veillait déjà sur Napoléon.
Paoli, quoi qu’en eût dit le comte de Vaux, n’avait pas encore quitté la Corse. Il se trouvait alors à quelques pas de Porto-Vecchio, et se préparait à partir pour la Toscane avec son frère et plusieurs autres patriotes, sur deux navires anglais que l’amiral Smittoy avait mis à sa disposition. Charles s’était également proposé de le suivre ; mais il ajourna l’exécution de ce louable projet, dans le but de reconduire sa femme et son enfant au sein de sa famille.
Le lendemain de son arrivée à Ajaccio, il se disposa à partir pour le rejoindre et pour partager avec lui toutes les souffrances de l’exil. Son oncle, l’archidiacre Lucien Bonaparte, et sa femme conjurèrent les larmes aux yeux de ne pas les abandonner dans une circonstance si périlleuse, de différer encore du moins son départ pour voir quelle direction on donnerait aux affaires, lui promettant de l’accompagner si les Français voulaient abuser de la victoire. Charles ne put resister aux prières d’un oncle pour lequel il avait le respect d’un fils ; il se laissa toucher par les larmes de son épouse qu’il chérissait de tout son coeur.
juillet 21, 2007
TRAVAUX ETHNOLOGIQUES SUR LA CORSE
Reconstituer la vie de Napoléon Bonaparte en BD implique de se documenter dans toute une série de domaines. Et sans le précieux savoir de l’éminent spécialiste Rennie Pecqueux-Barboni, rien de sérieux n’était envisageable sur la Corse.
Spécialiste du costume corse, Rennie Pecqueux-Barboni s’est engagé spontanément à nos cotés dans cette aventure, nous fournissant dans un premier temps des croquis détaillés de femmes et d’hommes vivant en cette fin du dix-huitième siècle dans l’Île de Beauté. Il nous a aussi alimenté d’autres dessins toujours réalisés par ses soins sur le mobilier corse, sans oublier d’y joindre comme pour les costumes des textes explicatifs ou descriptifs, indispensables pour une bonne compréhension de ces images inédites. Il nous a aussi transmis des informations ethnologiques manuscrites plus générales sur la Corse de cette époque troublée. Il répondait à bon nombre de questions qui se posaient là encore, et cela parfois dès l’écriture du scénario.
Dans un second temps, son rôle consistera à poursuivre son rôle de conseiller scientifique en continuant d’apporter des correctifs ethnologiques d’une grande précision scientifique. Il suivra le travail des illustrateurs à chacune des étapes du dessin (crayonnés de mise en place, de report, encrage, mise en couleurs), du moins pour ce qui est des planches se déroulant en Corse. Il faut à tout prix éviter au maximum les approximations dans notre reconstitution de la jeunesse de Napoléon Bonaparte en BD.
juillet 20, 2007
DIAPORAMAS – CRAYONNES ET ICONOGRAPHIE – LA JEUNESSE DE NAPOLEON BONAPARTE EN BD
Voici deux diaporamas sur lequel vous pourrez voir les premiers crayonnés et un échantillon de l’iconographie sur la base de laquelle les dessins ont été conçus. Si vous appréciez ce projet, il est très important que vous preniez quelques instants après le visionnage des vidéos, pour répondre au questionnaire de l’étude de marché. Merci.
juillet 18, 2007
NAPOLEON BONAPARTE EN BD – REPORTAGE CORSICA SERA
Napoléon Bonaparte
Interview réalisée au Musée de La Malmaison avec Monsieur Bernard Chevallier, Conservateur Général du Patrimoine. Elle a été diffusée sur France 3 Corse, puis sur France 3 Nationale.
Nota Bene : Les journalistes de France 3 Corse, dans leur enthousiasme, anticipaient malgré mes prudentes réserves sur une issue favorable des démarches entreprises auprês des Institutions centralisées.
juillet 17, 2007
BIBLIOGRAPHIE RELATIVE A LA JEUNESSE DE NAPOLEON BONAPARTE
Si vous désirez vous instruire sur la Jeunesse de Napoléon 1er, je vous conseille vivement de prendre connaissance de l’intégralité de cette bibliographie commentée avant de vous jeter sur le premier Max Gallo ou André Castelot venu. La liste des ouvrages présentés ci-dessous n’est pas exhaustive, mais vous dirigera vers les incontournables spécialistes que sont Jean-Baptiste Marcaggi, Frédéric Masson, Arthur Chuquet, ou Dorothy Carrington.
1 « La genèse de Napoléon : sa formation intellectuelle et morale » J.B. Marcaggi (1902) ****
 La plus passionnante biographie des années de jeunesse de Napoléon. L’auteur est insulaire, et cela lui confère un net avantage sur tous les autres historiens (qui pour la plupart ne se sont d’ailleurs pas déplacés en Corse). Il est de surcroît tout aussi fiable s’agissant des étapes sur le Continent. En plus de son approche extrêmement méticuleuse sur le plan scientifique, Jean-Baptiste Marcaggi est un écrivain de très grande valeur. Il convient de signaler qu’il n’a pas encore trente ans lorsqu’il publie la première édition de « La genèse » dont le style lyrique est puissamment évocateur. Ce livre inégalable est donc la référence absolue pour qui veut appréhender correctement la jeunesse de Buonaparte.
La plus passionnante biographie des années de jeunesse de Napoléon. L’auteur est insulaire, et cela lui confère un net avantage sur tous les autres historiens (qui pour la plupart ne se sont d’ailleurs pas déplacés en Corse). Il est de surcroît tout aussi fiable s’agissant des étapes sur le Continent. En plus de son approche extrêmement méticuleuse sur le plan scientifique, Jean-Baptiste Marcaggi est un écrivain de très grande valeur. Il convient de signaler qu’il n’a pas encore trente ans lorsqu’il publie la première édition de « La genèse » dont le style lyrique est puissamment évocateur. Ce livre inégalable est donc la référence absolue pour qui veut appréhender correctement la jeunesse de Buonaparte.
2 « Napoléon et ses parents au seuil de l’Histoire » Dorothy Carrington (1993) ****
Cet ouvrage est le fruit de longues et minutieuses recherches dans des archives privées et publiques. Corse d’adoption et ajaccienne de coeur, cette britannique nous instruit sur les pérégrinations du clan Bonaparte dans l’Île de Beauté, tout cela d’après des documents inédits dont elle a su habilement tirer la substance. Le travail d’une érudite donc, sur lequel on ne peut faire l’impasse. Publiée initialement en anglais, cette précieuse étude a été magistralement traduite en français. De plus, ses sources font l’objet d’annotations pertinentes et sont toujours référencées. Ajoutons enfin une impressionnante bibliographie qui complète ce livre d’une grande portée. La faible notoriété de Dorothy Carrington sur le Continent ne reflète évidemment pas ses immenses mérites.
3 « La jeunesse de Napoléon » (3 volumes) Arthur Chuquet (1897-99) ****
La référence classique et incontournable. Ces trois volets sont à lire impérativement, même si l’on regrette de n’y trouver que des bribes de sources à l’instar des travaux de ses contemporains Marcaggi et Masson. A noter enfin que chaque volume présente de riches notes complémentaires ou biographiques.
4 « Napoléon dans sa jeunesse » Frédéric Masson (1907) ****
Dernier « évangéliste » des premières années de Napoléon, le grand historien bonapartiste Frédéric Masson est après Arthur Chuquet l’autre « continental » à prendre en considération. Sa rigueur extrême comme ses vastes connaissances inspirent le respect. Il est en effet le plus renommé des généralistes de l’épopée napoléonienne.
5 « Napoléon inconnu » (2 volumes) Frédéric Masson/Guido Biagi (1895) ****
Ce livre compile tous les écrits de jeunesse de Napoléon, documents inestimables dans lesquels se dévoile Buonaparte. Ils sont commentés et annotés par Frédéric Masson. C’est le complément logique de la partie biographique qui précède.
6 « Manuscrits inédits 1786-1791 » Frédéric Masson/Guido Biagi (1912) ****
Extrait du « Napoléon inconnu », l’ouvrage ne contient que les seuls écrits de Buonaparte.
7 « Biographie des premières années de Napoléon Bonaparte » (2 volumes) F. Coston (1840) ****
Réalisé sur la base de témoignages directs de contemporains (qui donnent quelques crédits aux anecdotes), mais aussi d’après de nombreux documents manuscrits d’époque, ce travail de fonds est la première véritable biographie sur le jeune Buonaparte. Malgré des erreurs et manques, c’est une référence à consulter. Il est aussi bon de préciser que le Baron François de Coston est originaire de Valence, d’où l’intérêt tout particulier que l’on doit lui accorder sur les séjours de Buonaparte dans la Drôme.
8 « Napoléon au jour le jour » Louis Garros (1947) ****
Cette chronologie est un guide indispensable. Un travail colossal.
9 « Lettres de jeunesse de Napoléon » Ernest d’Hauterives (1931) ****
Ces écrits parus tardivement éclairent la personnalité et l’état d’esprit de Buonaparte au commencement de la Révolution Française.
10 « Le Mémorial de Sainte-Hélène » Emmanuel de Las Cases (1823) ****
La bible du bonapartisme, dans laquelle l’Empereur déchu fait quelques confidences sur ses jeunes années.
11 « Le Dictionnaire Napoléon » Jean Tulard (1987) ****
Ouvrage collectif dirigé par le plus célèbre historien contemporain du Premier Empire.
12 « Bonaparte et son temps » (3 volumes) Théodore Iung (1880-81) ***
Trilogie importante mais non dépourvue d’erreurs et de lacunes.
13 « Napoléon d’Ajaccio » Marcel Mirtil (1947) ***
Si ce livre n’a pas vraiment de fil conducteur, il s’agit pourtant là d’une vraie contribution d’historien. D’après des documents originaux, il trace entre autre un portrait très détaillé du patriarche des Bonaparte l’archidiacre Luciano.
14 « Madame Mère » (2 volumes) Baron Hipollyte Larrey (1892) ***
La plus sérieuse des biographies consacrées à Letizia Bonaparte. Elle est toutefois très austère.
15 « Napoléon, Joseph, Lucien au collège d’Autun en Bourgogne » H. de Fontenay (1869) ***
Courte étude claire et rigoureuse sur la scolarité des trois frères Buonaparte en Saone-et-Loire.
16 « Le collège et les premiers maîtres de Napoléon : les Minimes de Brienne » Abbé Arthur Prévost (1915) ***
Petit fascicule très utile pour la période champenoise.
17 « L’école militaire. Le monument 1781-1788 » Robert Laulan (1950) ***
Ouvrage écrit par un conservateur de la bibliothèque du célèbre monument parisien.
18 « L’Ecole Militaire » Collectif (2002) ***
Beau livre très complet et magnifiquement illustré.
19 « Série d’études 3 » Arthur Chuquet (SD) ***
Contient des informations sur Lorenzo Giubega et les frères Le Lieur.
20 « La famille maternelle de Napoléon : les Ramolino et leur généalogie » F. Beaucour (1974) ***
Etude très pointue de l’un des plus grands savants napoléoniens.
21 « Bonaparte, les années obscures » Henry d’Estre (1942) ***
Travail de compilation certes, mais sérieux et plutôt plaisant.
22 « Portrait de Charles Bonaparte d’après ses écrits de jeunesse » D. Carrington (2002) ***
Très intéressant, bien que tout ou presque est déjà dans « Napoléon et ses parents au seuil de l’Histoire ».
23 « Napoléon Bonaparte lieutenant d’artillerie à Auxonne » Maurice Bois (1897) ***
Sans conteste, la meilleure approche locale sur Buonaparte à Auxonne.
24 « Le souvenir de Napoléon à Ajaccio » Jean-Baptiste Marcaggi (1930) ***
Succession d’articles sur Buonaparte et la Corse, suivis d’une synthèse des lieux de mémoires napoléoniens dans la cité impériale et ses alentours.
25 « Le Berceau de Napoléon » Jean-Baptiste Marcaggi (1921) ***
Relate le parcours du berceau de Nabulio.
26 « Bonaparte » Job et Montorgueil (1910) ***
C’est un chef-d’oeuvre sur le plan artistique, les dessins de Job, bien qu’un peu désuets sont toujours d’une grande beauté. Le charme opère encore de nos jours. Dommage que le travail historique ne se situe pas au même niveau. Ajaccio et les autres lieux de jeunesse sont de l’ordre de l’imaginaire.
27 « Les Bonaparte en Corse » François Damartini et A.M. Graziani (2001) ***
Etude généalogique très sérieuse.
28 « Pascal Paoli à Maria Cosway – Lettres et documents 1782-1803 » Francis Baretti (2003) ***
De riches enseignements sur le père de la nation corse à travers ses échanges épistolaires avec son amie intime l’artiste Maria Coswey.
29 « Bonaparte à Auxonne » Martine Speranza (1988) ***
Catalogue très réussi sur les séjours du jeune lieutenant en second à Auxonne, conçu à l’occasion du bicentenaire par la bibliothécaire d’Auxonne, érudite passionnée par le patrimoine local et régional.
30 « Souvenirs d’un valentinois sur Bonaparte » Pierre-Auguste Bou (SD) ***
Notes laissées par le demi-frère de la logeuse de Buonaparte à Valence. Assez instructif.
31 « La Maison Bonaparte » Bernard Chevallier (1986) ***
Petit guide historique sur la Casa Bonaparte et ses propriétaires successifs.
32 « Mémoires sur l’enfance et la jeunesse de Napoléon » Tommaso Nasica (1852) **
Chroniqueur corse. Bien que souvent passionnant, il faut le prendre non sans réserves. Les témoignages oraux et la volonté hagiographique l’emportent sur les aspects scientifiques par trop absents. A noter en première partie de l’ouvrage, une première tentative de biographie de Charles Bonaparte.
33 « La chambre de Bonaparte » Robert Laulan (1944-45) **
Ce texte nous confirme l’impossibilité de localiser la chambre du plus célèbre élève de l’Ecole Militaire.
34 « Monsieur de Buonaparte ou le livre inachevé » Xavier Versini (1977) **
Cette première biographie de Charles Bonaparte est un peu décevante compte tenu des matériaux à disposition de l’auteur.
35 « Lucien Bonaparte et ses mémoires » Théodore Iung (1882-83) **
Peu de faits fiables sur le Napoléon des jeunes années.
36 « La jeunesse inédite de Napoléon » Paul Bartel (1954) **
Le seul mérite de cette biographie confuse tient à ses annexes relatifs à Le Lieur et surtout aux fameux cahiers de son meilleur ami d’adolescence Alexandre des Mazis.
37 « Que valent les cahiers d’Alexandre Des Mazis » Laulan (1956) **
Jugement sévère et un peu contestable de la part d’un historien pourtant très rigoureux. Sceptique, il doute (à tort) de la réalité des cahiers d’Alexandre des Mazis. Et contrairement à ses suppositions, ces courts mémoires n’ont a priori fait l’objet d’aucune falsification.
38 « Une famille militaire au XVIIIème siècle » Baron Joseph du Teil (1896) **
Buonaparte est évoqué dans ses relations avec le général du Teil. Toutefois aucun fait sensationnel n’en ressort.
39 « La vraie figure de Bonaparte en Corse » Lorenzo de Bradi (1926) **
40 « Napoléon à Auxonne » Jean Savant (1946) **
L’auteur a parfaitement lu ses prédécesseurs, et c’est déjà ça. Sinon rien de neuf.
41 « Les misères du Lieutenant Bonaparte » A. Genin (SD) **
Travail de compilation plutôt sympathique, juste et efficace.
42 « Le Cardinal Fesch » Hélène Colombani (1979) **
43 « Letizia, mère de l’Empereur » Alain Decaux (1983) **
Là encore, un ouvrage sans prétention scientifique, mais vivant et plutôt agréable à lire.
44 « Le chant du départ » Max Gallo (1997) **
Compilation d’un romancier de l’Histoire. Max Gallo a l’immense mérite à mes yeux d’admirer Napoléon, de l’avoir globalement bien appréhender sur le plan psychologique ou politique. Sinon ce n’est pas un historien, juste un romancier dont le style « urinaire » indispose d’emblée (surtout si vous avez relu « La vie de Napoléon » par Chateaubriand ou « L’âme de Napoléon » de Léon Bloy peu de temps avant). Max Gallo souffre du syndrome de la « sistite de l’écrivain » et pisse de la page sans discontinuer. Or cela s’en ressent péniblement à la lecture de ses quatre volumes qui ne peuvent être qu’une première approche pédagogique.
45 « Bonaparte » André Castelot (1967) **
De réels talents de conteur (bien meilleur romancier de l’Histoire que Max Gallo), mais ses compilations approximatives plus fantaisistes que celles de son « héritier » Max Gallo, ne sont assurément pas à prendre en exemple. Les bévues sont légions chez cet auteur qui jouit d’une réputation totalement surfaite.
46 « La jeunesse de Napoléon » Jean Defranceschi (2001) **
Tendancieux malgré de connaissances réelles. Beaucoup de divagations et de fantasmes. A ne manier qu’avec d’extrêmes précautions.
47 « Napoléon 1er à l’école royale militaire de Brienne » Alexandre Assier (1874) **
Les sources ne sont pas spécifiées, d’où le peu de crédit qu’il faut accorder aux multiples anecdotes prétendument originales dont use et abuse pourtant l’auteur.
48 « L’enfance de Napoléon depuis sa naissance jusqu’à sa sortie de l’école militaire » Chevalier de Beauterne (1846) **
Vision assez candide sur les sentiments religieux du jeune Buonaparte. Le Chevalier de Beauterne a sans doute croisé Alexandre Des Mazis dans le cadre de recherches visiblement consciencieuses.
49 « Les Thiard » Bernard Alis (1997) **
Saga des seigneurs du château de Pierre de Bresse.
50 « L’écolier de Brienne » Henry-Rosier Marguerite (1957) *
Pathétique, d’autant que les illustrations qui accompagnent les textes sont d’une faiblesse graphique consternante. Impardonnable à une époque où subsistait encore un vaste choix de dessinateurs compétents et talentueux.
51 « La jeunesse de Napoléon 1er de 1786 au siège de Toulon » Benjamin Gadobert (1897) *
Farfelu. A proscrire.
52 « Madame Mère » Augustin Thierry (1939) *
Biographie sans le moindre intérêt.
53 « La jeunesse de Napoléon » Louis Madelin (1937) *
Plus que navrant pour un académicien.
54 « La jeunesse Napoléon Bonaparte » Baron Thiry (1975) *
Dans la droite ligne des compilateurs qui pullulent face aux rares chercheurs et historiens.
55 « Monsieur de Bonaparte » Georges Roux (1964) *
Fade compilation.
56 « De quoi vivait Bonaparte » Bernard Simiot (1952) *
Ne nous apprend pas grand chose.
57 « Napoléon d’Ajaccio » Pierre Bonardi (1935) *
Opte pour une fiction fantaisiste et sans charme.
58 « La jeunesse de Napoléon Bonaparte » Dimitri Sokorine (1967) *
59 « La jeunesse de Napoléon Bonaparte » Jules Mazé (SD) *
60 « Correspondances, bulletins, et ordres du jour de Brienne au 13 vendemiaire » A. Keller (1900) *
**** Indispensable *** Intéressant ** A lire éventuellement * A négliger
LA QUETE DU GRAAL NAPOLEONIEN
Le Sacre de Napoléon par David comme les tableaux des Batailles de Napoléon par Gros ne pouvaient qu’éblouir par leurs puissances oniriques un enfant esthète et romantique. Mon désir de voir se prolonger le rève napoléonien à travers l’image trouve sa source initiale chez ces peintres, bien avant que les albums des Maîtres de l’Ecole de Bruxelles (Jacobs, Hergé, Martin) finissent par me convaincre de l’impérieuse nécessité d’une grande fresque napoléonienne en BD.
LA GENÈSE D’UN RÊVE…
Avant de présenter les différents aspects de ce projet, il me semble indispensable d’expliquer le long cheminement qui m’a conduit à donner à mes rêveries d’enfant et d’adolescent un prolongement artistique bien concret.
Tout d’abord, je dois dire que le nom de Napoléon stimule mon imagination depuis ma plus petite enfance. Et cette précoce fascination demeure une énigme dont je ne peux déterminer l’origine, ayant grandi dans un environnement nullement napoléonien et encore moins d’obédience bonapartiste.
Vers l’âge de 8 ans, je me procurais enfin le tome 6 de L’Histoire de France en Bandes Dessinées, collection éditée par Larousse, impatient que j’étais de me plonger dans les quelques planches consacrées à mon héros. Mais celles-ci se révélaient de très médiocres factures, car vite réalisées par plusieurs dessinateurs, si bien que l’ensemble débouchait ainsi sur un produit de commande relativement bâclé, aussi bien sur le fond historique que sur la forme artistique. Le résultat répondait toutefois parfaitement aux impératifs de la logique quasi industrielle voulue par l’éditeur, sans évidemment assouvir pleinement mes fantasmes napoléoniens. La frustration engendrée attisait même un peu plus en moi le désir de voir un jour l’extraordinaire destinée romanesque, romantique, épique, et onirique de Napoléon sublimée par le biais d’une fresque au dessin léché. J’étais d’autant plus convaincu de ce fait que je découvrais parallèlement les oeuvres de Edgar P. Jacobs, Hergé, et Jacques Martin.
Quelques années plus tard, je constatais avec stupéfaction et amertume que le Consulat et le Premier Empire étaient intégralement occultés par les programmes scolaires. Et je ne devais croiser Napoléon III et le Second Empire qu’en classe de Première, période survolée en moins d’une heure.
Les années passant, la nécessité de mettre en chantier une grande saga napoléonienne en BD devenait donc à mes yeux de plus en plus patente, sans trop savoir comment m’y prendre pour réunir les moyens de mes ambitions artistique, historique, et pédagogique. Quand fin 1993, j’obtenais d’un mensuel de faire l’interview et le portrait de Jacques Martin, ancien collaborateur des Studios Hergé, et dernière grande figure classique de l’Âge d’Or de l’École de Bruxelles. Ce célèbre dessinateur, en perpétuels conflits avec ses éditeurs, et bien que septuagénaire, envisageait de développer une structure éditoriale embryonnaire. Grand admirateur de sa principale série Alix (bien qu’en très sérieux déclin depuis une quinzaine d’années), je songeais avec enthousiasme à la possibilité d’intégrer son équipe, jusqu’au moment où celui-ci devait tardivement se raviser. A mon grand désappointement, pour des motifs divers, Jacques Martin abandonnait ses projets d’autonomie éditoriale. Je demeurais donc dans l’expectative, m’interrogeant sur la suite à donner à mes aspirations professionnelles, ne pouvant renoncer à la Bande Dessinée et de facto condamner mon rêve napoléonien. C’est alors qu’en me rendant aux Invalides, j’apercevais dans sa boutique deux ouvrages sortis simultanément sur le Prince Impérial. Après avoir pris connaissance de chacun d’eux, j’entrais en contact avec Monsieur Jean-Claude Lachnitt, auteur de la plus érudite de ces biographies de Napoléon IV, et l’un des gardiens du temple napoléonien. Son accueil aimable et courtois m’encourageait à poursuivre, si bien que je me décidais à « franchir le Rubicon » et commençais à étudier plus sérieusement la faisabilité du projet.
Je crois en effet qu’il est grand temps de ranimer la flamme sur le plan artistique tant notre époque fait pale figure face au XIXme siècle, où les plus grands artistes se sont tous dépassés dans leurs disciplines respectives, se nourrissant et alimentant dans un « cercle vertueux » la légende napoléonienne. Et pour ce faire quoi de mieux que d’exploiter ce puissant vecteur de communication qu’est le Neuvième Art ? Il présente l’avantage sur le Cinéma d’être beaucoup moins coûteux, tout en touchant lui aussi un large public, plus lentement certes, mais bien plus en profondeur et sur la longueur. Napoléon affirmait que l’on ne fait rien qu’en remuant les masses. Si aujourd’hui encore son nom jouit d’une notoriété sans égale, elle n’en demeure pas moins que très superficielle. Qui connaît vraiment l’homme, son parcours hors du commun, et même simplement les deux dates principales qui résument sa courte et dense existence ? Peu de gens en fait. Napoléon se réduit pour beaucoup d’individus aux clichés du bicorne et de la main glissée à l’intérieur de sa redingote. C’est pourquoi il faut s’adresser aux profanes à travers la Bande Dessinée, forme d’expression artistique moderne et pertinente pour vulgariser sa vie. C’est un outil pédagogique et didactique d’une remarquable efficacité.
LA RECHERCHE DU DESSINATEUR OU LA QUÊTE D’UN GRAAL ARTISTIQUE
Dès l’instant où je me suis décidé à initier le projet, je savais que le point d’achoppement principal se situerait au niveau du dessinateur. Compte tenu des contraintes artistiques imposées (à contre courant des tendances actuelles), je ne m’attendais pas à trouver facilement et rapidement le bon dessinateur. Aussi déroutant que cela puisse paraître à première vue, j’excluais la piste de la Bande Dessinée, ne voyant pas dans la production contemporaine de profils jacobsiens ou martiniens (de valeurs du moins), les dessinateurs les plus doués explorant à mon regret des voies sans rapport avec le style exigé.
C’est ainsi que j’orientais mes recherches vers les Ecoles d’Art parisiennes… Où le bilan s’y est avéré catastrophique. De 1998 à 2000, j’ai promené mon bâton de pèlerin dans toutes les écoles susceptibles d’avoir pu former la « perle rare ». J’entrais en relations avec une quarantaine d’étudiants, anciens élèves et professeurs de dessins des établissements les plus réputés (ESAG, Gobelins, Estienne, Olivier de Serres, Arts Déco, etc…), sans pour autant parvenir à mettre la main sur un artiste possédant tout à la fois les bases techniques du dessin classique, comme les qualités de rigueur et d’abnégation pour jouer dans la cour des Grands de la « Haute Epoque » du Journal Tintin. Issus de l’ENSAD, j’ai bien vu les travaux de deux surdoués. Le premier était l’auteur de quatre planches d’un Blake et Mortimer inédit (et atomisant tous les profanateurs de l’oeuvre jacobsienne depuis 1987), mais s’avérait proprement incapable de mener à bien un album complet. Le second, tout aussi prodige n’avait pas quant à lui la sensibilité et le goût pour le programme néo-classique que je lui proposais, même s’il en avait indubitablement les capacités techniques et artistiques. Je devais par la suite faire sans conviction les écoles préparatoires avec le même résultat. Au total, en trois ans de prospections sur Paris, je devais écumer en vain toutes les écoles ou presque, sans détecter l’ébauche de la réincarnation d’un Philippoteaux, d’un Paul Delaroche ou d’un François Gérard.
Je multipliais alors mes champs d’explorations, dirigeant mes nouvelles recherches quasi simultanément dans plusieurs directions :
Le milieu de la BD, négligé sciemment dans un premier temps en raison de la ligne artistique bien précise, en total décalage avec la production actuelle, piste qui comme prévu ne débouchait pas sur des résultats très probants,
Des écoles de Province (Arts Décoratifs de Strasbourg, Emile Cohl à Lyon, Brassart à Tours), où j’y ai rencontré des personnages intéressants, mais pas l’ultime pièce manquant à mon puzzle,
La Pologne, d’où après trois séjours à Cracovie, Varsovie, et Poznan en 2000, je suis revenu tout aussi sec,
Enfin, les catalogues de non-fiction de Bologne de ces dernières années, suivant en cela les conseils de Monsieur Xavier Pangaud, coordinateur en illustrations de l’ENSAD de Paris. Cette suggestion s’est révélée salutaire puisque c’est dans l’un de ces ouvrages que j’ai découvert la piste florentine, solutionnant ma complexe équation artistique.
C’est donc après bien des pérégrinations que j’ai levé le dernier obstacle. Seule manquait la « pierre angulaire », soit le ou les artistes dignes de succéder à David, Stendhal, ou Canova. Je peux désormais affirmer disposer de l’équipe parfaite pour mettre en oeuvre ma grande fresque biographique sur Napoléon, et ceci dans le respect absolu de mes idéaux néo-classiques.
DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ÉDITORIAL
FOND ET FORME D’UN PROJET ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Ligne Artistique et Contenu Historique
Ce projet ne peut se concevoir qu’en respectant une ligne artistique précise et préalablement définie. Depuis l’après-guerre, plusieurs générations de lecteurs ont été marquées par les immortels dessinateurs de l’Ecole de Bruxelles. Et c’est tout à la fois leur style réaliste et classique, ainsi que l’esprit méticuleux et perfectionniste caractérisant ces auteurs, qui doivent aujourd’hui inspirer la réalisation de l’épopée napoléonienne en Bandes Dessinées. Je suis intimement convaincu que c’est la seule option artistique susceptible de donner pleine satisfaction à moyen comme à long terme. En effet :
Le dessin classique et académique apparaît naturellement comme le plus judicieux pour le genre historique et l’est d’autant plus qu’il s’agit de reconstituer les XVIIIème et XIXème siècles, ceux des génies de la peinture néo-classique.
Le dessin classique est intemporel et universel. Fédérateur, il s’inscrit par delà les modes sur la durée, est accessible à tous, et par conséquent en totale adéquation avec le plus grand héros des temps modernes.
Enfin, tout à la fois romantique et classique, Napoléon ne peut être transposé en Bandes Dessinées avec justesse que sous les crayons de disciples de Ingres ou David.
Mon souhait est de toucher le plus grand nombre (de 7 à 77 ans pour reprendre le slogan du Journal Tintin), soit aussi bien de jeunes enfants et adolescents ignorant tout de la vie de l’Empereur que les napoléoniens les plus savants, cela impliquant deux degrés de lecture. Et tout sera fait en ce sens, avec une approche historique extrêmement rigoureuse, s’appuyant en particulier sur les travaux d’authentiques historiens érudits et passionnés tels Dorothy Carrington, Arthur Chuquet, Jean-Baptiste Marcaggi, ou Frédéric Masson. Mais, il faut surtout être en mesure de fournir aux dessinateurs des supports iconographiques exploitables. Ils sont indispensables en vue de reproduire de façon crédible l’environnement dans lequel Napoléon a pu évoluer. Cette reconstitution historique impose donc des recherches personnelles conséquentes sur les lieux où se sont déroulés les évènements pour y photographier, filmer, et croquer les décors. Il en est de même pour les costumes, l’architecture ou le mobilier. Enfin, il faut insister sur l’aspect biographique du concept. Il s’agit bien de suivre Napoléon tel un personnage de fiction, tant sa destinée surclasse celles des plus grands héros issus d’oeuvres purement imaginaires.
Première Étape : Une Trilogie sur sa Jeunesse
Outre la ligne artistique incontournable, il faut savoir que j’envisage de traiter la Jeunesse de Buonaparte en trois volumes de plus ou moins 60 planches chacun (dont 6 à 8 illustrations). Cela répond à la fois au standing artistique ambitionné, mais aussi aux impératifs de ce premier cycle qui couvre les 26 premières années de la vie de Napoléon. Le premier tome commencera par un flash-back à Rome en 1821, pour revenir en Corse en 1768, avant de se conclure en août 1789 au terme de son premier séjour à Auxonne. Le deuxième reprendra le récit en Corse au début son troisième séjour pour s’achever quant à lui par la rupture avec les paolistes fin mai 1793. Le troisième tome relatera ensuite ses errances dans la tourmente révolutionnaire de la prise de Toulon jusqu’à sa réelle éclosion suite à Vendémiaire et sa rencontre avec Joséphine de Beauharnais. Au total, chaque ouvrage comprendra plus de 500 dessins (9 à 10 vignettes par planche en moyenne), soit autant de petits tableaux pour retracer les années initiatiques du jeune Buonaparte. Le « packaging » des albums s’alignera sur le modèle de la collection Blake et Mortimer pour des raisons d’images, afin que la filiation artistique revendiquée soit clairement identifiable par les lecteurs. En plus de cela, je veux réaliser un tirage de tête qui présentera la Bande Dessinée et son « making of » (croquis, photos, textes, etc…) destiné en priorité aux napoléoniens et aux collectionneurs de Bandes Dessinées avertis.
LES INTERVENANTS
La Structure Éditoriale
Souhaitant conserver le contrôle absolu de mon projet, j’ai opté pour la création de ma propre maison d’édition dont la dénomination est Le Rubicon Editeur. Celle-ci aura pour objet de publier l’intégralité de l’épopée napoléonienne, et élargira progressivement son domaine d’activité à la fiction.
Les Collaborateurs
N’étant pas plus historien que scénariste de formation, et n’ayant pas de réelles prétentions en la matière à terme, j’ai tout de même tenu à écrire seul les récitatifs et dialogues du premier album, ceci dans l’unique but d’affirmer mes partis pris artistiques et littéraires. J’ai toutefois estimé nécessaire de m’adjoindre dès à présent le concours de Monsieur Bernard Chevallier, Directeur des Châteaux de Malmaison et Bois Préau, qui me fait l’honneur de superviser mon travail sur le plan historique. J’envisage de me faire seconder ultérieurement par un assistant pour les aspects touchant au scénario et à la documentation.
Mais comme je l’ai déjà spécifié, c’est le choix du ou des dessinateurs qui m’a bloqué dans l’avancement du projet. Dubitatif et insatisfait aux vues des dossiers insipides ou médiocres qui m’étaient soumis en matière de dessin, il m’a fallu tout ajourner pendant près de cinq ans. Et c’est après de très longues prospections en France, Belgique, Pologne, et Italie, que j’ai pu dénicher les puissants coups de crayons dignes d’interpréter « Le plus puissant souffle de vie que jamais argile humaine anima » (Chateaubriand). Cet épineux problème n’est donc résolu que depuis mes récents séjours en Toscane. Le dessin sera donc confié à un studio d’illustrateurs extrêmement talentueux, professionnels expérimentés et spécialisés dans la reconstitution historique. Leur exceptionnel savoir-faire comme leur approche du dessin satisfont à l’exigence d’excellence pour servir au mieux la mythologie napoléonienne. Ainsi, je vais devoir m’installer partiellement à Florence pour coordonner et suivre au plus près la réalisation de l’album, et ceci dès que j’aurai rassemblé les budgets. Je désire en effet écourter au plus vite la période de travail à distance, génératrice de quiproquos et malentendus relativement dommageables sur le plan créatif.
Les Partenaires
Outre l’équipe artistique constituée, je dois recourir à divers partenaires dans le cadre des recherches documentaires. Compte tenu de la complexité de l’entreprise, elle ne serait réalisable sans les appuis ponctuels d’individus ou structures détenant des éléments propres à nous aider dans notre travail de reconstitution. Depuis plus de cinq ans que je m’investis sur ce projet, j’ai été très agréablement surpris par les accueils toujours bienveillants des historiens, conservateurs, historiens, bibliothécaires, ou délégués et adhérents du Souvenir Napoléonien sollicités. Je me suis aussi familiarisé avec quelques bibliothèques (Marmottan, Thiers, Forney, Galliera), m’étant par ailleurs rendu à Rome, Ajaccio, Corte, Autun, Brienne, Auxonne, ou Valence, où j’ai noué de nombreux contacts. Ces relais locaux me sont très précieux dans ma quête d’informations concernant les lieux de la jeunesse de Napoléon et la documentation que l’on peut encore s’y procurer.
En plus de ces soutiens techniques m’accompagnant tout au long du processus de création, l’intervention de mécènes m’est indispensable pour amorcer dans les meilleures conditions matérielles cette vaste création artistique. En plus de la Fondation Napoléon, partenaire incontournable qui m’a très tôt assuré son concours, je devais bénéficier du soutien du Ministère de la Culture, et a priori de la Collectivité Territoriale de Corse pour compléter mon budget, et escomptais encore un ou deux partenaires pour boucler confortablement le financement. L’engagement de ces mécènes auraient dû me permettre de réaliser d’emblée un album de Bandes Dessinées « très haut de gamme », à la hauteur de mes aspirations et ambitions artistiques. Les défaillances des institutionnels ont finalement bloqué l’avancement du projet, jouant un rôle plus que négatif.
LES OBJECTIFS
Le Moyen Terme
Cela prendra près de trois ans pour dessiner les quelques 180 planches décrivant le parcours si laborieux et tellement instructif du jeune Buonaparte l’amenant à l’aube de sa foudroyante entrée sur le théâtre de l’Histoire. Je souhaite donner au premier album une exposition la plus large dans les 12 à 18 mois consécutifs à sa parution. Dans un premier temps, il s’agira de communiquer sur l’ouvrage via Internet, les réseaux associatifs napoléoniens, la presse écrite, voire si possible l’arme absolue qu’est la télévision, bénéficiant là encore du soutien de la Fondation Napoléon (Site Internet, réseaux). La souscription sera employée pour commercialiser le tirage de tête, alors que l’album sera lui vendu sur les nombreux salons de Bandes Dessinées, par Internet, dans les boutiques des RMN, mais aussi celles des monuments historiques napoléoniens, ainsi que quelques premières librairies tests (dans le domaine de l’Histoire et de la BD). Si la réussite commerciale se confirme, une autre étape sera franchie lors de la sortie du deuxième volume. Les deux titres seront progressivement présents dans toutes les librairies spécialisés ainsi que les linéaires des grandes surfaces. J’aimerais aussi qu’ils pénètrent rapidement les bibliothèques scolaires. Je suis persuadé que le succès se dessinera assez vite. Toutefois je procéderai avec prudence, engrangeant avec le premier titre un maximum de données, que je disséquerai et recouperai par la suite avec d’autres informations pour aborder au mieux l’écueil de la diffusion/distribution et la délicate gestion des retours. La reconstitution de l’intégralité de sa biographie prendra de nombreuses années, puisque l’ensemble de la série devrait comprendre près de 25 volumes.
Le Long Terme
Si le décollage s’effectue convenablement, j’envisagerai parallèlement à la série sur Napoléon 1er, la réalisation de « one shots » ou doubles albums sur chacun des aiglons, et à plus longue échéance lancer la série consacrée à Napoléon III. Car je le répète l’objectif est bien de mettre en oeuvre l’ensemble de l’épopée napoléonienne, de la Maison Bonaparte au sinistre épilogue sud-africain. La Quatrième Dynastie incarne formidablement ce XIXème siècle, tant les Napoléons ont en commun d’être des personnages romanesques et romantiques. C’est un programme ambitieux que de réaliser leurs biographies en Bandes Dessinées. Il demandera quelques vingt années, disposant pour ce faire d’un studio d’artistes-artisans avec lequel je privilégierai la qualité sur la quantité. L’impact artistique n’en sera que plus fort et durable.
Il est fort probable que ma structure éditoriale se consacre par la suite à la réédition d’ouvrages historiques épuisés, prolongements indispensables aux albums de Bandes Dessinées pour des lecteurs désireux d’approfondir leurs connaissances de telle ou telle période de la vie de Napoléon.
Enfin, au delà de ces projets de reconstitutions historiques, j’aspire aussi à relancer un courant de fiction réaliste classique ou néo-classique, reprenant le flambeau éteint de l’École de Bruxelles.